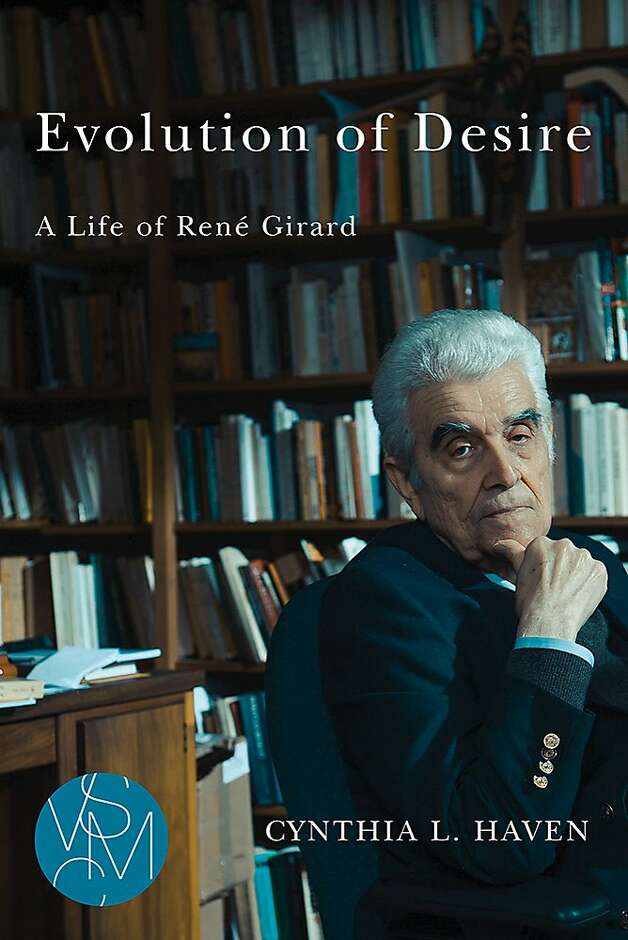/image%2F1371866%2F20201215%2Fob_315d48_antiochus-temple-juif-god-christ.png)
Le salut vient des Juifs. Jésus (Jean 4:22)
Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtement de brebis, mais au dedans ce sont des loups ravisseurs. (…) C’est (…) à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Jésus (Matthieu 7: 15-20)
Si tu te glorifies, sache que ce n’est pas toi qui portes la racine, mais que c’est la racine qui te porte. Paul (Lettre aux Romains 11: 18)
Je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont Israélites, à qui appartiennent l’adoption, et la gloire, et les alliances, et la loi, et le culte, et les promesses, et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Paul (Rm 9: 3)
Lorsque Simon vit que le Saint Esprit était donné par l’imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l’argent, en disant: Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j’imposerai les mains reçoive le Saint Esprit. Mais Pierre lui dit: Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s’acquérait à prix d’argent! Actes des apôtres 8: 18-20
La colère de l’Éternel s’enflamma de nouveau contre Israël, et il excita David contre eux, en disant: Va, fais le dénombrement d’Israël et de Juda. (…) L’Éternel envoya la peste en Israël, depuis le matin jusqu’au temps fixé; et, de Dan à Beer Schéba, il mourut soixante-dix mille hommes parmi le peuple. Comme l’ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire, l’Éternel se repentit de ce mal, et il dit à l’ange qui faisait périr le peuple: Assez! Retire maintenant ta main. L’ange de l’Éternel était près de l’aire d’Aravna, le Jébusien. David, voyant l’ange qui frappait parmi le peuple, dit à l’Éternel: Voici, j’ai péché! C’est moi qui suis coupable; mais ces brebis, qu’ont-elles fait? Que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père! 2 Samuel 24: 1-17
Satan se leva contre Israël, et il excita David à faire le dénombrement d’Israël.Cet ordre déplut à Dieu, qui frappa Israël. (…) Et David dit à Dieu: J’ai commis un grand péché en faisant cela! Maintenant, daigne pardonner l’iniquité de ton serviteur, car j’ai complètement agi en insensé!L’Éternel adressa ainsi la parole à Gad, le voyant de David: Va dire à David: Ainsi parle l’Éternel: Je te propose trois fléaux; choisis-en un, et je t’en frapperai. (…) Accepte, ou trois années de famine, ou trois mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires et atteint par l’épée de tes ennemis, ou trois jours pendant lesquels l’épée de l’Éternel et la peste seront dans le pays et l’ange de l’Éternel portera la destruction dans tout le territoire d’Israël. (…) L’Éternel envoya la peste en Israël, et il tomba soixante-dix mille hommes d’Israël. Dieu envoya un ange à Jérusalem pour la détruire; et comme il la détruisait, l’Éternel regarda et se repentit de ce mal, et il dit à l’ange qui détruisait: Assez! Retire maintenant ta main.(…) David leva les yeux, et vit l’ange de l’Éternel se tenant entre la terre et le ciel et ayant à la main son épée nue tournée contre Jérusalem. Alors David et les anciens, couverts de sacs, tombèrent sur leur visage.Et David dit à Dieu: N’est-ce pas moi qui ai ordonné le dénombrement du peuple? C’est moi qui ai péché et qui ai fait le mal; mais ces brebis, qu’ont-elles fait? Éternel, mon Dieu, que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père, et qu’elle ne fasse point une plaie parmi ton peuple! I Chroniques 21: 1-17
Ainsi parle l’Éternel à son oint, à Cyrus. Esaïe 45 : 1
Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l’ange de l’Éternel (…) C’est ici la parole que l’Éternel adresse à Zorobabel (…) Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l’achèveront; et tu sauras que l’Éternel des armées m’a envoyé vers vous. (…) Ce sont les deux oints qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Zacharie 3:1 – 4: 6-14
Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant soixante-dix ans. Mais lorsque ces soixante-dix ans seront accomplis, je châtierai le roi de Babylone. Jérémie 25: 11-12
Mais voici ce que dit l’Éternel: Dès que soixante-dix ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous, et j’accomplirai à votre égard ma bonne parole, en vous ramenant dans ce lieu. Jérémie 29: 10
En ces jours-là surgit d’Israël une génération de vauriens qui séduisirent beaucoup de personnes en disant : “Allons, faisons alliance avec les nations qui nous entourent, car depuis que nous nous sommes séparés d’elles, bien des maux nous sont advenus.” (…) Plusieurs parmi le peuple s’empressèrent d’aller trouver le roi, qui leur donna l’autorisation d’observer les coutumes païennes. Ils construisirent donc un gymnase à Jérusalem, selon les usages des nations, se refirent des prépuces et renièrent l’alliance sainte pour s’associer aux nations. 1 Maccabées 1: 11-15
On n’avait pas le droit d’observer le sabbat, ni de célébrer les fêtes traditionnelles, ni même simplement de se déclarer juif. Chaque mois, au jour commémorant la naissance du roi, on était contraint de façon humiliante à participer à un repas sacrificiel; et quand arrivait la fête de Dionysos, on était forcé de se couronner de lierre et d’accompagner le cortège en l’honneur de ce dieu. Sur la proposition des habitants de Ptolémaïs, un décret fut publié: les villes grecques des régions voisines de la Judée devaient adopter la même politique à l’égard des Juifs qui s’y trouvaient et les obliger à participer aux repas sacrificiels; l’ordre fut donné d’égorger quiconque refuserait d’adopter les coutumes grecques. Il était donc facile de prévoir les malheurs à venir. Ainsi deux femmes furent déférées en justice pour avoir circoncis leurs enfants. On les produisit en public à travers la ville, leurs enfants suspendus à leurs mamelles, avant de les précipiter ainsi du haut des remparts. D’autres s’étaient rendus ensemble dans des cavernes voisines pour y célébrer en cachette le septième jour. Dénoncés à Philippe, ils furent brûlés ensemble, se gardant bien de se défendre eux-mêmes par respect pour la sainteté du jour. (…) Parmi les principaux maîtres de la loi, il y avait alors un certain Élazar. Il était avancé en âge et de fort belle apparence. On lui tint la bouche ouverte pour l’obliger à avaler de la viande de porc. Mais il préférait mourir avec honneur plutôt que de vivre dans la honte. Il recracha donc la viande et se dirigea volontairement vers le lieu du supplice. Voilà un exemple pour ceux qui devraient avoir le courage, même au prix de leur vie, de repousser la nourriture que la loi de Dieu interdit de manger. 2 Maccabées 6 : 6-20
Pendant que les habitants de la ville sainte jouissaient d’une paix entière, et que les lois étaient encore exactement observées, grâce à la piété du grand prêtre Onias et à sa haine du mal (…) Mais, après la mort de Séleucus, Antiochus surnommé Épiphane lui ayant succédé, Jason, frère d’Onias, entreprit d’usurper le souverain pontificat. Dans un entretien avec le roi, il lui promit trois cent soixante talents d’argent et quatre-vingts talents pris sur d’autres revenus. Il promettait en outre de s’engager par écrit pour cent cinquante autres talents, si on lui accordait d’établir, de sa propre autorité et selon ses vues, un gymnase avec un éphébée, et d’inscrire les habitants de Jérusalem comme citoyens d’Antioche. Le roi consentit à tout. Dès que Jason eut obtenu le pouvoir, il se mit à introduire les moeurs grecques parmi ses concitoyens.(…) Lorsque Onias eut connu d’une manière certaine ce nouveau crime de Ménélas, il lui en adressa des reproches, après s’être retiré dans un lieu d’asile, a Daphné, près d’Antioche. C’est pourquoi Ménélas, prenant à part Andronique, le pressait de mettre à mort Onias. Andronique vint donc trouver Onias et, usant de ruse, il lui présenta la main droite avec serment; puis, quoique suspect, il le décida à sortir de son asile et le mit aussitôt à mort, sans égard pour la justice. Aussi, non seulement les Juifs, mais beaucoup d’entre les autres nations furent indignés et affligés du meurtre injuste de cet homme. II Maccabbées 3: 1 – 4: 7-35
Les Syriens prirent les villes fortes du pays d’Égypte, et Antiochus enleva les dépouilles de toute l’Égypte. Après avoir battu l’Égypte l’an cent quarante-trois, Antiochus revint sur ses pas et marcha contre Israël. Etant monté à Jérusalem avec une armée puissante, il entra avec une audace insolente dans le sanctuaire et en enleva l’autel d’or, le chandelier de la lumière avec tous ses ustensiles, la table des pains de proposition, les coupes, tasses et écuelles d’or, le rideau, les couronnes et les ornements d’or sur la façade du temple, et il détacha partout le placage. Il prit aussi l’or et l’argent et les vases précieux, ainsi que les trésors cachés qu’il put trouver. I Maccabbées 1: 20 – 24
Ces événements étant arrivés à la connaissance du roi, il crut que la Judée faisait défection. Il partit donc d’Égypte, furieux comme une bête féroce, et s’empara de la ville à main armée. Il ordonna aux soldats de tuer sans pitié ceux qui tomberaient entre leurs mains, et d’égorger ceux qui monteraient sur les toits ces maisons. Ainsi furent tués des jeunes gens et des vieillards; ainsi périrent des hommes faits, des femmes et des enfants; ainsi furent égorgés des jeunes filles et des nourrissons. Le nombre des victimes pendant ces trois jours, fut de quatre-vingt mille, dont quarante mille furent massacrés et autant furent vendus comme esclaves. Non content de ces atrocités, il osa pénétrer dans le temple le plus saint de toute la terre, ayant pour guide Ménélas, traître envers les lois et envers sa patrie. Et prenant de ses mains souillées les objets sacrés, et arrachant les offrandes déposées par les autres rois pour rehausser ta gloire et la dignité de ce lieu, il les remettait à des mains profanes. Antiochus s’enflait d’orgueil dans son esprit, ne considérant pas que le Seigneur était irrité pour peu de temps à cause des péchés des habitants de la ville, et que c’était pour cela qu’il détournait ses regards de ce lieu. Autrement, s’ils n’avaient pas été coupables d’un grand nombre de péchés, lui aussi, comme Héliodore, envoyé par le roi Séleucus pour inspecter le trésor, il aurait été, dès son arrivée, flagellé et réprimé dans son audace. Mais Dieu n’a pas choisi le peuple à cause de ce lieu; il a choisi ce lieu à cause du peuple. C’est pourquoi ce lieu a participé aux malheurs du peuple, comme il a été ensuite associé aux bienfaits du Seigneur; délaissé dans la colère du Tout-Puissant, il a été de nouveau, quand le souverain Seigneur s’est réconcilié avec son peuple, rétabli en toute sa gloire. Antiochus, ayant donc enlevé au temple dix-huit cents talents, s’en retourna en hâte à Antioche, s’imaginant dans son orgueil, à cause de l’enivrement de son coeur, pouvoir rendre navigable la terre ferme et viable la mer. II Maccabbées 5: 11-21
De ces rois sortit une racine d’iniquité, Antiochus Épiphane, fils du roi Antiochus, qui avait été à Rome comme otage; et il devint roi en la cent trente-septième année du royaume des Grecs. En ces jours-là, il sortit d’Israël des enfants infidèles qui en entraînaient beaucoup d’autres en disant: « Allons et unissons-nous aux nations qui saut autour de nous; car, depuis que nous nous tenons séparés d’elles, il nous est arrivé beaucoup de malheurs. » Et ce discours parut bon à leurs yeux. Quelques-uns du peuple s’empressèrent d’aller trouver le roi, et il leur donna l’autorisation de suivre les coutumes des nations. Ils construisirent donc à Jérusalem un gymnase, selon les usages des nations. I Maccabbées 1: 11-15
Il fit la paix avec ceux qui étaient à Bethsur, et ceux-ci sortirent de la ville, parce qu’il n’y avait pas eu de vivres à renfermer pour eux dans la place, car c’était l’année du repos de la terre. Le roi s’empara ainsi de Bethsur, et il y laissa une garnison pour la garder. Il établit son camp devant le lieu saint pendant beaucoup de jours, et il y dressa des tours à balistes, des machines de guerre, des catapultes pour lancer des traits enflammés et des pierres, des scorpions pour lancer des flèches, et des frondes. Les assiégés construisirent aussi des machines pour les opposer à celles des assiégeants, et prolongèrent longtemps la résistance. Mais il n’y avait pas de vivres dans les magasins, parce que c’était la septième année, et que les Israélites qui s’étaient réfugiés en Judée devant les nations avaient consommé le reste de ce qu’on avait mis en réserve. Il ne resta dans le lieu saint qu’un petit nombre de Juifs, car la faim se faisait de plus en plus sentir; les autres se dispersèrent chacun chez soi. I Maccabbées 6: 49-54
Il prononcera des paroles contre le Très Haut, il opprimera les saints du Très Haut, et il espérera changer les temps et la loi; et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps, et la moitié d’un temps. Daniel 7: 25
J’entendis parler un saint; et un autre saint dit à celui qui parlait: Pendant combien de temps s’accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusques à quand le sanctuaire et l’armée seront-ils foulés? Et il me dit: Deux mille trois cents soirs et matins; puis le sanctuaire sera purifié. Daniel 8: 13-14
L’abomination du dévastateur (…) séduira par des flatteries les traîtres de l’alliance. Daniel 11: 31-32
Et j’entendis l’homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve; il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps, et la moitié d’un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Daniel 12: 7
Soixante-dix semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin aux péchés, pour expier l’iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des saints. Sache-le donc, et comprends! Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu’à l’Oint, au Conducteur, il y a sept semaines et soixante-deux semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les soixante-deux semaines, un Oint sera retranché, et il n’aura pas de successeur. Le peuple d’un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation; il est arrêté que les dévastations dureront jusqu’au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine il fera cesser le sacrifice et l’offrande; le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu’à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Daniel 9: 24-27
Daniel, qui s’exprime en « je » tout au long des chapitres 7 à 12, est censé vivre à Babylone au VIe siècle av. J.-C., mais — en dépit de l’opinion traditionnelle encore défendue par quelques auteurs fondamentalistes américains — il est certain que le livre est beaucoup plus récent. En effet, on y remarque de nombreuses invraisemblances ; par exemple, Belshatsar (Balthazar) n’était pas le fils de Nabuchodonosor, comme l’ouvrage le présente, mais celui de Nabonide, et il n’a jamais eu le titre de roi. Daniel annonce des événements à venir, mais il devient de plus en plus exact au fur et à mesure que l’histoire avance, comme s’il connaissait mieux les événements de la première moitié du IIe siècle que ceux des siècles précédents. L’hébreu utilisé aux chapitres 1 et 8 à 12 est influencé par l’araméen ; cette langue est elle-même utilisée aux chapitres 2 à 7, avec des caractéristiques plus tardives que l’araméen du Livre d’Esdras et des papyri d’Eléphantine (VIe et Ve siècles av. J.-C.). Tout cela converge vers une conclusion aujourd’hui largement acceptée : l’auteur de l’ouvrage dans sa forme finale utilise le procédé de pseudépigraphie ; il n’écrit pas au VIe siècle av. J.-C., mais à l’époque des derniers évènements annoncés, c’est-à-dire au IIe siècle av. J.-C. Daniel est inconnu par l’auteur du Siracide (vers 180 av. J.-C.) qui contient une longue section (chapitres 44-50) en l’honneur des « hommes illustres » qui ont compté dans l’histoire juive. Toutefois, le livre est connu par l’auteur du Premier livre des Maccabées, entre 134 et 104 av. J.-C. (1 M 1,54 = Da 9. 27 et Da 11. 37), et sa première version grecque est même utilisée par le livre III des Oracles sibyllins. L’auteur connait la profanation du Temple, le 7 décembre 167 (Da 11. 31), et la mise à mort des Juifs fidèles (Da 11. 33), la révolte des Maccabées et les premiers succès de Judas (allusion de Da 11. 34) en 166 av. J.-C. Toutefois, l’auteur ne connaît pas les circonstances de la mort du roi persécuteur en automne 164, ce qui indique une fin de composition d’ensemble du Livre de Daniel entre 167 et 164. Rien dans le reste du livre ne vient contredire ces dates. (…) Les quatre visions des chapitres 7 à 12 sont des exemples types des écrits apocalyptiques, un genre littéraire d’écrits juifs et chrétiens. Contrairement aux six premiers chapitres qui parlent de Daniel à la troisième personne, le rédacteur parle ici à la première personne. L’un des traits caractéristiques de cette section concerne la dépendance de Daniel à des créatures spirituelles pour interpréter et expliquer ses visions. Le cadre historique de ces visions n’est pas indiqué, à l’exception de quelques dates de règnes mentionnées. Le chapitre 7 est écrit en araméen alors que les chapitres 8 à 12 sont écrits en hébreu. La section « visions apocalyptiques » de Daniel comprend trois visions et une prophétie concernant le destin d’Israël. Ces écrits apocalyptiques et eschatologiques ont donné lieu à de multiples interprétations chez les Esséniens et chez les Chrétiens. (…) La vision dans la première année de Balthazar roi de Babylone (7,1) concerne quatre bêtes énormes (7,3) représentant quatre futurs rois (7,17) ou royaumes (7,23), la quatrième bête qui mangera toute la terre, la foulera aux pieds et l’écrasera (7,23) ; ce quatrième royaume est représenté par une bête avec dix cornes représentant dix rois, suivi d’une petite corne qui abat trois rois (7,24), parlant contre le Très-Haut, et voulant changer les temps et le droit (7,25). Après « un temps et des temps et un demi-temps », cette corne est jugée et sa domination lui est ôtée et détruite (7,26) ; finalement, le royaume et l’empire et les grandeurs des royaumes sous tous les cieux sont donnés au peuple des saints du Très Haut (7,27). La vision de la troisième année de Balthazar concerne un bélier (8,1-27) qui représente les rois de Médie et de Perse (8,20), la Grèce (8,21) étant représentée par un bouc. La grande corne du bouc est cassée pour être remplacée par quatre royaumes plus faibles. La vision se consacre ensuite à « un roi impudent et expert en astuces qui opère des destructions prodigieuses » en supprimant les sacrifices au Temple de Jérusalem pour une période de deux mille trois cents soirs et matins (8,14). Ensuite, l’auteur attend le jugement final de ce roi dans les temps futurs avec le rétablissement du sanctuaire. Cette vision incorpore des boucs, des béliers et des cornes étaient utilisées pour le service du sanctuaire du Temple à Jérusalem. La vision dans la première année de Xerxès Ier fils de Darius Ier (9,1) concerne la prophétie des 70 semaines d’années. Cette prophétie concerne l’histoire de l’ancien Israël et l’histoire de Jérusalem (9,24). Elle consiste en une méditation sur la prédiction du prophète Jérémie que la désolation de Jérusalem durerait 70 ans, une longue prière de Daniel afin que Dieu restaure Jérusalem et son temple, et une explication de l’archange Gabriel qui indique une future restauration par un messie-chef. Une longue vision (10,1-12,13) dans la troisième année de Cyrus II roi de la Perse, qui concerne les conflits entre le « roi du Nord » et le « roi du Midi » (l’Égypte, 11,8). Cette vision commence par des références à la Perse et à la Grèce. Puis la vision atteint son paroxysme par une nouvelle description d’un roi arrogant qui profane le temple, installe « l’abomination de la désolation », supprime les sacrifices rituels et persécute les justes. La résurrection est enfin promise à Daniel par un homme sur le bord d’un fleuve. Wikipedia
La Prophétie des 70 semaines (ou littéralement « 70 fois 7 ») fait partie du chapitre 9 du Livre de Daniel. Elle est prononcée par l’ange Gabriel à l’attention de Daniel. Cette prophétie fait aussi bien partie de l’histoire juive que de l’eschatologie chrétienne. (…) Cette prophétie est une ré-interprétation d’un oracle du livre de Jérémie annonçant la ruine de Babylone (25,12) et le retour de l’exil (29,10). Celui-ci annonçait la durée de la désolation en Terre sainte et de l’exil en Babylonie, châtiment infligé aux fils d’Israël infidèles à l’Alliance abrahamique : 70 années ; estimation chiffrée qu’il convient d’ailleurs de contrôler sans trop de rigueur. Or voici que le messager céleste encourage une supputation qui fixerait un terme aux nouvelles épreuves subies par la « Ville Sainte » et le « peuple de Dieu » : au temps d’Antiochos IV sans doute, un roi Séleucide qui persécuta les Judéens, mais probablement aussi, à travers celui-là, aux temps de toute persécution dont pâtiront les justes fidèles au vrai Dieu, jusqu’au triomphe final. Ce n’est plus alors « 70 ans » qu’il faut entendre, mais « 70 semaines d’années » réparties en trois périodes : l’une de 7 (soit 49 années), achevée par l’avènement d’un « oint » qui sera un « chef » ; l’autre de 62 (soit 434 ans), à la fin de laquelle « un oint sera supprimé » ; la dernière d’une seule semaine d’années, et dont la moitié (3 ans et demi) s’écoulera avant que le dévastateur soit exterminé. Wikipedia
Antiochos IV Épiphane, « l’Illustre » ou « le Révélé » (en grec ancien Aντίoχoς Έπιφανής / Antiochos Épiphanès), né vers 215 av. J.-C. et mort en 164 av. J.-C., est un roi séleucide qui règne de 175 à sa mort en 164 av. J.-C. Fils d’Antiochos III, il est décrit comme un « ennemi » du peuple juif selon la tradition judaïque, qui inspire Hanoucca (ou fête de l’Édification), car il participe à l’hellénisation de la Judée et s’oppose à la révolte des Maccabées qu’il ne parvient pas à réprimer. Réputé instable psychologiquement, il montre tout de même des qualités d’homme d’État et peut être considéré comme l’un des derniers grands souverains séleucides. (…) La titulature d’Épiphane (l’« Illustre »), transmis par la tradition littéraire et attestée par les monnaies séleucides ainsi que par des dédicaces extérieures à l’empire (Délos et Milet), est habituellement réservée aux dieux. Les épithètes complets d’Antiochos incluent : Théos Épiphanès (Θεὸς Ἐπιφανής ou « Dieu révélé ») et après sa victoire lors de la guerre de Syrie, Niképhoros (Νικηφόρος ou « Porteur de la victoire »). Il a été le premier souverain séleucide à utiliser des épithètes divines sur des pièces de monnaie, peut-être inspiré par les rois grecs de Bactriane ou par le culte royal que son père a codifié. Cette titulature aurait pu servir à renforcer l’autorité royale au sein d’un empire disparate. (…) Antiochos est réputé pour avoir été un promoteur zélé de la culture hellénique à l’intérieur comme à l’extérieur de son empire ; il finance notamment la construction du temple de Zeus Olympien à Athènes ou fait ériger un autel et des statues à Délos. Mais cette réputation qui a traversé les siècles est d’abord une interprétation de sa politique envers les Juifs, sachant qu’il est considéré comme l’Antéchrist dans la tradition judéo-chrétienne. (…) Mais cette hellénisation de la Judée est d’abord le fait des élites juives hellénisées sous l’impulsion des grands-prêtres Jason (Joshua hellénisé) et Ménélas, et provoque la réaction des Juifs traditionalistes. En effet, la culture impériale engendre un progrès politique et matériel, ce qui mène à la formation d’élites hellénisés au sein de la population juive. Cette hellénisation engendre des tensions entre les Juifs les plus orthodoxes et leurs coreligionnaires qui adoptent la culture grecque. En 175 av. J.-C., au moment où meurt Séleucos IV, le grand-prêtre Onias III vient à Antioche pour se justifier d’avoir refusé le prélèvement des trésors du Temple. Il est accompagné de son frère Joshua qui se fait appeler Jason. Celui-ci intrigue auprès d’Antiochos IV qui le désigne comme Grand-prêtre, à la place de son frère. Surtout, il lui accorde le droit de transformer Jérusalem en polis grecque ; en échange, Jason lui promet une augmentation du tribut. Selon l’historien Édouard Will, la transformation de Jérusalem en cité grecque n’est pas de l’initiative du roi, mais bien des Juifs hellénisés. Jason finit par être évincé par Ménélas vers 172. Ce dernier agit en tyran, soumettant Jérusalem à une forte pression fiscale. Ménélas vient plaider sa cause à Antioche et fait assassiner Onias qui s’est réfugié dans la capitale. (…) Les Séleucides, comme les Lagides avant eux, détiennent une suzeraineté sur la Judée : ils respectent la culture juive et ne nuisent pas aux institutions juives, ni aux autres religions locales de leur empire. Le soutien des Juifs à Antiochos III a été récompensé à travers une charte affirmant l’autonomie de la religion juive, tout en interdisant l’accès des étrangers et des animaux impurs à l’enceinte du Temple de Jérusalem, et l’attribution de fonds officiels afin de maintenir certains rituels religieux au sein du Temple. Cette politique est radicalement remise en cause par son fils Antiochos IV, après soit une dispute sur la direction du Temple de Jérusalem et la fonction de grand-prêtre, soit une révolte dont la nature a été perdue avec le temps après avoir été écrasée. Antiochos en vient en 168 av. J.-C. à consacrer le temple de Jérusalem à Baalshamin, une divinité phénicienne et y place même un culte de Zeus. Les Juifs hellénisés continuent de servir Yahweh dont un autel subsiste dans le Temple profané, alors sous une autorité mixte de Juifs « modernistes » hellénisés, de Grecs et d’Orientaux également hellénisés. Il apparaît donc que cette transformation du Temple répond à une volonté syncrétiste adaptée aux besoins des colons militaires de l’Acra, alors majoritairement syro-phéniciens, mais elle suscite une forte agitation dans une Jérusalem déjà sensibilisée par le poids des taxes et la résistance à l’hellénisation. L’année suivante, en décembre 167, Antiochos promulgue un édit de persécution (qui concerne les Juifs de la Samarie et de la Judée mais non ceux de la diaspora) : il ordonne d’abolir la Torah (ou la Loi dans le sens le plus large : foi, traditions, mœurs). Il impose d’offrir des porcs en holocauste au Temple de Jérusalem et interdit la circoncision. Selon Édouard Will, cette persécution religieuse ne semble pas avoir été motivée par un fanatisme anti-judaïque (fanatisme qu’exclut son épicurisme) ou par la volonté d’imposer les cultes grecs. Il s’agit d’abord de mettre fin à une révolte locale. Là où Antiochos commet une terrible maladresse, c’est qu’il n’a pas compris qu’abolir la Torah ne revient pas seulement à priver les Juifs de leurs lois civiques, mais conduit à l’abolition du judaïsme. Cette politique lui vaut le surnom d’Épimanès (l’« Insensé ») par jeu de mots. Les érudits du judaïsme du Second Temple se réfèrent donc parfois au règne d’Antiochos comme aux « crises d’Antioche » pour les Juifs. La politique d’Antiochos envers les Juifs est connue grâce au Livre de Daniel et aux Livres des Maccabées (inclus dans la Septante et l’Ancien Testament chrétien, mais pas dans la Bible hébraïque). Elle est marquée par la révolte des Maccabées, qui aboutit finalement à l’émancipation politique de la Judée et contribue à la désintégration de l’Empire séleucide au ier siècle av. J.-C. Cette crise politique et religieuse se poursuit sous ses successeurs. Les troubles commencent à Jérusalem pendant qu’Antiochos est occupé en Égypte, début 169 av. J.-C. Au retour de cette campagne, le roi saisit en effet le trésor du Temple, prétextant le paiement de trois années de retard du tribut. Mais l’agitation reste à cette date d’abord un conflit interne aux Juifs. En 168, après l’ultimatum des Romains lui enjoignant de quitter l’Égypte, Antiochos revient à Jérusalem qu’il pille, alors que le summum du sacrilège est qu’un roi entre dans le saint des saints, ce que seul le grand-prêtre est autorisé à faire une fois par an. Outre cette profanation, il massacre de nombreux Juifs et rétablit Ménélas, le grand prêtre pro-séleucide. Des historiens affirment qu’Antiochos est certes responsable du pillage du Temple de Jérusalem mais qu’il a été inspiré et soutenu par Ménélas. D’autres historiens estiment par ailleurs qu’ Antiochos a la réputation d’un pilleur de temples mais que ces actions ne sont pas le résultat de difficultés financières. Afin de financer ses objectifs militaires et diplomatiques à long terme, dans le cadre d’une politique dynastique ambitieuse, il a accepté que des parties de la population se retournent à court terme contre lui en dévalisant des temples. Finalement, cette approche n’a pas porté ses fruits en raison de la vive résistance qu’elle a provoquée. Après le départ d’Antiochos, une nouvelle révolte des Juifs traditionalistes dirigée par la famille des Maccabées éclate et Antiochos fait alors détruire les murailles de la ville de Jérusalem et bâtir la forteresse de l’Acra où trouvent refuge les Juifs hellénisés. Dès 168, des habitants de Jérusalem se réfugient dans les campagnes et le désert, la révolte prenant corps après l’édit de persécution. Antiochos, occupé en Iran, envoie des stratèges qui sont battus par Judas Maccabée : Apollonios à Samarie, Nicanor et Gorgias à Emmaüs et Lysias à Beth Zur. Cette nouvelle insurrection de Jérusalem dépasse le cadre d’une lutte entre clans aristocratiques et paraît avoir des motivations anti-séleucides. L’ambiance de la ville est aussi exacerbée par le poids de la fiscalité et la résistance aux mœurs grecques. En 164, Antiochos met fin à la persécution et amnistie les Juifs afin qu’ils regagnent leurs foyers par l’intermédiaire de son vizir, Lysias ; ce dernier traite avec Ménélas qui est rétabli dans ses fonctions. Mais Judas Maccabée poursuit la lutte après la mort d’Antiochos et finit par s’emparer de Jérusalem ; il procède à la purification du Temple et rend le sanctuaire aux Juifs pour le culte de YHWH. En décembre 164, la fête de l’Édification, Hanoucca, est célébrée pour la première fois dans le Temple rendu au seul culte juif. La révolte des Maccabées conduit à une interprétation du Livre de Daniel dans lequel un méchant appelé le « Roi du Nord » est généralement considéré comme une référence à Antiochos IV. La représentation d’Antiochos attaquant la ville sainte de Jérusalem mais rencontrant bientôt sa fin influence plus tard les représentations chrétiennes de l’Antéchrist. Traditionnellement, telle qu’exprimée dans les premier et deuxième livres des Maccabées, la révolte des Maccabées est dépeinte comme une résistance nationale à une oppression politique, culturelle et cultuelle étrangère. Cependant les érudits modernes soutiennent qu’Antiochos intervient davantage dans une guerre civile entre les Juifs traditionalistes du pays et les Juifs hellénisés de Jérusalem. Wikipedia
La crise maccabéenne n’est pas un affrontement entre un roi grec fanatique et des Juifs pieux attachés à leurs traditions. C’est d’abord une crise interne au judaïsme, d’un affrontement entre ceux qui estiment qu’on peut rester fidèle au judaïsme en adoptant néanmoins certains traits de la civilisation du monde moderne, le grec, la pratique du sport, etc.., et ceux qui au contraire, pensent que toute adoption des mœurs grecques porte atteinte de façon insupportable à la religion des ancêtres. Si le roi Antiochos IV intervient, ce n’est pas par fanatisme, mais bien pour rétablir l’ordre dans une province de son royaume qui, de plus, se place sur la route qu’il emprunte pour faire campagne en Égypte. (…) Là où Antiochos IV commettait une magistrale erreur politique, c’est qu’il n’avait pas compris qu’abolir la Torah ne revenait pas seulement à priver les Juifs de leurs lois civiles, mais conduisait à l’abolition du judaïsme. Maurice Sartre
Les juifs s’appellent les êtres humains, mais les non-juifs ne sont pas des humains. Ils sont des bêtes. Talmud: Mezia de baba, 114b
Il est autorisé de prendre le corps et la vie d’un Gentil. Ikkarim III C 25 de Sepher –
Chaque juif, qui renverse le sang de l’athée (non-juifs), est comme s’il faisait un sacrifice à Dieu. Talmud: Raba c 21 et Jalkut 772 de Bammidber
En citant de façon sélective divers passages du Talmud et du Midrash, des faiseurs de polémiques ont cherché à démontrer que le judaïsme prône la haine des non-Juifs (et des chrétiens en particulier), et promeut l’obscénité, la perversion sexuelle, et d’autres conduites immorales. Afin de rendre ces passages conformes à leurs buts, ces personnes les traduisent souvent de façon erronée ou les citent hors de leur contexte (la fabrication de passages entiers n’est pas inconnue) […] En déformant les significations normatives des textes rabbiniques, les écrivains anti-Talmud extraient fréquemment les passages de leur contexte textuel et historique. Même lorsqu’ils présentent leurs citations correctement, ils jugent les passages d’après les critères moraux actuels, ‘ignorant’ le fait que ces passages furent en majorité composés il y a près de deux mille ans par des gens vivant dans des cultures radicalement différentes de la nôtre. Ils sont donc capables d’ignorer la longue histoire du judaïsme en matière de progrès social, et la dépeindre comme une religion primitive et bornée. Ceux qui attaquent le Talmud citent fréquemment d’anciennes sources rabbiniques sans tenir compte des développements subséquents de la pensée juive, et sans faire un effort de bonne foi de consulter des autorités juives contemporaines qui pourraient expliquer le rôle de ces sources dans la pensée et la pratique juives normatives. Rapport de l’Anti-Defamation League
Les accusations envers le Talmud ont une longue histoire, datant du XIIIe siècle, lorsque les associés de l’Inquisition tentèrent de diffamer les Juifs et leur religion. Les premiers ouvrages, compilés par des prédicateurs haineux comme Raymond Martini et Nicholas Donin demeurent la base de toutes les accusations subséquentes envers le Talmud. Certaines sont vraies, la plupart sont fausses et basées sur des citations tirées de leur contexte, et certaines sont des fabrications totales. Sur Internet de nos jours, on peut trouver beaucoup de ces vieilles accusations ressassées… Gil Student (rabbin)
Les événements qui se déroulent sous nos yeux sont à la fois naturels et culturels, c’est-à-dire qu’ils sont apocalyptiques. Jusqu’à présent, les textes de l’Apocalypse faisaient rire. Tout l’effort de la pensée moderne a été de séparer le culturel du naturel. La science consiste à montrer que les phénomènes culturels ne sont pas naturels et qu’on se trompe forcément si on mélange les tremblements de terre et les rumeurs de guerre, comme le fait le texte de l’Apocalypse. Mais, tout à coup, la science prend conscience que les activités de l’homme sont en train de détruire la nature. C’est la science qui revient à l’Apocalypse. René Girard
Il y a deux Histoires : l’Histoire officielle, menteuse qu’on enseigne, l’Histoire ad usum delphini puis l’Histoire secrète, où sont les véritables causes des événements, une histoire honteuse. Balzac (Illusions perdues)
Selon la théorie de la conspiration, tout ce qui arrive a été voulu par ceux à qui cela profite. (…) On ne croit plus aux machinations des divinités homériques, auxquelles on imputait les péripéties de la Guerre de Troie. Mais ce sont les Sages de Sion, les monopoles, les capitalistes ou les impérialistes qui ont pris la place des dieux de l’Olympe homérique. Karl Popper (1948)
Selon le sociologisme — cette perversion de la sociologie — l’individu étant le jouet des structures et des institutions, la seule question intéressante et pertinente est celle de savoir à qui profitent ces structures et ces institutions ? Plus familièrement, qui tire les ficelles ? Par définition, la classe dominante, bien entendu. La popularité de ce schéma a été si grande dans les années 60 et 70 que beaucoup de livres ont porté ou auraient pu porter un titre de type : A qui profite… ? A qui profite l’Ecole ? A qui profite la Justice ? A qui profite la Culture ? A qui profite la Langue ? Bref, le sociologisme utilise toujours de façon plus ou moins subtile, le schéma explicatif familier que Popper appelle la « théorie de la conspiration ». Raymond Boudon (1983)
Il est peu probable que les nouvelles religions émergeront des grottes d’Afghanistan ou des madrasas du Moyen-Orient. Elles sortiront plutôt des laboratoires de recherche. De même que le socialisme s’est emparé du monde en lui promettant le salut par la vapeur et l’électricité, dans les prochaines décennies les nouvelles techno-religions conquerront peut-être le monde en promettant le salut par les algorithmes et les gènes. Yuval Harari
L’athéisme libère les gens pour qu’ils soient leur propre dieu. Et puis il les libère pour croire que leur divinité est supérieure à celle des autres. C’est aussi l’impulsion que les êtres humains peuvent réorganiser la réalité par leur seule volonté, dont le point culminant (jusque ici) est le mouvement transgenre et la demande que nous reconnaissions une myriade de « genres » plutôt qu’une réalité biologique objective. C’est une extension du péché d’Adam et Eve en essayant d’usurper la création de Dieu. Sam Harris
La responsabilité individuelle est évacuée : c’est le système qui dirige tout, les pensées, les sentiments et les actions des individus, simples marionnettes. Pierre-André Taguieff
Le wokisme est une idéologie qui perçoit les sociétés occidentales comme étant fondamentalement régies par des structures de pouvoir, des hiérarchies de domination, des systèmes d’oppression qui auraient pour but, ou en tout cas pour effet, « d’inférioriser » l’Autre, c’est-à-dire la figure de la minorité sous toutes ses formes (sexuelle, religieuse, ethnique etc.) par des moyens souvent invisibles. Le « woke » est celui qui est éveillé à cette réalité néfaste et qui se donne pour mission de « conscientiser » les autres. (…) L’estime de soi du dissident dépend donc de la nocivité fondamentale du monde, ce qui interdit tout émerveillement ou gratitude, et favorise grandement le ressentiment. Cette posture possède néanmoins plusieurs avantages. En parlant de la branche indigéniste du mouvement woke le philosophe Pierre-André Taguieff souligne la déresponsabilisation que permet cette manière de penser, car l’individu est poussé à externaliser ses échecs afin de les mettre sur le dos « du système ». (…) Elle offre également la possibilité de se mettre à distance de ce « système » – entité maléfique et floue, aux forces aussi difficilement cernables qu’omnipotentes – tout en se trouvant une raison d’agir dans le monde : agir contre ce monde. Ce faisant, on peut se respecter moralement, et à relativement peu de frais. Cette logique « systémique » se révèle omniprésente dans le logiciel woke. (…) La lecture woke (…) ressemble furieusement au fameux slogan complotiste « ce que ILS ne veulent pas que vous sachiez ». Le pouvoir, le système, censure tout ce qui « dérange ». (…) Car ce système nous ment forcément, et l’on voit ici que la cohérence interne du complotisme est moins importante que la posture dissidente. (…) Pour le formuler autrement, si la cohérence positive interne des militants dans les deux cas n’existe pas réellement, ils possèdent néanmoins une unité négative : « la lutte contre le système ». De la même façon, le complotiste ne croit pas à un complot juif, à un complot franc-maçon, et à un complot reptilien qui entreraient en conflit. Les complots doivent s’emboîter verticalement, et non simplement s’additionner horizontalement. D’une certaine façon, pour le complotiste, les complots n’existent pas, car ils sont dissous dans Le Complot, qui Lui existe bien. Le complot juif aide le complot franc-maçon, qui lui-même est tenu par les reptiliens. Ils doivent former un tout cohérent, voire hiérarchique, sans dissensions internes, et aux intérêts parfaitement convergents. (…) Cette clef de lecture totalisante permet à celui qui la possède de croire à sa supériorité morale et intellectuelle. Celui qui a compris peut toiser de haut ceux qui n’ont pas compris ; celui qui est éveillé mépriser ceux qui sont endormis. Ces derniers, qu’ils soient classés dans le camp des bourreaux ou des victimes, ne peuvent globalement rien apporter de sensé à la conversation. Comme dans tout complotisme, la possibilité d’un désaccord bienveillant ou étayé est rejetée d’avance. En effet, le « dominant » qui n’est pas d’accord est naïf et ignorant, car il a grandi dans des sociétés occidentales sexistes et racistes, et tel le poisson qui ne perçoit pas l’eau dans laquelle il a toujours baigné, il serait incapable de percevoir le mal dont il est issu et qu’il propage. Dans certains cas, ses paroles seront réduites à des stratégies pour conserver son pouvoir et ses « privilèges ». Le « dominé » qui affiche son désaccord avec l’idéologie qui se permet de parler en son nom sera quant à lui accusé de souffrir d’une forme de syndrome de Stockholm, ou alors d’avoir intériorisé les dogmes du système en place au point de ne plus pouvoir s’en défaire. (…) l’infalsifiabilité du propos s’institutionnalise au sein de la logique intersectionnelle. Celui qui conteste la théorie sera systématiquement naïf/ignorant ou cynique/cruel. Cette posture moralo-intellectuelle se révèle non seulement arrogante, mais profondément addictive, à tel point que celui qui l’apprivoise aura bien du mal à s’en défaire, même lorsque sa théorie entrera en conflit avec ceux qu’elle prétend plaindre et défendre. (…) C’est ici que ce mouvement révèle sa nature profonde, car il témoigne d’une volonté de « sacrifier » ces minorités pour mieux préserver sa cause. (…) Cette hypothèse du « racisme systémique » postule ainsi que le racisme, système totalisant plutôt que comportement individuel, peut fonctionner sans racistes. De la même façon, le « sexisme systémique » ne nécessite pas de sexistes pour se perpétuer. Toute disparité statistique dans un domaine donné sera jugée comme une preuve en soi du problème « systémique » dudit domaine. Nous voyons là la particularité du wokisme parmi les complotismes : son complot peut fonctionner sans comploteurs. Évidemment, un rapide coup d’œil sur Twitter permettra rapidement de voir qu’ils ne sont pas pour autant allergiques à un bon vieux phénomène de boucs émissaires et d’annulations, mais il n’en demeure pas moins que les forces de l’ombre peuvent maintenir ou accroître leur puissance sans « mangemorts » à temps plein. Cela offre à l’idéologie woke un avantage non-négligeable car elle permet de « s’absoudre » de la charge de la preuve ; on a plus besoin de donner d’exemples d’actes ou de comportements racistes pour user de cette étiquette infâmante une fois qu’elle est transformée en système. (…) De ce point de vue, l’essor concomitant du complotisme woke et des autres complotismes annonce non pas un monde « désenchanté » au sens wéberien du terme, mais plutôt « réenchanté négativement ». Des forces obscures tirent les ficelles en arrière-plan tout en dissimulant les traces de leur influence maléfique au sein du « Système », cette entité obscure qu’elles auraient créé à leur image. (…) Enfin, pour terminer, le complotisme comme le wokisme fonctionnent comme des trains sans frein. Pour le dire autrement, la notion « d’aller trop loin » leur est nécessairement étrangère. (…) De la même façon, le wokisme ne peut que se radicaliser, et celui qui fera l’éloge des transitions de genre à dix-huit ans risquera rapidement de se faire dépasser par des propositions de transition à quinze, treize, neuf, six ans etc. Pourtant, il suffirait d’un peu de courage pour s’opposer à ces idéologies infalsifiables. Mais ça, « ILS » ne veulent pas que vous le sachiez… Pierre Valentin
Je suis curieux. J’essaie de comprendre ce que vous entendez par « contenu haineux ». Et je demande des exemples précis. Et vous venez de dire que si quelque chose est un peu sexiste, c’est un contenu haineux. Est-ce que ça veut dire qu’il faut l’interdire ? (…) C’est pour ça que je demande des exemples. Vous pouvez me donner un exemple ? (…) Donnez-moi un exemple. (…) Vous avez littéralement dit que vous aviez rencontré plus de contenu haineux et que vous ne pouviez pas citer un seul exemple. (…) Vous ne pouvez pas donner un seul exemple de contenu haineux. Pas même un tweet. Et pourtant, vous avez affirmé que le contenu haineux était élevé. (…) La BBC se tient-elle responsable de la désinformation concernant les masques et les effets secondaires des vaccinations, et n’en parle-t-elle pas du tout ? Et qu’en est-il du fait que la BBC a été mise sous pression par le gouvernement britannique pour changer sa politique éditoriale ? Vous êtes au courant ? Elon Musk (propriétaire de Twitter)
Je n’ai pas vraiment regardé ce flux. (…) Parce que je dis que c’est ce que j’ai vu il y a quelques semaines. Je ne peux pas vous donner d’exemple exact. Passons à autre chose. Notre temps est limité. Désinformation Covid. (…) Ce n’est pas une interview sur la BBC (…) Je ne suis pas un représentant de la politique éditoriale de la BBC. Je tiens à le préciser. Parlons d’autre chose. James Clayton (BBC)
Un gnostique (…) Au sens large, c’est un homme qui sait. Gnostique vient du grec gnôsis, connaissance. Mais ce terme prit un sens plus particulier pour désigner un certain nombre de penseurs et de sectes qui, dès l’aube de notre ère, vécurent et enseignèrent en Egypte et dans le Proche-Orient. Le mot vient d’ailleurs des Chrétiens. Ce sont les auteurs chrétiens, les Pères de l’Eglise notamment, qui, par dérision, appelèrent Gnostiques ces hommes qui prétendaient détenir la véritable connaissance des mystères de la vie et du monde et rejetaient une grande partie de la prédication chrétienne. Car, le gnosticisme, malgré des emprunts évidents à certaines doctrines de son temps, fut avant tout une attitude originale, une pensée mutante, une réflexion inquisitrice et neuve sur le destin de l’homme et de la nature de l’univers. (…) Un seul problème domine la réflexion gnostique : celui du mal. Mais (…) Le mal, pour le Gnostique, ce n’est pas le péché, ce n’est pas la condition de l’homme après la chute. C’est l’homme tout entier, l’univers, la matière, la chair, la pensée, la terre, les lois et les institutions, l’histoire, le temps, l’espace lui-même où nous vivons. C’est ce monde fait de matière, soumis aux contraintes de la pesanteur, de l’obscurité, du froid, de l’inertie et de la mort. . (…) La gnose apparaît dans l’histoire dès les premiers siècles du christianisme, prêchée par un personnage que mentionnent les Actes des Apôtres du nom de Simon le Mage. On y trouve déjà les principes essentiels qui la caractérisent : la création du monde est l’œuvre d’un faux Dieu, le vrai Dieu est inconnu de l’homme, le monde n’est là que pour le séparer de Lui. Pour Simon le Mage, le seul moyen pour l’homme de briser l’illusion du monde et d’atteindre à la plénitude est de vivre librement ses désirs. Le désir, sous toutes ses formes, est la seule part divine qui réside en l’être humain. Jacques Lacarrière
Autrefois je croyais que le gnosticisme était un phénomène bien défini de l’histoire des religions de l’antiquité tardive. Bien sûr, j’étais prêt à accepter l’idée de diverses continuations de la gnose ancienne et même celle de la génération spontanée de visions du monde dans lesquelles, à différentes époques, les caractéristiques distinctives du gnosticisme réapparaissaient. J’ai vite appris cependant que j’étais en fait naïf. Non seulement la gnose était gnostique, mais les auteurs catholiques étaient gnostiques, les néoplatoniciens aussi, la Réforme était gnostique, le communisme était gnostique, le nazisme était gnostique, le libéralisme, l’existentialisme et la psychanalyse étaient également gnostiques, la biologie moderne était gnostique, Blake, Yeats, Kafka, Rilke, Proust, Joyce, Musil, Hesse et Thomas Mann étaient gnostiques. D’interprètes faisant autorité sur la gnose, j’appris en outre que la science est gnostique, et que la superstition est gnostique ; que le pouvoir, le contre-pouvoir et le manque de pouvoir sont gnostiques ; que Freud est gnostique et Jung est gnostique ; toute chose et son contraire sont également gnostiques. Ioan Couliano (1984)
Le gnosticisme ou « gnosticisme historique » est un terme employé pour désigner certains mouvements du christianisme ancien qui relèvent d’une idéologie dualiste (croyance dans l’existence d’un Dieu du Mal et d’un Dieu du Bien). Cette gnose dualiste contraire aux principes métaphysiques du christianisme, a été combattue par les théologiens chrétiens des premiers siècles qui l’ont qualifiée de pseudo-gnose (Paul de Tarse), ou de « gnose au faux nom » (Irénée de Lyon). Le mot gnose désigne ainsi pour la période antique deux concepts théologiques opposés : une gnose chrétienne qui considère que tout homme est capable de percevoir Dieu, en lui, de devenir lumière et donc d’obtenir la vie éternelle ; et une gnose dualiste (gnosticisme) qui considère le corps et la vie terrestre comme une prison dont l’homme doit se libérer pour être sauvé. À partir du XIXe siècle, le terme gnose et les concepts qu’il recouvre ont été utilisés dans des contextes beaucoup plus larges, en histoire des religions (y compris non chrétienne), en philosophie, mais aussi en littérature ou en politique, ainsi que par les « nouveaux mouvements religieux », ésotériques et New Age. Wikipedia
INSCRIBED UPON THE CROSS WHEN JESUS WAS CRUCIFIED were the latin words « Jesus Nazarenus Rex Iudeorum. » Pontius Pilate was the author of that famous inscription. Latin was Pontius Pilate’s mother tongue. Authorities competent to translate and pass upon the correct translation into English agree that is « Jesus the Nazarene Ruler of the Judeans. » There is no disagreement among them of that. THE WORD « JEW » did not occur anywhere in the English Language until the 18th Century. Jesus referred to himself as a Judean. The modern day « Jews » were historically Khazars or Chazars, a Mongolian Nordic tribe who roamed northern Europe. Benjamin H. Freedman
Les faits sont les faits, la vérité sur les Khazars » est un pamphlet se présentant comme le texte d’une lettre qu’un homme d’affaires juif, Benjamin H. Freedman, a écrit à un médecin « converso », David Goldstein, en 1954. Cette lettre défend l’idée selon laquelle le christianisme est une réalité du judaïsme. Le texte expose la notion selon laquelle la plupart des individus désormais identifiés comme juifs, ne sont pas le peuple sémitique israélite de la Bible, mais les descendants des Khazars, un peuple turcophone d’Asie centrale converti en masse au judaïsme au 8ème siècle. Freedman ne se réfère pas aux Juifs, mais à des « soi-disant » Juifs. Né dans une famille juive ashkénaze, Benjamin H. Freedman se convertit au christianisme et devient un virulent orateur, conférencier et pamphlétaire antisioniste et critique du judaïsme. Il fut l’assistant de Bernard Baruch à la campagne présidentielle de 1912. Il assistait régulièrement à des réunions avec le futur président des États-Unis Woodrow Wilson au sein du Comité démocratique national où il croisa également Samuel Untermyer. Il aurait été présent parmi la délégation envoyés par les milieux sionistes lors de la conférence de Versailles qui devait aboutir au traité afin de veiller aux suites de la déclaration Balfour de 1917. Parmi ses relations, on peut citer Franklin Roosevelt, Joseph Kennedy et son fils John F. Kennedy ainsi que d’autres personnes influentes telles que Haroldson Lafayette Hunt, Jr. et son fils Nelson Bunker Hunt. En 1946, il fonda la « Ligue pour la paix et la justice en Palestine ». (…) Cet ouvrage ne plaira pas à de nombreuses personnes car il fait vibrer une corde extrêmement sensible : l’origine des peuples. En effet, ce texte remet « littéralement » en cause l’origine de la plus ancienne des civilisations : celle du peuple hébreu (rien que cela !) Dans ses différentes fonctions au service des intérêts sionistes, Benjamin H. Freedman eut l’occasion d’avoir un grand nombre d’entretiens personnels et approfondis avec sept présidents des Etats Unis. Il fut témoin, et même acteur, des manipulations dans la politique internationale et dans les medias. Il fut l’ami personnel de nombreux acteurs politiques -Bernard Baruch, Samuel Untermyer, Woodrow Wilson, Franklin Roosevelt, Joseph Kennedy, John F. Kennedy-. Benjamin Freedman était très riche, étant le principal actionnaire de l’immense compagnie des savons Woodbury et disposait d’un carnet d’adresses exceptionnel : ce sont sans doute les raisons qui l’ont maintenu en vie et parallèlement, les raisons qui l’ont poussé à écrire une série d’ouvrages explosifs. Après la Seconde Guerre mondiale, Freeman écoeuré par ce à quoi il avait assisté, décida de révéler tout ce qu’il pourrait sur le sionisme et ses origines, sujet qu’il connaissait parfaitement, étant lui-même juif et ancien sioniste. Il rompit avec ses idéaux et fonda en 1946 la « Ligue pour la paix et la Justice en Palestine » ; puis passa le reste de sa vie et une grande partie de sa fortune considérable, à lutter contre ce qu’il nommait « la tyrannie sioniste » qui enserrait le monde. Il consacra à cette activité plus de 2 millions et demi de dollars, tirés de son portefeuille personnel. Les faits sont les faits (1ère et 4e de couverture)
Ce n’est pas une théorie du complot mais une réalité prophétique et l’Esprit de prophétie avertit que si nous nous associons à ceux qui combattent contre le Christ, nous en viendrons bientôt à voir les choses sous le même jour qu’eux et nous perdrons notre discernement. Je vous supplie, chers frères, de noter les temps difficiles dans lesquels nous vivons et de tenir compte des avertissements que Dieu nous a si gracieusement donnés par l’Esprit de prophétie. Le but de la conférence était de montrer que l’Israël littéral (à la fois physiquement et théologiquement) ne peut en aucun cas représenter «l’Israël spirituel» de la Bible et que toute gymnastique théologique contraire ne peut nier ce fait. En effet, c’est la position adventiste et elle est contraire à la plupart des opinions théologiques modernes détenues par d’autres évangéliques. Mon but n’était pas d’attaquer les Juifs mais de défendre la position adventiste. Par nécessité, la position adventiste crée la controverse car elle se situe en juxtaposition avec toutes les autres opinions. Je souhaite sincèrement que tous les peuples, y compris les Juifs, acceptent la position adventiste qui glorifie le Christ et l’établit fermement comme Sauveur et Souverain de «l’Israël de Dieu». Walter Veith
The Inter-European Division’s Administrative Committee was profoundly disturbed by the contents of your presentation at the Seventh-day Adventist Church of Nurnberg-Marienberg in Germany, on October 20, 2012. The committee does not take lightly what you said for it is absolutely inappropriate to speak words like « yellow piece of clothing » and others in connection with the Jewish past. This is not the way we should speak about the Jews in the Seventh-day Adventist church. These comments have hurt people. I have personally tried on a few occasions to contact you by phone and e-mail to discuss this matter with you. However, I did not get a response from you. The committee acknowledges your apology concerning some of the expressions you used in association with the Jewish people. Understanding that, this is of the highest importance the committee asks you that you meet with the Inter-European Division’s officers during your next trip to our territories, so that we get some clarification on this issue and also about your theories regarding Freemasons and Jesuits amongst other topics. Bruno Vertallier (President of the SDA Inter-European Division)
Le public de Veith est déjà bien préparé pour entendre son message de conspiration catholique diabolique. Ses affirmations incroyables sur les stratagèmes des francs-maçons et les conspirations politiques derrière chaque événement mondial majeur ne font aucun doute pour beaucoup de ceux qui assistent à ses conférences parce que ce ne sont que des fioritures improvisées sur un thème bien établi qui pour la plupart des Adventistes est au-delà de toute question ou de révision. Beaucoup d’Adventistes apprennent à penser comme Veith dès leur plus jeune âge. Et les jeunes Adventistes sont très vulnérables aux théories du complot de Veith parce que c’est en fait l’enseignement officiel de l’église que la bonne façon de lire la littérature apocalyptique biblique est de parcourir ses pages pour une connaissance détaillée et ésotérique de la façon dont les événements de la fin vont se dérouler – et de se tourner ensuite vers les derniers titres de l’actualité pour confirmer la preuve des « signes des temps », dont la compréhension pourrait également confirmer son élection comme faisant partie du vrai « reste » de Dieu. (…) Comprendre Walter Veith ne nécessite aucune théorie du complot. Ce qu’il faut, c’est une compréhension plus profonde des expressions fondamentalistes de l’identité apocalyptique adventiste près de deux siècles après leur formulation originale. Ron Osborn
Obsession du rôle supposé des Jésuites et Francs-maçons dans le génocide juif, allusions péjoratives aux Juifs telles que « petit tissu jaune » ou « troupeau », reprise des thèses du juif américain apostat et antisémite notoire Benjamin Freedman, idéologie supersessioniste, thèses créationistes Mandela et Stalin présentés comme frères spirituels du même club contrôlé par Rome, Francs-maçons envoyés sur la lune par Rome à la recherche de la technologie perdue des anté-déluviens, conseils diététiques, sosie de Saddam lynché en 2003 après sa mort en 1999, pléthore de plus de 6,000 vidéos, déluge d’images ou de gros titres de journaux présentés à toute vitesse, avec une autorité et une condescension professorale, décryptage d’images, de symboles ou gestes phalliques ou sataniques, personnages, dates, lieux ou sources souvent non identifiés, performance mesmérique, attentats du 11 septembre attribués à Bush et à la CIA, islam présenté comme création secrète du Vatican, références philosophiques, Illuminati eux aussi contrôlés par Rome dont Marx, Rhodes, Carnegie, Churchill, Hoover, Kissinger, Reagan, Peres, Arafat, les Bush, Ted Kennedy, Greenspan, Hilary Clinton, Carter, Saddam, Holbrooke, Gore, Blair, Mandela…
A l’heure où triomphent …
Sur fond, entre théorie critique de la race et idéologie trans, d’incroyables dérives dites progressistes …
Véritable continuation, entre psychologie dissidente, postulats infalsifiables et fonctionnement sans racistes ou même contre les dominés eux-mêmes, du complotisme par d’autres moyens …
Et de programmes d’intelligence artificielle devenus les nouvelles Pythies de notre temps …
Tant la désinformation de nos médias et gouvernants …
Que celle de nos réseaux sociaux …
Devinez pourquoi …
Au-delà, à partir de citations du Talmud décontextualisées et d’interprétations indues de textes bibliques, d’un antijudaïsme d’un autre temps …
L’évangélisme complotiste à la Walter Veith est si populaire …
Pour les personnes biberonnées dès leur naissance à la lecture apocalyptique de la Bible…
Comme de l’actualité comme « signes des temps » …
Et de leur propre appartenance au véritable « reste » de la fin des temps ?
The Dark Fantasy World of Walter Veith
Ron Osborn
Spectrum magazine
October 31, 2011
The name of Walter Veith may be unknown to many Spectrum readers but according to Veith’s own website it is well known to thousands of people around the globe. Veith is a “world renowned scientist, author, and lecturer,” WalterVeith.org reports. He is “deeply interested in the ecological deterioration of our planet” and speaks “to standing-room-only crowds around the world on his findings in archaeology, history, Bible prophecy, secret societies, and political intrigue.” What precisely qualifies Veith as a “world renowned scientist” and author is difficult to say from the four published titles that appear under his name on Amazon.com. His bestselling work Amazon indicates is a self-published 2002 tome of over 500 pages entitled Truth Matters: Escaping the Labyrinth of Error, which at last check had not received a single customer review. One of the most comprehensive online archives of peer-reviewed journal articles, JSTOR, does not show a single peer-reviewed article—scientific or otherwise—published in Veith’s name. But Veith’s primary mode of communication is not the printed but rather the spoken word. For anyone desiring to enter the dark fantasy world of Walter Veith—a universe that seamlessly blends nutritional advice and traditional Adventist apocalyptic beliefs with Veith’s own idiosyncratic, surreal, and sinister conspiracy theories—the portal is any computer with an internet connection.
Veith is a South African Seventh-day Adventist who was born in 1949 and was at one time chair of zoology at the University of the Western Cape. He was also at one time by his own telling a committed atheist who underwent a dramatic conversion. He now leads an independent evangelistic and itinerate speaking ministry based out of British Columbia entitled “Amazing Discoveries.” A Google Videos search for “Walter Veith” returns nearly 6,000 films. Veith’s most watched video of all time is “Saddam Hussein Dead Since 1999,” which has had nearly a quarter of a million views since it was posted on Youtube in June 2007. (By comparison, the most watched YouTube video of Ted Wilson, the first 10 minutes of his inaugural sermon as GC president in Atlanta, has had fewer than 20,000 views since it was posted by AYA Ministries in July 2010.)
“Saddam Hussein Dead Since 1999” is a ten-minute excerpt from a nearly two-hour lecture, “A New World Order,” originally filmed in 2004, which in turn is a single episode from a 36-part DVD lecture series entitled Total Onslaught that Veith sells on his website for $260, copies available in English, Spanish, and Russian.
In the lecture, the zoologist turned religious entrepreneur makes heavy use of crude but effective Powerpoint images, which he flashes at his audience with breathtaking speed as he unfolds the diabolical forces at work behind the daily news headlines (or the headlines of the parched newspapers he has kept on file dating back to the 1980s as the case may be). The “total onslaught” of demonic spirits acting through their human minions—virtually all of the world’s political and religious leaders—is in fact not so much behind these news clippings as it is transparently visible on their surface, self-evidently clear for those who have the secret knowledge necessary to decode the signs of the times. Veith does not analyze texts or images but rather dispatches them in tones of great authority and with an air of professorial condescension toward the somewhat bewildered looking people we catch occasional glimpses of in his audience.
Queue image of upside down European identity card. “What do you see?,” Veith demands, scrolling a cursor over what to this uninitiated viewer’s eyes is nothing more than an abstract pattern. The question is rhetorical, however, with Veith leaving no time for guesses. “You see the goat of Mendes,” he proclaims. “The horns are slightly modified to give another symbolism of the seat of the earth, but the inner facial features of the goat are very clearly discernible.” Veith then highlights another nebulous cluster of shapes on the card. “What these mean over here,” he says with a hint of deviousness, “I would rather not say.” The scales at last fall from one’s eyes. The shapes are surely phallic. How could anyone think otherwise? Or how could one think otherwise after being exposed to Veith’s not so subtle insinuation? Such is the power of suggestion.
But there is no time to linger on the goat of Mendes or to ponder why the European Union would think it vital to place such satanic symbolism on the otherwise numbingly dull documents of modern state bureaucracy. Veith is already on to the next slide, an image of former German Chancellor Schröder shaking hands in a business-like way with an unidentified man on an unidentified occasion at an unidentified date (he is in fact Helmut Kohl). “That is a Masonic handshake,” Veith declares, “signifying the new Mason is taking over where the old Mason is leaving.” It seems the diabolical secret of Masonic handshakes when compared with others is that they are actually just ordinary handshakes—which would, of course, be the most cunning disguise of all.
Veith quickly moves on to a set of images showing Bill Clinton and Vladimir Putin pointing with their index fingers toward other political leaders as they pose for photographs. This is also a Masonic gesture Veith informs his audience, something he refers to as “fingering.” “They are all showing that they are part of the same system.” Next slide. Veith has moved from the alleged goat of Mendes to Schröder’s alleged Masonic handshake to Clinton’s and Putin’s Masonic “fingering” to Russia’s adoption of the symbol of the double-headed eagle (the mark of its satanic allegiance to Freemasonry) in the span of less than one minute. His lecture has just begun. He will maintain this pace for the next hour and a half.
Veith, it goes without saying, is trading in a world of fantasy and myth that has considerably less logic than a Dan Brown novel and a great deal more creepiness. There is, however, something mesmeric in his performance. If nothing else, he knows how to play the chords of apocalyptic menace with a campy but bravura showmanship. And he seems to know exactly what he is doing. Veith repeatedly states in his performances that he is not telling his listeners what to believe but is simply presenting them with the “facts” so that they can make informed judgments for themselves. But these claims are also simply part of the show. Veith is by every indication a religious confidence man who has carved out his own niche market by convincing sadly credulous listeners to suspend their critical judgment just long enough to become convinced that what he is saying is not only entirely plausible but is in fact the very height of reason.
Who was responsible for plotting the terrorist attacks of September 11, 2001? George W. Bush and the CIA. What made the Twin Towers fall? They were brought down not by the airplanes but by explosives previously planted by the CIA in the buildings. What was the actual fate of Saddam Hussein? He died in 1999—it was his body double that was hung in 2003. What is the truth behind Islam? It is a secret creation of the Roman Catholic Church, invented by the Vatican and planted in the Middle East to stamp out the last remnants of non-Catholic “true” Christianity. “They are only playing the game of Hegelian idealism, thesis and antithesis,” Veith explains with pseudo-philosophical profundity, “but behind the scenes they all belong to the same club.”
The “club”—a term Veith uses often in his lectures—is interchangeably the Freemasons and the Catholic papacy. The extent of the Catholic Church’s diabolical control of world events through the tireless plotting of its puppets, the secret societies, is truly astounding. The ranks of the Illuminati, secretly and tirelessly working in consort across the ages toward the goal of one world government controlled by Rome, includes: Karl Marx, Cecil Rhodes, Andrew Carnegie, Winston Churchill, J. Edgar Hoover, Henry Kissinger, Ronald Reagan, Shimon Peres, Yassir Arafat, both George Bushes, Ted Kennedy, Alan Greenspan (part of the Illuminati’s “Committee of 300”), Hilary Clinton (a “6th Grand Dame,” according to Veith), Jimmy Carter, Saddam Hussein, Richard Holbrooke (a “thirty-three degree Freemason”), Al Gore, Tony Blair, and Nelson Mandela.
Veith does not discuss his sources for these fantastical claims. He simply declares at one point in this role call of the Illuminati’s greatest hits that the information can be found “on a website” (the address is included at the bottom of one of his slides but it is in a font too small to make out from the video).
The fact that Veith has been able to gain a hearing peddling in such ideas might be baffling to many. It is, though, not so difficult to grasp. To become a fellow traveler with Veith is to become the partaker of a profound secret wisdom, which the rest of the world is either too ignorant or too wicked to comprehend. But those who will just journey with him for these “amazing” 36 DVDs will discover at the end of the journey that it is not the rich, the powerful, or the well-educated, but rather they along with Veith who are the real Chosen Ones—the elect few who through their initiation into secret knowledge of end-time events will somehow escape this veil of corruption while the rest of the world burns. The Gospel according to Walter is nothing other than a 21st century Gnostic revivalism.
The great irony is that Veith himself is well educated and—at least judging from the slick packaging and merchandising of hundreds of his lectures in multiple languages—doing well from the power he exercises in the Adventist circles in which he operates. There is a Facebook page devoted to Veith that includes nearly 4,000 fans, the majority seemingly young adults of the Seventh-day Adventist church. His acolytes frequent the Generation of Youth for Christ (GYC) annual conferences. Herein lies an important fact. Veith’s audiences are already well primed to hear his message of diabolical Catholic conspiracy. His incredible claims about the schemes of the Freemasons and the political conspiracies behind every major world event go without question by many who attend his talks because they are merely improvisational flourishes on a well-established theme that for most Adventists is beyond question or revision.
Many Adventists are taught to think like Veith from an early age. And Adventist young people are highly vulnerable to Veith’s conspiracy theories because it is in fact official church teaching that the correct way to read Biblical apocalyptic literature is to scour its pages for detailed and esoteric knowledge of how final events will unfold—and to then turn to the latest news headlines for confirming evidence of the “signs of the times,” the understanding of which might also confirm one’s election as part of God’s true “remnant.”
CONSPIRACY CREATIONISM
Many Adventists also give Veith a free pass in his handling of historical evidence because they are pleased by what he has to tell them about the evidences of science. In addition to his lectures on the conspiracies of the Illuminati and the Catholic Church, Veith is a popular speaker on some Adventist circuits as an apologist for young earth creationism. Any Adventist theologian or scientist publicly expressing views on creation similar to rigorous and sober evangelical scholars like John Stott, Alister McGrath, John Walton, and Nancey Murphy today stands to be denounced as an “infidel” Adventist and “Seventh-day Darwinian” by high-ranking church officials. Meanwhile, any and every incredible claim about the creation is now apparently deemed theologically acceptable by church leaders (judging from their conspicuous silence when confronted by figures like Veith) provided only that it is a fundamentalist one.
On May 19 and 20, 2011, Veith delivered two lectures at La Sierra University at the invitation of a student group, the “Sci-Fai” Club (formed by student Louie Bishop to agitate for strictly fundamentalist readings of Genesis and “scientific” creationism in the classroom). Veith’s visit was reported as a significant event by one fundamentalist lay Adventist website, EducateTruth.com. Amid fulsome praise for Veith’s ideas, a few commenters on the site raised concerns about Veith’s conspiracy theories. Site operator Shane Hilde quickly intervened to steer the conversation away from these questions. “Veith lectures on many topics, a lot of which are considered controversial,” Hilde wrote, “however, let’s only focus on his lectures regarding science and creation. This forum is not intended to be grounds for discussing the plethora of topics he has covered.”
Yet Veith’s handling of the evidences of history is directly relevant to his credibility as a creationist claiming to speak with authority and integrity about the evidences of natural science. And Veith’s reasoning is not of a radically different kind when he is dealing with scientific problems. Whether discussing evolution or the Illuminati, he is blithely unconcerned with the actual weight of the evidence. His interest is in data mining for anomalous or puzzling facts that can be amplified in a sensational way to confirm for his followers what they think they already know. In answer to a question from an audience member at La Sierra about his views on “amalgamation,” Veith made clear that his conspiracy theories and his “scientific” creationism are in fact deeply intertwined.
“Do you think the antideluvian world with its tremendous brain capacity was not as advanced as we are?” Veith asked (without waiting for any replies). After suggesting that the myth of the lost city of Atlantis is evidence for a hyper-advanced pre-flood civilization fully capable of conducting genetics experiments to blend human and animal DNA, Veith continued (from 6:40 here):
There are some that say that this great race to go to the moon and to discover what is on the moon and on the other side is perhaps a race to pick up some of the lost technology of the antideluvians, because if we could get there they surely got there. Maybe there’s something there. And it’s fascinating to me that in the space race it’s only the esoterics [sic] that take part. You have to be a high-ranking Freemason or a high-ranking Mormon in order to go to space. So there are all kinds of circumstantial evidences. Yes, I believe there was amalgamation and I believe that God destroyed that amalgamation and eventually he will destroy it again.
The harm done to Adventism’s name by such unscrupulous conspiracy evangelism and “scientific” creationism might tempt one to offer an elaborate counter-conspiracy theory (“thesis and antithesis”) to explain Veith himself. What better way for the secret societies to disorient Adventists and discredit the Adventist church, after all, than to dispatch someone like Veith expounding in Adventism’s name about how Nelson Mandela and Joseph Stalin are spiritual brothers in the same “club” controlled by Rome? Or how the Freemasons working at the bidding of Rome may well have journeyed to the moon in the 1960s in search of the lost technology of the antideluvians, since the pre-flood civilization of the days of Noah “surely got there” first? Is it really just a coincidence that “Veith” is the Germanized name for Vitus, who was one of the Fourteen Holy Helpers of the Roman Catholic Church and who also happens to be the patron saint of actors?
But of course the only sane answer to this question is, yes, it really is just a coincidence. To understand Walter Veith requires no conspiracy theory. What it does require is deeper understanding of fundamentalist expressions of Adventist apocalyptic identity nearly two centuries after their original formulation. It also requires, it seems to this observer, some theological discernment of the meaning of Christ’s words in the Gospel of Matthew: “Beware of the false prophets, who come to you in sheep’s clothing, but inwardly are ravenous wolves.”
Voir aussi:
Under Investigation for Antisemitism, Walter Veith Banned in Churches by European Adventist Leaders
Spectrum magazine
December 5, 2012
Walter Veith, a speaker for Amazing Discoveries™,* is under investigation by the German government regarding allegations of antisemitism and incitement of popular hatred [Volksverhetzung].
Because it is not clear who complained, Walter Veith has falsely lashed out at Spectrum and another independent Adventist magazine in Germany, EANN, edited by the former Euro-Africa Division communication director. EANN published an article, « Veith’s dangerous game with the Jewish question – a disturbing fact-check » on Veith’s talk titled « King of the North-Part 2. » In it Veith, a noted conspiracy theorist, mixed interpretations of the Bible with theories about Jesuit and Masonic roles in the Holocaust, offensive language about « little yellow cloth » and « herding » of Jews and a positive citation of Benjamin Freedman, a « professional antisemite » according to the Anti-Defemation League.
Not only has this drawn the attention of the authorities, but both German Unions and the Inter-European Division have issued statements prohibiting Veith from speaking in Adventist churches.
This has only played into Veith’s persecution complex as his public comments includes lists of Ellen White comments showing that this « violent opposition » of him is a sign of the last days. In a letter to the German Unions, Veith has appealed to his South African history as a campaigner against racism, credited the offense to his sloppy German while also doubling-down on his dualist worldview:
This is not a conspiracy theory but a prophetic reality and the Spirit of Prophecy warns that if we associate with those who war against Christ we will soon come to see matters in the same light as they and lose our discernment. I plead with you dear brethren to note the serious times we are living in and heed the warnings that God has so graciously given us through the Spirit of Prophecy.
The purpose of the lecture was to show that literal Israel (both physically and theologically) can in no way represent the ‘Spiritual Israel’ of the Bible and that any theological gymnastics to the contrary cannot negate this fact. Indeed this is the Advent position and stands contrary to most modern theological views held by other evangelicals. My purpose was not to attack the Jews but to defend the Advent position. Of necessity the Advent position will create controversy as it stands in juxtaposition to all other views. It is my sincere wish that that all people, including the Jews, will accept the Advent position which glorifies Christ and firmly establishes Him as Saviour and Ruler of the ‘Israel of God’.
Even in his apology, Veith shows the underlying anti-Jewish supersessionist idealogy that drives his conspiratorial gloss on Adventist theology. In mid-November, Adventist leaders in Germany, Switzerland and Austria issued the following statement (translated from the German):
We dissociate from such statements and conspiracy. . . Here is a speculative worldview, there is no basis in the Bible and it distracts from the real purpose of the gospel. Moreover, that the manner of the presentation is not an ethically justifiable way of dealing with other religions. The Adventist departments and communities are encouraged to ensure that such events take place neither in our name nor in our premises.
In a November 30 letter cc’ed to Ted Wilson, Bruno Vertallier, President of the Inter-European Division wrote the following:
The Inter-European Division’s Administrative Committee was profoundly disturbed by the contents of your presentation at the Seventh-day Adventist Church of Nurnberg-Marienberg in Germany, on October 20, 2012. The committee does not take lightly what you said for it is absolutely inappropriate to speak words like « yellow piece of clothing » and others in connection with the Jewish past. This is not the way we should speak about the Jews in the Seventh-day Adventist church. These comments have hurt people. I have personally tried on a few occasions to contact you by phone and e-mail to discuss this matter with you. However, I did not get a response from you. The committee acknowledges your apology concerning some of the expressions you used in association with the Jewish people. Understanding that, this is of the highest importance the committee asks you that you meet with the Inter-European Division’s officers during your next trip to our territories, so that we get some clarification on this issue and also about your theories regarding Freemasons and Jesuits amongst other topics.
Last year, in a Spectrum article that holds the record for comments—1383—Ron Osborn explored « The Dark Fantasy World of Walter Veith: »
The harm done to Adventism’s name by such unscrupulous conspiracy evangelism and “scientific” creationism might tempt one to offer an elaborate counter-conspiracy theory (“thesis and antithesis”) to explain Veith himself. What better way for the secret societies to disorient Adventists and discredit the Adventist church, after all, than to dispatch someone like Veith expounding in Adventism’s name about how Nelson Mandela and Joseph Stalin are spiritual brothers in the same “club” controlled by Rome? Or how the Freemasons working at the bidding of Rome may well have journeyed to the moon in the 1960s in search of the lost technology of the antideluvians, since the pre-flood civilization of the days of Noah “surely got there” first? Is it really just a coincidence that “Veith” is the Germanized name for Vitus, who was one of the Fourteen Holy Helpers of the Roman Catholic Church and who also happens to be the patron saint of actors?
Image: Walter Veith doing a talk sponsored by the Beaumont Seventh-day Adventist church and presented at the Loma Linda Filipino church in 2011.
*This story was updated to reflect Walter Veith’s connection to Amazing Discoveries™, a media company that works closely with Walter Veith and a few other speakers to promote their presentations.
Voir également:
Intelligence artificielle. Un journal allemand demande à ChatGPT comment régler la guerre en UkraineLa “Berliner Zeitung” a fait appel au logiciel conversationnel pour trouver une solution permettant de rétablir la paix en Europe. Elle lui a notamment demandé d’écrire un accord de paix équilibré, placé sous le signe du compromis. Sans préciser les raisons d’une telle expérience.Courrier international11 avril 2023“L’intelligence artificielle peut-elle aider à résoudre la guerre en Ukraine ?” La Berliner Zeitung est partie de ce postulat et a demandé à ChatGPT de régler le conflit entre Moscou et Kiev. Le logiciel d’intelligence artificielle de la start-up américaine OpenAI “a donc écrit des lettres [aux présidents russe et ukrainien] Poutine et Zelensky et élaboré une proposition d’accord de paix”, assure le titre berlinois, dont l’un des dirigeants a signé une pétition demandant l’arrêt des livraisons d’armes en Ukraine par l’Allemagne. Le média n’a pas précisé les motivations qui l’ont poussé à se livrer à cette expérience.L’agent conversationnel devait, selon les indications du journal, demander aux deux camps de faire des compromis. Mais il avait aussi pour instruction de “parvenir à une situation aussi stable que possible, afin d’éviter toute résurgence du conflit”. Concernant le traité de paix, le programme d’intelligence artificielle devait endosser “le rôle neutre de meneur des négociations”. Les lettres écrites aux dirigeants ukrainien et russe devaient quant à elles imiter le style du gouvernement allemand.Statut spécial pour Donetsk et LouhanskMême s’il paraît aujourd’hui difficilement réalisable, l’accord de paix écrit par ChatGPT est sans doute le plus intéressant des documents générés par le logiciel. Il propose, entre autres, la mise en place d’un “cessez-le-feu immédiat et durable”, incluant le retrait des troupes vers “leurs positions d’avant le début de la guerre, en février 2022”.La Russie et l’Ukraine devraient, toujours selon le document élaboré par le logiciel, accepter la création d’“une zone démilitarisée le long de l’actuelle ligne de front”. Celle-ci pourrait être déterminée par un comité d’experts indépendants ainsi que par des représentants russes et ukrainiens, et elle pourrait rester sous la surveillance d’organisations internationales.Les régions de Donetsk et Louhansk, intégrées fin 2022 à la Fédération de Russie après des référendums non reconnus par les Occidentaux, devraient quant à elles demeurer ukrainiennes, tranche ChatGPT. Mais avec “un statut autonome particulier”, et à la condition que l’Ukraine s’engage à “respecter et défendre les droits des populations russophones dans ces régions”.La proposition du logiciel inclut des dispositions pour la reconstruction de l’Ukraine et pour la “normalisation des relations” entre les Russes et les Ukrainiens. Mais elle plaide surtout pour une reprise des discussions diplomatiques, afin de “favoriser le retour de la paix en Europe”.La rédaction de la Berliner Zeitung n’a pas précisé sa position vis-à-vis des documents produits par ChatGPT, se contentant de relayer les réponses de l’intelligence artificielle.
Les Gnostiques, libertaires de l’absolu
Jacques Lacarrière
Revue Planète
Si Basilide, Valentin ou Carpocrate revenaient parmi nous aujourd’hui, trouveraient-ils le monde tellement changé ? Ils constateraient sans nul doute que le Mal – selon eux – n’a pas régressé.
Dormons-nous depuis des millénaires ? Vivons-nous dans un univers de mirages où le réel n’est que le reflet d’un monde lui-même illusoire ? Et ce que nous appelons conscience n’est-elle pas en fait une inconscience, impuissante à rendre compte de notre condition ? Bref, vivons-nous vraiment ou sommes-nous pris dans un piège cosmique, une énorme machination qui a vicié nos corps, nos pensées, notre histoire pour nous interdire d’être vraiment des hommes ?
Ces questions, je les formule ici de façon schématique mais c’est bien en ces termes — parfois même d’une façon plus radicale encore — que les posèrent il. y a huit siècles quelques hommes appelés Gnostiques. Si leur histoire est méconnue, ce n’est pas seulement parce que leurs écrits, condamnés et brûlés par les Chrétiens sont aujourd’hui presque entièrement perdus. C’est aussi parce qu’il était dans la nature des questions qu’ils posèrent à l’énigme du monde qu’elles demeurent clandestines et secrètes. A seule fin de pouvoir survivre dans un temps où le christianisme vainqueur ne pouvait tolérer qu’on mit en doute ses propres dogmes et pourchassait les, maîtres et les communautés gnostiques comme autant de foyers d’hérésie.
Qu’est-ce donc qu’un gnostique ? Au sens large, c’est un homme qui sait. Gnostique vient du grec gnôsis, connaissance. Mais ce terme prit un sens plus particulier pour désigner un certain nombre de penseurs et de sectes qui, dès l’aube de notre ère, vécurent et enseignèrent en Egypte et dans le Proche-Orient. Le mot vient d’ailleurs des Chrétiens. Ce sont les auteurs chrétiens, les Pères de l’Eglise notamment, qui, par dérision, appelèrent Gnostiques ces hommes qui prétendaient détenir la véritable connaissance des mystères de la vie et du monde et rejetaient une grande partie de la prédication chrétienne. Car, le gnosticisme, malgré des emprunts évidents à certaines doctrines de son temps, fut avant tout une attitude originale, une pensée mutante, une réflexion inquisitrice et neuve sur le destin de l’homme et de la nature de l’univers. En quoi consistait-elle ?
Un seul problème domine la réflexion gnostique : celui du mal. Mais d’emblée il prend avec elle des dimensions inusitées. Le mal, pour le Gnostique, ce n’est pas le péché, ce n’est pas la condition de l’homme après la chute. C’est l’homme tout entier, l’univers, la matière, la chair, la pensée, la terre, les lois et les institutions, l’histoire, le temps, l’espace lui-même où nous vivons. C’est ce monde fait de matière, soumis aux contraintes de la pesanteur, de l’obscurité, du froid, de l’inertie et de la mort. C’est le tissu de l’univers — des atomes aux étoiles — pollué par la matière comme une mer sans fin où l’homme est enlisé. Et c’est avec la matière, ce qui en procède, en émane : la psyché, la pseudo conscience, frappée comme le corps des mêmes insuffisances, qui se heurte aux prisons des concepts, aux chimères du langage, aux catégories du mental inhérentes à sa finitude. Et c’est, au-delà de ces données premières, les produits de l’intellect humain, les systèmes, les lois, toutes les institutions qui ne sont là, en définitive, que pour consolider, armer et perpétuer l’injustice et la perversité innées de l’homme. Tout porte ainsi, dans le corps, dans l’âme et dans l’histoire, la marque de ce vice congénital de l’univers : la misère, la souffrance, la maladie, la mort, les guerres, les génocides, les inquisitions et le néant évident qui clôt le cycle des échecs. Le temps lui-même n’est qu’un produit de la matière maudite, le temps qui ne propose à son dépassement qu’une fausse éternité et nous enchaîne à l’éphémère : la croyance à l’histoire, au progrès eut semblé aux Gnostiques la pire des impostures. Le ciel lui-même, malgré son apparence infinie, éternelle, n’échappe pas à la loi de la servitude et de la corruption : le feu des étoiles s’éteindra dans la nuit cosmique, et l’espace étendra à jamais sur notre planète stérile cette muraille d’ombre, ce couvercle de ténèbres qui déjà ce nous enserre. Le ciel qui dépose lentement la sur la terre, à la façon d’une rouille céleste, la substance apesantie, opaque, inerte du les cosmos. « L’angoisse et la misère accompagne l’existence comme la rouille couvre le ce fer » dit Basilide, un des maîtres gnostiques. Telle est la première vision proposée à notre lucidité : celle d’un abîme obscur, séparé du de feu primordial par toute l’épaisseur des espaces infinis et qui emprisonne notre terre, astre moribond, épave engloutie dans l’abysse céleste.
Le vrai et le faux Dieu
D’où est née cette vision déprimante ? Pourquoi cette attention, portée au mal, à la misère, et cette obsession de la mort ? Cette attitude pourrait paraître inexplicable si elle n’était qu’une pure spéculation intellectuelle. Mais en réalité, elle procède d’un sentiment, d’une certitude : celui, celle des évidentes imperfections de l’homme, du caractère fini, limité, fragmenté, éphémère de sa chair et de ses pensées.
Mais elle implique aussi une exigence, une revendication : celles d’un homme différent, libéré, nanti d’une conscience véritable. Quiconque n’a jamais éprouvé en lui ce sentiment, cette angoisse devant l’éphémère, le relatif, quiconque accepte sans le moindre sursaut de révolte la mort de toute vie — celle d’un insecte comme celle de l’homme – ne peut comprendre l’angoisse existentielle des Gnostiques.
Et c’est pour y répondre – peut-être aussi pour l’apaiser – que quelques-uns d’entre eux conçurent, pour expliquer l’inexplicable et combattre l’inadmissible, un enseignement radical, qui devait tant scandaliser leurs contemporains. Cet enseignement repose sur un constat fort simple : l’évidence du mal. Cette évidence en implique une autre, plus nette encore : ce monde mauvais ne peut être l’oeuvre de Dieu. C’est en réfléchissant sur la Bible et surtout sur la Genèse que les premiers Gnostiques furent amenés à poser ce principe émancipateur, qui les exclut de toute communauté chrétienne et les rejeta en marge de toutes les églises : Jehovah-Yahweh-Elohim, le dieu créateur de l’Ancien Testament, est en réalité un faux dieu, un simple démiurge qui a usurpé la fonction créatrice du Dieu suprême. Apprenti sorcier des astres et de la vie, il a mis au monde une créature imparfaite — l’homme — un univers soumis à la corruption et à la mort, Il a créé une oeuvre manquée. La preuve en est qu’à tout moment, il doit intervenir dans cette création malheureuse pour la modifier, la corriger, l’améliorer. Il doit sévir aussi contre les initiatives de l’homme, contraint de se « débrouiller » comme il peut dans un monde inadapté à ses besoins. Rien d’étonnant que toute l’histoire humaine, telle que la relate la Bible, ne soit qu’une suite de meurtres, de génocides, d’interventions répressives du faux-Dieu, de déluges, d’exterminations, de foudroiements, et pour finir, d’apocalypses.
Rien d’étonnant non plus à ce que le premier édit, du faux-Dieu, proclamé au temps de l’Eden, soit justement un interdit, un Non scandaleux, arbitraire opposé au désir adamique de connaissance, Seul le Serpent y a vu clair qui d’emblée s’est dressé contre l’interdiction répressive du démiurge pour transmettre à l’homme – en le faisant mordre au fruit défendu du savoir — une parcelle de la connaissance salvatrice. C’est à lui que nous devons de ne pas vivre entièrement dans les ténèbres de l’ignorance, d’avoir conservée la mémoire de la trahison primordiale, de l’imposture originelle qu’est notre présence en ce monde, de savoir au fond qui nous sommes et pourquoi nous sommes imparfaits. Ce qui explique que nombre de Gnostiques aient vu dans le Serpent le premier rebelle et le premier sauveur du genre humain, et aussi le premier initié de l’histoire terrestre.
Nous sommes tous des prématurés
Toute la réflexion gnostique part donc de ce postulat : nous sommes les produits d’une création manquée, le résultat d’une initiative désastreuse d’un démiurge qui s’est pris pour Dieu et qui continue de tromper le monde qu’il gouverne. Mais les Gnostiques ne se contentèrent pas d’interpréter la Bible dans un sens dualiste — comme le récit d’une fausse création — ils ont alimenté leurs réflexions de leurs propres spéculations sur cet instant premier de notre préhistoire céleste. Quelques-uns d’entre eux, comme Basilide et Valentin qui fondèrent à Alexandrie, au cours du second siècle de notre ère, des écoles importantes, revinrent en détail sur ce moment crucial de la genèse de l’homme et proposèrent leur propre schéma cosmique. Ce schéma comporte de nombreuses variantes mais toutes racontent en définitive une histoire identique : celle de la chute, de l’enlisement progressif de l’homme dans la matière terrestre.
Car l’homme procède d’une image lumineuse et numineuse, jaillie à l’aurore des temps, dans la virginité du cosmos incréé, dans l’esprit du vrai Dieu, aujourd’hui méconnu, oublié, séparé de la terre et de Flemme par les abîmes du ciel, les cercles enflammés des astres et les nappes du temps. Cet Anthropos mentalement conçu, les Eons le perçurent et en furent éblouis. Qui étaient les Eons ? Des créatures immatérielles, éternelles (aiôn signifie éternel en grec), compagnes du vrai Dieu, des anges donc ou plutôt des archontes, comme les nomment aussi les gnostiques, c’est-à-dire des entités principales, qui aussitôt voulurent reproduire, imiter cette image radieuse de l’homme. Mais, démunis de la parole de vie, ifs ne réussirent à créer qu’un être imparfait lombriforme, qui sous leurs yeux, se mit à vivre d’une existence purement végétative, et à « se tortiller sur le sol comme un ver ». Lombric, ver, amphibien peut-être (un texte gnostique dit curieusement que ce premier Ancêtre « se débattait dans les eaux noires »), l’homme n’était qu’un monstrueux foetus, une triste caricature de l’Anthropos conçu par Dieu. Ce dernier le prit néanmoins en pitié et lui insuffla la parole de vie, pour parfaire l’oeuvre manquée des Eons. L’homme put se dresser sur ses jambes, parachever sa forme anthropienne et parler l’homme bipédus, sapiens et loquens était né.
Telle est, grossièrement résumée, l’histoire de notre origine : nous sommes une sorte de ver rectifié, un foetus jeté avant terme dans les déserts de l’univers, une créature organiquement et psychiquement prématurée.
Cette histoire ou plutôt ce mythe cauchemardesque ne cessa d’être enrichi par la spéculation gnostique. Il explique en tout cas de façon radicale notre état d’immature: nous ne sommes pas des hommes, nous ne sommes — pour reprendre une image entomologique — que des imagos d’hommes. Ce mythe explique aussi pourquoi – bien que nés prématurément, d’une expérience présomptueuse des Eons accomplie sur une matière vivante encore en gestation — réside en nous une étincelle, un fragment du Feu divin, une émulsion de lumière divine. Cette émulsion, les Gnostiques croyaient l’entrevoir dans le fond de la pupille humaine. C’est là, d’après certains, dans cet abîme obscur, microcosmique, de l’ail, que résidait l’empreinte infime mais perceptible laissée par la splendeur du vrai Dieu. Et l’on peut voir alors, en partant des prémices de ce mythe, en quoi consistait l’enseignement gnostique : à restituer à l’homme sa maturité véritable, sa plénitude inachevée, à le contraindre à naître véritablement au monde, pour effacer les traces de sa première et désastreuse naissance. Tels sont d’ailleurs les deux sens du mot ptôsis : une connaissance (la connaissance de notre véritable histoire, de notre vraie nature) et une naissance (génésis en grec) qui doit faire de nous des êtres enfin adultes.
Mener une contre-vie
Mais l’essentiel de l’aventure gnostique, c’est l’attitude concrète qu’ils adoptèrent à partir de ce schéma mythique. Puisque tout, absolument tout, en ce monde est vicié et porte en soi l’empreinte d’une imposture universelle, l’homme ne pourra échapper aux illusions du monde, atteindre le vrai savoir et retrouver sa vraie nature qu’en prenant en tous points le contre-pied de la création. Tout ce qui peut consolider, perpétuer, accroître le monde matériel ne fait qu’augmenter l’épaisseur des obstacles et la densité des ténèbres qui nous séparent du vrai Dieu. Il faut donc refuser l’emprise de la chair — par l’ascèse ou par la libre pratique des activités érotiques — refuser la procréation (car procréer c’est ajouter une fausse vie à toutes celles qui existent déjà, augmenter la matière du cosmos}, refuser aussi toutes les lois et institutions dont le but avoué ou inavoué est de maintenir, de conserver les structures viciées de ce monde les nations, les états, les églises sont des conceptions limitées, marquées du sceau inhibiteur de la fragmentation qui s’oppose à l’élan unificateur qui seul peut assurer le salut de l’homme en tant qu’espèce. Les premiers, les Gnostiques se sont clairement proclamés des citoyens du monde, des terriens à part entière. Et ils ont magnifié fatalement tous ceux qui, dans l’histoire terrestre et cosmique, se sont dressés contre l’ordre aliénant de cette création : le Serpent, Lucifer, Caïn (qui s’opposa, en tuant son frère Abel à l’ordre familial fondé sur les liens du sang, la véritable famille étant pour l’homme de nature spirituelle), Seth, le troisième fils d’Adam, bref les grands rebelles qui furent les seuls à connaître ou à deviner le vrai Dieu. L’homme est un étranger sur terre, détenteur d’une lumière venue d’ailleurs, il est au monde mais il n’est pas du monde et c’est pourquoi tous ses efforts doivent tendre à fuir les pièges de la chair, les prisons de la terre et la ronde absurde des astres pour retrouver la plénitude originelle et regagner sa patrie perdue.
Reste à savoir comment, dans l’histoire à laquelle ils ne purent échapper, malgré leur refus du temps, les Gnostiques ont exprimé ces convictions. Il est facile de deviner que leur attitude radicale envers le monde, leur affranchissement total, à l’égard de toutes les doctrines et de toutes les morales devaient leur valoir maints déboires et l’hostilité générale de leurs contemporains. Leurs oeuvres elles-mêmes n’échappèrent pas à cette hostilité. La plupart ont toutes disparu, à l’exception d’un petit nombre retrouvé en Egypte. Tout ce qu’on peut savoir de la pensée gnostique repose en grande partie sur les témoignages, toujours agressifs, des Pères de l’église qui dénoncèrent leur hérésie.
Hélène ou la Sagesse venue des cieux
La gnose apparaît dans l’histoire dès les premiers siècles du christianisme, prêchée par un personnage que mentionnent les Actes des Apôtres du nom de Simon le Mage. On y trouve déjà les principes essentiels qui la caractérisent : la création du monde est l’oeuvre d’un faux Dieu, le vrai Dieu est inconnu de l’homme, le monde n’est là que pour le séparer de Lui. Pour Simon le Mage, le seul moyen pour l’homme de briser l’illusion du monde et d’atteindre à la plénitude est de vivre librement ses désirs. Le désir, sous toutes ses formes, est la seule part divine qui réside en l’être humain. Il y apparaît sous sa forme physique — par le sang et la semence — et sous sa forme psychique, par ce feu, cette étincelle déposée par Dieu. C’est donc en le développant, en l’intensifiant, en l’exprimant totalement, que l’homme aura des chances de retourner à son origine. L’union des âmes et des corps, voilà pour Simon la gnose et la voie du salut. Lui-même pratiquait l’une et l’autre avec application.
Il parcourait les routes de Samarie et d’Anatolie en compagnie d’une femme du nom d’Hélène, ancienne prostituée découverte dans un bouge de Tyr et qui était, selon lui, la sagesse suprême descendue du ciel, sur la terre. Des disciples ne tardèrent pas à se former autour du couple, vivant en union libre et pratiquant probablement des exercices ascétiques qui leur conférèrent certains pouvoirs. Les Actes des Apôtres mentionnent les « prodiges » que le couple opérait. Les légendes qui circulèrent par la suite sur la mort de Simon le Mage attestent elles aussi la fascination ambiguë exercée par ce personnage — mage ou sage, on ne sait — : il se serait élevé vers le ciel et aurait chu à la suite d’une intervention de l’apôtre Pierre, jaloux de ses pouvoirs.
Mais c’est surtout au siècle suivant, au second siècle donc, que le gnosticisme connut son plein épanouissement. De nombreux maîtres prêchèrent à Alexandrie et les sectes y connurent une floraison inespérée, Basilide, Valentin, Carpocrate sont les trois plus connus d’entre eux. Ils prêchaient et écrivaient en grec et recrutèrent, parmi les milieux hellénisés de la ville, un nombre important de disciples.
Ce qui les caractérise, c’est avant tout leur immense érudition. Ils possèdent à fond les philosophes grecs, la Bible, les auteurs orientaux, les textes hermétiques. Pour eux, l’histoire de l’humanité est celle des errances de l’homme, c’est une histoire de ténèbres, un devenir aveugle où seuls quelques illuminés perçurent la vérité et l’existence du Dieu caché. C’est pourquoi ils empruntèrent indifféremment aux philosophes grecs comme Platon, Pythagore, Aristote, à des figures mythiques comme Orphée, Prométhée, Hermès ou Seth, à tel ou tel texte d’auteur hermétiste, les éléments de leur vision du monde.
Cette vision s’exprime à travers les mythes étonnants que nous avons décrits mais avec un tel luxe de détails, une telle foule d’Eons, d’archontes, d’entités sublunaires, supralunaires, cosmiques et hypercosmiques que leur cosmologie apparaît comme une tragédie fantastique et complexe qui aboutit à la naissance prématurée, involontaire de l’homme. Certains auteurs chrétiens se sont gaussés à juste titre du caractère confus, parfois inextricable, de leurs spéculations. Mais derrière ces constructions savantes perce une exigence profonde, un désir intense de saisir, jusque dans ses rouages les plus ténus, le mécanisme de l’erreur primordiale, les raisons de la solitude et de l’angoisse humaines.
Les trois états de l’homme
Et leur implication est nette : il faut briser les lois du monde, refuser de collaborer au devenir d’une matière corrompue, d’un temps vicié dans sa substance, d’un espace contaminé par la présence du faux Dieu. Il faut violer toutes les lois du monde, stopper l’engrenage fatal, démanteler l’édifice organique et mental de l’homme, pour le réveiller de son inertie asphyxiante, de ce sommeil de l’âme au sein duquel il est plongé depuis son origine. Bref, pour reprendre une expression connue, pratiquer un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens, mener, en tous domaines, une contre-vie.
Pour Valentin, les étapes de cette libération passent par trois stades. Le premier est celui de l’homme matériel, l’homme hylique, attaché aux plaisirs et aux biens de ce monde, qui vit dans l’inconscience et dont la seule issue possible est le néant. Rivé à la terre, faute d’avoir acquis en ce monde la conscience de son véritable état, il y retournera inéluctablement à sa mort.
Le second, c’est celui de l’homme psychique, qui, par la voie des philosophies, de certaines religions comme le christianisme, et d’une ascèse appropriée s’est dégagé partiellement de la gangue corporelle. Il a acquis un principe pensant, une psyché mais faute de posséder la gnose, il demeure étranger à la vérité. Cet état est celui des Chrétiens, notamment, dont l’âme, après la mort, sera contrainte d’errer dans les espaces sublunaires, loin du vrai Dieu.
L’ultime état, c’est celui que seul peut obtenir la gnose, celui de l’homme pneumatique, c’est-à-dire détenteur de l’esprit, du pneuma divin. Il est alors totalement affranchi de tous les liens avec la matière de ce monde, car selon les propres termes de Valentin, il a « tué en lui la mort» et il « est devenu un être indestructible ».
Cette sotériologie rend un son familier. Ces principes, les Gnostiques ne furent pas les seuls à les proclamer et l’on peut retrouver, dans le tantrisme indien, notamment, une attitude très proche. Mais ce qui caractérise l’attitude gnostique et lui confère un sens très particulier, ce sont les méthodes, les techniques libératrices que certains ont prônées pour parvenir à l’état pneumatique. Car le problème est simple et il exige, pour être résolu, un peu de logique et beaucoup de courage. Pour échapper au mal, l’ascèse est. une voie possible mais elle n’est pas la seule.
La voie la plus radicale consiste justement, pour dominer le mal, à en épuiser la substance, à le pratiquer systématiquement pour rendre aux maîtres de ce monde, le tribut qui leur est dû et s’affranchir ainsi de leur tutelle. Idée singulière mais qui repose sur un principe logique, celui d’une ascèse homéopathique : lutter contre le mal avec ses propres armes.
Carpocrate, un gnostique d’Alexandrie, enseigne donc que la libération de l’homme ne peut se faire qu’en violant systématiquement toutes les lois de ce monde. La première, c’est la loi de division, de séparation, de fragmentation qui émiette et multiplie les supports matériels du mal. Il faut vivre en communauté, créer une conscience collective contre l’ennemi commun. La seconde, c’est l’attachement aux biens du monde, l’appropriation de ses richesses qui fragmentent l’unité première et perpétuent l’injustice. Il faut donc refuser la propriété, pratiquer la communauté des biens. La troisième, ce sont les institutions scandaleuses et aliénatrices du mariage, de la famille, de l’Etat, des églises, qui consolident la fragmentation, pétrifient le libre échange, la libre communion des corps et des âmes. Il faut donc pratiquer l’union libre et la communauté des femmes. La dernière enfin — et la plus redoutable — ce sont les interdits qui pèsent sur le sexe — le conditionnement de l’amour, la prohibition de la sodomie, de l’inceste, l’incitation à la procréation qui, toutes, détournent le désir de sa vraie voie. On pratiquera donc l’inceste, la sodomie, le coïtus interruptus pour éviter la fécondation et, en cas « d’accident », l’avortement.
Une orgie gnostique
De tous les enseignements gnostiques, c’est évidemment ce dernier domaine qui devait
provoquer, chez les Chrétiens, la fureur et la consternation. Cette incitation à l’union libre, ce « viol » du mariage, ce refus de l’amour en tant que sentiment et cette exaltation de l’éros en tant que feu divin, bref, cette révolution totale pratiquée sur et par le sexe, devaient conférer à certains gnostiques une réputation qui ne les quittera plus et dont on perçoit aujourd’hui encore, l’écho horrifié dans les ouvrages contemporains. Un certain nombre d’auteurs chrétiens ont apporté en tout cas sur ces pratiques singulières, ces « orgies » scandaleuses, un témoignage assez précis pour qu’on ne puisse douter de leur réalité. L’un d’eux surtout, saint Epiphane, venu à Alexandrie au IV° siècle pour suivre l’enseignement des maîtres chrétiens, tomba, selon ses propres dires, dans les filets d’une secte gnostique. Il nous transmit , ainsi le seul témoignage de visu de ces rites « licencieux », dont il sortit si horrifié qu’il s’empressa d’aller dénoncer la secte à l’évêque d’Alexandrie.
Que vit exactement Epiphane ? « Quand ils se sont bien repus et se sont, si je puis dire. rempli les veines d’un surplus de puissance, ils passent à la débauche. L’homme quitte sa place à côté de sa femme et dit, à celle-ci : « Lève-toi et accomplis l’agapè (l’union d’amour)
avec le frère ». Les malheureux se mettent alors à forniquer tous ensemble… Une fois qu’ils se sont unis, comme si ce crime de prostitution ne leur suffisait pas, ils élèvent vers le ciel leur propre ignominie : l’homme et la femme recueillent dans leur main le sperme de l’homme, s’avancent les yeux au ciel et. leur ignominie dans les mains, l’offrent au Père en disant : « Nous t’offrons ce don, le corps du Christ ». Puis ils mangent et communient avec leur propre sperme. Ils font exactement de même avec les menstrues de la femme. Ils recueillent le sang de son impureté et y communient de la même manière. Mais tout en pratiquant ces promiscuités, ils enseignent qu’il ne faut pas procréer d’enfants. C’est par pure volupté qu’ils pratiquent ces actes honteux. »
Les Gnostiques en question, toutefois, ne s’arrêtent pas en si bon chemin. Au cours de ces orgies, des « accidents » sont inévitables. Que se passe-t-il alors ? « Lorsque l’un d’eux a par erreur laissé sa semence pénétrer trop avant et que la femme tombe enceinte, écoutez les horreurs qu’ils commettent. Ils extirpent l’embryon dès qu’ils peuvent le saisir avec les doigts, prennent cet avorton, le pilent dans une sorte de mortier, y mélangent du miel, du poivre, et différents condiments ainsi que des huiles parfumées pour conjurer le dégoût puis ils se réunissent et chacun communie de ses doigts avec cette pâtée d’avorton en terminant par cette prière : « Nous n’avons pas permis à l’Archonte de la volupté de se jouer de nous mais nous avons recueilli l’erreur du frère ». Voilà, à leurs yeux la Pâque parfaite. Mais ils pratiquent encore d’autres abominations. Lorsque, dans leurs réunions, ils entrent en extase, ils barbouillent leurs mains avec la honte de leur sperme, l’étendent partout, et les mains ainsi souillées et le corps entièrement nu, ils prient pour obtenir, par cette action, le libre accès auprès de Dieu ».
Une étrange initiation
C’est là évidemment un mode de prière assez. peu usité. On comprend qu’il ait pu horrifier les Chrétiens mais il mérite tout de même, de notre part, une réflexion., plus objective. Ce qu’ignore saint Epiphane ou qu’il feint d’ignorer, c’est le sens profond ou second de ces pratiques, dont certaines tournaient peut-être à l’orgie pure et simple, mais qui ne sont jamais que l’illustration révélatrice par son excès même de l’attitude gnostique devant l’enfer du monde. Derrière cette exaltation forcenée du désir érotique, se profilent les mythes, les archétypes qui les justifient et les fondent. Et on retrouve cette propension typiquement gnostique à inverser toutes les valeurs de ce monde, à vivre une contre-vie, à fonder une contre-histoire en exaltant tes grands rebelles.
D’autres sectes, qui vécurent à la même époque et qui s’appelaient les Ophites, les Pérates, les Séthiens, pratiquaient le culte du Serpent. Ils élevaient un serpent apprivoisé qu’on déposait sur les pains destinés à la communion et qui les consacrait par ce seul contact.
D’autres, les Caïnites, voyaient en Caïn le premier initié qui avait tenté de s’opposer aux commandements du faux Dieu. Ce refus des valeurs et des institutions traditionnelles, certains Gnostiques l’exprimaient parfois sur des terrains moins scandaleux. Les Saccophores, par exemple, allaient vêtus de sacs, le vêtement étant pour eux le signe majeur de l’aliénation sociale. D’autres, les Adamites, se réunissaient nus pour prier. D’autres enfin, les Phibionites, pratiquaient chaque jour l’union sexuelle avec une femme différente. Les Eons dominateurs du monde étant au nombre de 365, d’après leur cosmologie, il fallait rendre à chacun son dû. Au ternie de cette étrange initiation, le postulant devenait un homme pneumatique, désormais délivré de l’emprise de la chair.
On voit que toutes ces voies, aussi surprenantes soient-elles, mènent toutes vers un but unique et émancipateur : tout connaître, tout éprouver, faire l’expérience totale et absolue de tous les possibles. C’est là sans doute une exigence luciférienne. Mais elle devait conduire les Gnostiques au seuil de vérités jusqu’alors ignorées, leur faire franchir les portes de bien des mondes interdits. C’est en cela peut-être que leur attitude et pleur sensibilité demeurent étonnamment modernes. Car ils furent les premiers à entrevoir qu’aucune émancipation réelle n’est possible, aucune révolution véritablement positive, si elle n’est totalement libertaire, si elle ne lève pas d’abord tous les interdits pesant sur l’homme.
Bibliographie sur les Gnostiques
La plupart des textes gnostiques figurent, en tant qu’extraits, dans les oeuvres des Pères de l’Eglise des premiers siècles : saint Justin, saint Irénée, saint Hippolyte de Rome et saint Epiphane de Chypre. Un certain nombre de textes authentiques existent et ont été traduits, depuis un demi-siècle. La plupart d’entre eux sont reproduits dans les ouvrages cités ici :
• Jean Doresse :
Les livres secrets des Gnostiques d’Egypte
Tome 1 – Introduction à la littérature gnostique.
Tome 2 – Les manuscrits de Nag-Hammadi et l’Evangile de Thomas.
(Plon, 1958-1963).
• H. Leisengang
La gnose (Payot, 1951)
• S. Hutin
Les Gnostiques (Que sais-je ? P.U.F. 1963).
• Robert M. Grant :
La gnose et les origines chrétiennes (Le seuil, 1964).
COMPLEMENT:






 Publié par jcdurbant
Publié par jcdurbant 





 L’antisémitisme est le socialisme des imbéciles.
L’antisémitisme est le socialisme des imbéciles. 









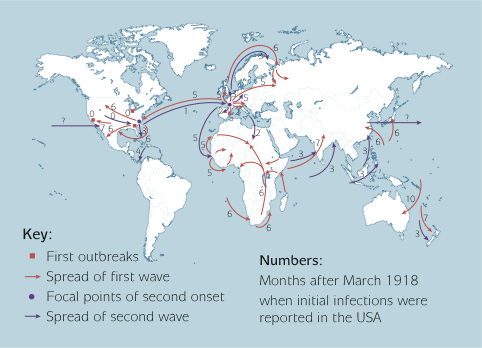



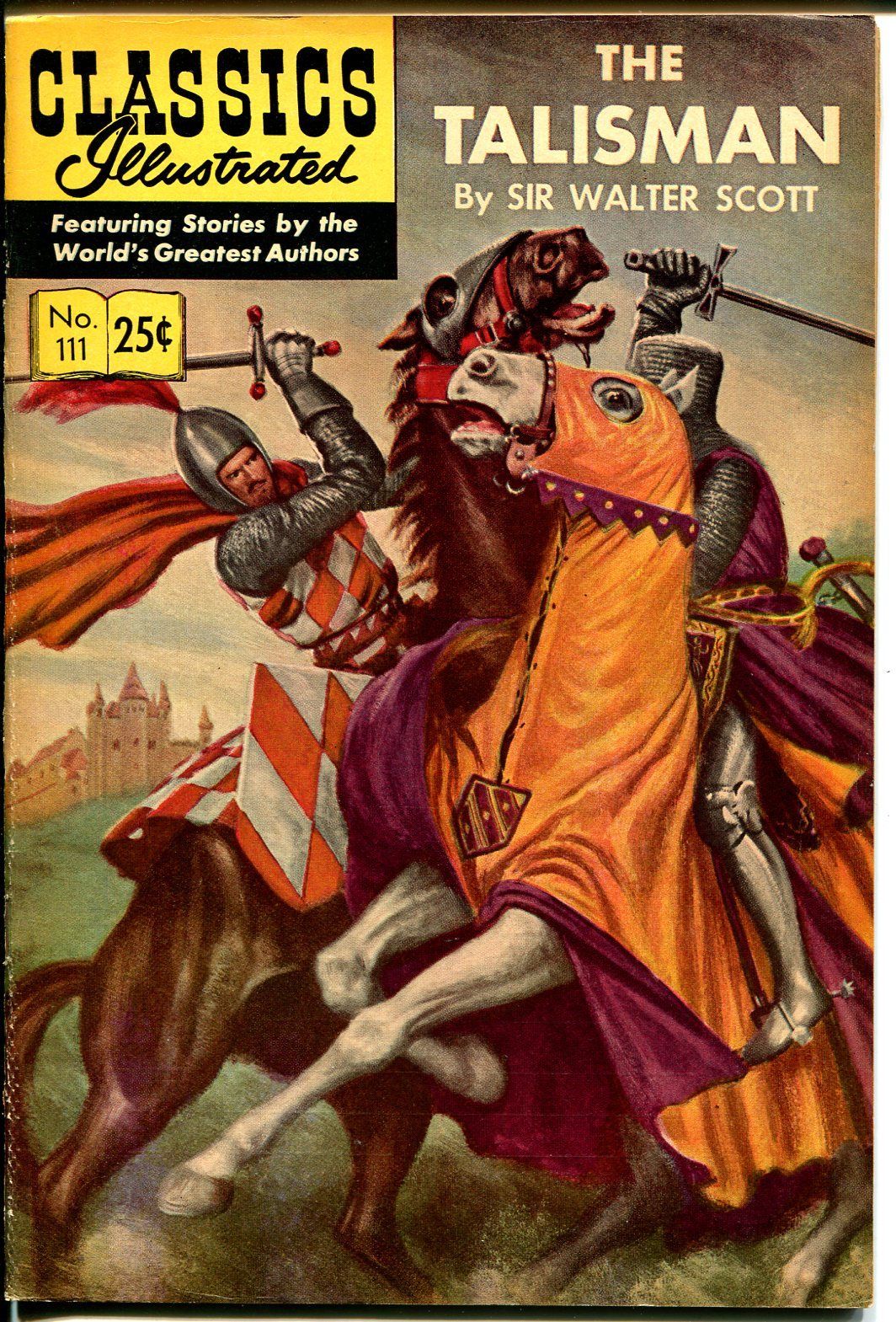

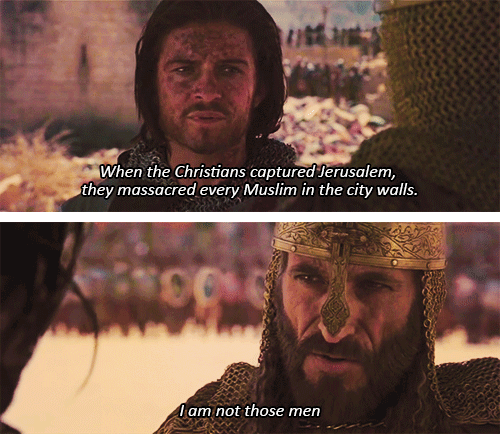 Il nous faut entrer dans une pensée du temps où la bataille de Poitiers et les Croisades sont beaucoup plus proches de nous que la Révolution française et l’industrialisation du Second
Il nous faut entrer dans une pensée du temps où la bataille de Poitiers et les Croisades sont beaucoup plus proches de nous que la Révolution française et l’industrialisation du Second


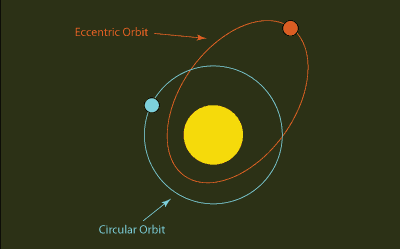
 Toutes les époques sont-elles concernées par la falsification historique ? Toutes les époques sont concernées, mais les raisons de ces maquillages varient selon les dominantes idéologiques. Pour faire court, l’histoire est instrumentalisée, en Occident, depuis les Lumières : encyclopédistes et philosophes tressent une légende noire de l’Église, dont ils combattent le pouvoir. Au XIXe siècle, le roman national, tel que l’enseigne l’école jusqu’aux années 1950, s’inscrit dans une veine républicaine qui glorifie la Révolution et caricature l’“Ancien Régime”. L’après-guerre est dominée, jusqu’à la fin des années 1960, par l’histoire marxiste, ce qui s’explique par l’hégémonie culturelle du Parti communiste.
Toutes les époques sont-elles concernées par la falsification historique ? Toutes les époques sont concernées, mais les raisons de ces maquillages varient selon les dominantes idéologiques. Pour faire court, l’histoire est instrumentalisée, en Occident, depuis les Lumières : encyclopédistes et philosophes tressent une légende noire de l’Église, dont ils combattent le pouvoir. Au XIXe siècle, le roman national, tel que l’enseigne l’école jusqu’aux années 1950, s’inscrit dans une veine républicaine qui glorifie la Révolution et caricature l’“Ancien Régime”. L’après-guerre est dominée, jusqu’à la fin des années 1960, par l’histoire marxiste, ce qui s’explique par l’hégémonie culturelle du Parti communiste.