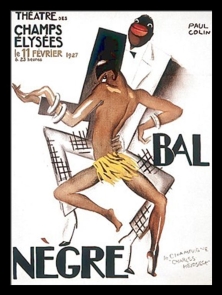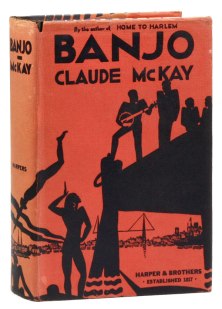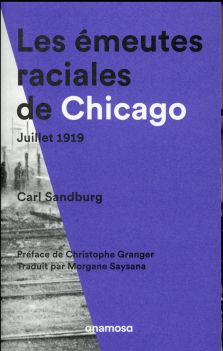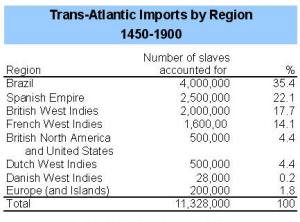Malheur à vous! parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes, que vos pères ont tués. Vous rendez donc témoignage aux oeuvres de vos pères, et vous les approuvez; car eux, ils ont tué les prophètes, et vous, vous bâtissez leurs tombeaux. C’est pourquoi la sagesse de Dieu a dit: Je leur enverrai des prophètes et des apôtres; ils tueront les uns et persécuteront les autres, afin qu’il soit demandé compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été répandu depuis la création du monde, depuis le sang d’Abel jusqu’au sang de Zacharie, tué entre l’autel et le temple … Jésus (Luc 11: 47-51)
L’heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Jésus (Jean 16: 2)
Beat me, hate me
You can never break me
Will me, thrill me
You can never kill me
Jew me, sue me
Everybody do me
Kick me, kike me
Don’t you black or white me
All I wanna say is that
They don’t really care about us … Michael Jackson
J’ai une prémonition qui ne me quittera pas: ce qui adviendra d’Israël sera notre sort à tous. Si Israël devait périr, l’holocauste fondrait sur nous. Eric Hoffer
D’abord ils sont venus (…) pour les Juifs, mais je n’ai rien dit parce que je n’étais pas juif … Martin Niemöller
Si Israël est un occupant dans son pays, le christianisme, qui tire sa légitimité de l’histoire d’Israël, l’est aussi comme le serait tout autre État infidèle. Bat Ye’or
Le canari (…) fut longtemps élevé dans les mines où il était utilisé pour détecter le grisou. L’appareil respiratoire de l’oiseau étant fragile, le canari cessait de chanter et mourait dès l’apparition de ce gaz. Daniele
L’employé juif d’un coiffeur parisien va voir son patron et lui dit : « Patron, je dois démissionner ». « Mais pourquoi donc ? » lui répond le patron. « Parce que tous vos employés sont antisémites ! » « Allons bon, mon cher Jean-Claude. Je suis sûr que ce n’est pas vrai. Qu’est ce qui vous fait penser cela ? » « C’est simple, patron. Lorsque je leur dit qu’Hitler a voulu tuer tous les juifs et les coiffeurs… » Le patron l’interrompt : « Mais Jean-Claude, pourquoi les coiffeurs ? » « Vous voyez patron, vous aussi ! » Blague juive
Tuez les Juifs partout où vous les trouverez. Cela plaît à Dieu, à l’histoire et à la religion. Cela sauve votre honneur. Dieu est avec vous. (…) [L]es Allemands n’ont jamais causé de tort à aucun musulman, et ils combattent à nouveau contre notre ennemi commun […]. Mais surtout, ils ont définitivement résolu le problème juif. Ces liens, notamment ce dernier point, font que notre amitié avec l’Allemagne n’a rien de provisoire ou de conditionnel, mais est permanente et durable, fondée sur un intérêt commun. Haj Amin al-Husseini (moufti de Jérusalem, discours sur Radio Berlin, le 1er mars 1944)
Israël existe et continuera à exister jusqu’à ce que l’islam l’abroge comme il a abrogé ce qui l’a précédé. Hasan al-Bannâ (préambule de la charte du Hamas, 1988)
Les enfants de la nation du Hezbollah au Liban sont en confrontation avec [leurs ennemis] afin d’atteindre les objectifs suivants : un retrait israélien définitif du Liban comme premier pas vers la destruction totale d’Israël et la libération de la Sainte Jérusalem de la souillure de l’occupation … Charte du Hezbollah (1985)
La libération de la Palestine a pour but de “purifier” le pays de toute présence sioniste. Charte de l’OLP (article 15, 1964)
Depuis les premiers jours de l’islam, le monde musulman a toujours dû affronter des problèmes issus de complots juifs. (…) Leurs intrigues ont continué jusqu’à aujourd’hui et ils continuent à en ourdir de nouvelles. Sayd Qutb (membre des Frères musulmans, Notre combat contre les Juifs)
Nous vous bénissons, nous bénissons les Mourabitoun (hommes) et les Mourabitat (femmes). Nous saluons toutes gouttes de sang versées à Jérusalem. C’est du sang pur, du sang propre, du sang qui mène à Dieu. Avec l’aide de Dieu, chaque djihadiste (shaheed) sera au paradis, et chaque blessé sera récompensé. Nous ne leur permettrons aucune avancée. Dans toutes ses divisions, Al-Aqsa est à nous et l’église du Saint Sépulcre est notre, tout est à nous. Ils n’ont pas le droit de les profaner avec leurs pieds sales, et on ne leur permettra pas non plus. Mahmoud Abbas
Enveloppés dans leurs châles de prières, quatre fidèles s’effondrent sous les coups des tueurs opérant à visage découvert, qui seront ensuite tués par deux policiers israéliens accourus sur place. Trois des victimes israéliennes étaient également de nationalité américaine, la quatrième avait aussi la nationalité britannique. Huit fidèles ont été par ailleurs blessés, dont un se trouvait hier dans un état critique tandis que trois autres étaient sérieusement atteints. Les terroristes, des cousins âgés d’une vingtaine d’années, venaient du quartier arabe de Jabal Moukaber, à Jérusalem-Est (annexée). Ils sont parvenus jusqu’à la synagogue sans rencontrer la moindre difficulté. Les 270 000 Arabes de la Ville sainte, sur un total de 800 000 habitants, peuvent en effet circuler librement en Israël. À Gaza, des tirs de joie ont éclaté et le Hamas a salué « un acte héroïque ». Mais, à Ramallah (Cisjordanie), le président palestinien Mahmoud Abbas a vivement condamné cet attentat « visant des civils, dans un lieu sanctifié ». Dans la foulée, il a aussi dénoncé « les attaques contre Al-Aqsa et les mosquées ». Le secrétaire d’État américain, John Kerry, s’est indigné contre l’attaque. « Ce matin à Jérusalem, des Palestiniens ont attaqué des juifs qui priaient dans une synagogue. Des gens venus prier Dieu dans le sanctuaire d’une synagogue (…) ont été assassinés dans ce qui constitue un acte de pure terreur, d’une brutalité insensée », a fustigé le chef de la diplomatie américaine. Invoquant l’intensification de la colonisation israélienne et les provocations de juifs radicaux à l’Esplanade des mosquées (troisième lieu saint de l’islam), appelé le Mont du Temple (de Salomon) par les juifs, les Palestiniens multiplient les manifestations et les attaques depuis l’été dernier. La Croix (19 novembre 2014)
Si vous pouvez tuer un incroyant américain ou européen – en particulier les méchants et sales Français – ou un Australien ou un Canadien, ou tout […] citoyen des pays qui sont entrés dans une coalition contre l’État islamique, alors comptez sur Allah et tuez-le de n’importe quelle manière. (…) Tuez le mécréant qu’il soit civil ou militaire. (…) Frappez sa tête avec une pierre, égorgez-le avec un couteau, écrasez-le avec votre voiture, jetez-le d’un lieu en hauteur, étranglez-le ou empoisonnez-le. Abou Mohammed al-Adnani (porte-parole de l’EI)
Toujours viser les endroits fréquentés, tel que les lieux touristiques, les grandes surfaces, les synagogues, les églises, les loges maçonniques, les permanences des partis politiques, les lieux de prêches des apostats, le but étant d’installer la peur dans leur coeur (…) avec n’importe quel moyen qui est à votre disposition, un simple couteau de cuisine ou un autre objet tranchant comme des cutters. Dar al Islam (magazine de l’Etat islamique, mars 2016)
Il est remarquable que dans son ensemble la presse française n’ait jamais fait le parallèle entre les attentats djihadistes dont le pays souffre depuis les crimes perpétrés par Mohamed Merah en 2012 et ceux qu’endurent les Israéliens depuis bien des années. L’idée qu’il s’agit d’un combat commun contre la barbarie ne semble pas avoir effleuré la cervelle de nos journalistes patentés, fidèles lecteurs des communiqués de l’Agence France Presse. Le préjugé en faveur des Palestiniens est tel que, même lorsque ces derniers se livrent à des attentats délibérément dirigés contre des civils tels que les bombes, les « kamikazes », dans les autobus ou les cafés, et plus encore lorsque leurs méthodes, comme récemment, sont conformes aux instructions de Daech, à savoir l’attaque indiscriminée au couteau, à la voiture-bélier, etc, les commentaires des médias français se gardent bien de faire le lien avec les attentats en France. Il y aurait pourtant bien des leçons à prendre des Israéliens sur le contre-terrorisme que l’on ne consulte qu’en catimini, par exemple pour la sécurité d’Aéroport de Paris, celui de Ben Gourion étant devenu l’aéroport le plus sûr du monde. Sans remonter au déluge, Israël a fait l’objet de 45 attaques utilisant des véhicules divers depuis septembre 20151. Aucune de ces attaques n’a fait autant de morts et de blessés que celle de Nice. Les attentats au couteau, à l’arme automatique, aux divers « engins-béliers » ont été contrés pour la plupart de manière beaucoup plus efficace qu’en France. Malgré la diversité des procédés employés et leurs effets de surprise, la neutralisation ou la mise en fuite des terroristes a été rapide. En effet, ces derniers se sont heurtés à un peuple préparé à la riposte, reposant sur la présence d’hommes (et de femmes) armés dans la foule : policiers, militaires en service ou en permission, réservistes bénéficiant d’une autorisation de port d’arme. À cela on doit ajouter les contrôles systématiques de tout individu présentant un comportement suspect et la surveillance des réseaux sociaux. Ces réactions et ces précautions ont limité le nombre des victimes d’attentats en ville. Mais elles demeurent insuffisantes à la sécurité des personnes isolées, mitraillées sur une route, ou surprise chez elles, comme ce fut le cas dernièrement à Kiriat Arba (Hébron) d’une fillette de 13 ans, assassinée dans son lit. Mais à ma connaissance, on ne proclame pas en Israël, à la suite de ces meurtres, que le risque zéro n’existe pas, ce qui est vrai, mais ne doit pas servir à diluer les failles des dispositifs défensifs dans un fatalisme compassionnel. Marc Nacht
Les Etats-Unis prendront des mesures pour stopper le terrorisme dans le monde (…) Vous voyez de quoi ils sont capables… Les Etats-Unis devront dorénavant s’impliquer (…) Israël a maintenant l’espoir que le monde nous comprendra. Les Américains sont naïfs et l’Amérique est facile à pénétrer. Il n’y a pas beaucoup de contrôles en Amérique. Et désormais l’Amérique sera plus dure à propos de ceux qui débarquent sur son territoire. Israéliens interrogés par le FBI (septembre 2001)
J’en avais les larmes aux yeux. Ces gars-là plaisantaient et ca m’a dérangé. Pour ces gars-là, c’était comme, ‘maintenant l’Amérique sait ce que nous vivons.’ Urban Moving worker
According to Cannistraro, many people in the U.S. intelligence community believed that some of the men arrested were working for Israeli intelligence. Cannistraro said there was speculation as to whether Urban Moving had been « set up or exploited for the purpose of launching an intelligence operation against radical Islamists in the area, particularly in the New Jersey-New York area. » Under this scenario, the alleged spying operation was not aimed against the United States, but at penetrating or monitoring radical fund-raising and support networks in Muslim communities like Paterson, N.J., which was one of the places where several of the hijackers lived in the months prior to Sept. 11. For the FBI, deciphering the truth from the five Israelis proved to be difficult. One of them, Paul Kurzberg, refused to take a lie-detector test for 10 weeks — then failed it, according to his lawyer. Another of his lawyers told us Kurzberg had been reluctant to take the test because he had once worked for Israeli intelligence in another country. Sources say the Israelis were targeting these fund-raising networks because they were thought to be channeling money to Hamas and Islamic Jihad, groups that are responsible for most of the suicide bombings in Israel. « [The] Israeli government has been very concerned about the activity of radical Islamic groups in the United States that could be a support apparatus to Hamas and Islamic Jihad, » Cannistraro said. The men denied that they had been working for Israeli intelligence out of the New Jersey moving company, and Ram Horvitz, their Israeli attorney, dismissed the allegations as « stupid and ridiculous. » (…) Despite the denials, sources tell ABCNEWS there is still debate within the FBI over whether or not the young men were spies. Many U.S. government officials still believe that some of them were on a mission for Israeli intelligence. But the FBI told ABCNEWS, « To date, this investigation has not identified anybody who in this country had pre-knowledge of the events of 9/11. » Sources also said that even if the men were spies, there is no evidence to conclude they had advance knowledge of the terrorist attacks on Sept. 11. The investigation, at the end of the day, after all the polygraphs, all of the field work, all the cross-checking, the intelligence work, concluded that they probably did not have advance knowledge of 9/11, » Cannistraro noted. As to what they were doing on the van, they say they read about the attack on the Internet, couldn’t see it from their offices and went to the parking lot for a better view. But no one has been able to find a good explanation for why they may have been smiling with the towers of the World Trade Center burning in the background. Both the lawyers for the young men and the Israeli Embassy chalk it up to immature conduct. According to ABCNEWS sources, Israeli and U.S. government officials worked out a deal — and after 71 days, the five Israelis were taken out of jail, put on a plane, and deported back home. While the former detainees refused to answer ABCNEWS’ questions about their detention and what they were doing on Sept. 11, several of the detainees discussed their experience in America on an Israeli talk show after their return home. Said one of the men, denying that they were laughing or happy on the morning of Sept. 11, « The fact of the matter is we are coming from a country that experiences terror daily. Our purpose was to document the event. » ABC News
Sur le Coran de La Mecque, je vais attaquer une église. Adel Kermiche
Vers 9h25, deux hommes porteurs d’armes blanches ont surgi dans l’église de Saint-Etienne-du-Rouvray. Ils ont pris en otages six personnes, le prêtre, trois religieuses et un couple de paroissiens. L’une des religieuses est parvenue à prendre la fuite et à donner l’alerte. La brigade d’intervention (BRI) et une brigade anti-criminalité arrivées sur place ont tenté d’entamer une négociation avec les terroristes. Les policiers ont ensuite tenté une incursion, sans succès. Peu après, trois otages – les deux religieuses et une paroissienne – sont sortis de l’église suivis par les deux terroristes criant « Allah Akbar », dont l’un portait une arme de poing. Les deux assaillants ont été tués par la BRI. Selon le témoignage d’une religieuse parvenue à s’enfuir, les terroristes se sont « enregistrés » au moment du crime, l’un a fait « un peu comme un sermon autour de l’autel en arabe » avant l’assassinat du prêtre. Le Figaro
For many Israelis, the horrifying images of a truck plowing through crowds for more than a mile in the French resort town of Nice struck a macabrely familiar chord. (…) Nice was an even more direct, if far deadlier, echo of a 2011 rampage in which an Arab-Israeli man’s truck barreled down a Tel Aviv street for a mile, killing one and wounding 17. These followed a spate of attacks with heavy construction vehicles and cars as weapons in 2008. And since October, according to Shin Bet, Israel’s domestic security agency, at least 32 Palestinians have rammed vehicles into people at bus stops, intersections and military checkpoints. The French prime minister said after the Nice attack, the nation’s third mass killing in 18 months, that France “must live with terrorism.” That is what Israelis have been doing for decades, through the plane hijackings of the 1970s; the suicide bombers of the second intifada, or Palestinian uprising, which began in 2000; and the lone-wolf stabbings and shootings of the past 10 months. In Israel, ordinary citizens, security officials and experts feel they have seen it all and say they have adapted to a perennial, if ever-changing, threat. They speak of constantly staying alert, exercising caution and growing accustomed to what some may find to be intrusive levels of security, but essentially carrying on. (…) That routine includes opening bags for a check and passing through metal detectors at train or bus stations, shopping malls and movie complexes. At the height of the suicide bombings, customers paid a small surcharge at cafes and restaurants to subsidize the cost of a guard at the door. Hundreds of armed civilian guards have been deployed to protect public transportation in Jerusalem in recent months amid the wave of attacks, which have been glorified by some Palestinians on social media. The guards stand at bus and light-rail stops, and hop on and off buses along main routes, with the same powers to search and arrest as the police. Israel has also invested hugely in intelligence, its tactics evolving as its enemies change theirs. Several psychological studies in Israel have found that people habituate quickly to threats, making adjustments to daily life — keeping children at home, for example, rather than sending them to summer camp — and adopting dark humor about the randomness of the threat. (…) Some Israeli politicians have been disparaging about what they view as European negligence in security matters. After the attacks in March in Brussels, for example, a senior minister, Israel Katz, said Belgium would not be able to fight Islamist terrorism “if Belgians continue eating chocolate and enjoying life and looking like great democrats and liberals.” In a radio interview on Sunday, Yaakov Perry, a former Shin Bet chief now in Parliament, recommended deeper intelligence supervision of neighborhoods “where Muslims, refugees, Daesh supporters of various sorts live,” using an Arabic acronym to refer to the Islamic State. He also suggested that the French police were complacent, referring to news reports that the driver in Nice had told officers he was delivering ice cream. “If the driver says he has ice cream, open the truck and check if he has ice cream,” Mr. Perry said. That the attack occurred at a mass gathering for Bastille Day, France’s national holiday, had Israelis shaking their heads. Micky Rosenfeld, an Israeli police spokesman, said that to secure a major event like Independence Day celebrations, when tens of thousands of people gather along the Tel Aviv seafront to watch an air and naval display, officers gather intelligence for weeks beforehand, and erect a 360-degree enclosure of the area, with layers of security around the perimeter. Main roads are typically blocked off with rows of buses, and smaller side streets with patrol cars. In addition to a large uniformed and undercover police presence, counterterrorism teams are strategically placed to provide a rapid response if needed. For intelligence gathering, Shin Bet has used a “basic coverage” method, which involves homing in on a particular neighborhood or population sector that is considered a potential security risk. The agency then builds an intimate system of surveillance and a network of local informers who can point to any sign of suspicious or unusual activity.(…) But several security experts acknowledged that with citizens in a democracy, including Israel’s large Arab minority, these methods of intelligence gathering — “neighbors informing on neighbors,” as one put it — can be difficult to balance with civil liberties. These measures are also less effective, they say, in trying to prevent individual attacks that are not affiliated with any organization and that at times appear to have erupted spontaneously. The NYT
There, is of course, a very important reason why the mainstream media ignores radical Muslim persecution of Christians: if the full magnitude of this phenomenon was ever known, many cornerstones of the mainstream media—most prominent among them, that Israel is oppressive to Palestinians—would immediately crumble. Why? Because radical Muslim persecution of Christians throws a wrench in the media’s otherwise well-oiled narrative that “radical-Muslim-violence-is-a-product-of-Muslim-grievance”—chief among them Israel. Consider it this way: because the Jewish state is stronger than its Muslim neighbors, the media can easily portray Islamic terrorists as frustrated “underdogs” doing whatever they can to achieve “justice.” No matter how many rockets are shot into Tel Aviv by Hamas and Hezbollah, and no matter how anti-Israeli bloodlust is articulated in radical Islamic terms, the media will present such hostility as ironclad proof that Palestinians under Israel are so oppressed that they have no choice but to resort to terrorism. However, if radical Muslims get a free pass when their violence is directed against those stronger than them, how does one rationalize away their violence when it is directed against those weaker than them—in this case, millions of indigenous Christians? The media simply cannot portray radical Muslim persecution of Christians—which in essence and form amount to unprovoked pogroms—as a “land dispute” or a product of “grievance” (if anything, it is the ostracized and persecuted Christian minorities who should have grievances). And because the media cannot articulate radical Islamic attacks on Christians through the “grievance” paradigm that works so well in explaining the Arab-Israeli conflict, their main recourse is not to report on them at all. In short, Christian persecution is the clearest reflection of radical Islamic supremacism. Vastly outnumbered and politically marginalized Christians simply wish to worship in peace, and yet still are they hounded and attacked, their churches burned and destroyed, their women and children enslaved and raped. These Christians are often identical to their Muslim co-citizens, in race, ethnicity, national identity, culture, and language; there is no political dispute, no land dispute. The only problem is that they are Christian and so, Islamists believe according to their scriptural exegesis, must be subjugated. If mainstream media were to report honestly on Christian persecution at the hands of radical Islamists so many bedrocks of the leftist narrative currently dominating political discourse would crumble, first and foremost, the idea that radical Islamic intolerance is a product of “grievances,” and that Israel is responsible for all Jihadist terrorism against it. Raymond Ibrahim
The Maginot Line of “European values” won’t prevail over people who recognize none of those values. So much was made clear by French Prime Minister Manuel Valls, who remarked after the Nice attack that “France is going to have to live with terrorism.” This may have been intended as a statement of fact but it came across as an admission that his government isn’t about to rally the public to a campaign of blood, toil, tears and sweat against ISIS—another premature capitulation in a country that has known them before (…) Then there is Germany, site of three terror attacks in a week. It seems almost like a past epoch that Germans welcomed a million Middle Eastern migrants in an ecstasy of moral self-congratulation, led by Angela Merkel’s chant of “We can do it!” Last summer’s slogan now sounds as dated and hollow as Barack Obama’s “Yes we can!” Now Germany will have to confront a terror threat that will make the Baader-Meinhof gang of the 1970s seem trivial. The German state is stronger and smarter than the French one, but it also surrenders more easily to moral intimidation. The idea of national self-preservation at all costs will always be debatable in a country seeking to expiate an inexpiatable sin. Thus the question of whether Europe is helpless. At its 1980s peak, under François Mitterrand and Helmut Kohl, the European project combined German economic strength and French confidence in power politics. Today, it mixes French political weakness with German moral solipsism. This is a formula for rapid civilizational decline, however many economic or military resources the EU may have at its disposal. Can the decline be stopped? Yes, but that would require a great unlearning of the political mythologies on which modern Europe was built. Among those mythologies: that the European Union is the result of a postwar moral commitment to peace; that Christianity is of merely historical importance to European identity; that there’s no such thing as a military solution; that one’s country isn’t worth fighting for; that honor is atavistic and tolerance is the supreme value. People who believe in nothing, including themselves, will ultimately submit to anything. The alternative is a recognition that Europe’s long peace depended on the presence of American military power, and that the retreat of that power will require Europeans to defend themselves. Europe will also have to figure out how to apply power not symbolically, as it now does, but strategically, in pursuit of difficult objectives. That could start with the destruction of ISIS in Libya. More important, Europeans will have to learn that powerlessness can be as corrupting as power—and much more dangerous. The storm of terror that is descending on Europe will not end in some new politics of inclusion, community outreach, more foreign aid or one of Mrs. Merkel’s diplomatic Rube Goldbergs. It will end in rivers of blood. Theirs or yours? In all this, the best guide to how Europe can find its way to safety is the country it has spent the best part of the last 50 years lecturing and vilifying: Israel. For now, it’s the only country in the West that refuses to risk the safety of its citizens on someone else’s notion of human rights or altar of peace. Europeans will no doubt look to Israel for tactical tips in the battle against terrorism—crowd management techniques and so on—but what they really need to learn from the Jewish state is the moral lesson. Namely, that identity can be a great preserver of liberty, and that free societies cannot survive through progressive accommodations to barbarians. Bret Stephens
Dans une enquête publiée aujourd’hui, Libération accuse le ministre de l’Intérieur d’avoir menti s’agissant de la sécurisation de la Promenade des Anglais le soir du 14 juillet dernier. Riposte immédiate de Bernard Cazeneuve : Libération utilise des «procédés qui empruntent aux ressorts du complotisme» et cherche à l’atteindre «dans sa réputation». Dans un édito en forme de «c’est celui qui dit qui l’est», Johan Hufnagel, directeur délégué de Libération, suggère que c’est Bernard Cazeneuve qui est victime d’«une poussée de complotisme». (…) Ni la presse ni le Gouvernement, cibles de choix des complotistes patentés, ne sortent grandis d’une telle séquence. Morale de l’histoire : cessons de gloser sur le complotisme présumé des uns et des autres à partir de matériaux aussi fragiles. Ne contribuons pas à faire du «complotisme» une étiquette infamante parmi d’autres. Utiliser ce mot de manière aussi peu fondée pour délégitimer un détracteur est en réalité une manière d’œuvrer à sa démonétisation et de rendre, au final, un fier service à tous ceux – vrais imposteurs et autres désinformateurs professionnels – qui prospèrent sur la montée contemporaine du complotisme. Conspiracy watch
Sait-on par exemple que les seules personnes arrêtées le jour même et en relation avec les attaques terroristes du 11-Septembre sont des Israéliens ? L’information a été rapportée dès le lendemain par le journaliste Paulo Lima dans The Record, quotidien du comté de Bergen dans le New Jersey, d’après des sources policières. Immédiatement après le premier impact sur la tour Nord, trois individus furent aperçus par divers témoins sur le toit d’un van stationné à Liberty State Park dans Jersey City, « en train d’exulter » (celebrating), de « sauter de joie » (jumping up and down), et de se photographier avec les tours jumelles en arrière-plan. Ils déplacèrent ensuite leur van sur un autre parking de Jersey City, où d’autres témoins les virent se livrer aux mêmes réjouissances ostentatoires. La police émit aussitôt une alerte BOLO (be-on-the-look-out) : « Véhicule possiblement lié à l’attaque terroriste de New York. Van blanc Chevrolet 2000 avec une plaque du New Jersey et un signe ‘Urban Moving Systems’ à l’arrière, a été vu au Liberty State Park, Jersey City, NJ, au moment du premier impact d’avion de ligne dans le World Trade Center. Trois individus avec le van ont été vus se réjouissant après l’impact initial et l’explosion qui s’en suivit. » Le van fut intercepté par la police quelques heures plus tard, avec à son bord cinq jeunes Israéliens : Sivan et Paul Kurzberg, Yaron Shmuel, Oded Ellner et Omer Marmari. Contraint physiquement de sortir du véhicule et plaqué à terre, le conducteur, Sivan Kurzberg, lança cette phrase étrange : « On est Israéliens. On n’est pas votre problème. Vos problèmes sont nos problèmes. Les Palestiniens sont le problème. » Les sources policières qui informèrent Paulo Lima étaient convaincues de l’implication de ces Israéliens dans les attentats de la matinée : « Il y avait des cartes de la ville dans le van avec certains points surlignés. On aurait dit qu’ils étaient au courant, […] qu’ils savaient ce qui allait se passer lorsqu’ils étaient à Liberty State Park. » On trouva également sur eux des passeports de nationalités diverses, près de 6 000 dollars en espèces et des billets d’avion open pour l’étranger. Les frères Kurzberg furent formellement identifiés comme agents du Mossad. Les cinq Israéliens travaillaient officiellement pour une compagnie de déménagement nommée Urban Moving Systems, dont les employés étaient majoritairement israéliens. « J’étais en pleurs. Ces types blaguaient et ça me perturbait, » révéla au Record un des rares employés non-israéliens. Le 14 septembre, après avoir reçu la visite de la police, le propriétaire de l’entreprise, Dominik Otto Suter, quittait le pays pour Tel-Aviv. L’information divulguée par le Record, confirmée par le rapport de police, a été reprise par des sites d’investigation comme le Wayne Madsen Report (14 septembre 2005) et Counterpunch (7 février 2007). Elle fut aussi rapportée dans quelques grands médias comme mais d’une façon qui minimisait sa portée : le New York Times (21 novembre 2001) omettait de préciser la nationalité des individus, tout comme Fox News et l’agence Associated Press. Le Washington Post (23 novembre 2001) disait bien qu’ils étaient Israéliens, mais passa sous silence leur apparente préconnaissance de l’événement. En revanche, The Forward (15 mars 2002), magazine de la communauté juive new-yorkaise, révéla, d’après une source anonyme du renseignement états-unien, qu’Urban Moving Systems était une antenne sous couverture du Mossad (ce qui ne l’empécha pas de bénéficier d’un prêt fédéral de 498 750 dollars, comme le révèlent les archives du fisc. Le FBI diligenta sur cette affaire une enquête consignée dans un rapport de 579 pages, partiellement déclassifié en 2005 (il le sera totalement en 2035). Le journaliste indépendant Hicham Hamza a analysé ce rapport en détail dans son livre : Israël et le le 11-Septembre : le Grand Tabou. Il en ressort plusieurs éléments accablants. Tout d’abord, les photos prises par ces jeunes Israéliens les montrent effectivement dans des attitudes de célébration devant la tour Nord en feu : « Ils souriaient, ils s’embrassaient et ils se tapaient mutuellement dans les mains. » Pour expliquer cette attitude, les intéressés dirent qu’ils s’étaient simplement réjoui « que les États-Unis auraient maintenant à prendre des mesures pour arrêter le terrorisme dans le monde » (alors que, à ce point, une majorité de gens pensait à un accident plutôt qu’à un acte terroriste). Plus grâve, un témoin au moins les a vus positionnés dès 8 heures, soit avant qu’un avion ne percute la première tour, tandis que d’autres certifient qu’ils prenaient déjà des photos cinq minutes après, ce que confirment leurs photos. Un ancien employé confirma au FBI l’ambiance fanatiquement pro-israélienne et anti-américaine qui régnait dans l’entreprise, prêtant même à son directeur Dominik Otto Suter ces paroles : « Donnez-nous vingt ans et nous nous emparerons de vos médias et détruirons votre pays. » Les cinq Israéliens arrêtés étaient en contact avec une autre entreprise de déménagement dénommée Classic International Movers, dont quatre employés avaient été interrogés indépendamment pour leur liens avec les dix-neufs pirates de l’air présumés. L’un d’eux avait téléphoné à « un individu en Amérique du Sud possédant des liens authentiques avec les militants islamiques au Moyen Orient. » Enfin, « un chien renifleur donna un résultat positif pour la présence de traces d’explosifs dans le véhicule. » Comme le remarque Hamza, la conclusion du rapport laisse sonjeur : le FBI informe la police locale, qui détient les suspects, « que le FBI n’a plus aucun intérêt à enquêter sur les détenus et qu’il convient d’entamer les procédures d’immigration appropriées. » Une lettre du Service fédéral de l’immigration et de la naturalisation prouve qu’en fait la direction du FBI avait recommandé la clôture de l’enquête dès le 24 septembre 2001. Les cinq Israéliens passèrent cependant 71 jours dans une prison de Brooklyn, au cours desquels ils refusèrent puis échouèrent plusieurs fois au détecteur de mensonge. Puis ils furent rapatriés sous la simple charge de visa violations. On doit, pour finir, évoquer un détail essentiel de cette affaire, qui apporte peut-être une explication supplémentaire au comportement exhubérant de ces jeunes Isréaliens : certains témoins précisent, dans leurs appels à la police, que les individus se réjouissant sur le toit de leur van semblaient « arabes » ou « Palestiniens ». En particulier, peu après l’effondrement des tours, un appel anonyme à la police de Jersey City, rapporté le jour même par NBC News, signale « un van blanc, avec deux ou trois types à l’intérieur, ils ressemblent à des Palestiniens et ils tournent autour d’un bâtiment » ; l’un d’eux « mélange des choses et il a cet uniforme ‘sheikh’. […] Il est habillé comme un arabe. » Tout porte à croire que ces individus étaient précisément les cinq Israéliens arrêtés plus tard. Deux hypothèses viennent à l’esprit : ou bien nos faux déménageurs se sont effectivement livrés à une mise en scène pour apparaître comme arabes/Palestiniens, ou bien le ou les témoins les ayant décrits comme tels étaient des complices. Dans un cas comme dans l’autre, il ressort que leur but était d’initier la rumeur médiatique qu’on avait repéré des musulmans qui non seulement se réjouissaient des attentats, mais en avaient préconnaissance. L’information fut effectivement diffusée sur certaines radios dès midi, et sur NBC News dans l’après-midi. Je penche personnellement pour la seconde hypothèse (les informateurs complices plutôt que de vrais déguisement arabes), car le rapport de police ne signale pas de vêtement exotique trouvé dans le van, mais surtout parce que l’informateur cité plus haut, qui insiste sur ce détail vestimentaire, semble avoir voulu induire en erreur la police sur la localisation exacte du van ; ce dernier ne fut intercepté que parce que la police, au lieu de se contenter de cette localisation, barra tous les ponts et souterrains entre New Jersey et New York. Mais l’important est ceci : Si les Israéliens n’avaient pas été interpelés en fin d’après-midi, l’histoire aurait probablement fait la une des journaux sous le titre : The Dancing Arabs. Au lieu de ça, elle fut totalement étouffée et ne circula que confidentiellement, sous le titre the dancing Israelis, ou the highfivers. Laurent Guyenot (Réseau Voltaire)
1/ Des résidus explosifs ont été retrouvés dans le fourgon des cinq Israéliens (1-7). Un chien affecté à la détection de bombes a également réagi lors de la fouille du véhicule (5-44).
2/ Les trois Israéliens aperçus -avant et après l’impact du second avion- en train de se filmer et de se photographier, avec la première tour embrasée en arrière-plan, étaient joviaux (1-35, 1-65). 76 photos en noir et blanc ont été développées par les enquêteurs (1-80).
3/ La présence de leur véhicule sur le lieu des réjouissances est attestée par deux témoins vers 8h/8h15 du matin, ce mardi 11 septembre 2001, soit une demi-heure environ avant le crash du premier avion dans la Tour Nord (6-42, 5-25). Les trois Israéliens concernés affirmeront aux enquêteurs n’avoir débarqué qu’aux alentours de 9h -juste avant l’impact du second avion-et seulement après avoir appris l’information du premier crash sur Internet. Vers 9h20, soit une quinzaine de minutes après le crash du second avion, le van blanc aura déjà quitté les lieux.
4/ Un autre témoin raconte les avoir vus en action 5 mn après l’impact du premier avion (5-25). Les photos développées confirment qu’ils étaient déjà sur place : la fumée –visible sur leurs images- vient à peine de s’échapper de la Tour Nord (5-62).
5/ Plusieurs témoins ont rapporté avoir constaté l’usage d’une caméra vidéo qui n’aurait pas été retrouvée lors de l’arrestation des Israéliens (6-45). Ceux-ci ont démenti avoir eu recours à un tel appareil. Le FBI évoque pourtant une « tromperie » (5-56). Sur ce point crucial comme sur la question de leur emploi du temps, les enquêteurs ont déjà noté de nombreuses contradictions dans leurs témoignages (6-43).
6/ Lors de leur arrestation musclée et arme au poing, les policiers ont retrouvé des cartes d’étudiant falsifiées, aucun équipement relatif à leur activité de déménageur (5-45), un passeport allemand, près de 6000 dollars en cash ainsi que des billets d’avion pour un départ ouvert et immédiat à destination de l’étranger (5-44).
7/ Interrogés sur leur perception des attentats, les Israéliens ont tenu des propos très politiques : « Les Etats-Unis prendront des mesures pour stopper le terrorisme dans le monde » (5-86), « Vous voyez de quoi ils sont capables…Les Etats-Unis devront dorénavant s’impliquer » (5-20), « Israël a maintenant l’espoir que le monde nous comprendra. Les Américains sont naïfs et l’Amérique est facile à pénétrer. Il n’y a pas beaucoup de contrôles en Amérique. Et désormais l’Amérique sera plus dure à propos de ceux qui débarquent sur son territoire »
8/ Les enquêteurs du FBI ont appris de la part d’un ancien salarié de l’entreprise de déménagement que le dirigeant -nommé Dominic Suter et considéré depuis comme un fugitif (90-1)- avait un profond mépris pour les Etats-Unis ( 5-42). Un anti-américanisme partagé par ses employés israéliens dont l’un aurait jadis déclaré cette phrase stupéfiante : « Donnez-nous vingt ans et nous nous emparerons de vos médias et détruirons votre pays » (1-37).
9/ Le FBI a constaté dans son enquête plusieurs éléments troublants : la petite compagnie de déménagement disposait d’une quinzaine d’ordinateurs –soit un nombre disproportionné par rapport à la taille de l’entreprise (1-47) ; le personnel était essentiellement composé d’Israéliens, de Russes et d’Hongrois qui pratiquaient une forme de discrimination dans leurs réunions à l’encontre des employés non-Juifs (5-41) ; un des cinq détenus israéliens s’était fait passer pour un « ouvrier de chantier » le 10 septembre 2001 aux abords de l’endroit où il sera présent le lendemain lors de la capture photographique des tours embrasées (5-46) ; le chauffeur du van blanc était capable, selon un employé égyptien d’une station d’essence qui fut interrogé par le FBI, de s’exprimer en arabe (5-31).
10/ Pour conclure, une attention particulière mérite d’être consacrée à ces quatre extraits étonnants : les cinq employés d’Urban Moving Systems étaient en contact avec d’autres déménageurs israéliens exerçant pour une compagnie basée également dans le New Jersey et dénommée Classic International Movers. Chose étrange : le FBI a interrogé quatre de ses employés -tous issus de l’armée israélienne- en raison de leur lien avéré avec un des dix-neuf pirates de l’air présumés (1-39).
L’un d’entre eux sera visiblement mal à l’aise durant l’interrogatoire (6-47).
Un des cinq Israéliens disposa également du contact téléphonique d’un homme vivant en Amérique du Sud et lié aux « militants islamiques du Moyen-Orient » (6-40).
Les enquêteurs du FBI ont remarqué un fait qualifié de « bizarre » : un van appartenant à la compagnie Urban Moving Systems s’était dirigé -hors de son secteur régulier- le matin du 11 septembre 2001 en direction du site du crash du vol 93 (1-36).
Enfin, l’un des cinq Israéliens a exprimé, de retour ce matin-là dans l’entreprise, une phrase curieuse à la suite de la chute de la première tour : « Ils vont abattre le second bâtiment ». Interrogé sur le sens des mots employés, il s’est contenté d’affirmer aux enquêteurs qu’il avait d’abord envisagé que l’effondrement de la Tour Sud était une démolition contrôlée par les autorités afin d’éviter des dégâts colossaux (3-64).
Chacun pourra tirer ses propres déductions de cette sélection nécessairement parcellaire. Prochainement, Oumma continuera de soulever le voile en revenant notamment sur l’histoire de ce réseau américain d’espions israéliens dont la mission, en 2000/2001, aurait été uniquement de surveiller les cellules islamistes. En outre, nous aborderons également l’un des aspects les plus méconnus du 11-Septembre : l’existence de liens privilégiés entre les autorités de Tel Aviv et plusieurs responsables du World Trade Center. D’ici là, nous vous invitons à interpréter comme bon vous semblera cet autre passage issu du rapport sur les cinq Israéliens.
En date du 24 septembre 2001, soit 13 jours à peine après leur arrestation, le QG du FBI avait déjà transmis à l’antenne locale chargée de l’enquête -officiellement achevée en 2003- cette « recommandation » (5-59) : « Le FBI n’a plus aucun intérêt à enquêter sur les détenus ». Rapport du FBI (Extraits)
Les Afro-Américains ont toujours su qu’un petit peu de paranoïa ne pouvait pas nous faire de mal. Cynthia McKinney
J’aurai probablement des problèmes pour ce que je viens de vous dire ce soir, confie-t-elle un soir d’été de l’année 2003, devant un parterre de fidèles de l’Eglise baptiste abyssinienne de Harlem. Mais ce ne sera pas la première fois que j’aurai des problèmes pour avoir dit la vérité. Et je continuerai à dire la vérité. Comme je l’ai déjà dit auparavant, je ne m’assiérai pas et je ne me tairai pas. Cynthia McKinney
Ce qui s’est passé au Rwanda n’est pas un génocide planifié par les Hutu. C’est un changement de régime. Un coup d’Etat terroriste perpétré par Kagame avec l’aide de forces étrangères. Cynthia McKinney
Le lobby sioniste dresse sa tête hideuse dans bien trop de facettes de la vie de ce pays, en particulier dans la vie politique (…) les sionistes ont réussi à me mettre à la porte du Congrès à deux reprises. Cynthia McKinney
Les Juifs ont acheté tout le monde. Bill McKinney (ancien représentant, père et plus proche conseiller politique de Cynthia McKinney)
L’occupation israélienne doit finir, y compris au Congrès. Raeed Tayeh (plume de Cynthia McKinney)
Le même photographe israélien prend en photo les tragédies de Nice et Munich. Quelle en était la probabilité ? Vous souvenez-vous des Israéliens qui dansent ? … Cynthia McKinney
McKinney professe un internationalisme consistant, pour l’essentiel, à accuser le gouvernement de son pays et l’Etat d’Israël d’être à l’origine de tous les maux de la planète. A contrario, elle excelle à prendre la défense des régimes les plus liberticides, pourvus qu’ils « résistent à l’Empire ». Ainsi McKinney n’hésite-t-elle pas à chanter les louanges du régime de Robert Mugabe au Zimbabwe ou à exalter la « résistance » du Hamas et du Hezbollah. Concernant le génocide rwandais, l’ancienne membre du Congrès américain partage les thèses très controversées d’un Pierre Péan ou d’un Charles Onana (…) Pour elle, « ce qui s’est passé au Rwanda n’est pas un génocide planifié par les Hutu. C’est un changement de régime. Un coup d’Etat terroriste perpétré par Kagame avec l’aide de forces étrangères ». McKinney a également relayé sans scrupule la théorie du complot selon laquelle les Etats-Unis dissimulerait au monde l’existence d’immenses réserves de pétrole au large des côtes d’Haïti, une richesse qu’ils convoiteraient depuis des décennies, privant ainsi scandaleusement le peuple haïtien de ses ressources naturelles. (…) Se comparant souvent à Rosa Parks, Cynthia McKinney se voit elle-même en martyr de la liberté d’expression, en pasionaria de la Vérité (…) le politologue Michael Barkun classe Cynthia McKinney parmi ces « rebelles de la politique » dont les outrances s’inscrivent dans une stratégie du dérapage n’ayant d’autre fin que de faire parler d’eux. En 2002, quelques mois après ses premières philippiques conspirationnistes sur le 11-Septembre, elle perd le siège qu’elle occupait à la Chambre des représentants depuis 1993 à l’occasion d’une primaire démocrate. La candidate malheureuse explique sa défaite par l’hostilité des « médias » à son encontre. Son père, l’ancien représentant Bill McKinney, qui est aussi le plus proche conseiller politique de Cynthia, fait valoir une toute autre interprétation : la veille du scrutin, interrogé sur l’un des soutiens de sa fille, il incrimine « les Juifs [qui] ont acheté tout le monde », avant d’épeler chacune des lettres du mot « Jews » pour s’assurer que chacun comprenne clairement ce qu’il est en train de dire. Une déclaration que Cynthia McKinney n’a jamais cru devoir désavouer. Les violentes diatribes anti-israéliennes dans lesquelles se lance Cynthia McKinney lui valent une popularité réelle au sein de la communauté arabo-musulmane américaine, particulièrement sensible à la cause palestinienne. En 2002, le Washington Post révèle ainsi que les trois-quarts des fonds levés par McKinney pour sa campagne proviennent de donateurs issus de la communauté musulmane ne résidant même pas dans le 4ème district de l’Etat de Géorgie dans lequel elle se présentait. (…) McKinney retrouve momentanément son siège de représentante de l’Etat de Géorgie en 2004 mais le perd à nouveau aux primaires démocrates d’août 2006, un scrutin marqué par la révélation de la présence, au sein de l’équipe chargée de sa sécurité et jusque dans son QG de campagne, de membres du New Black Panther Party, organisation suprématiste noir ouvertement antisémite (…) formation dissidente du Black Panther Party historique. (…) Pour McKinney, l’explication de cette seconde défaite tient en deux mots : « lobby sioniste ». (…) La décennie 2000-2010 l’a vu passer du respectable Parti démocrate – dont elle claqua la porte en 2007 – aux marges les plus nauséabondes de la scène politique américaine. Parallèlement à la fondation de son propre mouvement, « Dignity », sur le modèle de celui créé en Grande-Bretagne par son ami George Galloway, elle n’a eu de cesse de resserrer ses liens avec cette nébuleuse parfois qualifiée de « rouge-brune » où se croisent, se rencontrent et se mêlent militants pro-palestiniens radicaux, activistes islamistes, suprématistes noirs et racistes d’extrême droite. Le Southern Poverty Law Center (…) a consacré un article à Cynthia McKinney, soulignant ses flirts poussés avec le petit monde des négationnistes. (…) McKinney est l’une des personnalités phares du 9/11 Truth Movement ; elle fréquente des antisémites notoires qui pensent que tous les maux de ce monde prennent leur source dans une vaste conspiration judéo-maçonnique ourdie depuis des siècles ; elle explique ses échecs électoraux par le pouvoir « impitoyable » du « lobby sioniste » ; elle considère que Barack Obama aspire à « créer un Etat policier » aux Etats-Unis (…)… Mais n’allez surtout pas dire à Cynthia McKinney qu’elle est une conspirationniste : elle croira que vous faites partie d’un complot visant à la discréditer. Conspiracy watch
Le 17 septembre 2001, la chaîne libanaise du Hezbollah ouvre son journal avec un scoop qu’elle attribue au journal jordanien Al-Watan, lui-même informé par « des sources diplomatiques arabes » : 4 000 Juifs ne sont pas venus travailler au World Trade Center, avertis par le Mossad de l’imminence d’une attaque menée par des agents israéliens. Dans les jours qui suivent, des dizaines de journaux arabes ou musulmans, à Londres, au Caire, à Téhéran, à Damas, à Riyad, rapportent l’affaire des 4 000 Juifs manquants. Le 19 septembre 2001, en direct sur Al-Jazira, le présentateur vedette Faycal Al-Qassem avance qu’« aucun des 4 000 Juifs travaillant au WTC n’est venu travailler le 11 septembre ». La chaîne qatarie est potentiellement regardée par quarante millions de téléspectateurs. Al-Qassem sera suspendu quelques semaines par sa hiérarchie. Le 21 septembre, la Pravda russe emboîte le pas, sous la signature d’Irina Malenko, reprenant pratiquement mot pour mot les « révélations » d’Al-Manar. (…) Le chiffre de 4 000 Juifs est totalement imaginaire. Personne ne peut dire avec certitude combien de Juifs travaillaient dans les tours, dans la mesure où, fort heureusement, personne ne tenait de registre des Juifs du World Trade Center. Pour savoir combien sont morts dans les tours, on en est réduit à compter les noms à consonance juive parmi les patronymes des victimes. Ils sont nombreux, entre trois et quatre cents : Adler, Aron, Berger, Bernstein, Cohen, Eichler, Eisenberg, etc. La folie de certains esprits oblige à dresser des listes, une pratique de sinistre mémoire. Alors pourquoi précisément ce chiffre ? On en trouve trace dans une interview donnée par un diplomate israélien en poste à New York le matin des attentats. Celui-ci déclarait que ses services avaient reçu 4 000 appels téléphoniques d’Israéliens, inquiets pour leurs proches, citoyens israéliens vivant ou travaillant à Manhattan. Comment cette brève s’est métamorphosée en la théorie d’Al-Manar que l’on sait ? Insondables sont les mystères de l’imagination lorsqu’elle est en proie à la paranoïa, au dogmatisme et à la bêtise. Sans doute aussi les journalistes de la chaîne libanaise n’ont-ils vu que peu d’inconvénients à prendre des libertés avec la déontologie. Al-Manar TV est en effet la propriété d’un groupe en bonne place sur la liste des organisations terroristes du département d’État américain : le Hezbollah, le « parti de Dieu » télécommandé par l’Iran. Après avoir révélé le scoop prouvant l’implication du Mossad, le présentateur avait avancé un argument supplémentaire : « Les seuls à profiter de cet acte de terrorisme sont les Juifs ». Autrement dit : à qui profite le crime ? (…) Mahmud Bakri, le représentant officiel d’Al-Manar dans la capitale égyptienne (…) n’est pas directement à l’origine de l’information délirante sur les Juifs du WTC, puisqu’elle venait du siège de Beyrouth, mais il continue d’en défendre la véracité. (…) Pour preuve, il se livre à un jeu de questions-réponses : « Pourquoi pas le Mossad ? S’agit-il d’un simple accident normal effectué par de jeunes Arabes ou s’agit-il d’un complot ? Car il faut lier ces événements avec leur suite, la guerre contre le terrorisme et la destruction de pays arabes musulmans, dans le cadre d’un plan américain qui vise à servir les intérêts israéliens en premier lieu. Et si en plus on voit qu’il y a un soutien américain à Israël hors du commun, on peut arriver à la conclusion que le 11 septembre était un complot israélien ». Argument classique des aficionados du complot, à Paris comme au Caire, qui consiste à inverser les faits et les conséquences, au nom du non moins classique « à qui profite le crime ? ». Conspiracy watch
Vous souvenez-vous des Israéliens dansants ?
Devinez sur qui, pour éviter de voir l’évidence qui désormais crève les yeux, courent les rumeurs les plus folles …
Pour Nice comme pour les autres attentats depuis ceux de Charlie hebdo …
Ou même depuis le 11 septembre avec sans compter ceux qui – à 300 ou 400 près – avaient été « prévenus » …
Les fameux «Israéliens dansants» …
Coupables de s’être réjouits un peu tôt qu’Israël allait avoir «maintenant l’espoir que le monde nous comprendra» ?
Une ex-membre du Congrès prétend qu’Israël est derrière les massacres européens
Cynthia McKinney a posté le lien d’une vidéo « prouvant » qu’Israël est responsable des attaques de Nice et Munich, car un photographe allemand aurait assisté aux deux drames et est marié à une ancien députée de la Knesset
25 juillet 2016
Une ancienne membre du Congrès des États-Unis a affirmé sur Twitter qu’un photographe israélien avait été sur place pour les massacres à Nice et Munich, prouvant qu’Israël avait un lien avec ces deux attaques.
Cynthia McKinney, une démocrate et ancienne membre de la Chambre des représentants de la Géorgie, a posté une vidéo sur Twitter avec le message : « le même photographe israélien prend en photo les tragédies de Nice et Munich. Quelle en était la probabilité ? Vous souvenez-vous des Israéliens qui dansent ? … »
La vidéo affirme que Richard Gutjahr, un journaliste allemand marié à une ancienne membre de la Knesset, l’Israélienne Einat Wilf, était présent à la fois sur les lieux du saccage par un chauffeur de camion à Nice, en France, au début du mois qui a fait 84 morts, et lors d’une fusillade dans un centre commercial à Munich, où neuf adolescents ont été tués.
Le profil Twitter de Gutjahr montre qu’il a posté des photos de Nice, mais pas de Munich. Il n’aurait pas pris la nationalité israélienne.
« Les Israéliens qui dansent » se réfère à une théorie du complot largement discréditée alléguant que cinq hommes israéliens ont été arrêtés dans le New Jersey, le 11 septembre 2001, après avoir été vus célébrant l’attaque terroriste.
Dans un tweet antérieur, McKinney avait demandé « pourquoi étaient-ils en train de danser dans le parc alors que les Américains étaient en train de mourir ? Pourquoi étaient-ils dans le parc en premier lieu ? »
McKinney, qui a été à la Chambre des représentants de la Géorgie de 1992 à 2002, a été connue pendant son mandat pour faire des remarques incendiaires et a été accusée d’antisémitisme par le passé. En 2002, elle a perdu la primaire démocrate, un jour après que son père soit apparu à la télévision disant que les « Juifs ont acheté tout le monde … J-E-W-S ».
Dans son message original, McKinney a posté un lien vers une vidéo intitulée « Richard Gutjahr le photographe allemand à Nice et à Munich – Connexions israéliennes » postée par une chaîne YouTube qui semble se spécialiser dans les théories du complot et les sentiments antisémites.
Dans la vidéo, dont la séquence d’ouverture est un symbole des Illuminati, le narrateur semble se demander comment « ils » pourraient être « tellement négligeants » qu’ils ont envoyé Gutjahr sur les deux attaques.
« Le fait que ce gars-là se trouvait aux deux endroits, il n’y a aucun moyen que ce soit une coïncidence », allègue l’homme, ajoutant qu’il est « clair à 100 % que les empreintes digitales d’Israël sont sur tous ces événements ».
)
Cette conclusion est fondée sur une vérification joyeuse de la page Wikipedia de Wilf qui confirme qu’elle est Israélienne et a servi dans une unité de renseignement supérieur dans l’armée israélienne.
« Nice est une opération déguisée et Munich est soit une opération déguisée, soit un canular », dit l’homme, qui n’apparaît pas dans la vidéo.
Voir aussi:
Attentats: ce que l’on pourrait apprendre d’Israël
Après Nice…
Marc Nacht
Psychanalyste et écrivain.
Causeur
19 juillet 2016
Il est remarquable que dans son ensemble la presse française n’ait jamais fait le parallèle entre les attentats djihadistes dont le pays souffre depuis les crimes perpétrés par Mohamed Merah en 2012 et ceux qu’endurent les Israéliens depuis bien des années. L’idée qu’il s’agit d’un combat commun contre la barbarie ne semble pas avoir effleuré la cervelle de nos journalistes patentés, fidèles lecteurs des communiqués de l’Agence France Presse.
Le préjugé en faveur des Palestiniens est tel que, même lorsque ces derniers se livrent à des attentats délibérément dirigés contre des civils tels que les bombes, les « kamikazes », dans les autobus ou les cafés, et plus encore lorsque leurs méthodes, comme récemment, sont conformes aux instructions de Daech, à savoir l’attaque indiscriminée au couteau, à la voiture-bélier, etc, les commentaires des médias français se gardent bien de faire le lien avec les attentats en France.
Il y aurait pourtant bien des leçons à prendre des Israéliens sur le contre-terrorisme que l’on ne consulte qu’en catimini, par exemple pour la sécurité d’Aéroport de Paris, celui de Ben Gourion étant devenu l’aéroport le plus sûr du monde.
Sans remonter au déluge, Israël a fait l’objet de 45 attaques utilisant des véhicules divers depuis septembre 20151. Aucune de ces attaques n’a fait autant de morts et de blessés que celle de Nice. Les attentats au couteau, à l’arme automatique, aux divers « engins-béliers » ont été contrés pour la plupart de manière beaucoup plus efficace qu’en France. Malgré la diversité des procédés employés et leurs effets de surprise, la neutralisation ou la mise en fuite des terroristes a été rapide.
En effet, ces derniers se sont heurtés à un peuple préparé à la riposte, reposant sur la présence d’hommes (et de femmes) armés dans la foule : policiers, militaires en service ou en permission, réservistes bénéficiant d’une autorisation de port d’arme. À cela on doit ajouter les contrôles systématiques de tout individu présentant un comportement suspect et la surveillance des réseaux sociaux. Ces réactions et ces précautions ont limité le nombre des victimes d’attentats en ville.
Mais elles demeurent insuffisantes à la sécurité des personnes isolées, mitraillées sur une route, ou surprise chez elles, comme ce fut le cas dernièrement à Kiriat Arba (Hébron) d’une fillette de 13 ans, assassinée dans son lit. Mais à ma connaissance, on ne proclame pas en Israël, à la suite de ces meurtres, que le risque zéro n’existe pas, ce qui est vrai, mais ne doit pas servir à diluer les failles des dispositifs défensifs dans un fatalisme compassionnel.
La résilience pour les survivants et les témoins proches des attaques terroristes est fonction des soins qui leur sont apportés très rapidement dans le cadre d’une médecine de guerre. La prévention des syndromes post-traumatiques fait l’objet de techniques nouvelles dont la dureté s’avère nécessaire pour permettre aux victimes de sortir d’un état souvent quasi autistique.
Voir également:
Ex-candidate du Green Party aux présidentielles américaines de 2008, Cynthia McKinney est aussi une figure incontournable du 9/11 Truth Movement. Peu connue en France, cette militante de 55 ans a pourtant une réputation sulfureuse outre-Atlantique. Elle a été récemment épinglée par le Southern Poverty Law Center pour son flirt poussé avec les milieux négationnistes.
9 octobre 2009. Le maire du 2ème Arrondissement de Paris accueille dans ses murs une conférence de presse de Cynthia McKinney. Rien d’exceptionnel à ce qu’un élu vert parisien reçoive la candidate du Green Party aux dernières élections présidentielles américaines. Comme son homologue héxagonal, le Green Party est signataire de la Charte des Verts mondiaux et partage ses préoccupations écologiques. Pourtant, Cynthia McKinney ne s’est pas attardée sur la protection de l’environnement ou le réchauffement climatique. Ce jour-là, cette ex-membre du Congrès est venue parler… du 11-Septembre. C’est d’ailleurs à l’initiative privée d’Alix Dreux-Boucard, alias AtMOH, fondateur et animateur du site conspirationniste ReOpen911, que la conférence a été organisée.
Certes, en matière de conspirationnisme, McKinney est loin d’en être à son premier coup d’essai. Chris Suellentrop, du magazine en ligne Slate.com, constatait en 2002 que « sur les dix années qu’elle a passées au Congrès, il est difficile d’en trouver une seule où elle ne s’est pas livré à des accusations bizarres ou à de folles théories du complot ». Nourrissant une défiance quasi-paranoïaque à l’égard des autorités fédérales, McKinney est par exemple persuadée que le programme Cointelpro (acronyme d’un programme du FBI mis en œuvre entre 1956 et 1971) est toujours en vigueur et qu’il ne serait pas étranger aux assassinats de JFK, Martin Luther King, Bob Kennedy ou du chanteur de rap Tupac Shakur. Elle a même commencé une thèse sur le sujet.
Il y a deux ans, en pleine campagne présidentielle, à Oakland, le fief historique des Black Panthers, McKinney cite des « témoignages » – anonymes, cela va sans dire – selon lesquels l’armée américaine aurait profité de la confusion régnant durant l’ouragan Katrina pour assassiner d’une balle dans la tête pas moins de 5 000 prisonniers avant de se débarrasser de leurs cadavres dans un marais de Louisiane… Des propos qui portent un grave coup à la crédibilité du Green Party et expliquent, peut-être, le pourcentage dérisoire des suffrages qui se sont portés sur la candidature McKinney : 0,12%. Un score très inférieur à celui de Ralph Nader. Inférieur également aux scores des deux autres « petits » candidats, Bob Barr et Chuck Baldwin.
« Un peu de paranoïa ne peut pas nous faire de mal »
McKinney professe un internationalisme consistant, pour l’essentiel, à accuser le gouvernement de son pays et l’Etat d’Israël d’être à l’origine de tous les maux de la planète. A contrario, elle excelle à prendre la défense des régimes les plus liberticides, pourvus qu’ils « résistent à l’Empire ». Ainsi McKinney n’hésite-t-elle pas à chanter les louanges du régime de Robert Mugabe au Zimbabwe ou à exalter la « résistance » du Hamas et du Hezbollah. Concernant le génocide rwandais, l’ancienne membre du Congrès américain partage les thèses très controversées d’un Pierre Péan ou d’un Charles Onana, dont elle a préfacé, l’année dernière, un livre intitulé : Ces tueurs tutsi au cœur de la tragédie congolaise. Pour elle, « ce qui s’est passé au Rwanda n’est pas un génocide planifié par les Hutu. C’est un changement de régime. Un coup d’Etat terroriste perpétré par Kagame avec l’aide de forces étrangères ».
McKinney a également relayé sans scrupule la théorie du complot selon laquelle les Etats-Unis dissimulerait au monde l’existence d’immenses réserves de pétrole au large des côtes d’Haïti, une richesse qu’ils convoiteraient depuis des décennies, privant ainsi scandaleusement le peuple haïtien de ses ressources naturelles. Cette intox a été propagée sur internet à partir d’une interview de deux conférenciers haïtiens, Ginette et Daniel Mathurin . Sans surprise, McKinney s’appuie sur les prétendues « recherches » de ce couple de scientifiques – dont aucun n’a la moindre qualification en matière de prospection pétrolière – dans un article mis en ligne récemment sur le site du Green Party, et dont ReOpen911 a gracieusement assuré la traduction en français.
McKinney assume. « Les Afro-Américains ont toujours su, a-t-elle un jour répondu à un journaliste du mensuel de gauche The Progressive, qu’un petit peu de paranoïa ne pouvait pas nous faire de mal ». Se comparant souvent à Rosa Parks, Cynthia McKinney se voit elle-même en martyr de la liberté d’expression, en pasionaria de la Vérité : « J’aurai probablement des problèmes pour ce que je viens de vous dire ce soir, confie-t-elle un soir d’été de l’année 2003, devant un parterre de fidèles de l’Eglise baptiste abyssinienne de Harlem. Mais ce ne sera pas la première fois que j’aurai des problèmes pour avoir dit la vérité. Et je continuerai à dire la vérité. Comme je l’ai déjà dit auparavant, je ne m’assiérai pas et je ne me tairai pas ».
« Les sionistes ont réussi à me mettre à la porte du Congrès »
Dans son ouvrage A Culture of Conspiracy: Apocalyptic Visions in Contemporary America (University of California Press, 2003), le politologue Michael Barkun classe Cynthia McKinney parmi ces « rebelles de la politique » dont les outrances s’inscrivent dans une stratégie du dérapage n’ayant d’autre fin que de faire parler d’eux. En 2002, quelques mois après ses premières philippiques conspirationnistes sur le 11-Septembre, elle perd le siège qu’elle occupait à la Chambre des représentants depuis 1993 à l’occasion d’une primaire démocrate. La candidate malheureuse explique sa défaite par l’hostilité des « médias » à son encontre. Son père, l’ancien représentant Bill McKinney, qui est aussi le plus proche conseiller politique de Cynthia, fait valoir une toute autre interprétation : la veille du scrutin, interrogé sur l’un des soutiens de sa fille, il incrimine « les Juifs [qui] ont acheté tout le monde », avant d’épeler chacune des lettres du mot « Jews » pour s’assurer que chacun comprenne clairement ce qu’il est en train de dire. Une déclaration que Cynthia McKinney n’a jamais cru devoir désavouer.
Malaise au sein du Parti démocrate. D’autant plus palpable que quelques mois plus tôt, le porte-plume de Cynthia McKinney, Raeed Tayeh, l’auteur de la plupart de ses discours à l’époque, avait déclaré à la presse que « l’occupation israélienne [devait] finir, y compris au Congrès ». Une déclaration plus qu’ambigüe, qui s’ajoute à la réputation déjà sulfureuse de Cynthia McKinney : dès 1994, la deuxième année de son mandat à la Chambre des représentants, McKinney avait refusé, au nom de la liberté d’expression, de voter une résolution condamnant les propos haineux d’un ténor de la Nation of Islam, Khalid Abdul Muhammad. Peu après, elle était apparue aux côtés du chef de ce mouvement, le prédicateur antisémite Louis Farrakhan, lors d’une conférence organisée à l’Université Howard.
Les violentes diatribes anti-israéliennes dans lesquelles se lance Cynthia McKinney lui valent une popularité réelle au sein de la communauté arabo-musulmane américaine, particulièrement sensible à la cause palestinienne. En 2002, le Washington Post révèle ainsi que les trois-quarts des fonds levés par McKinney pour sa campagne proviennent de donateurs issus de la communauté musulmane ne résidant même pas dans le 4ème district de l’Etat de Géorgie dans lequel elle se présentait.
McKinney retrouve momentanément son siège de représentante de l’Etat de Géorgie en 2004 mais le perd à nouveau aux primaires démocrates d’août 2006, un scrutin marqué par la révélation de la présence, au sein de l’équipe chargée de sa sécurité et jusque dans son QG de campagne, de membres du New Black Panther Party, organisation suprématiste noir ouvertement antisémite dirigé par Malik Zulu Shabazz. Les New Black Panthers sont une formation dissidente du Black Panther Party historique. A l’heure actuelle, leur représentant en France n’est autre que Kémi Séba, le très médiatique fondateur de la Tribu Ka .
Pour McKinney, l’explication de cette seconde défaite tient en deux mots : « lobby sioniste ». Le 14 août dernier, lors d’un dîner organisé par le Council on American-Islamic Relations (CAIR), elle expliquait ainsi que le « le lobby sioniste dresse sa tête hideuse dans bien trop de facettes de la vie de ce pays, en particulier dans la vie politique » (sic) et que « les sionistes [avaient] réussi à [la] mettre à la porte du Congrès à deux reprises » (voir la vidéo).
Descente aux enfers
Le Southern Poverty Law Center (SPLC) est l’une des organisation de défense des droits de l’homme les plus actives outre-Atlantique. Il publie chaque année un rapport sur les groupes extrémistes américains qui fait autorité. A l’hiver 2009, il a consacré un article à Cynthia McKinney, soulignant ses flirts poussés avec le petit monde des négationnistes. L’ancienne élue démocrate a en effet fraternisé publiquement avec plusieurs figures notoires de l’antisémitisme contemporain. Parcourant le monde à l’invitation de l’ancien Premier ministre malaisien Mahathir Mohamad , (« l’un de mes héros » écrit-elle à son propos sur le site du Green Party), elle a également fait l’éloge d’un livre de Matthias Chang sur la crise financière (voir ici ). Matthias Chang recycle ouvertement les écrits du propagandiste nazi américain Eustace Mullins et fût parmi les invités de la conférence négationniste organisée à Téhéran en 2006 à l’instigation du président Ahmadinejad. Cela ne semble pas ébranler McKinney. Tout comme elle n’est nullement gênée de se faire photographier bras dessus bras dessous en compagnie des négationnistes Michele Renouf (elle aussi présente à la conférence iranienne de 2006), Israël Shamir (de son vrai nom : Adam Ermash ; voir ici et là), ou encore du théoricien islamiste David Musa Pidcock (qu’elle affuble du petit nom affectueux de « My London friend »). Ce Britannique est le fondateur de l’Islamic Party of Britain. Son livre, Satanic Voices Ancient & Modern (1992), dénonce une conspiration séculaire impliquant la franc-maçonnerie, la famille Rockefeller, les grandes compagnies pétrolières, le Council on Foreign Relations (CFR), les Illuminati et les « Sionistes Lucifériens ».
Le 30 avril 2009, Cynthia McKinney passe pour la première fois dans une émission de radio diffusée sur internet animée par Ognir alias Noel Ryan. L’émission est consacrée obsessionnellement à la dénonciation des « Juifs sionistes ». Face à McKinney, Ognir explique que Rahm Emanuel, le chef des services administratifs de la Maison Blanche, a une « nationalité juive et une loyauté juive ». Il manipulerait même le président Obama à travers une grande conspiration sioniste internationale. Pendant l’interview, les « sionistes » sont accusés d’encourager le cannabis thérapeutique et le mariage gay dans le seul but d’« affaiblir » la société américaine, de la rendre moins résistante à leurs projets maléfiques. McKinney ne se démarque pas des propos d’Ognir, l’approuvant même lorsqu’il explique que les « sionistes » contrôlent la Maison Blanche et le Congrès et abondant dans son sens en expliquant que des espions « sionistes » ont infiltré sa propre campagne pour le Congrès. Pour McKinney, cette émission de radio n’est pas un dérapage. Elle y retourne un mois plus tard.
En juin 2009, McKinney continue sa descente aux enfers. Elle est reçue à trois reprises dans l’émission de radio de Daryl Bradford Smith (ici, là et encore là). Elle le retrouve de nouveau le 14 janvier 2010, en compagnie d’Ognir cette fois-ci. Daryl Bradford Smith est un autre obsédé du complot juif. Son site web, où l’on trouve des interviews radio de David Pidcock, Israël Shamir et Eustace Mullins ainsi que les signatures de Christopher Bollyn et Eric Hufschmid (voir ici), fait la promotion des Protocoles des Sages de Sion – le célèbre faux antisémite –, du Juif International d’Henry Ford, ou encore de La Synagogue de Satan d’Andrew Carrington Hitchcock. On y trouve même des raretés comme la traduction d’un livre publié dans l’Allemagne hitlérienne sur la pratique du meurtre rituel chez les juifs ou encore un ouvrage de Leslie Fry intitulé La Guerre contre la Royauté du Christ, présentant le communisme comme un « complot judéo-bolchevique contre la Chrétienté »… Bref, la bibliothèque du parfait petit nazillon. La page d’accueil du site est bandée dans toute sa largeur par une phrase en majuscule indiquant : « LE MONDE DOIT DECLARER LA GUERRE A L’ETAT D’ISRAEL ! ».
L’interview avec McKinney prend un tour stupéfiant lorsque Daryl Bradford Smith suggère avec insistance que le Mossad est derrière les attentats du 11-Septembre et se met à citer plusieurs noms juifs – parmi lesquels ceux de Larry Silverstein (le propriétaire des immeubles du World Trade Centrer) et de Ari Fleischer (ancien porte-parole de la Maison Blanche sous Georges W. Bush) – avant de déclarer : « Tous ces gens, en fait, sont une cinquième colonne qui a envahi la structure de contrôle de notre gouvernement. Et ils sont fortement impliqués au Congrès, ils ont un contrôle complet de l’exécutif. Maintenant, comment est-ce que nous pouvons faire pour nous libérer de l’emprise de ce genre de gang criminel ? » Et Cynthia McKinney de répondre : « Eh bien… les gens doivent se lever ! L’une des choses que vous avez dite, je dois le dire, j’ai entendu un discours extraordinaire donné par Lord Levy, qui est, je crois, à la Chambre des Lords britannique. Et le langage qu’il a utilisé était absolument incroyable ! En gros, il a dit que seulement 3% des Israéliens ont voté pour la paix… il a parlé d’Israël comme d’un Etat indéfendable… En étant aux Etats-Unis, nous n’entendons jamais ce genre de discours. C’était un membre juif de la Chambre des Lords qui disait cela ».
« Je ne suis pas une conspirationniste ». C’est ce que Cynthia McKinney a déclaré devant la caméra de John-Paul Lepers lors de son dernier séjour parisien. McKinney est l’une des personnalités phares du 9/11 Truth Movement ; elle fréquente des antisémites notoires qui pensent que tous les maux de ce monde prennent leur source dans une vaste conspiration judéo-maçonnique ourdie depuis des siècles ; elle explique ses échecs électoraux par le pouvoir « impitoyable » du « lobby sioniste » ; elle considère que Barack Obama aspire à « créer un Etat policier » aux Etats-Unis (lire sa dernière déclaration)… Mais n’allez surtout pas dire à Cynthia McKinney qu’elle est une conspirationniste : elle croira que vous faites partie d’un complot visant à la discréditer.
Le rôle d’Israël dans les événements du 11 Septembre 2001 — qui déterminent le 21ème siècle — fait l’objet d’âpres controverses, ou plutôt d’un véritable tabou au sein même du « Mouvement pour la vérité sur le 11-Septembre » (9/11 Truth Movement) provoquant la mise à l’écart de l’homme par qui le scandale arriva, Thierry Meyssan. La plupart des associations militantes, mobilisées derrière le slogan « 9/11 was an Inside Job » (Le 11-Septembre était une opération intérieure), restent discrètes sur les pièces à conviction mettant en cause les services secrets de l’État hébreux. Laurent Guyénot fait le point sur quelques données aussi incontestables que méconnues, et analyse les mécanismes du déni.
Tandis que le rôle d’Israël dans la déstabilisation du monde post-11-Septembre devient de plus en plus évident, l’idée qu’une faction de likoudniks, aidés par leurs alliés infiltrés dans l’appareil d’Etat US, sont responsables de l’opération sous fausse bannière du 11-Septembre devient plus difficile à refouler, et quelques personnalités ont le courage de l’énoncer publiquement. Francesco Cossiga, président d’Italie entre 1985 et 1992, déclara le 30 novembre 2007 au quotidien Corriere della Sera : « On nous fait croire que Ben Laden aurait avoué l’attaque du 11 septembre 2001 sur les deux tours à New York — alors qu’en fait les services secrets américains et européens savent parfaitement que cette attaque désastreuse fut planifiée et exécutée par la CIA et le Mossad, dans le but d’accuser les pays arabes de terrorisme et de pouvoir ainsi attaquer l’Irak et l’Afghanistan [1]. » Alan Sabrosky, ancien professeur du U.S. Army War College et à la U.S. Military Academy, n’hésite pas à clamer sa conviction que le 11-Septembre est « une opération classiquement orchestrée par le Mossad » réalisée avec des complicités au sein du gouvernement états-unien, et sa voix est relayée avec force par quelques sites de vétérans de l’armée U.S., dégoutés par les guerres ignobles qu’on leur a fait faire au nom du mensonge du 11-Septembre ou de celui des armes de destruction massives de Saddam Hussein [2].
Les arguments en faveur de l’hypothèse du Mossad ne tiennent pas seulement à la réputation du service secret le plus puissant du monde, qu’un rapport de la U.S. Army School for Advanced Military Studies (cité par le Washington Times la veille du 11-Septembre), décrit comme : « Sournois. impitoyabe et rusé. Capable de commettre une attaque sur les forces américaines et de les déguiser en un acte commis par les Palestiniens/Arabes [3]. » L’implication du Mossad, associé à d’autres unités d’élite israéliennes, est rendue évidente par un certain nombre de faits peu connus.
- Le livre électronique de Hicham Hamza, Israël et le 11-Septembre : le Grand Tabou (2013) réunit l’ensemble du dossier à charge d’Israël, avec une rigueur irréprochable et l’ensemble des sources aisément accessibles.
Les Israéliens dansants
Sait-on par exemple que les seules personnes arrêtées le jour même et en relation avec les attaques terroristes du 11-Septembre sont des Israéliens [4] ? L’information a été rapportée dès le lendemain par le journaliste Paulo Lima dans The Record, quotidien du comté de Bergen dans le New Jersey, d’après des sources policières. Immédiatement après le premier impact sur la tour Nord, trois individus furent aperçus par divers témoins sur le toit d’un van stationné à Liberty State Park dans Jersey City, « en train d’exulter » (celebrating), de « sauter de joie » (jumping up and down), et de se photographier avec les tours jumelles en arrière-plan. Ils déplacèrent ensuite leur van sur un autre parking de Jersey City, où d’autres témoins les virent se livrer aux mêmes réjouissances ostentatoires. La police émit aussitôt une alerte BOLO (be-on-the-look-out) : « Véhicule possiblement lié à l’attaque terroriste de New York. Van blanc Chevrolet 2000 avec une plaque du New Jersey et un signe ‘Urban Moving Systems’ à l’arrière, a été vu au Liberty State Park, Jersey City, NJ, au moment du premier impact d’avion de ligne dans le World Trade Center. Trois individus avec le van ont été vus se réjouissant après l’impact initial et l’explosion qui s’en suivit [5]. » Le van fut intercepté par la police quelques heures plus tard, avec à son bord cinq jeunes Israéliens : Sivan et Paul Kurzberg, Yaron Shmuel, Oded Ellner et Omer Marmari. Contraint physiquement de sortir du véhicule et plaqué à terre, le conducteur, Sivan Kurzberg, lança cette phrase étrange : « On est Israéliens. On n’est pas votre problème. Vos problèmes sont nos problèmes. Les Palestiniens sont le problème [6]. » Les sources policières qui informèrent Paulo Lima étaient convaincues de l’implication de ces Israéliens dans les attentats de la matinée : « Il y avait des cartes de la ville dans le van avec certains points surlignés. On aurait dit qu’ils étaient au courant, […] qu’ils savaient ce qui allait se passer lorsqu’ils étaient à Liberty State Park [7]. » On trouva également sur eux des passeports de nationalités diverses, près de 6 000 dollars en espèces et des billets d’avion open pour l’étranger. Les frères Kurzberg furent formellement identifiés comme agents du Mossad. Les cinq Israéliens travaillaient officiellement pour une compagnie de déménagement nommée Urban Moving Systems, dont les employés étaient majoritairement israéliens. « J’étais en pleurs. Ces types blaguaient et ça me perturbait [8], » révéla au Record un des rares employés non-israéliens. Le 14 septembre, après avoir reçu la visite de la police, le propriétaire de l’entreprise, Dominik Otto Suter, quittait le pays pour Tel-Aviv.
L’information divulguée par le Record, confirmée par le rapport de police, a été reprise par des sites d’investigation comme le Wayne Madsen Report (14 septembre 2005) et Counterpunch (7 février 2007). Elle fut aussi rapportée dans quelques grands médias comme mais d’une façon qui minimisait sa portée : le New York Times (21 novembre 2001) omettait de préciser la nationalité des individus, tout comme Fox News et l’agence Associated Press. Le Washington Post (23 novembre 2001) disait bien qu’ils étaient Israéliens, mais passa sous silence leur apparente préconnaissance de l’événement. En revanche, The Forward (15 mars 2002), magazine de la communauté juive new-yorkaise, révéla, d’après une source anonyme du renseignement états-unien, qu’Urban Moving Systems était une antenne sous couverture du Mossad (ce qui ne l’empécha pas de bénéficier d’un prêt fédéral de 498 750 dollars, comme le révèlent les archives du fisc [9].
Le FBI diligenta sur cette affaire une enquête consignée dans un rapport de 579 pages, partiellement déclassifié en 2005 (il le sera totalement en 2035). Le journaliste indépendant Hicham Hamza a analysé ce rapport en détail dans son livre : Israël et le le 11-Septembre : le Grand Tabou. Il en ressort plusieurs éléments accablants. Tout d’abord, les photos prises par ces jeunes Israéliens les montrent effectivement dans des attitudes de célébration devant la tour Nord en feu : « Ils souriaient, ils s’embrassaient et ils se tappaient mutuellement dans les mains. » Pour expliquer cette attitude, les intéressés dirent qu’ils s’étaient simplement réjoui « que les États-Unis auraient maintenant à prendre des mesures pour arrêter le terrorisme dans le monde » (alors que, à ce point, une majorité de gens pensait à un accident plutôt qu’à un acte terroriste). Plus grâve, un témoin au moins les a vus positionnés dès 8 heures, soit avant qu’un avion ne percute la première tour, tandis que d’autres certifient qu’ils prenaient déjà des photos cinq minutes après, ce que confirment leurs photos. Un ancien employé confirma au FBI l’ambiance fanatiquement pro-israélienne et anti-américaine qui régnait dans l’entreprise, prêtant même à son directeur Dominik Otto Suter ces paroles : « Donnez-nous vingt ans et nous nous emparerons de vos médias et détruirons votre pays. » Les cinq Israéliens arrêtés étaient en contact avec une autre entreprise de déménagement dénommée Classic International Movers, dont quatre employés avaient été interrogés indépendamment pour leur liens avec les dix-neufs pirates de l’air présumés. L’un d’eux avait téléphoné à « un individu en Amérique du Sud possédant des liens authentiques avec les militants islamiques au Moyen Orient. » Enfin, « un chien renifleur donna un résultat positif pour la présence de traces d’explosifs dans le véhicule [10]. »
Comme le remarque Hamza, la conclusion du rapport laisse sonjeur : le FBI informe la police locale, qui détient les suspects, « que le FBI n’a plus aucun intérêt à enquêter sur les détenus et qu’il convient d’entamer les procédures d’immigration appropriées [11]. » Une lettre du Service fédéral de l’immigration et de la naturalisation prouve qu’en fait la direction du FBI avait recommandé la clôture de l’enquête dès le 24 septembre 2001. Les cinq Israéliens passèrent cependant 71 jours dans une prison de Brooklyn, au cours desquels ils refusèrent puis échouèrent plusieurs fois au détecteur de mensonge. Puis ils furent rapatriés sous la simple charge de visa violations.
Omer Marmari, Oded Ellner et Yaron Shmuel, trois des cinq « Israéliens dansants », sont invités à témoigner dans une émission israélienne dès leur retour en novembre 2001. Niant être membres du Mossad, l’un d’eux déclara candidement : « Notre but était d’enregistrer l’événement. »
On doit, pour finir, évoquer un détail essentiel de cette affaire, qui apporte peut-être une explication supplémentaire au comportement exhubérant de ces jeunes Isréaliens : certains témoins précisent, dans leurs appels à la police, que les individus se réjouissant sur le toit de leur van semblaient « arabes » ou « Palestiniens ». En particulier, peu après l’effondrement des tours, un appel anonyme à la police de Jersey City, rapporté le jour même par NBC News, signale « un van blanc, avec deux ou trois types à l’intérieur, ils ressemblent à des Palestiniens et ils tournent autour d’un bâtiment » ; l’un d’eux « mélange des choses et il a cet uniforme ‘sheikh’. […] Il est habillé comme un arabe [12]. » Tout porte à croire que ces individus étaient précisément les cinq Israéliens arrêtés plus tard. Deux hypothèses viennent à l’esprit : ou bien nos faux déménageurs se sont effectivement livrés à une mise en scène pour apparaître comme arabes/Palestiniens, ou bien le ou les témoins les ayant décrits comme tels étaient des complices. Dans un cas comme dans l’autre, il ressort que leur but était d’initier la rumeur médiatique qu’on avait repéré des musulmans qui non seulement se réjouissaient des attentats, mais en avaient préconnaissance. L’information fut effectivement diffusée sur certaines radios dès midi, et sur NBC News dans l’après-midi. Je penche personnellement pour la seconde hypothèse (les informateurs complices plutôt que de vrais déguisement arabes), car le rapport de police ne signale pas de vêtement exotique trouvé dans le van, mais surtout parce que l’informateur cité plus haut, qui insiste sur ce détail vestimentaire, semble avoir voulu induire en erreur la police sur la localisation exacte du van ; ce dernier ne fut intercepté que parce que la police, au lieu de se contenter de cette localisation, barra tous les ponts et souterrains entre New Jersey et New York. Mais l’important est ceci : Si les Israéliens n’avaient pas été interpelés en fin d’après-midi, l’histoire aurait probablement fait la une des journaux sous le titre : The Dancing Arabs. Au lieu de ça, elle fut totalement étouffée et ne circula que confidentiellement, sous le titre the dancing Israelis, ou the highfivers.
- Ehud Barak, ancien chef du Renseignement militaire israélien (Sayeret Matkal), était premier ministre de juillet 1999 à mars 2001. Remplacé par Ariel Sharon, il s’installe aux États-Unis comme conseiller pour Electronic Data Systems et pour SCP Partners, une compagnie écran du Mossad spécialisée dans les questions de sécurité qui, avec ses partenaires Metallurg Holdings et Advanced Metallurgical, avait la capacité de produire de la nano-thermite. SCP Partners disposait d’un bureau à moins de dix kilomètres d’Urban Moving Systems. Une heure après la désintégration des tours, Ehud Barak est sur le plateau de BBC World pour désigner Ben Laden comme principal suspect(Bollyn, Solving 9-11, p. 278-280).
200 espions experts en explosifs
Peu de gens, même parmi les 9/11 Truthers, connaissent cette histoire d’ « Israéliens dansants » (on attend toujours, par exemple, que l’association Reopen 9/11 en parle sur son site francophone, pourtant très pointus sur tous les autres aspects du dossier). Peu de gens également savent qu’à la date des attentats, les polices fédérales US étaient occupées à démanteler le plus vaste réseau d’espionnage israélien jamais identifié sur le sol états-unien. En mars 2001, le National CounterIntelligence Center (NCIC) avait posté ce message sur son site web : « Durant les dernières six semaines, des employés des bureaux fédéraux situés dans tout les États-Unis ont signalé des activitées suspectes liées à des individus se présentant comme des étudiants étrangers vendant ou livrant des œuvres d’art. » Le NCIC précise que ces individus, de nationalité israélienne, « se sont également rendus aux domiciles privés d’officiers fédéraux sous le prétexte de vendre des objets artistiques [13]. »
Puis dans l’été, la Drug Enforcement Agency (DEA), après avoir été visée par un grand nombre d’incidents de ce type, compila un rapport qui sera révélé au public par le Washington Post le 23 novembre 2001, puis dans Le Monde le 14 mars 2002, avant d’être rendu entièrement accessible par le magazine français Intelligence Online. Ce rapport liste 140 Israéliens appréhendés depuis mars 2001. Âgés entre 20 et 30 ans et organisés en équipes de 4 à 8 membres, ils ont visité au moins « 36 sites sensibles du Département de la Défense ». Nombres d’entre eux furent identifiés comme membres du Mossad ou du Aman (renseignement militaire israélien), et six étaient en possession de téléphones payés par un ancien vice-consul israélien. Soixante arrestations eurent encore lieu après le 11-Septembre, ce qui porte à 200 le nombre d’espions Israéliens arrêtés. Tous furent finalement relâchés.
- Michael Chertoff, citoyen israélien, fils d’un rabbin orthodoxe et d’une pionnière du Mossad, dirigeait la Criminal Division du Department of Justice en 2001, et fut à ce titre responsable de la rétention et destruction de toutes les preuves concernant le 11-Septembre — des caméras du Pentagone aux poutres du World Trade Center. C’est à lui également que les « Israéliens dansants » doivent leur discret rapatriement. En 2003, il fut nommé à la tête du nouveau Department of Homeland Security, chargé du contre-terrorisme sur le territoire états-unien, ce qui lui permet de contrôler la dissidence tout en continuant à restreindre l’accès au dossier du 11-Septembre à travers la loi Sensitive Security Information.
Le rapport de la DEA conclut que « la nature des comportements des individus […] nous conduit à penser que les incidents constituent peut-être une activité de collecte de renseignement [14]. » Mais la nature des renseignements collectés reste inconnue. Il se pourrait qu’en fait l’espionnage n’ait été qu’une couverture secondaire — un sous-vêtement — de ces Israeli art students, si l’on considère les formations militaires reçues par certains comme demolition/explosive ordnance expert, combat engineer, bomb disposal expert, electronic signal intercept operator, selon la DEA. L’un des agents arrêtés, Peer Segalovitz, « a reconnu qu’il était capable de faire exploser des bâtiments, des ponts, des voitures, et tout ce qu’il voulait [15]. » Pourquoi ces agents israéliens auraient-ils fait diversion sur leur véritable mission par une campagne d’espionnage aussi ostentatoire qu’improductive, curieusement concentrée sur la Drug Enforcement Agency ? La réponse à cette question est suggérée par un lien troublant, de nature géographique, entre ce réseau et les attentats du 11-Septembre.
Selon le rapport de la DEA, « La localité d’Hollywood en Floride semble être le point focal de ces individus [16]. » En effet, plus d’une trentaine des faux étudiants-espions israéliens arrêtés peu avant le 11 septembre vivaient dans ou près de la ville d’Hollywood en Floride, où s’étaient précisément regroupés 15 des 19 prétendus pirates de l’air islamistes (9 à Hollywood même, 6 à proximité). L’un d’eux, Hanan Serfaty, par qui transita au moins 100 000 dollars en trois mois, avait loué deux appartements à Hollywood à proximité immédiate de l’appartement et de la boite postale loués par Mohamed Atta, qu’on nous présentera comme le chef de la bande des pirates de l’air. Quels étaient les rapports entre les « espions israéliens » et les « terroristes islamistes » ? Selon l’explication embarrassée des médias alignés, les premiers ne faisaient que surveiller les seconds. Écoutons par exemple David Pujadas introduisant l’article d’Intelligence Online au journal télévisé du 5 mars 2002 sur France 2 : « Toujours à propos d’Israël, mais concernant l’Afghanistan maintenant, cette affaire d’espionnage, qui sème le trouble : un réseau israélien a été démantelé aux États-Unis, notamment en Floride : l’une de ses missions aurait été de pister les hommes d’Al-Qaïda (c’était avant le 11 septembre). Certaines sources vont même plus loin : elles indiquent que le Mossad n’aurait pas livré toutes les informations en sa possession. » Cette explication euphémique est un bel exemple de damage control. Israël en ressort à peine entachée, puisqu’on ne peut raisonnablement blâmer un service d’espionnage de ne pas partager ses informations. Tout au plus Israël pourra-t-il être accusé d’avoir « laissé faire », ce qui lui garantit l’impunité. Ainsi s’explique, à mon avis, la sous-couverture d’espions des faux étudiants israéliens, en réalité experts en attentats sous fausse bannière. En fait, leur couverture volontairement grossière d’étudiants était faite pour attirer l’attention sur leur couverture secondaire, celle d’espions, qui servirait d’alibi à leur proximité avec les pirates supposés.
Pourquoi Pujadas (propulsé au journal télévisé de France 2 tout juste une semaine avant le 11-Septembre) évoque-t-il l’Afghanistan, qui n’a aucun rapport avec l’information qu’il introduit ? Le lapsus ne peut être que volontaire et illustre « le grand tabou » dont parle Hicham Hamza : ne jamais mentionner le 11-Septembre et Israël dans la même phrase.
La vérité est probablement qu’ils n’espionnaient pas ces pirates, mais qu’ils les manipulaient, les finançaient, et probablement les ont éliminés peu avant le 11-Septembre. Un article du New York Times du 18 février 2009 a établi qu’Ali al-Jarrah, cousin d’un pirate présumé du vol UA93, Ziad al-Jarrah, avait été pendant 25 ans espion pour le Mossad, infiltré dans la résistance palestinienne et dans le Hezbollah depuis 1983. Il est actuellement en prison au Liban. Rappelons également que le Mohamed Atta de Floride était un faux. Le vrai Mohamed Atta, qui téléphona à son père au lendemain des attentats (comme ce dernier le confirma au magazine allemand Bild am Sonntag fin 2002), est décrit par sa famille comme réservé, pieux, évitant les femmes et ayant la phobie des avions. Il s’était fait voler son passeport en 1999 alors qu’il étudiait l’architecture à Hambourg. Le faux Mohamed Atta de Floride vivait avec une strip-teaseuse, mangeait du porc, aimait les voitures rapides, les casinos et la cocaïne. Comme l’a rapporté le South Florida Sun-Sentinel dès le 16 septembre (sous le titre « Suspects’ Actions Don’t Add Up » (« Les comportements des suspects ne collent pas »), suivi par de nombreux quotidiens nationaux, ce Atta s’est saoulé, drogué et a payé les services de plusieurs prostituées dans les semaines et les jours précédant le 11-Septembre, et quatre autres des terroristes suicidaires ont eu des comportements similaires peu compatibles avec des islamistes se préparant à la mort [17].
Le réseau new-yorkais
Selon l’agent renégat Victor Ostrovsky (By Way of Deception, 1990), le Mossad tire son efficacité de son réseau international de sayanim (« collaborateurs »), terme hébreu désignant des juifs vivant hors d’Israël et prêts à accomplir sur demande des actions illégales, sans nécessairement connaître leur finalité. Ils se comptent par milliers aux États-Unis, et particulièrement à New York, où se concentre la communauté juive US. Larry Silverstein, titulaire du bail des tours jumelles depuis avril 2001, apparaît comme l’archétype du sayan du 11-Septembre. Il est membre dirigeant de la United Jewish Appeal Federation of Jewish Philanthropies of New York, le plus grand leveur de fonds américains pour Israël (après l’État US, qui verse chaque année trois milliards d’aide à Israël). Silverstein était aussi, au moment des attentats, l’ami intime d’Ariel Sharon et de Benjamin Netanyahou, avec qui il est en conversation téléphonique chaque dimanche, selon le journal israélien Haaretz. Le partenaire de Silverstein dans le bail du WTC était, pour le centre commercial du sous-sol, Frank Lowy, un autre « philanthrope » sioniste proche d’Ehud Barak et Ehud Olmert, ancien membre de la Haganah. Le chef de la New York Port Authority, qui privatisa le WTC en concédant le bail à Silverstein et Lowy, était Lewis Eisenberg, également membre de la United Jewish Appeal Federation et ancien vice-président de l’AIPAC. Silverstein, Lowy et Eisenberg furent sans aucun doute trois hommes clés dans la planification des attentats contre les tours jumelles.
Lucky Larry ! Chaque matin, sans exception, Larry Silverstein prenait son petit-déjeuner au Windows on the World au sommet de la tour Nord du WTC. Jusqu’au matin du 11 septembre, où il avait rendez-vous chez le dermatologue.
D’autres membres du réseau new-yorkais peuvent être identifiés. Selon le rapport du NIST, le Boeing qui s’encastra dans la tour Nord « a fait une entaille de plus de la moitié de la largeur du bâtiment et qui s’étendait du 93ème au 99ème étage. Tous ces étages étaient occupés par Marsh & McLennan, une compagnie d’assurance internationale qui occupait également le 100ème étage [18]. » Le PDG de Marsh & McLennan est alors Jeffrey Greenberg, membre d’une richissime famille juive qui contribua massivement à la campagne de George W. Bush. Les Greenberg étaient aussi les assureurs des tours jumelles et, le 24 juillet 2001, ils avaient pris la précaution de réassurer leur contrat auprès de concurrents, qui durent indemniser Silverstein et Lowy. Et comme le monde des néoconservateurs est petit, en novembre 2000, le conseil d’administration de Marsh & McLennan accueille Paul Bremer, président de la National Commission on Terrorism au moment des attentats, et nommé en 2003 à la la tête de la Coalition Provisional Authority (CPA) en 2003
Paul Bremer intervient le 11 septembre 2001 sur le plateau de NBC, calme et détendu, tandis que 400 employés de sa compagnie sont portés disparus (au final, 295 employés et plus de 60 collaborateurs du groupe seront officiellement dénombrés parmi les victimes).
Des complicités devront aussi être cherchées dans les aéroports et les compagnies aériennes impliquées dans les attentats. Les deux aéroports d’où sont partis les vols AA11, UA175 et UA93 (l’aéroport Logan à Boston et l’aéroport Newark Liberty près de New York) sous-traitaient leur sécurité à la compagnie International Consultants on Targeted Security (ICTS), une firme à capital israélien présidée par Menahem Atzmon, un des trésoriers du Likoud. Une enquête approfondie permettrait certainement de remonter à d’autres complicités. Elle devrait par exemple s’intéresser à Zim Israel Navigational, un géant du transport maritime détenu à 48 % par l’État hébreu (connu pour servir occasionnellement de couverture aux services secrets israéliens), dont l’antenne états-unienne quitta ses bureaux du WTC avec ses 200 employés le 4 septembre 2001, une semaine avant les attentats — « comme par un acte de Dieu [19] », commente le PDG Shaul Cohen-Mintz.
It’s the oil, stupid !
Tous ces faits donnent un sens nouveau aux propos du membre de la Commission sur le 11-Septembre Bob Graham, qui citait dans son interview à PBS en décembre 2002, « des preuves que des gouvernements étrangers ont contribué à faciliter les activités d’au moins certains des terroristes aux États-Unis [20]. » Graham, bien sûr, voulait parler de l’Arabie saoudite. Pourquoi la famille Saoud aurait-elle aidé Oussama Ben Laden, après l’avoir déchu de sa nationalité saoudienne et avoir mis sa tête à prix pour ses attentats sur leur sol ? La réponse de Graham, formulée en juillet 2011, est : « la menace de soulèvements sociaux contre la monarchie, conduits par Al-Qaïda [21]. » Les Saoud auraient aidé Ben Laden sous sa menace de fomenter une révolution. Cette théorie ridicule (que Graham, à court d’argument, développa dans un roman) [22] n’a qu’un seul but : détourner les soupçons loin du seul « gouvernement étranger » dont les liens avec les terroristes présumés sont démontrés, Israël, vers son ennemi l’Arabie Saoudite. On sourit pareillement en lisant, dans le résumé du livre La Guerre d’après (2003) de l’anti-saoudien Laurent Murawiec, que « Le pouvoir royal [saoudien] a réussi au fil des ans à infiltrer des agents d’influence au plus haut niveau de l’administration américaine et à organiser un efficace lobby intellectuel qui contrôle désormais plusieurs universités du pays parmi les plus prestigieuses [23]. »
En affirmant en outre que la piste saoudienne a été étouffée en raison de l’amitié entre les Bush et les Saoud, Graham et ses amis néconservateurs se servent de George W. Bush comme fusible ou paratonnerre. La stratégie paye, puisque le 9/11 Truth movement, dans son ensemble, s’acharne contre lui et renacle à prononcer le nom d’Israël. On reconnaît l’art de Machiavel : faire accomplir le sale boulot par un autre, puis diriger la vindicte populaire contre lui.
- Comme je l’ai montré ailleurs, une dénomination plus appropriée pour les « néo-conservateurs » serait « machiavelo-sionistes ». Michael Ledeen en donne la preuve dans un article de la {Jewish World Review} du 7 juin 1999, où il défend la thèse que Machiavel était « secrètement juif » comme l’étaient à l’époque des milliers de familles nominalement converties au catholicisme sous menace d’expulsion (principalement les Marranes issus de la péninsule ibérique). « Écoutez sa philosophie politique et vous entendrez la musique juive » Par définition, le machiavélisme avance masqué par un discours vertueux (c.a.d. droit-de-l’hommiste), mais un nombre croissant de sionistes s’en réclament ouvertement : un autre exemple avec le livre d’Obadiah Shoher, « Samson Blinded : A Machiavellian Perspective on the Middle East Conflict ».
Le jour où, sous la pression de l’opinion publique, les grands médias seront forcés d’abandonner la thèse officielle, le mouvement constestataire aura déjà été soigneusement infiltré, et le slogan 9/11 is an inside job aura préparé les esprits à un déchaînement contre Bush, Cheney et quelques autres, tandis que les néonconservateurs resteront hors d’atteinte de toute Justice. Et si, par malheur, le jour du grand déballage, les médias sionisés ne parvenaient pas à maintenir Israël hors d’atteinte, l’État hébreu pourra toujours jouer la carte chomskienne : America made me do it. Noam Chomsky [24], qui campe à l’extrême gauche depuis que le trotskiste Irving Kristol virait à l’extrême droite pour former le mouvement néoconservateur, continue en effet d’asséner sans relâche la thèse éculée qu’Israël ne fait qu’exécuter la volonté des États-Unis, dont elle ne serait que le 51ème État et le gendarme au Proche-Orient.
Selon Chomsky et les figures médiatisées de la gauche radicale états-unienne comme Michael Moore, la déstabilisation du Proche-Orient serait la volonté de Washington avant d’être celle de Tel-Aviv. La guerre d’Irak ? Pour le pétrole évidemment : « Bien sûr que c’était les ressources énergétiques de l’Irak. La question ne se pose même pas [25]. » Signe des temps, voilà Chomsky rejoint dans ce refrain par Alan Greenspan, directeur de la Réserve Fédérale, qui dans son livre Le Temps des turbulences (2007) fait mine de concéder « ce que tout le monde sait : l’un des grands enjeux de la guerre d’Irak était le pétrole de la région ».
- « Je crois personnellement qu’il y a une relation profonde entre les événements du 11-Septembre et le pic pétrolier, mais ce n’est pas quelque-chose que je peux prouver, » énonce déjà Richard Heinberg, spécialiste de la déplétion énergétique, dans le documentaire {Oil, Smoke and Mirrors}{.} Autant dire que la thèse relève de la foi irrationnelle.
À cela il faut répondre, avec James Petras (Zionism, Militarism and the Decline of US Power), Stephen Sniegoski (The Transparent Cabal) ou Jonathan Cook (Israel and the Clash of Civilizations) : « Big Oil non seulement n’a pas encouragé l’invasion, mais n’a même pas réussi à contrôler un seul puits de pétrole, malgré la présence de 160 000 soldats états-uniens, 127 000 mercenaires payés par le Pentagone et le Département d’ État, et un gouvernement fantoche corrompu [26] ». Non, le pétrole n’explique pas la guerre en Irak, pas plus qu’il n’explique la guerre en Afghanistan, pas plus qu’il n’explique l’agression de la Syrie par mercenaires interposés, pas plus qu’il n’explique la guerre programmée contre l’Iran. Et ce n’est certainement pas le lobby du pétrole qui a le pouvoir d’imposer le « grand tabou » sur toute la sphère médiatique (de Marianne aux Échos, pour ce qui concerne la France).
La culture israélienne de la terreur sous fausse bannière
Un petit rappel s’impose ici, pour mieux situer le 11-Septembre dans l’histoire. Les Etats-uniens ont une longue pratique dans la fabrication des faux prétextes de guerre. On pourrait remonter à 1845 avec la guerre expansionniste contre le Mexique, déclenchée par des provocations américaines sur la zone contestée de la frontière avec le Texas (la rivière Nueces selon le Mexique, le Rio Grande selon les Texans) jusqu’à ce que des affrontements donnent au président James Polk (un Texan) l’occasion de déclarer que les Mexicains « ont versé le sang américain sur le sol américain. » Après la guerre, un député du nom d’Abraham Lincoln fit reconnaître par le Congrès le caractère mensonger de ce casus belli. Par la suite, toutes les guerres entreprises par les États-Unis l’ont été sous de faux prétextes : l’explosion du USS Maine pour la guerre contre l’Espagne à Cuba, le torpillage du Lusitania pour l’entrée dans la Première Guerre mondiale, Pearl Harbor pour la seconde, et le Golfe du Tonkin pour l’embrasement du Nord-Vietnam. Cependant, seule l’explosion du USS Maine, qui fit peu de morts, relève à proprement parler du stratagème de fausse bannière ; encore n’est-ce pas certain.
- Le paquebot transatlantique {RMS Lusitania} fut torpillé le 7 mai 1915 par les Allemands, alors qu’il naviguait dans une zone de guerre. C’est par le slogan {Remember the Lusitania} que le président Woodrow Wilson mobilisa ensuite l’opinion US en faveur de l’entrée en guerre. Le fait qu’une seule torpille ait suffi à couler le navire en quinze minutes suscite des questions. Dans son journal, le colonel Mendel Edward House, conseiller de Wilson, rapporte une conversation qu’il eut peu avant avec le ministre des Affaires étrangères britannique Edward Grey (qui deviendra en 1919 ambassadeur aux États-Unis). « Que feraient les Américains si les Allemands coulait un transatlantique avec des passagers américains à bord ? » demanda Grey. House lui répondit : « Je pense qu’un feu d’indignation balaierait les États-Unis et que cela suffirait à nous entraîner dans la guerre »
En revanche, c’est un fait qu’Israël a un passé chargé et une grande expertise des attaques et attentats sous faux drapeaux. Une histoire mondiale de ce stratagème devrait sans doute consacrer la moitié de ses pages à Israël, pourtant la plus jeune des nations modernes. Le pli a été pris avant même la création d’Israël, avec l’attentat du King David Hotel, quartier-général des autorités britanniques à Jérusalem. Le 22 juillet 1946 au matin, six terroristes de l’Irgun (la milice terroriste commandée par Menahem Begin, futur premier ministre) habillés en Arabes pénètrent dans le bâtiment et déposent autour du pillier central du bâtiment 225 kg d’explosif TNT cachés dans des bidons de lait, tandis que d’autres miliciens de l’Irgun répandent des explosifs le long des routes d’accès à l’hôtel pour empêcher l’arrivée des secours. Quand un officier britannique se montre suspicieux, une fusillade éclate dans l’hôtel et les membres du commando s’enfuient en allumant les explosifs. L’explosion tua 91 personnes, majoritairement des Britanniques, mais aussi 15 juifs.
Le stratagème fut répété en Égypte durant l’été 1954, avec l’Opération Susannah, dont le but était de compromettre le retrait des Britanniques du Canal de Suez exigé par le colonel Abdul Gamal Nasser avec le soutien du président Eisenhower. Cette opération fut également éventée et reste connu comme « l’Affaire Lavon », du nom du ministre israélien qui fut porté responsable. La plus célèbre et la plus calamiteuse des attaques israéliennes sous fausse bannière est celle du navire américain de la NSA USS Liberty, le 8 juin 1967 au large de l’Égypte, deux jours avant la fin de guerre des Six Jours ; on y voit déjà à l’œuvre une collaboration profonde entre Israël et les USA, l’administration Johnson ayant couvert et peut-être même incité ce crime contre ses propres ingénieurs et soldats. J’ai évoqué ces deux affaires dans un précédent article et n’y reviens pas [27].
En 1986, le Mossad a tenté de faire croire qu’une série d’ordres terroristes était transmise depuis la Libye à diverses ambassades libyennes dans le monde. Selon l’ancien agent Victor Ostrovsky (By Way of Deception, 1990), le Mossad utilisa un système spécial de communication nommé « Cheval de Troie » implanté par des commandos à l’intérieur du territoire ennemi. Le système agit comme station relais pour de fausses transmissions émises depuis un navire israélien et réémises instantanément sur une fréquence utilisée par l’État libyen. Ainsi que le Mossad l’avait espéré, la NSA capta et déchiffra les transmissions, qui furent interprétées comme une preuve que les Libyens soutenaient le terrorisme, ce que des rapports du Mossad venaient opportunément confirmer. Israël comptait sur la promesse de Reagan de représailles contre tout pays surpris en flagrant délit de soutien au terrorisme. Les États-uniens tombèrent dans le piège et entraînèrent avec eux les Britanniques et les Allemands : le 14 avril 1986, cent soixante avions US lâchèrent plus de soixante tonnes de bombes sur la Libye, ciblant principalement les aéroports et les bases militaires. Parmi les victimes civiles du coté libyen se trouvait la fille adoptive de Kadhafi, âgée de quatre ans. La frappe fit capoter un accord pour la libération des otages états-uniens détenus au Liban, ce qui permettait de conserver le Hezbollah comme ennemi numéro un aux yeux de l’Occident.
- Isser Harel, fondateur des services secrets israéliens, aurait prédit au chrétien sioniste Michael Evans en 1980 que le terrorisme islamique finirait par frapper les USA. « Dans la théologie islamique, le symbole phallique est très important. Votre plus gros symbole phallique est New York City et le plus haut bâtiment sera le symbole phallique qu’ils frapperont » En rapportant cet entretien dans une interview en 2004, Evans, auteur de « The American Prophecies, Terrorism and Mid-East Conflict Reveal a Nation’s Destiny », espère faire passer Harel pour un prophète. Les esprits rationnels y verront plutôt l’indice que le 11-Septembre mûrissait depuis 30 ans au sein de l’État profond israélien.
La capacité de manipulation du Mossad à cette époque peut encore être illustrée par deux histoires analysées par Thomas Gordon. Le 17 avril 1986, une jeune irlandaise du nom d’Ann-Marie Murphy embarque, à son insue, 1,5 kilos de Semtex dans un vol Londres-Tel-Aviv. Son fiancé, un Pakistanais du nom de Nezar Hindaoui, est arrêté alors qu’il tente de se réfugier à l’ambassade de Syrie. Tous deux ont en fait été manipulés par le Mossad, qui obtient ainsi le résultat souhaité : le gouvernement Thatcher rompt ses relations diplomatiques avec la Syrie. Mais la manipulation est éventée en haut lieu (comme Jacques Chirac le confiera au Washington Times) [28].
En janvier 1987, le Palestinien Ismaïl Sowan, une taupe du Mossad ayant infiltré l’OLP à Londres, se voit confier, par un inconnu soit-disant envoyé par son chef à l’OLP, deux valises bourrées d’armes et d’explosifs. Ismaïl en fait part à ses contacts au Mossad, qui lui font faire un aller-retour à Tel-Aviv, puis le dénonce à Scotland Yard comme suspect dans un projet d’attentat islamiste à Londres. Ismaïl est cueilli à son retour à l’aéroport d’Heathrow et inculpé sur la base des armes trouvées chez lui. Résultat : le Mossad rentre dans les faveurs du gouvernement Thatcher [29]. Après l’attentat du 26 février 1993 contre le WTC, le FBI arrêta le Palestinien Ahmed Ajaj et l’identifia comme un terroriste lié au Hamas, mais le journal israélien Kol Ha’ir démontra qu’Ajaj n’avait jamais été mêlé au Hamas ou à l’OLP. Selon le journaliste Robert Friedman, auteur d’un article dans The Village Voice le 3 août 1993, Ajaj n’était en réalité qu’un petit escroc arrêté en 1988 pour fabrication de faux dollars, condamné à deux ans et demi de prison et libéré au bout d’un an après un marché avec le Mossad, pour le compte duquel il devait infiltrer les groupes palestiniens. À sa libération, Ajaj subit un sheep-dipping classique en étant à nouveau brièvement emprisonné, cette fois pour avoir tenté de passer des armes en Cisjordanie pour le Fatah. On a donc, avec l’attentat de 1993 contre le WTC, un précédent et prototype du 11-Septembre, dans lequel sont démontrées la responsabilité d’Israël dans le terrorisme et sa volonté de faire accuser les Palestiniens.
- L’attentat contre l’ambassade d’Israël à Buenos Aires en 1992, qui fit 29 morts et 242 blessés, fut instantanément mis sur le compte de kamikazes du Hezbollah ayant utilisé un camion piégé. Mais le juge chargé de l’instruction révéla des pressions exercées par des délégués états-uniens et israéliens, ainsi que des manipulations de preuves et un faux témoignage destinés à orienter l’enquête vers l’hypothèse d’un camion piégé, alors que les faits indiquaient que l’explosion provenait de l’intérieur du bâtiment. Lorsque la Cour Suprême argentine confirma cette thèse, le porte-parole de l’ambassade d’Israël accusa les juges d’antisémitisme.
Il est intéressant de rappeler ce qu’écrivit Philip Zelikow avec John Deutch en décembre 1998 dans un article de Foreign Affairs intitulé « Catastrophic Terrorism », imaginant à propos de cet attentat de 1993 que la bombe fût nucléaire, et évoquant déjà un nouveau Pearl Harbor : « Un tel acte de ‘terrorisme catastrophique’ qui tuerait des milliers ou des dizaines de milliers et affecteraient les nécessités vitales de centaines de milliers, peut-être de millions, serait un point de non-retour dans l’histoire des États-Unis. Il pourrait provoquer des pertes humaines et matérielles sans précédent en temps de paix et réduirait à néant le sentiment de sécurité de l’Amérique à l’intérieur de ses frontières, d’une manière similaire au test atomique des Soviétique en 1949, ou peut-être pire. […]. Comme Pearl Harbor, cet événement diviserait notre histoire entre un avant et un après. Les États-Unis pourraient répondre par des mesures draconniennes, en réduisant les libertés individuelles, en autorisant une surveillance plus étroite des citoyens, l’arrestation des suspects et l’emploi de la force létale [30]. »
Le 12 janvier 2000, selon l’hebdomadaire indien The Week, des officiers des Renseignements indiens ont arrêté à l’aéroport de Calcutta onze prêcheurs islamistes qui s’apprêtaient à embarquer sur un vol à destination du Bengladesh. Ils étaient soupçonnés d’appartenir à Al-Qaïda et de vouloir détourner l’avion. Ils se présentèrent comme des Afghans ayant séjourné en Iran avant de passer deux mois en Inde pour prêcher l’islam. Mais on découvrit qu’ils possédaient tous des passeports israéliens. L’officier des services de Renseignement indien déclara à The Week que Tel Aviv « exerted considerable pressure » sur New Delhi pour les faire libérer.
Le 12 octobre 2000, dans les dernières semaines du mandat de Clinton, le destroyer USS Cole, en route vers le Golfe persique, reçoit l’ordre depuis son port d’attache de Norfolk de faire le plein dans le port d’Aden au Yémen, une procédure inhabituelle puisque ces destroyers sont généralement approvisionnés en mer par un pétrolier de la Navy. Le commandant du navire exprima sa surprise et son inquiétude : le USS Cole avait fait récemment le plein à l’entrée du Canal de Suez, et le Yémen est une zone hostile. Le USS Cole était en manœuvre d’amarrage lorsqu’il fut abordé par un dinghy destiné apparemment à l’évacuation des poubelles, qui explosa contre sa coque, tuant 17 marins et en blessant 50. Les deux « kamikazes » pilotant l’embarcation périrent aussi dans cet « attentat-suicide ». L’attaque fut aussitôt attribuée à Al-Qaïda, bien que Ben Laden ne l’ait pas revendiquée et que les Talibans nièrent que leur « hôte » ait pu être impliqué. L’accusation donna aux États-Unis un prétexte pour forcer le président yéménite Ali Abdullah Saleh à coopérer à la lutte contre l’islamisme anti-impérialiste, en fermant pour commencer treize camps paramilitaires sur son territoire. En plus de cela, quelques semaines avant les élections, l’attentat fut l’October Surprise qui porta Bush au pouvoir.
John O’Neill fut chargé de l’enquête. Au FBI depuis vingt ans, spécialiste expérimenté du contre-terrorisme, il avait déjà enquêté en 1993 sur l’attentat à la bombe au WTC. Son équipe en vint à soupçonner Israël d’avoir tiré un missile depuis un sous-marin : le trou était en effet indicatif d’une charge perforante et inexplicable par la seule explosion du dinghy. Les soupçons étaient partagés par le président Saleh, qui évoqua dans une interview à Newsweek la possibilité que l’attaque soit due à Israël, « essayant de nuire aux relations USA-Yémen [31]. » O’Neill et son équipe subirent l’hostilité de l’ambassadrice US, Barbara Bodine. Ils se virent interdire de plonger pour inspecter les dégâts. Finalement, profitant de leur retour à New York pour Thanksgiving, Bodine leur refusa l’entrée au Yémen. Les membres de l’équipage du Cole se virent ordonner de ne parler de l’attentat qu’au Naval Criminal Investigative Service (NCIS). En juillet 2001, O’Neill démissionna du FBI. Il se vit peu après offrir un poste de responsable de la sécurité au WTC, qu’il devait assurer à partir du 11 septembre 2001. Son corps fut retrouvé dans les décombres du WTC, après qu’il ait disparu depuis deux jours. Quant à Barbara Bodine, elle intégrera en 2003 l’équipe corrompue de la Coalition Provisional Authority (CPA) de Baghdad.
- Où s’arrête la liste du faux terrorisme islamique de conception sioniste ? Le « New York Times » et d’autres journaux rapportèrent que le 19 septembre 2005, deux agents des forces spéciales britanniques (SAS) furent arrêtés après avoir forcé un barrage à bord d’une voiture remplie d’armes, munitions, explosifs et détonateurs, qu’ils conduisaient déguisés en Arabes. On soupçonne qu’ils planifiaient de commettre des attentats meurtriers dans le centre de Bassora durant un événement religieux, pour attiser les conflits entre shiites et sunnites. Le soir même, une unité du SAS libéra les deux agents en détruisant la prison à l’aide d’une dizaine de tanks assistés par des hélicoptères. Le capitaine Masters, chargé de l’enquête sur cette affaire embarrassante, mourut à Bassora le 15 octobre.
[1] Article original en italien : « Demystifying 9/11 : Israel and the Tactics of Mistake »,
[2] “Wildcard. Ruthless and cunning. Has capability to target U.S. forces and make it look like a Palestinian/Arab act” (Rowan Scarborough, « U.S. troops would enforce peace Under Army study », The Washington Times, 10 septembre 2001, ).
[3] Outre le livre de Hicham Hamza et celui de Christopher Bollyn, on consultera sur ce dossier : Justin Raimondo, The Terror Enigma : 9/11 and the Israeli Connection, iUniversal, 2003 ainsi qu’à un article de Christopher Ketcham, « What Did Israel Know in Advance of the 9/11 Attacks ? » CounterPunch, 2007, vol. 14, p. 1-10, ).
[4] « Vehicle possibly related to New York terrorist attack. White, 2000 Chevrolet van with New Jersey registration with ’Urban Moving Systems’ sign on back seen at Liberty State Park, Jersey City, NJ, at the time of first impact of jetliner into World Trade Center. Three individuals with van were seen celebrating after initial impact and subsequent explosion » (Raimondo, The Terror Enigma, p. xi).
[5] « We are Israelis. We are not your problem. Your problems are our problems. The Palestinians are your problem » (Hicham Hamza, Le Grand Tabou, ch. 2).
[6] « There are maps of the city in the car with certain places highlighted. It looked like they’re hooked in with this. It looked like they knew what was going to happen when they were at Liberty State Park » (Raimondo, The Terror Enigma, p. xi).
[7] « I was in tears. These guys were joking and that bothered me » (Raimondo, The Terror Enigma, p. 19 ). Hamza, Le Grand Tabou, ch. 2.
[8] « They smiled, they hugged each other and they appeared to ‘high five’ one another » ; « the United States will take steps to stop terrorism in the world » ; « Give us twenty years and we’ll take over your media and destroy your country » ; « an individual in South America with authentic ties to Islamic militants in the middle east » ; « The vehicule was also searched by a trained bomb-sniffing dog which yielded a positive result for the presence of explosive traces » (Hamza, Le Grand Tabou, ch. 2).
[9] « that the FBI no longer has any investigative interests in the detainees and they should proceed with the appropriate immigration proceedings » (Hamza, Le Grand Tabou, ch. 2).
[10] “Our purpose was to document the event” (voir sur Youtube, « Dancing Israelis Our purpose was to document the event »).
[11] « Yes, we have a white van, 2 or 3 guys in there, they look like Palestinians and going around a building. […] I see the guy by Newark Airport mixing some junk and he has those sheikh uniforms. […] He’s dressed like an Arab » (Bollyn, Solving 9-11, p. 278-80).
[12] « Yes, we have a white van, 2 or 3 guys in there, they look like Palestinians and going around a building. […] I see the guy by Newark Airport mixing some junk and he has those sheikh uniforms. […] He’s dressed like an Arab » (Bollyn, Solving 9-11, p. 278-80).
[13] “In the past six weeks, employees in federal office buildings located throughout the United States have reported suspicious activities connected with individuals representing themselves as foreign students selling or delivering artwork.” “these individuals have also gone to the private residences of senior federal officials under the guise of selling art.” Le rapport comlet de la DEA est sur
[14] “The nature of the individuals’ conducts […] leads us to believe the incidents may well be an organized intelligence gathering activity” (Raimondo, The Terror Enigma, p. x).
[15] “acknowledged he could blow up buildings, bridges, cars, and anything else that he needed to” (Bollyn, Solving 9/11, p. 159).
[16] The Hollywood, Florida, area seems to be a central point for these individuals” (Raimondo, The Terror Enigma, p. 3).
[17] David Ray Griffin, 9/11 Contradictions, Arris Books, 2008, p. 142-156, citant le Daily Mail, le Boston Herald, le San Francisco Chronicle et le Wall Street Journal.
[18] « The aircraft cut a gash that was over half the width of the building and extended from the 93rd floor to the 99th floor. All but the lowest of these floors were occupied by Marsh & McLennan, a worldwide insurance company, which also occupied the 100th floor » (p. 20). Ces éléments ont été analysés par Lalo Vespera dans La Parenthèse enchantée, chapitre 10.
[19] « Like an act of God, we moved » (USA Today, 17 septembre 2001).
[20] “evidence that there were foreign governments involved in facilitating the activities of at least some of the terrorists in the United States” (Raimondo, The Terror Enigma, p. 64).
[21] « the threat of civil unrest against the monarchy, led by al Qaeda » » (« Saudi Arabia : Friend or Foe ? », The Daily Beast, 11 juillet 2011).
[22] The Keys to the Kingdom, Vanguard Press, 2011.
[24] « Le contrôle des dégâts : Noam Chomsky et le conflit israélo-israélien » et « Contrairement aux théories de Chomsky, les États-Unis n’ont aucun intérêt à soutenir Israël », par Jeffrey Blankfort, Traduction Marcel Charbonnier, Réseau Voltaire, 30 juillet et 21 août 2006,
[25] “Of course it was Iraq’s energy resources. It’s not even a question” (cité dans Stephen Sniegoski, The Transparent Cabal : The Neoconservative Agenda, War in the Middle East, and the National Interest of Israel, Enigma Edition, 2008, p. 333).
[26] « ‘Big Oil’ not only did not promote the invasion, but has failed to secure a single oil field, despite the presence of 160,000 US troops, 127,000 Pentagon/State Department paid mercenaries and a corrupt puppet régime » (James Petras, Zionism, Militarism and the Decline of US Power, Clarity Press, 2008, p. 18).
[27] http://www.voltairenet.org/article1…
[28] Gordon Thomas, Histoire secrète du Mossad : de 1951 à nos jours, Nouveau Monde éditions, 2006, p. 384-5.
[29] Thomas, Histoire secrète du Mossad, p. 410-41.
[30] “An act of catastrophic terrorism that killed thousands or tens of thousands of people and/or disrupted the necessities of life for hundreds of thousands, or even millions, would be a watershed event in America’s history. It could involve loss of life and property unprecedented for peacetime and undermine Americans’ fundamental sense of security within their own borders in a manner akin to the 1949 Soviet atomic bomb test, or perhaps even worse. […] Like Pearl Harbor, the event would divide our past and future into a before and after. The United States might respond with draconian measures scaling back civil liberties, allowing wider surveillance of citizens, detention of suspects and use of deadly force” (Griffin, 9/11 Contradictions, p. 295-6).
Veille
Dans une enquête publiée aujourd’hui, Libération accuse le ministre de l’Intérieur d’avoir menti s’agissant de la sécurisation de la Promenade des Anglais le soir du 14 juillet dernier. Riposte immédiate de Bernard Cazeneuve : Libération utilise des «procédés qui empruntent aux ressorts du complotisme» et cherche à l’atteindre «dans sa réputation». Dans un édito en forme de «c’est celui qui dit qui l’est», Johan Hufnagel, directeur délégué de Libération, suggère que c’est Bernard Cazeneuve qui est victime d’«une poussée de complotisme».
Première observation : on peut regretter que le ministre de l’Intérieur ne se soit pas abstenu d’user du terme «complotisme» sans préciser la différence de nature qu’il peut y avoir entre un journal comme Libération et les médias authentiquement complotistes qui prolifèrent sur la Toile. Surtout dans un moment où la prévention «des risques d’emprise complotiste» est constitutive des actions que le Gouvernement cherche à mettre en oeuvre pour lutter contre la radicalisation et le terrorisme.
Remarquons cependant que Bernard Cazeneuve n’accuse pas la rédaction de Libération d’être complotiste, comme le suggère le titre de l’édito de Johan Hufnagel. Dans un contexte où Libération lui reproche rien moins que d’avoir diffusé «un mensonge», de surcroît en une de son édition, le locataire de la place Beauvau a cru devoir dénoncer des «procédés qui empruntent aux ressorts du complotisme», ce qui n’est pas exactement la même chose que de mettre sur le même plan Libération et, mettons, Egalité & Réconciliation.
Le ministre a également laissé entendre que Libération était partie prenante «de campagnes politiques ou de presse qui visent à [l’] atteindre […] dans sa réputation». Etait-il vraiment nécessaire que Libération en tire prétexte pour accuser à son tour Bernard Cazeneuve de céder aux sirènes du complotisme ? Ne peut-on pas, là aussi, regretter l’usage d’un tel terme dirigé contre un ministre de la République qui ne saurait être confondu avec le premier théoricien du complot venu ? Ne peut-on, dans le même temps, trouver malvenue sa dénonciation de «campagnes de presse» là où, de toute évidence, Libération se contente d’assumer le rôle que lui assigne son statut d’acteur du quatrième pouvoir ?
Ni la presse ni le Gouvernement, cibles de choix des complotistes patentés, ne sortent grandis d’une telle séquence. Morale de l’histoire : cessons de gloser sur le complotisme présumé des uns et des autres à partir de matériaux aussi fragiles. Ne contribuons pas à faire du «complotisme» une étiquette infamante parmi d’autres. Utiliser ce mot de manière aussi peu fondée pour délégitimer un détracteur est en réalité une manière d’œuvrer à sa démonétisation et de rendre, au final, un fier service à tous ceux – vrais imposteurs et autres désinformateurs professionnels – qui prospèrent sur la montée contemporaine du complotisme.
Attentat de Nice : le retour des théories du complot







 Publié par jcdurbant
Publié par jcdurbant  Tout se disloque. Le centre ne peut tenir. L’anarchie se déchaîne sur le monde Comme une mer noircie de sang : partout On noie les saints élans de l’innocence …Sûrement que quelque révélation, c’est pour bientôt … Sûrement que la Seconde Venue, c’est pour bientôt. La Seconde Venue ! A peine dits ces mots, Une image, immense, du Spiritus Mundi Trouble ma vue : quelque part dans les sables du désert, Une forme avec corps de lion et tête d’homme Et l’oeil nul et impitoyable comme un soleil Se meut, à cuisses lentes, tandis qu’autour Tournoient les ombres d’une colère d’oiseaux… La ténèbre, à nouveau ; mais je sais, maintenant, Que vingt siècles d’un sommeil de pierre, exaspérés Par un bruit de berceau, tournent au cauchemar, – Et quelle bête brute, revenue l’heure, Traîne la patte vers Bethléem, pour naître enfin ?
Tout se disloque. Le centre ne peut tenir. L’anarchie se déchaîne sur le monde Comme une mer noircie de sang : partout On noie les saints élans de l’innocence …Sûrement que quelque révélation, c’est pour bientôt … Sûrement que la Seconde Venue, c’est pour bientôt. La Seconde Venue ! A peine dits ces mots, Une image, immense, du Spiritus Mundi Trouble ma vue : quelque part dans les sables du désert, Une forme avec corps de lion et tête d’homme Et l’oeil nul et impitoyable comme un soleil Se meut, à cuisses lentes, tandis qu’autour Tournoient les ombres d’une colère d’oiseaux… La ténèbre, à nouveau ; mais je sais, maintenant, Que vingt siècles d’un sommeil de pierre, exaspérés Par un bruit de berceau, tournent au cauchemar, – Et quelle bête brute, revenue l’heure, Traîne la patte vers Bethléem, pour naître enfin ? 
















 Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents, et simples comme les colombes.
Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents, et simples comme les colombes.