






Tu n’as voulu ni sacrifice ni oblation… Donc j’ai dit: Voici, je viens. Psaume 40: 7-8
Voici l’Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Jean le baptiste (Jean 1: 29)
Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre; je ne suis pas venu apporter la paix, mais l’épée. Car je suis venu mettre la division entre l’homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère; et l’homme aura pour ennemis les gens de sa maison. Jésus (Matthieu 10 : 34-36)
Vous ne réfléchissez pas qu’il est dans votre intérêt qu’un seul homme meure pour le peuple, et que la nation entière ne périsse pas. Caïphe (Jean 11: 50)
Dionysos contre le ‘crucifié’ : la voici bien l’opposition. Ce n’est pas une différence quant au martyre – mais celui-ci a un sens différent. La vie même, son éternelle fécondité, son éternel retour, détermine le tourment, la destruction, la volonté d’anéantir pour Dionysos. Dans l’autre cas, la souffrance, le ‘crucifié’ en tant qu’il est ‘innocent’, sert d’argument contre cette vie, de formulation de sa condamnation. (…) L’individu a été si bien pris au sérieux, si bien posé comme un absolu par le christianisme, qu’on ne pouvait plus le sacrifier : mais l’espèce ne survit que grâce aux sacrifices humains… La véritable philanthropie exige le sacrifice pour le bien de l’espèce – elle est dure, elle oblige à se dominer soi-même, parce qu’elle a besoin du sacrifice humain. Et cette pseudo-humanité qui s’institue christianisme, veut précisément imposer que personne ne soit sacrifié. Nietzsche
Le christianisme est une rébellion contre la loi naturelle, une protestation contre la nature. Poussé à sa logique extrême, le christianisme signifierait la culture systématique de l’échec humain. Adolf Hitler
Le religieux et l’homme sont sans doute la même chose. C’est cela, l’invention de la culture, ce qui différencie l’homme des animaux. Les animaux vivent selon des réseaux de dominant/dominé. Quand ils se rencontrent pour la première fois, ils ont une relation mimétique, autour d’une femelle par exemple. Ils se battent et le moins fort se rend toujours au plus fort qui lui épargne la vie. Les hommes, eux, luttent jusqu’à la mort parce qu’ils ont des capacités mimétiques beaucoup plus fortes. La capacité mimétique étant aussi bien l’intelligence que la puissance. C’est pour éviter cette lutte à la mort qu’intervient le religieux, ses interdits et ses rituels. (…) C’est pourquoi [l’homme] se trouve dans une situation impossible : quand il est bridé par des interdits idiots ou devenus inadaptés, il végète ; quand il les brise, il crée une ouverture qui enclenche les crises. Rompre avec l’interdit est très bénéfique, car cela libère l’intelligence humaine. Pour défricher un champ, passer à l’agriculture, les primitifs ont dû se débarrasser de tous les esprits qui les en empêchaient. L’homme moderne ne connaît plus ces obstacles, il peut donc entreprendre toutes sortes de choses. Mais il se trouve de ce fait exposé à une violence beaucoup plus forte. C’est pourquoi le religieux s’accompagne également du rite sacrificiel, celui du bouc émissaire, central dans tous les mythes et les religions archaïques. Quand la crise atteint son apogée, il advient un moment où le mimétique tend à se polariser sur un individu. Ce phénomène social fondamental a un caractère mécanique et spontané dont il faut prendre conscience. En lui-même, ce phénomène n’a pas de sens, mais les hommes lui en donnent un. Car lorsque le mimétisme se transforme pour se contenter d’une seule victime dont le sacrifice réconcilie la communauté, il apparaît comme un phénomène merveilleux qu’il faut réitérer pour guérir les crises suivantes. C’est pourquoi l’homme lui donne un sens religieux. (…) la critique que l’on me fait [c’est que] parce que je suis religieux, toute ma réflexion serait religieuse. Bien au contraire, je donne là une explication parfaitement athée du religieux, fondée sur ce mimétisme. Cela dit, je suis en effet christo-centré. L’expérience fondamentale du Christ me paraît irremplaçable car, si elle s’inscrit dans la rupture que fait l’Ancien Testament avec le rituel des religions archaïques, elle ne se contente plus de refléter la scène du sacrifice. Au lieu de l’accepter, de l’entériner et de l’interpréter comme un phénomène transcendental, le Christ la révèle et la condamne. (…) Et c’est précisément ce que les religions archaïques ne peuvent pas voir. Elles voient Dieu comme un être méchant qui cause ces crises, et très secourable parce que c’est également lui qui les règle. Mais de loin. C’est pourquoi il faut faire des sacrifices. Seul le christianisme supprime totalement le sacrifice sanglant. (…) dans la logique rituelle du sacrifice mimétique, on pourrait penser que la violence actuelle est peut-être le signe inquiétant que l’effet pacificateur des grandes catastrophes du XXe siècle est terminé. Si le dépassement de cette mécanique est présent dans les Evangiles, il n’a pas encore gagné l’Histoire. D’une certaine manière, le christianisme nous expose à la violence parce qu’en nous faisant trop bien comprendre la logique du bouc émissaire, il nous prive et prive la société de ce mode d’organisation. Le christianisme ne fait que dire cela : « Je séparerai le père, la mère, etc. » ; « Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix, j’apporte la guerre ». Mais par méconnaissance des textes, on considère le christianisme comme une espèce d’aspirine contre la violence qui ne produirait pas l’effet voulu. (…) L’homme ne se dit jamais qu’il est naturellement conflictuel. Le bouc émissaire ce n’est jamais soi, mais toujours les autres. Il n’y a pas d’expérience subjective du bouc émissaire. Sauf dans les Evangiles et chez Paul. Pierre fait cette expérience, après son reniement, quand il comprend qu’en ayant renié le Christ, il a participé à son sacrifice. Paul la fait aussi sur le chemin de Damas lorsque le Christ lui dit « pourquoi me persécutes-tu ? » L’expérience chrétienne fondamentale, c’est donc de comprendre que nous sommes incapables de nous passer de bouc émissaire. Et c’est justement ce que le christianisme nous demande : que nous nous en passions. Il nous appelle à une autre vocation. René Girard
Le christianisme (…) nous a fait passer de l’archaïsme à la modernité, en nous aidant à canaliser la violence autrement que par la mort.(…) En faisant d’un supplicié son Dieu, le christianisme va dénoncer le caractère inacceptable du sacrifice. Le Christ, fils de Dieu, innocent par essence, n’a-t-il pas dit – avec les prophètes juifs : « Je veux la miséricorde et non le sacrifice » ? En échange, il a promis le royaume de Dieu qui doit inaugurer l’ère de la réconciliation et la fin de la violence. La Passion inaugure ainsi un ordre inédit qui fonde les droits de l’homme, absolument inaliénables. (…) l’islam (…) ne supporte pas l’idée d’un Dieu crucifié, et donc le sacrifice ultime. Il prône la violence au nom de la guerre sainte et certains de ses fidèles recherchent le martyre en son nom. Archaïque ? Peut-être, mais l’est-il plus que notre société moderne hostile aux rites et de plus en plus soumise à la violence ? Jésus a-t-il échoué ? L’humanité a conservé de nombreux mécanismes sacrificiels. Il lui faut toujours tuer pour fonder, détruire pour créer, ce qui explique pour une part les génocides, les goulags et les holocaustes, le recours à l’arme nucléaire, et aujourd’hui le terrorisme. René Girard
La même force culturelle et spirituelle qui a joué un rôle si décisif dans la disparition du sacrifice humain est aujourd’hui en train de provoquer la disparition des rituels de sacrifice humain qui l’ont jadis remplacé. Tout cela semble être une bonne nouvelle, mais à condition que ceux qui comptaient sur ces ressources rituelles soient en mesure de les remplacer par des ressources religieuses durables d’un autre genre. Priver une société des ressources sacrificielles rudimentaires dont elle dépend sans lui proposer d’alternatives, c’est la plonger dans une crise qui la conduira presque certainement à la violence. Gil Bailie
Je viens vous aider à protéger votre belle diversité. Compteur d’ours français
Vous n’avez plus d’ours chez vous, on ne veut pas être le zoo de l’Europe ! Villageois roumain
Vous n’avez rien appris de Charlie Hebdo, vous n’avez plus rien de sacré ! Villageois roumain
Pendant le tournage, je suis tombé sur une photo de la fin du 19e siècle dans l’un des lieux de tournage, intitulée : L’Agneau de Dieu. J’ai pensé que ça ferait un bon titre. Christian Mungiu
L’histoire (…) parle de la façon dont nos croyances peuvent façonner nos choix, de nos instincts, de nos pulsions irrationnelles et de nos peurs, des animaux enfouis en nous, de l’ambiguïté de nos sentiments, de nos actions et de l’impossibilité de les comprendre pleinement. (… ) Il s’agit aussi d’une histoire sur la mondialisation et ses effets secondaires. (…) Le film évoque les effets de la mondialisation sur une petite communauté enracinée dans des traditions séculaires : les valeurs d’autrefois se sont dissipées, l’accès à l’internet n’a pas apporté à ces gens de nouvelles valeurs, mais les a plutôt accablés par la difficulté de distinguer la vérité de leurs opinions personnelles dans le chaos informationnel et moral actuel. R.M.N. aborde également les effets secondaires du politiquement correct : les gens ont appris qu’il valait mieux ne pas s’exprimer à haute voix quand leurs opinions diffèrent de la norme actuelle. Seulement le politiquement correct n’est pas un processus formateur et il n’a pas changé les opinions en profondeur ; il a juste fait en sorte que les gens expriment moins ce qu’ils pensent. Mais les choses finissent par s’accumuler et, à un moment donné, elles débordent. Christian Mungiu
Je savais dès le départ que cette scène serait capitale pour le film. Et pour l’écrire, je me base d’abord sur mes recherches. J’ai ainsi découvert que l’équivalent de cette scène existait sur Internet et avait d’ailleurs fait scandale lors de sa mise en ligne. Comme si ces échanges avaient mis en lumière des choses que personne ne voulait voir, alors que ceux qui l’ont mis en ligne l’avaient fait de manière tout à fait naïve sans se douter de ce que ça allait provoquer. Et ce que je trouve passionnant dans ce type de réunion, c’est la transformation de chaque individu au contact du groupe. Voilà pourquoi je voulais montrer le maximum de personnages à l’intérieur de cette scène. Le tout sans perdre le spectateur ni leur dire quoi penser. [le choix du plan-séquence, c’était] Pour respecter le continuum de la réalité et pour responsabiliser en quelque sorte le spectateur, en lui laissant le choix d’à travers qui suivre ces moments. Je ne l’oriente pas en passant par des champs contre-champs. Alors que je sais qu’aujourd’hui, on a plutôt tendance à pré-mâcher les choses. Je me sens à contre-courant en écrivant, tournant et montant R.M.N. et j’en ai pleinement conscience. Pour moi, s’il veut raconter la réalité, le cinéma ne peut pas diviser le monde en blanc et noir. Et c’est dans cette logique-là que cette scène est un pivot. (…) [Mes producteurs] craignaient que ce soit un film dans le film, une sorte de reportage filmé qui détonne avec le reste. Moi, j’avais exactement ce que je voulais en tête mais ce n’était pas simple de le formuler. A part une chose : le fait que, pendant tout ce plan-séquence, je n’allais jamais perdre de vue mon personnage central donc le fil de mon récit. Ce fut même la base de ma mise en scène. Mais par celle-ci, je devais aussi trouver le moyen de raconter ce que je cherchais à montrer : le rapport entre l’intimité et la société d’aujourd’hui. Car je trouve qu’il existe une grande différence – plus importante qu’avant – entre ce qu’on dit dans l’intimité et en public. Beaucoup s’autocensurent. Or, avec cette réunion, c’est l’inverse, il faut que les gens s’expriment et mettent tout sur la table pour régler les problèmes. (…) [Ce qui me plait au final dans cette scène, c’est] le fait qu’elle soit différente selon le personnage que vous allez choisir de suivre. Qu’elle puisse se lire et se voir de plein de façons. J’aime aussi son côté polyphonique et l’énergie qui va avec. Une dynamique qui épouse ce qui se passe dans nos sociétés actuelles et qui ambitionne d’en retranscrire la complexité. Cette complexité qui existe en chacun de nous entre notre côté animal et notre côté raisonnable. Je comprends que certains décrochent mais sans cette complexité, RMN n’aurait aucun intérêt. Christian Mungiu
R.M.N. (…) est l’acronyme local de notre IRM, l’Imagerie par résonance magnétique, autrement dit le scanner cérébral qui permet de révéler la maladie derrière la surface. Soit une bonne définition du cinéma de Cristian Mungiu qui, depuis ses débuts, diagnostique avec sa mise en scène au scalpel les maux de la société roumaine d’hier et d’aujourd’hui. Après les ravages de la politique nataliste sous la tyrannie de Ceausescu dans 4 mois, 3 semaines, 2 jours (Palme d’or 2007), la violence du pouvoir religieux dans Au-delà des collines (2012) ou la corruption endémique dans Baccalauréat (2016), les ravages du nationalisme et de la xénophobie sont au cœur de R.M.N. Et c’est aussi déprimant sur le plan politique qu’exaltant en termes de cinéma. Le film se déroule dans un petit village de Transylvanie, la région la plus à l’ouest de la Roumanie, où vivent encore une importante communauté hongroise et une petite minorité allemande. C’est là qu’est né Matthias, et où il revient après avoir perdu son boulot en Allemagne (…) Comme la quasi-totalité de ses voisins, Matthias refuse de travailler pour la boulangerie industrielle, le seul employeur du coin – mais qui ne paye pas assez… La patronne de l’usine et son adjointe, très impliquée dans la vie associative du village, n’ont d’autre solution que d’embaucher des ouvriers immigrés. Quand le village découvre qu’il s’agit de trois Sri-Lankais, ça coince… R.M.N. est, d’abord, une histoire d’incompréhension liée à la langue – ou, plutôt, aux langues. Le film passe sans arrêt (mais avec des couleurs différentes dans les sous-titres pour s’y retrouver !) du roumain au hongrois, avec quelques répliques en allemand et d’autres en anglais, l’idiome universel utilisé par les « étrangers » de l’histoire, dont, belle ironie, un zoologiste français venu, avec l’argent de l’Union européenne, recenser la population d’ours dans les forêts alentour. Les dialogues, remarquablement écrits et souvent très vifs, révèlent petit à petit le contexte explosif de l’intrigue : le poids de l’Histoire, les discriminations anti-Roms, l’exode massif des jeunes à l’Ouest pour une vie meilleure, et résumant tout cela, la haine d’une Europe perçue, au pire, comme une pseudo-dictature qui exploite le pays comme un vampire et voudrait imposer un mode de vie unique de Porto à Bucarest, au mieux, comme une tirelire à subventions. (…) lorsque les citoyens se réunissent dans la salle communale pour débattre du sort à réserver aux nouveaux venus (…) vingt-six personnages différents prennent la parole dans un flot d’invectives ininterrompu. Un grand déballage où toutes les rivalités culturelles ou économiques, tous les antagonismes personnels longtemps en sommeil se réveillent. Et où la haine de l’autre, surtout s’il vient de loin, l’obsession de l’invasion et du « grand remplacement » s’expriment sans la moindre retenue. R.M.N. se déroule en Roumanie mais difficile de ne pas penser à la situation en France ici et maintenant… Télérama
Radiographier le mal ou la maladie, c’est le projet du cinéaste, à l’échelle d’un village de Transylvanie, à la population multiethnique. (…) Matthias (…) un homme rustre et taciturne, impulsif. Humain malgré tout ? (…) son garçon, mutique depuis une rencontre traumatisante dans la forêt (…) son père, un berger vieillissant et malade (..) Csilla, son ancienne maîtresse (…) numéro 2 d’une boulangerie industrielle, seule entreprise dynamique du coin, mais aux salaires trop bas pour les jeunes locaux, qui ont préféré partir vers l’ouest (…) la main-d’œuvre étrangère, deux Sri-Lankais (…) la communauté, paupérisée, mécontentement et ressentiment (…) La violence xénophobe [qui] menace alors d’embraser le village. Il n’est pas question pour Cristian Mungiu (…) de la justifier, mais bien de la décortiquer, en exposant de manière magistrale les ressorts multiples qui l’alimentent. On écrit « magistrale », car le nombre d’éléments, à la fois économiques, culturels, religieux, anthropologiques, qu’il est parvenu à réunir force le respect. Ambitieuse est cette fresque, où l’on parle au moins cinq langues. Où se réfléchit le poids de l’histoire de la Transylvanie, avec un éclairage sur ses minorités — hongroises et allemandes. Et où sont montrés avec une ironie mordante les effets pervers de l’Union européenne et de la mondialisation. (…) Le privé et le public, le particulier et l’universel restent liés. Quant aux conflits, ils sont aussi intérieurs : le versatile Matthias ne sait plus très bien à quel camp lui-même appartient. R.M.N. montre comment chacun peut très vite se retrouver « le sale Gitan » d’un autre. Et comment la bête raciste tapie en nous peut se réveiller à tout moment, si on laisse les bas instincts prendre le dessus sur la raison. La peur de l’autre, de la nuit, des animaux traverse le film. Une peur implacable mais aussi grotesque, risible. L’atout majeur de R.M.N. réside sans doute dans son alliage de noirceur terrible et de farce absurde. Qui culmine dans la scène de la salle communale, où les habitants prennent à tour de rôle la parole pour débattre du sort des immigrés. Un formidable morceau de bravoure — dix-sept minutes de plan-séquence — pour un grand déballage, un théâtre de l’invective, de la rancœur, de la zizanie. On repense alors à ces vieux westerns qui finissent en bataille rangée, pire, en curée punitive. Mais celui-ci, glaçant, évoque l’ici et maintenant, un peu partout en Europe. Pourtant, dans une ultime pirouette, Cristian Mungiu réfute le pessimisme, en montrant ce que la nuit recèle aussi de profondeur énigmatique… Pas si loin, étrangement, de la magie de Noël. Télérama
Le titre de R.M.N. (…) résume bien l’horizon du récit, qui scanne les pulsions racistes et violentes d’un village perturbé par l’arrivée de travailleurs sri-lankais. Le programme n’est pas sans lourdeur – en témoigne un dernier plan métaphorique appuyé – mais la méthode de Mungiu, elle, se révèle plus sinueuse. Le film repose sur un entremêlement de petites scènes conservant une part lacunaire (le prologue où un enfant traverse seul un bois) ou qui mettent en exergue la complexité du maillage communautaire ici ausculté, afin d’entretenir un flottement permanent. Malin, le scénario brouille volontairement les pistes et dépeint un microcosme où la présence rampante du mal revêt potentiellement de multiples visages. D’une certaine manière, R.M.N. est ce que l’on pourrait appeler un film à « clignotants » : de nombreuses scènes font « signal », semblent indiquer que quelque chose d’important se joue, sans pour autant que l’on sache exactement quoi. (…) On voit un peu trop les coutures de la manœuvre : la stratégie, indéniablement habile, consiste à semer des petits cailloux pour donner l’impression d’une profondeur tentaculaire des enjeux, à force de sous-entendus et d’ambiguïtés, mais cette profondeur n’est dès lors qu’artificielle, fruit d’un calcul. Le film est en revanche plus intéressant lorsqu’il dépeint, en plan-séquence, des situations qui laissent libre cours à la parole et à l’impromptu. Ainsi d’une assemblée qui rappelle presque certains débats de City Hall de Frederick Wiseman. Si l’on devine que la scène est préparée au millimètre près, le retrait dont témoigne à ce moment-là la mise en scène permet de réellement donner vie à la communauté multi-ethnique divisée au cœur de l’intrigue. Critikart
Cristian Mungiu, qui avait reçu la palme d’or en 2007 pour 4 mois, 3 semaines et 2 jours et qui n’est pas connu pour sa puissance comique, sans doute parce qu’il a grandi dans un pays qui a connu la morne déliquescence d’une dictature grotesque et qu’il s’est forgé la certitude qu’il n’y a rien de bon à attendre de quelque organisation humaine que ce soit, nous offre avec R.M.N. une parenthèse de noirceur morale et de constats accablants. Le personnage principal est un type antipathique, Matthias, roumain travaillant dans un abattoir en Allemagne. Un contremaître le rappelle à l’ordre en le traitant de «gitan», ce qu’il prend très mal, secouant le mec et prenant la fuite. Il s’en revient dans sa Transylvanie natale où il avait laissé sa femme et son fils qui n’ont pas l’air particulièrement ravis de le voir rentrer. Le gamin ne parle plus depuis quelque temps, apparemment saisi d’horreur dans la forêt voisine qu’il doit traverser pour se rendre à l’école. Matthias, lui, est surtout pressé de renouer le contact très charnel avec son ex, devenue gérante d’une boulangerie industrielle qui tourne à plein régime mais doit recruter des travailleurs migrants pour le coup de pression des fêtes de fin d’année puisque apparemment les Roumains du secteur ne répondent pas aux petites annonces d’emplois trop mal payés. Trois Sri-Lankais débarquent dans le village où ils sont bien accueillis par une partie de la population mais aussi en butte à une coalition fortement organisée au sein de l’église locale qui veut les éjecter. Une longue scène de réunion publique tournée en plan-séquence montre les arguments des différents membres d’un bled traversé par le racisme, la haine de tout ce qui vient de l’Ouest associé à une forme de décadence morale, les conséquences jugées délétères de la construction européenne et de son libéralisme. Parmi les habitants, certains revendiquent toutes sortes de lubies folkloriques de défense d’une identité locale en peau de bêtes et virilisme gueulard, toujours prompt à sortir le fusil de chasse. Il faut savoir que la Transylvanie est composée d’une mosaïque de populations entre Roumains, Hongrois, Roms, Allemands… Il s’agit évidemment d’orchestrer la cacophonie contemporaine, ce grand désordre des points de vue, des opinions, des affects qui prend la forme d’un fascisme en gésine dont la petite musique terrifiante et mesquine contamine peu à peu le moindre espace de ce biotope asphyxié. La pesanteur démonstrative de l’ensemble qui ne laisse vraiment que peu d’espace aux personnages pour qu’ils puissent se sauver de ce traquenard (d’ailleurs à la fin, l’un d’eux se pend) rend finalement le film aussi peu aimable que ce qu’il entend dénoncer. Libération
Depuis sa palme d’or avec 4 mois, 3 semaines, 2 jours, en 2007, le Roumain Cristian Mungiu est toujours revenu du Festival de Cannes bardé de prix. En 2012, il est récompensé du prix du meilleur scénario et d’un double prix d’interprétation féminine pour Au-delà des collines. En 2016, il obtient le prix du meilleur scénario pour Baccalauréat . De retour cette année en compétition avec R.M.N., Mungiu est reparti bredouille. Son absence au palmarès interroge car il signe peut-être là son meilleur film. Il confirme en tout cas qu’il est un cinéaste passionnant. Un grand moraliste, le contraire d’un donneur de leçons. Et avant tout un vrai raconteur d’histoire. Matthias quitte l’abattoir où il travaille en Allemagne sur un coup de tête. Au propre comme au figuré. Il se fait traiter de «Gitan». L’insulte revient dans la bouche de plusieurs protagonistes de R.M.N., et change de cible selon le pays, la communauté, la position sociale. Chacun est le Gitan d’un autre. Matthias est Roumain. Il est de retour dans son village natal quelques jours avant Noël. Un village de Transylvanie, multiethnique, où l’on parle roumain, hongrois et allemand. Son fils Rudi, lui, ne parle plus depuis qu’il a vu «quelque chose de mal» dans la forêt. Son père aussi est mutique, de plus en plus impotent. Matthias retrouve son ancienne maîtresse, Csilla. Elle gère une usine qui fabrique du pain, parle anglais, joue du violoncelle. Elle peine à trouver des employés, les habitants refusant de travailler pour des salaires aussi bas. Elle finit par recruter trois Sri-Lankais qui débarquent sous la neige. Les premières tensions affleurent dans la communauté. Les forums internet déversent des torrents de haine à l’encontre de ces hommes à la peau sombre. R.M.N. n’est pas sans rapport avec As Bestas. L’Espagnol Rodrigo Sorogoyen mettait en scène Denis Ménochet et Marina Foïs en couple de bobos français pétris de bons sentiments dans un village isolé de Galice, affrontant une famille autochtone décidée à vendre sa ferme à un projet d’éoliennes pour ne pas crever de faim. Les meilleures scènes prenaient la forme de joutes verbales dans un café, purs moments de rhétorique. C’est aussi le cas ici, notamment dans la séquence de dix-sept minutes tournée en un seul plan. La scène n’est pas qu’un morceau de bravoure. Dans la salle des fêtes du village où se rassemble la communauté, 26 personnages prennent la parole. Dans ce laboratoire de la mondialisation malheureuse et du populisme, on entend 26 nuances d’intolérance et de xénophobie. De bonne conscience et d’hypocrisie aussi. L’Union européenne est incarnée par un Français candide, membre d’une ONG pour la préservation des ours. «Je viens vous aider à protéger votre belle diversité», assène la belle âme aux travailleurs qui ont vu leur mine fermer à cause des écologistes. Il se fait rembarrer: «Vous n’avez plus d’ours chez vous, on ne veut pas être le zoo de l’Europe!» Ou encore: «Vous n’avez rien appris de Charlie Hebdo, vous n’avez rien de sacré!» Matthias ne sait pas vraiment quoi penser de tout cela. Il chevauche sa moto, son fusil en bandoulière. Tempête sous un crâne. Entre les beaux yeux de Csilla et le poids des préjugés, son cœur balance. Comme le corps d’un pendu dans une forêt sombre de Transylvanie. Le Figaro
Dans tous ses films, Cristian Mungiu explore la société roumaine. Après l’avortement, les années Ceaușescu, la religion et l’éducation, il s’attaque aujourd’hui à la xénophobie qui gangrène le pays suite à la vague migratoire de ces dernières années. Le titre R.M.N. (I. R. M. en roumain) désigne l’imagerie médicale du cerveau du père de Mathias qu’il consulte régulièrement sur son portable. Cette représentation d’un cerveau dégénérescent pourrait renvoyer au logiciel roumain déréglé. Mais l’acronyme du titre fait aussi penser à celui de la Roumanie, comme sur une plaque minéralogique. Il évoquerait alors une Roumanie globale, à travers le cas particulier de ce village roumain. Le bilan n’est pas glorieux. (…) Le film s’enlise quelque peu dans la chronique de ce village enneigé, traversé d’anecdotes successives anodines dont il ressort une dramaturgie assez pauvre. Pourquoi pas ? Mais l’on se demande où Mungiu veut en venir avec ce collier de perles, aux épisodes répétitifs. Jusqu’à ce que le sujet de fond émerge enfin : l’opposition radicale de la population à la présence de trois étrangers dans le village. C’est la partie la plus intéressante du film, avec une scène de réunion municipale remarquable, jouée par des acteurs non professionnels qui improvisent leur texte. Mais quel déséquilibre dans la construction et le rythme du film. La scène finale, avec des acteurs grimés en ours est assez ridicule, et donne le coup de grâce à ce qui s’avère le moins bon film d’un cinéaste par ailleurs passionnant. France info
Au sein d’une ville dont tous les liants communautaires sont effilochés par un ordre libéral et supra-national incompréhensible, le metteur en scène chronique une inexorable spirale de folie et de mort. (…) Les récits portés par Cristian Mungiu, ambassadeur du cinéma roumain depuis tout juste deux décennies, ont toujours cherché, explorent les contradictions qui minent le corps social, quitte à le pousser à une forme d’auto-prédation terrible. Non-dits, révoltes rentrées ou compromissions insolubles, son cinéma a toujours pris le pouls de la société roumaine. Mais si depuis 2002 il aura alternativement traité de l’avortement, des liens parfois étroits entre religieux et superstition, ou encore des arrangements déraisonnables qui lestent l’ascenseur social de son pays, on aurait tort de décrire l’auteur comme un ascétique doloriste. La vibration inquiète qui a toujours porté ses films est surmultipliée dans R.M.N.. Pourtant, au premier abord, l’ensemble semble vouloir nous happer par la précision et la rigueur quasi-documentaire avec laquelle il aborde une problématique humaine et économique spécifique, à savoir le mouvement d’écartèlement vécu par des régions, dont la population active masculine s’expatrie pour travailler dans d’autres pays de l’Union européenne, contraignant leur localité d’origine à “importer” des travailleurs, souvent accueillis dans un climat de tension, voire de franc racisme. (…) La force première de R.M.N. est de feindre un geste naturaliste, dont on devine que la photographie comme les décors usent au maximum d’éléments réels, pour mieux laisser un sens de la dramaturgie (qui emprunte volontiers au réalisme magique, voire à l’horreur) s’insinuer comme un lent poison. En témoignent ces plans fixes qui pourraient n’être que d’innombrables pastilles grisâtres, mais dont l’étrangeté finit systématiquement par impressionner. Le monde qu’habite Matthias est saturé de violence, pollution qui a contaminé l’existant bien avant que notre anti-héros n’entame son chemin de croix. Dès l’ouverture, la lumière blafarde de l’abattoir, le son mat des coups sur les chairs dévitalisées de bovins… tout concourt à nous entraîner par petites, mais irrésistibles touches dans une réalité viciée, contaminée. Sous nos yeux, la Transylvanie de Mungiu dévisse, se dérègle et se complexifie. Le titre de l’œuvre nous intéresse puisqu’il peut à la fois se comprendre comme un quasi-acronyme de “Roumanie”, tandis qu’il s’entend aussi comme la traduction roumaine d’IRM. Examen que subit le père du protagoniste. Vieil homme à l’apparence paisible, harmonieuse, dont la santé se dégrade, son corps pourrissant par la tête. Et son fils de scruter, entre horreur et fascination, les clichés de son cerveau, comme pour détecter quelque insondable secret. (…) Connu pour un usage rigoureux et parfois sidérant de plans-séquences orchestrés autour d’un plan fixe, le metteur en scène propose ici une série de moments hallucinants. Le plus évident demeurera un conseil municipal (pas exactement un haut-lieu du romanesque sur grand écran) au cours duquel, à la faveur d’un cadre unique, toutes les passions mauvaises qui gangrènent les personnages vont entrer en éruption. L’image se compose autour des mains nouées de deux amants clandestins, qui jouent simultanément leur avenir amoureux et professionnel. Autour d’eux, fusent bientôt questionnements et invectives, une partie des habitants exigeant le départ des travailleurs étrangers, une autre fraction craignant que leur éviction ne s’accompagne de violences racistes, tout en menaçant le fragile équilibre économique de la région. Les arguments fusent, les faciès se croisent, se toisent et se tordent. (…) Finalement plus autopsie qu’examen médical, R.M.N. dresse un portrait terrible de la Roumanie. Pour autant, le scénario comme le filmage se gardent bien de trouver des coupables faciles ou monochromatiques à la putrescence qui menace de toute part. Le libéralisme inhumain est pointé du doigt, sans dissimuler non plus combien les mauvaises volontés individuelles ou désirs de dévoyer certains dispositifs sont au moins aussi responsables de la progression des haines. Personne n’échappe ni à la lumière ni aux ténèbres. Matthias n’est pas un homme hostile à des travailleurs étrangers dont il a partagé la condition, mais l’idée que sa maîtresse lui porte assistance éveille en lui une masculinité dominatrice et prédatrice. Le prêtre voudrait rassembler ses ouailles dans la paix et l’amour de leur prochain. De leur prochain, mais pas des Sri Lankais qu’il est prêt à sacrifier pour sauvegarder sa popularité. Csilla rêve de violon et d’émancipation, mais demeure l’exécutrice des basses-oeuvres d’une firme faisant des humains du bétail. « Pour survivre, il faut être impitoyable », explique tranquillement un père à son fils. Et les loups de sortir, vêtus de leurs capuches blanches et armés de torches, comme autant de spectres ou de monstres anciens, postés à la frontière entre lumière et ténèbres, pour mieux mordre qui aura l’inconséquence de s’approcher pour mieux les ramener à l’humanité. Et le film de le devenir radicalement dans son dernier mouvement, où le rideau du réel se déchire purement et simplement. (…) Ce que montre Mungiu, c’est le surgissement de ce que l’humanité a toujours voulu repousser, contenir loin de ses villes, de ses champs, de ses rêves, une forme d’animalité et de monstruosité qu’un XXIe siècle vorace et impitoyable convoque, et dont le surgissement est désormais imminent. Thierry Cheze
Si les cinéphiles connaissent la Transylvanie, c’est surtout parce que c’est dans cette région de la Roumanie qu’était censé habiter le comte Dracula, le héros de l’écrivain irlandais Bram Stoker et le personnage principal d’un grand nombre de films. La Transylvanie, toutefois, n’est pas que cela, c’est aussi une région que son histoire a rendu pluriethnique, même si elle l’est moins aujourd’hui qu’il y a un siècle. C’est ainsi que, dans la petite ville de Transylvanie où nous entraine Cristian Mungiu, cohabitent des populations roumaines, hongroises et allemandes, des gens de religions différentes, des gens qui, entre eux, parlent des langues différentes mais des gens qui, finalement, donnent l’impression de bien s’entendre. Comme beaucoup d’habitants de cette petite ville, Matthias était allé travailler à l’étranger et le voici de retour d’Allemagne à quelques jours de Noël, lui qui n’a pas supporté d’être traité de gitan par un collègue. A titre personnel, il s’inquiète pour Rudi, son fils de 8 ans, qui, en son absence, a pris de mauvaises habitudes et qui a peur d’aller seul à l’école car il a vu sur le chemin des choses qui l’ont effrayé. Il s’inquiète aussi pour Otto, son père, un homme âgé qui s’inquiète pour ses moutons, et il a hâte de retrouver Csilla, une femme de la communauté hongroise, qui était sa maîtresse avant son départ à l’étranger. Quant à la petite ville, elle est en train de prendre de plein fouet les méfaits de la mondialisation : en Roumanie, les salaires sont très bas par rapport aux autres pays européens et la population locale en âge de travailler préfère le plus souvent partir occuper un poste à l’étranger plutôt que d’en chercher un sur place. Comment, dans ces conditions, Csilla peut-elle arriver à embaucher du personnel dans la boulangerie industrielle qu’elle dirige, dans le but de dépasser le nombre de 50 employés et permettre ainsi l’obtention d’une subvention de l’Union Européenne ? En engageant des hommes ou des femmes venant de pays plus pauvres que la Roumanie, des sri-lankais, par exemple ? Sauf que les habitants de la ville qui refusent les salaires de misère qu’on leur propose sur place ne veulent pas entendre parler de l’installation chez eux d’une population venant de l’autre bout du monde et ils se liguent pour obtenir leur départ. Entourée d’une forêt épaisse et de collines, la petite ville roumaine dans laquelle se déroule l’action a tendance à vivre en vase clos. Certes, des communautés d’origines différentes, de langues différentes, de religions différentes arrivent à y vivre de façon cordiale les unes avec les autres, mais cette situation dure depuis longtemps et les antagonismes qui ont très probablement existé dans le passé ont petit à petit disparu. Par contre, il n’est pas question d’accueillir à bras ouverts une nouvelle communauté, qui plus est venant de très loin : dans cet environnement étriqué, tout nouvel arrivant est considéré comme un éventuel ennemi. En fait, des évènements à peu près similaires à ceux que raconte le film se sont réellement déroulés en Transylvanie dans les années précédant la pandémie. Il est bon de se rappeler, toutefois, que de telles situations sont loin d’être une exclusivité de la Roumanie et que, malheureusement, on les retrouve, plus ou moins prononcées, un peu partout dans le monde, ne serait-ce que dans notre beau pays. En fait, attirés par les salaires de l’ouest de l’Europe, de nombreux roumains acceptent d’y être mal accueillis, d’être rejetés comme l’a été Matthias, et, simultanément, rejettent avec force les populations du tiers-monde qui viennent occuper les postes qu’ils considèrent comme sous-payés et dont ils ne veulent pas. (…) R.M.N., le titre original du film, dit tout sur ce que voulait montrer le réalisateur : Rezonanta Magnetica Nucleara en roumain, Imagerie par résonance magnétique, IRM, en français, une technique qui permet de détecter ce qui se passe sous la surface. Tant au niveau de cette histoire que d’un point de vue cinématographique, le point d’orgue de R.M.N. se niche dans une grande assemblée publique qui réunit dans une salle municipale, sur le sort à réserver aux travailleurs sri-lankais, une très grande partie de la population et où cours de laquelle s’expriment des discours racistes et xénophobes à l’encontre des gitans et des immigrés : un plan séquence de 17 minutes avec une intervention orale de la part de 26 personnes, dont un prêtre qui n’est pas le dernier dans le discours haineux. Pour arriver au résultat recherché par le réalisateur, plus de 20 prises ont été nécessaires, sur une durée de 48 heures. Alors que les rôles secondaires sont interprétés par des non professionnels, les rôles principaux de R.M.N. sont tenus par des acteurs professionnels, dont Marin Grigore dans le rôle de Matthias et Judith Slate dans celui de Csilla (…) Vu le contexte général de l’histoire, un grand nombre de langues sont parlées dans le film : roumain, hongrois, allemand, sinhala, la langue des sri-lankais, anglais, puisque le film parle des effets de la mondialisation, français, puisqu’un français est là, dépêché par la Commission Européenne pour faire le décompte des ours de la région. A noter qu’un effort à base de couleurs différentes a été fait pour distinguer les langues au niveau du sous-titrage. (…) A partir d’une histoire qui se déroule dans une région isolée de la Roumanie, [Cristian Mungiu] embrasse un sujet malheureusement universel, le rejet de l’autre, le rejet de celui que l’on ne connait pas, le rejet de celui qui vient d’ailleurs. Jean-Jacques Corrio
Devinez pourquoi avec son démontage magistral de l’actuel politiquement correct Cristian Mungiu est revenu bredouille du Festival de Cannes l’an dernier ?
« Portrait au vitriol d’une Roumanie xénophobe », « scanner, auscultation ou radiographie de la xénophobie ordinaire » …
« Ravages des populismes », « nationalisme », « rejet de l’autre », « virilisme gueulard en peau de bêtes et du fusil de chasse », « fascisme en gésine », « obsession de l’invasion et du grand remplacement »…
Héros rustre et taciturne, impulsif ayant fui son pays aux emplois sous-payés pour une Allemagne qui le traite de gitan ….
Petit garçon, mutique depuis une rencontre traumatisante dans la forêt …
Berger vieillissant et malade qui voit son troupeau décimé par les ours et ne trouvant d’issue que dans le suicide …
Ou acceptant plutôt de finir en agneau sacrificiel, en cette nuit de Noël, pour éviter le lynchage que l’on sentait venir des trois étrangers …
Ancienne maîtresse numéro 2 d’une boulangerie industrielle rêvant, entre verre de vin français et morceau de violoncelle, émancipation et vie associative …
Mais exécutrice des basses-oeuvres d’une firme seule entreprise dynamique du coin mais faisant des humains du bétail, mais aux salaires trop bas pour les jeunes locaux, qui ont préféré partir vers l’ouest …
Main-d’œuvre étrangère importée jusque du Sri-Lanka pour remplacer les locaux ayant quitté leur pays pour cause de bas salaires ..
Village isolé de la forêt transylvanienne du légendaire Dracula, à l’histoire à peine pacifiée d’une histoire mouvementée entre des minorités de langues (hongroise, allemande et roumaine) et de religion (catholique, luthérienne et orthodoxe) différentes…
Mais à présent dévorée par le ressentiment, suite à sa paupérisation via la fermeture d’une mine d’or qui sous Ceausescu avait noyé et détruit l’environnement sous une eau remplie de cyanure …
Prêtre roulant en Mercedes prêt à sacrifier, sur fond de fêtes de Noël mêlant appel chrétien à la bienveillance universelle et processions au flambeau et en peaux d’ours, les nouveaux venus pour sauvegarder sa popularité…
Mondialisation et Union européenne incarnées par un zoologiste français anglophone et membre d’une ONG pour la préservation de la vie sauvage …
Venu « protéger », derrière la « belle diversité » annoncée, les ours mêmes qui dévastent les troupeaux des bergers du coin ..
Tout en prêchant un vivre ensemble qu’entre deux massacres, la France elle-même est incapable de réaliser …
Reprise d’une scène qui existait déjà sur Internet et avait fait scandale pour avoir mis en lumière des choses que personne ne voulait voir …
Comment ne pas être épaté, à l’instar de l’incroyable et inextricable complexité qu’est devenu notre monde, du nombre d’éléments, à la fois économiques, culturels, religieux, historiques et anthropologiques …
Que, mêlant habilement le plus grand naturalisme et le réalisme magique, le réalisateur roumain Cristian Mungiu a réussi à réunir dans cette histoire d’expulsion impossible (R.M.N. comme à la fois le terme roumain pour nos IRM et l’acronyme de la Roumanie) …
Et aussi comment contre le politiquement correct de la mondialisation heureuse et du vivre ensemble triomphant …
Il arrive à libérer comme peut-être jamais aussi explicitement dans le cinéma actuel …
La parole des victimes de ladite mondialisation, tout à leur désespoir face au saccage de leurs traditions et de leur mode de vie…
Mais comment ne pas voir aussi l’inévitable contresens de la plupart des critiques, n’y voyant que la dénonciation facile et habituelle de la xénophobie et du racisme ordinaire …
Et comment dès lors s’étonner de la sorte d’expulsion qu’a subi à son tour ce palmé d’or de Cannes et habitué multi-récompensé de ces temples du politiquement correct que sont devenus les grands festivals du cinéma mondiaux…
En en revenant pour la première fois bredouille l’an dernier ?
Cristian Mungiu : « Avec RMN, j’ambitionne de raconter la complexité de notre époque »
Thierry Cheze
Première
18/10/2022
Le cinéaste roumain décrypte le saisissant plan séquence de 17 minutes au cœur de son nouveau film qui ausculte la xénophobie ordinaire dans un petit village de Transylvanie.
RMN raconte comment, dans un village multi-ethnique de Transylvanie, l’embauche dans une usine locale de travailleurs venus du Sri- Lanka va faire exploser les haines de classe, de religion et de race enfouies depuis des années. Un film sur la xénophobie ordinaire au cœur duquel on trouve un plan-séquence renversant de 17 minutes captant la réunion municipale où se décide si les Sri-Lankais doivent quitter le village ou non. Comment naît ce plan- séquence à l’écriture ?
Cristian Mungiu : Je savais dès le départ que cette scène serait capitale pour le film. Et pour l’écrire, je me base d’abord sur mes recherches. J’ai ainsi découvert que l’équivalent de cette scène existait sur Internet et avait d’ailleurs fait scandale lors de sa mise en ligne. Comme si ces échanges avaient mis en lumière des choses que personne ne voulait voir, alors que ceux qui l’ont mis en ligne l’avaient fait de manière tout à fait naïve sans se douter de ce que ça allait provoquer. Et ce que je trouve passionnant dans ce type de réunion, c’est la transformation de chaque individu au contact du groupe. Voilà pourquoi je voulais montrer le maximum de personnages à l’intérieur de cette scène. Le tout sans perdre le spectateur ni leur dire quoi penser.
Pourquoi le choix du plan-séquence pour capter ce moment ?
Pour respecter le continuum de la réalité et pour responsabiliser en quelque sorte le spectateur, en lui laissant le choix d’à travers qui suivre ces moments. Je ne l’oriente pas en passant par des champs contre-champs. Alors que je sais qu’aujourd’hui, on a plutôt tendance à pré-mâcher les choses. Je me sens à contre-courant en écrivant, tournant et montant R.M.N. et j’en ai pleinement conscience. Pour moi, s’il veut raconter la réalité, le cinéma ne peut pas diviser le monde en blanc et noir. Et c’est dans cette logique-là que cette scène est un pivot
Est-ce qu’une telle scène a inquiété vos producteurs ?
Pas vraiment. Mais j’ai dû leur expliquer ce que je voulais faire car ils craignaient que ce soit un film dans le film, une sorte de reportage filmé qui détonne avec le reste. Moi, j’avais exactement ce que je voulais en tête mais ce n’était pas simple de le formuler. A part une chose : le fait que, pendant tout ce plan-séquence, je n’allais jamais perdre de vue mon personnage central donc le fil de mon récit. Ce fut même la base de ma mise en scène. Mais par celle-ci, je devais aussi trouver le moyen de raconter ce que je cherchais à montrer : le rapport entre l’intimité et la société d’aujourd’hui. Car je trouve qu’il existe une grande différence – plus importante qu’avant – entre ce qu’on dit dans l’intimité et en public. Beaucoup s’autocensurent. Or, avec cette réunion, c’est l’inverse, il faut que les gens s’expriment et mettent tout sur la table pour régler les problèmes.
Cette scène a-t’elle beaucoup évolué entre son écriture et le tournage ?
Oui parce qu’il faut s’adapter aux moyens qu’on a. Dans le scénario, la scène faisait 26 pages. Mais quand j’ai su que j’aurais seulement une journée pour répéter et deux jours pour la tourner, j’ai pris la décision de la réduire pour tenir les délais. Et ce en m’appuyant sur son essence-même, le fait que tout le monde parle en même temps et que personne n’écoute personne. J’ai donc choisi de mêler les dix premières pages puis j’ai entraîné les comédiens à parler les uns sur les autres. En ayant évidemment conscience de la prouesse technique que cela allait nécessiter de mon équipe son pour parvenir à tout capter et le rendre intelligible. Et le jour J, sur le plateau, j’ai demandé à tout le monde quelques heures de réflexion. Je me suis servi de morceaux de bois en les mettant au sol pour créer les positions et le mouvement que j’allais avoir à faire. Pour jouer aussi avec la lumière. Tout un travail qui doit être invisible aux yeux des spectateurs
Qu’avez-vous dit précisément à vos comédiens ?
Je leur ai envoyé un message la veille pour leur dire que ça allait être la scène la plus compliquée que j’ai jamais tournée dans un film et que cela serait sans doute la même chose pour eux. Je leur ai donc demandé de savoir leurs dialogues par cœur en leur assurant qu’à partir de là, je me débrouillerai, mais que sans cela, la scène irait droit dans le mur. Mais, le lendemain, j’ai tout de suite senti que les premières réactions des figurants ne donnaient pas aux comédiens l’énergie nécessaire. Je suis alors allé les voir et leur parler comme s’ils n’étaient plus des figurants mais des interprètes à part entière. Je leur ai donc laissé la possibilité de s’exprimer et ce faisant je les ai responsabilisés. Ca été un bordel sans nom au départ mais j’ai régulé tout ça et très vite, ça a donné une impulsion aux comédiens qui devaient s’imposer davantage. Puis, au fil des prises, je régulais le niveau des réactions comme un chef d’orchestre, ayant aussi besoin de moments de silence, et ce en changeant mes habitudes puisque d’habitude je reste derrière mon moniteur. Et pour que ceux qui ne soient plus dans le champ restent concentrés, j’ai inventé une deuxième caméra qui faisait partie intégrante de la scène avec un personnage de journaliste. Il était clair que je ne me servirai pas de ces images mais cela a changé l’implication des comédiens.
Comment s’est passée la post-production de cette scène ?
En tournant, je n’entendais pas tout ce que les gens disaient. Juste un mix dans le casque. C’est donc en post- production que j’ai écouté les pistes une par une et là j’ai entendu que tout ce petit monde avait dit des choses extrêmement intéressantes qui ne figuraient pas dans le scénario. J’ai pu les réintégrer. Le mixeur a eu un travail titanesque à faire. Ca peut servir de cas d’étude à la FEMIS ! (rires)
Qu’est ce qui vous plait au final dans cette scène telle qu’elle existe à l’écran ?
Le fait qu’elle soit différente selon le personnage que vous allez choisir de suivre. Qu’elle puisse se lire et se voir de plein de façons. J’aime aussi son côté polyphonique et l’énergie qui va avec. Une dynamique qui épouse ce qui se passe dans nos sociétés actuelles et qui ambitionne d’en retranscrire la complexité. Cette complexité qui existe en chacun de nous entre notre côté animal et notre côté raisonnable. Je comprends que certains décrochent mais sans cette complexité, RMN n’aurait aucun intérêt.
Voir aussi:
R.M.N. : critique qui a vu la bête
Simon Riaux
Ecran large
18 octobre 2022
Multi-primé depuis le début de sa carrière, Cristian Mungiu est de retour avec R.M.N., une plongée suffocante au coeur de la Roumanie. Au sein d’une ville dont tous les liants communautaires sont effilochés par un ordre libéral et supra-national incompréhensible, le metteur en scène chronique une inexorable spirale de folie et de mort.
Dans les bois, sur le chemin de l’école, Rudi a vu quelque chose. Ou quelqu’un. Quoique ce fût, sa découverte a marqué l’enfant assez profondément pour transformer son quotidien dans une petite ville de Transylvanie en un long flux d’irrépressibles angoisses. Angoisses qui décontenancent sa mère, aussi bien que son père, Matthias, de retour après avoir vécu à Berlin en tant que travailleur détaché des mois durant.
Les récits portés par Cristian Mungiu, ambassadeur du cinéma roumain depuis tout juste deux décennies, ont toujours cherché, explorent les contradictions qui minent le corps social, quitte à le pousser à une forme d’auto-prédation terrible. Non-dits, révoltes rentrées ou compromissions insolubles, son cinéma a toujours pris le pouls de la société roumaine. Mais si depuis 2002 il aura alternativement traité de l’avortement, des liens parfois étroits entre religieux et superstition, ou encore des arrangements déraisonnables qui lestent l’ascenseur social de son pays, on aurait tort de décrire l’auteur comme un ascétique doloriste.
Le miracle économique allemand
La vibration inquiète qui a toujours porté ses films est surmultipliée dans R.M.N.. Pourtant, au premier abord, l’ensemble semble vouloir nous happer par la précision et la rigueur quasi-documentaire avec laquelle il aborde une problématique humaine et économique spécifique, à savoir le mouvement d’écartèlement vécu par des régions, dont la population active masculine s’expatrie pour travailler dans d’autres pays de l’Union européenne, contraignant leur localité d’origine à “importer” des travailleurs, souvent accueillis dans un climat de tension, voire de franc racisme.
Le sujet est complexe, ultra-contemporain, tandis que les conditions de tournage du métrage (au beau milieu de la crise sanitaire internationale) le contraignent, a priori, à opter pour des dispositifs de mise en scène légers, au plus près du réel. Soit la recette d’une sécheresse souvent caricaturée par un public qui aime à tancer les “films roumains”, quand bien même il a rarement l’occasion d’en découvrir. Mais R.M.N. déjoue toutes les attentes : la nouvelle création de Cristian Mungiu est une des propositions de cinéma les plus puissantes, débordantes d’idées et de style qu’on ait vu depuis bien longtemps.
Qu’a-t-il vu qui aurait rendu un autre fou ?
La force première de R.M.N. est de feindre un geste naturaliste, dont on devine que la photographie comme les décors usent au maximum d’éléments réels, pour mieux laisser un sens de la dramaturgie (qui emprunte volontiers au réalisme magique, voire à l’horreur) s’insinuer comme un lent poison. En témoignent ces plans fixes qui pourraient n’être que d’innombrables pastilles grisâtres, mais dont l’étrangeté finit systématiquement par impressionner. Le monde qu’habite Matthias est saturé de violence, pollution qui a contaminé l’existant bien avant que notre anti-héros n’entame son chemin de croix. Dès l’ouverture, la lumière blafarde de l’abattoir, le son mat des coups sur les chairs dévitalisées de bovins… tout concourt à nous entraîner par petites, mais irrésistibles touches dans une réalité viciée, contaminée.
Sous nos yeux, la Transylvanie de Mungiu dévisse, se dérègle et se complexifie. Le titre de l’œuvre nous intéresse puisqu’il peut à la fois se comprendre comme un quasi-acronyme de “Roumanie”, tandis qu’il s’entend aussi comme la traduction roumaine d’IRM. Examen que subit le père du protagoniste. Vieil homme à l’apparence paisible, harmonieuse, dont la santé se dégrade, son corps pourrissant par la tête. Et son fils de scruter, entre horreur et fascination, les clichés de son cerveau, comme pour détecter quelque insondable secret.
L’amour au premier regard sur le contrat de travail
C’est dans ces instants suspendus que le style de Mungiu est le plus reconnaissable. Distinct, mais certainement pas dans un geste de répétition, car atteignant pour la première fois un degré d’incandescence ainsi qu’une puissance évocatrice qui font de cette fable amère un objet de cinéma purement sensitif, difficilement catégorisable. Connu pour un usage rigoureux et parfois sidérant de plans-séquences orchestrés autour d’un plan fixe, le metteur en scène propose ici une série de moments hallucinants. Le plus évident demeurera un conseil municipal (pas exactement un haut-lieu du romanesque sur grand écran) au cours duquel, à la faveur d’un cadre unique, toutes les passions mauvaises qui gangrènent les personnages vont entrer en éruption.
L’image se compose autour des mains nouées de deux amants clandestins, qui jouent simultanément leur avenir amoureux et professionnel. Autour d’eux, fusent bientôt questionnements et invectives, une partie des habitants exigeant le départ des travailleurs étrangers, une autre fraction craignant que leur éviction ne s’accompagne de violences racistes, tout en menaçant le fragile équilibre économique de la région. Les arguments fusent, les faciès se croisent, se toisent et se tordent. Le dispositif pourrait n’être qu’un happening austère, si Mungiu ne parvenait pas, dans ce cadre traversé de morceau de bravoure de ces comédiens 18 minutes durant, à transformer soudain tout l’espace filmique en une terrifiante dimension carcérale.
Quand le corps social pourrit de l’intérieur
Finalement plus autopsie qu’examen médical, R.M.N. dresse un portrait terrible de la Roumanie. Pour autant, le scénario comme le filmage se gardent bien de trouver des coupables faciles ou monochromatiques à la putrescence qui menace de toute part. Le libéralisme inhumain est pointé du doigt, sans dissimuler non plus combien les mauvaises volontés individuelles ou désirs de dévoyer certains dispositifs sont au moins aussi responsables de la progression des haines. Personne n’échappe ni à la lumière ni aux ténèbres.
Matthias n’est pas un homme hostile à des travailleurs étrangers dont il a partagé la condition, mais l’idée que sa maîtresse lui porte assistance éveille en lui une masculinité dominatrice et prédatrice. Le prêtre voudrait rassembler ses ouailles dans la paix et l’amour de leur prochain. De leur prochain, mais pas des Sri Lankais qu’il est prêt à sacrifier pour sauvegarder sa popularité. Csilla rêve de violon et d’émancipation, mais demeure l’exécutrice des basses-oeuvres d’une firme faisant des humains du bétail.
Quand le violon scelle
« Pour survivre, il faut être impitoyable », explique tranquillement un père à son fils. Et les loups de sortir, vêtus de leurs capuches blanches et armés de torches, comme autant de spectres ou de monstres anciens, postés à la frontière entre lumière et ténèbres, pour mieux mordre qui aura l’inconséquence de s’approcher pour mieux les ramener à l’humanité.
Et le film de le devenir radicalement dans son dernier mouvement, où le rideau du réel se déchire purement et simplement. R.M.N. verse-t-il alors dans la démence pure, dans l’expérimentation, s’assume-t-il finalement comme un pur film d’horreur ? Une allégorie ? Il revient au spectateur de prendre la responsabilité de trancher, face à une conclusion hypnotique, inattendue, brutale et surtout terrifiante. Ce que montre Mungiu, c’est le surgissement de ce que l’humanité a toujours voulu repousser, contenir loin de ses villes, de ses champs, de ses rêves, une forme d’animalité et de monstruosité qu’un XXIe siècle vorace et impitoyable convoque, et dont le surgissement est désormais imminent.
Voir également:
Critique : R.M.N.
Jean-Jacques Corrio
Critique
15 octobre 20220
S’il n’est pas particulièrement prolifique, avec seulement 5 longs métrages en 20 ans, le réalisateur roumain Cristian Mungiu peut se vanter qu’ils aient été tous les 5 présents au Festival de Cannes, dont 4 en compétition officielle. L’un d’entre eux, 4 mois, 3 semaines, 2 jours, a été récompensé de la Palme d’Or en 2007, Au delà des collines a obtenu le Prix du scénario et un double prix d’interprétation féminine en 2012 et Baccalauréat est reparti avec le Prix de la mise en scène en 2016. De nouveau en compétition cette année avec R.M.N., Cristian Mungiu est, cette fois ci, reparti bredouille malgré la grande qualité de son film.
Synopsis : Quelques jours avant Noël, Matthias est de retour dans son village natal, multiethnique, de Transylvanie, après avoir quitté son emploi en Allemagne. Il s’inquiète pour son fils, Rudi, qui grandit sans lui, pour son père, Otto, resté seul et il souhaite revoir Csilla, son ex-petite amie. Il tente de s’impliquer davantage dans l’éducation du garçon qui est resté trop longtemps à la charge de sa mère, Ana, et veut l’aider à surpasser ses angoisses irrationnelles. Quand l’usine que Csilla dirige décide de recruter des employés étrangers, la paix de la petite communauté est troublée, les angoisses gagnent aussi les adultes. Les frustrations, les conflits et les passions refont surface, brisant le semblant de paix dans la communauté.
Le retour de Matthias
Si les cinéphiles connaissent la Transylvanie, c’est surtout parce que c’est dans cette région de la Roumanie qu’était censé habiter le comte Dracula, le héros de l’écrivain irlandais Bram Stoker et le personnage principal d’un grand nombre de films. La Transylvanie, toutefois, n’est pas que cela, c’est aussi une région que son histoire a rendu pluriethnique, même si elle l’est moins aujourd’hui qu’il y a un siècle. C’est ainsi que, dans la petite ville de Transylvanie où nous entraine Cristian Mungiu, cohabitent des populations roumaines, hongroises et allemandes, des gens de religions différentes, des gens qui, entre eux, parlent des langues différentes mais des gens qui, finalement, donnent l’impression de bien s’entendre. Comme beaucoup d’habitants de cette petite ville, Matthias était allé travailler à l’étranger et le voici de retour d’Allemagne à quelques jours de Noël, lui qui n’a pas supporté d’être traité de gitan par un collègue.
A titre personnel, il s’inquiète pour Rudi, son fils de 8 ans, qui, en son absence, a pris de mauvaises habitudes et qui a peur d’aller seul à l’école car il a vu sur le chemin des choses qui l’ont effrayé. Il s’inquiète aussi pour Otto, son père, un homme âgé qui s’inquiète pour ses moutons, et il a hâte de retrouver Csilla, une femme de la communauté hongroise, qui était sa maîtresse avant son départ à l’étranger. Quant à la petite ville, elle est en train de prendre de plein fouet les méfaits de la mondialisation : en Roumanie, les salaires sont très bas par rapport aux autres pays européens et la population locale en âge de travailler préfère le plus souvent partir occuper un poste à l’étranger plutôt que d’en chercher un sur place. Comment, dans ces conditions, Csilla peut-elle arriver à embaucher du personnel dans la boulangerie industrielle qu’elle dirige, dans le but de dépasser le nombre de 50 employés et permettre ainsi l’obtention d’une subvention de l’Union Européenne ? En engageant des hommes ou des femmes venant de pays plus pauvres que la Roumanie, des sri-lankais, par exemple ? Sauf que les habitants de la ville qui refusent les salaires de misère qu’on leur propose sur place ne veulent pas entendre parler de l’installation chez eux d’une population venant de l’autre bout du monde et ils se liguent pour obtenir leur départ.
Un comportement malheureusement universel
Entourée d’une forêt épaisse et de collines, la petite ville roumaine dans laquelle se déroule l’action a tendance à vivre en vase clos. Certes, des communautés d’origines différentes, de langues différentes, de religions différentes arrivent à y vivre de façon cordiale les unes avec les autres, mais cette situation dure depuis longtemps et les antagonismes qui ont très probablement existé dans le passé ont petit à petit disparu. Par contre, il n’est pas question d’accueillir à bras ouverts une nouvelle communauté, qui plus est venant de très loin : dans cet environnement étriqué, tout nouvel arrivant est considéré comme un éventuel ennemi. En fait, des évènements à peu près similaires à ceux que raconte le film se sont réellement déroulés en Transylvanie dans les années précédant la pandémie. Il est bon de se rappeler, toutefois, que de telles situations sont loin d’être une exclusivité de la Roumanie et que, malheureusement, on les retrouve, plus ou moins prononcées, un peu partout dans le monde, ne serait-ce que dans notre beau pays. En fait, attirés par les salaires de l’ouest de l’Europe, de nombreux roumains acceptent d’y être mal accueillis, d’être rejetés comme l’a été Matthias, et, simultanément, rejettent avec force les populations du tiers-monde qui viennent occuper les postes qu’ils considèrent comme sous-payés et dont ils ne veulent pas.
Une mise en scène virtuose
C’est dans une mise en scène très virtuose, utilisant le plan séquence avec maestria, que Cristian Mungiu nous raconte l’histoire de cette petite ville roumaine sombrant dans le racisme et la xénophobie. R.M.N., le titre original du film, dit tout sur ce que voulait montrer le réalisateur : Rezonanta Magnetica Nucleara en roumain, Imagerie par résonance magnétique, IRM, en français, une technique qui permet de détecter ce qui se passe sous la surface. Tant au niveau de cette histoire que d’un point de vue cinématographique, le point d’orgue de R.M.N. se niche dans une grande assemblée publique qui réunit dans une salle municipale, sur le sort à réserver aux travailleurs sri-lankais, une très grande partie de la population et où cours de laquelle s’expriment des discours racistes et xénophobes à l’encontre des gitans et des immigrés : un plan séquence de 17 minutes avec une intervention orale de la part de 26 personnes, dont un prêtre qui n’est pas le dernier dans le discours haineux. Pour arriver au résultat recherché par le réalisateur, plus de 20 prises ont été nécessaires, sur une durée de 48 heures.
Alors que les rôles secondaires sont interprétés par des non professionnels, les rôles principaux de R.M.N. sont tenus par des acteurs professionnels, dont Marin Grigore dans le rôle de Matthias et Judith Slate dans celui de Csilla, un comédien et une comédienne déjà rencontré.e.s chez Cristi Puiu pour l’un, chez Cristi Puiu et Marius Olteanu pour l’autre. Vu le contexte général de l’histoire, un grand nombre de langues sont parlées dans le film : roumain, hongrois, allemand, sinhala, la langue des sri-lankais, anglais, puisque le film parle des effets de la mondialisation, français, puisqu’un français est là, dépêché par la Commission Européenne pour faire le décompte des ours de la région. A noter qu’un effort à base de couleurs différentes a été fait pour distinguer les langues au niveau du sous-titrage.
Conclusion
Une fois de plus, Cristian Mungiu prouve par le sujet qu’il a choisi et par sa mise en scène, qu’il est un des grands réalisateurs de notre époque. A partir d’une histoire qui se déroule dans une région isolée de la Roumanie, il embrasse un sujet malheureusement universel, le rejet de l’autre, le rejet de celui que l’on ne connait pas, le rejet de celui qui vient d’ailleurs. Par rapport au niveau de qualité très élevé de la plus grande partie du film, on regrettera les choix faits par le réalisateur pour le conclure, choix qui laissent les spectateurs dans le flou, chacun pouvant y aller de sa propre interprétation. Même si on peut apprécier qu’une fin ouverte nous soit offerte, on aurait aimé qu’elle soit mieux présentée !
Voir de même:
Jacques Morice
Télérama
18/10/2022
Traité de “sale Gitan” en Allemagne, un homme revient dans son village de Transylvanie, où couve aussi la violence xénophobe. Une fresque magistrale.
Dissipons la perplexité possible devant le titre. RMN est le sigle en roumain d’IRM (l’imagerie par résonance magnétique), soit un scanner très précis, cérébral en général. Radiographier le mal ou la maladie, c’est le projet du cinéaste, à l’échelle d’un village de Transylvanie, à la population multiethnique. Matthias y revient précipitamment, après avoir cogné son chef qui l’avait traité de « sale Gitan », en Allemagne, où il travaillait durement, dans un abattoir. Il n’est pas vraiment le bienvenu chez lui. Sa femme, qui élève seule leur fils, tient à garder ses distances : Matthias est un homme rustre et taciturne, impulsif. Humain malgré tout ? Il s’inquiète en tout cas pour la santé de son garçon, mutique depuis une rencontre traumatisante dans la forêt dont il ne veut rien dire. Et pour celle de son père, un berger vieillissant et malade. Le seul réconfort que le personnage semble trouver est entre les bras de Csilla, son ancienne maîtresse. Elle est la numéro 2 d’une boulangerie industrielle, seule entreprise dynamique du coin, mais aux salaires trop bas pour les jeunes locaux, qui ont préféré partir vers l’ouest. Csilla a donc fait appel à de la main-d’œuvre étrangère, deux Sri-Lankais parlant l’anglais. Elle les accueille, en leur trouvant un logement, chez des amis. Les nouveaux venus travaillent bien mais suscitent vite au sein de la communauté, paupérisée, mécontentement et ressentiment. La violence xénophobe menace alors d’embraser le village.
Il n’est pas question pour Cristian Mungiu (4 Mois, 3 semaines, 2 jours) de la justifier, mais bien de la décortiquer, en exposant de manière magistrale les ressorts multiples qui l’alimentent. On écrit « magistrale », car le nombre d’éléments, à la fois économiques, culturels, religieux, anthropologiques, qu’il est parvenu à réunir force le respect. Ambitieuse est cette fresque, où l’on parle au moins cinq langues. Où se réfléchit le poids de l’histoire de la Transylvanie, avec un éclairage sur ses minorités — hongroises et allemandes. Et où sont montrés avec une ironie mordante les effets pervers de l’Union européenne et de la mondialisation.
Tout cela pourrait s’avérer indigeste, mais le film reste étonnamment fluide, captivant de bout en bout, la fiction intime solidement chevillée à l’intrigue. On suit partout les deux personnages, Matthias et Csilla, au travail, en famille, chez le médecin ou dans l’alcôve. Le privé et le public, le particulier et l’universel restent liés. Quant aux conflits, ils sont aussi intérieurs : le versatile Matthias ne sait plus très bien à quel camp lui-même appartient. R.M.N. montre comment chacun peut très vite se retrouver « le sale Gitan » d’un autre. Et comment la bête raciste tapie en nous peut se réveiller à tout moment, si on laisse les bas instincts prendre le dessus sur la raison.
La peur de l’autre, de la nuit, des animaux traverse le film. Une peur implacable mais aussi grotesque, risible. L’atout majeur de R.M.N. réside sans doute dans son alliage de noirceur terrible et de farce absurde. Qui culmine dans la scène de la salle communale, où les habitants prennent à tour de rôle la parole pour débattre du sort des immigrés. Un formidable morceau de bravoure — dix-sept minutes de plan-séquence — pour un grand déballage, un théâtre de l’invective, de la rancœur, de la zizanie. On repense alors à ces vieux westerns qui finissent en bataille rangée, pire, en curée punitive. Mais celui-ci, glaçant, évoque l’ici et maintenant, un peu partout en Europe. Pourtant, dans une ultime pirouette, Cristian Mungiu réfute le pessimisme, en montrant ce que la nuit recèle aussi de profondeur énigmatique… Pas si loin, étrangement, de la magie de Noël.
Voir aussi:
Cannes : avec “R.M.N.”, Cristian Mungiu passe au scanner la xénophobie ordinaire
Télérama
COMPÉTITION – Le cinéaste roumain, lauréat de la palme d’or en 2007, revient sur la Croisette avec une chronique implacable des ravages du nationalisme dans un village de Transylvanie. Magistral
Impossible, au bout de cinq jours de festival de Cannes, de savoir quel prix le jury présidé par Vincent Lindon décernera (ou pas) à R.M.N. samedi 28 mai. Mais le nouveau film de Cristian Mungiu décroche déjà la palme du titre le plus énigmatique de cette soixante-quinzième édition. À moins de parler le roumain couramment… R.M.N. (merci le dossier de presse !) est l’acronyme local de notre IRM, l’Imagerie par résonance magnétique, autrement dit le scanner cérébral qui permet de révéler la maladie derrière la surface.
Soit une bonne définition du cinéma de Cristian Mungiu qui, depuis ses débuts, diagnostique avec sa mise en scène au scalpel les maux de la société roumaine d’hier et d’aujourd’hui. Après les ravages de la politique nataliste sous la tyrannie de Ceausescu dans 4 mois, 3 semaines, 2 jours (Palme d’or 2007), la violence du pouvoir religieux dans Au-delà des collines (2012) ou la corruption endémique dans Baccalauréat (2016), les ravages du nationalisme et de la xénophobie sont au cœur de R.M.N. Et c’est aussi déprimant sur le plan politique qu’exaltant en termes de cinéma.
Le film se déroule dans un petit village de Transylvanie, la région la plus à l’ouest de la Roumanie, où vivent encore une importante communauté hongroise et une petite minorité allemande. C’est là qu’est né Matthias, et où il revient après avoir perdu son boulot en Allemagne, pour retrouver son jeune fils, son père à la santé défaillante, sa femme avec qui les relations sont polaires et son ex-maîtresse qu’il aimerait bien reconquérir. Comme la quasi-totalité de ses voisins, Matthias refuse de travailler pour la boulangerie industrielle, le seul employeur du coin – mais qui ne paye pas assez… La patronne de l’usine et son adjointe, très impliquée dans la vie associative du village, n’ont d’autre solution que d’embaucher des ouvriers immigrés. Quand le village découvre qu’il s’agit de trois Sri-Lankais, ça coince…
Un plan fixe de dix-sept minutes
R.M.N. est, d’abord, une histoire d’incompréhension liée à la langue – ou, plutôt, aux langues. Le film passe sans arrêt (mais avec des couleurs différentes dans les sous-titres pour s’y retrouver !) du roumain au hongrois, avec quelques répliques en allemand et d’autres en anglais, l’idiome universel utilisé par les « étrangers » de l’histoire, dont, belle ironie, un zoologiste français venu, avec l’argent de l’Union européenne, recenser la population d’ours dans les forêts alentour. Les dialogues, remarquablement écrits et souvent très vifs, révèlent petit à petit le contexte explosif de l’intrigue : le poids de l’Histoire, les discriminations anti-Roms, l’exode massif des jeunes à l’Ouest pour une vie meilleure, et résumant tout cela, la haine d’une Europe perçue, au pire, comme une pseudo-dictature qui exploite le pays comme un vampire et voudrait imposer un mode de vie unique de Porto à Bucarest, au mieux, comme une tirelire à subventions.
Le talent de Mungiu pour les plans-séquences trouve son apogée lorsque les citoyens se réunissent dans la salle communale pour débattre du sort à réserver aux nouveaux venus. Dans ce plan fixe magistral de dix-sept minutes (!), vingt-six personnages différents prennent la parole dans un flot d’invectives ininterrompu. Un grand déballage où toutes les rivalités culturelles ou économiques, tous les antagonismes personnels longtemps en sommeil se réveillent. Et où la haine de l’autre, surtout s’il vient de loin, l’obsession de l’invasion et du « grand remplacement » s’expriment sans la moindre retenue. R.M.N. se déroule en Roumanie mais difficile de ne pas penser à la situation en France ici et maintenant…
Multirécompensé au Festival de Cannes, Cristian Mungiu est reparti bredouille de l’édition 2022 avec un film consacré à l’immigration en Roumanie.
Jacky Bornet
France Télévisions
19/10/2022
Trois fois récompensé à Cannes, avec une Palme d’or pour 4 mois, 3 semaines, 12 jours en 2007, Cristian Mungiu poursuit son analyse de la société roumaine avec R.M.N. qui sort en salles mercredi 19 octobre. Le cinéaste est quelque peu en deçà des attentes en raison d’un manque d’équilibre entre la chronique d’un village roumain pris dans un hiver rigoureux, et la dénonciation de la xénophobie qui y sévit.
Imagerie médicale
Mathias revient d’Allemagne dans son petit village roumain, après avoir fui son travail, suite à une rixe dans son entreprise. Il retrouve son fils perturbé par une vision obsessionnelle, sa compagne qui s’en occupe, son père malade, et son ancienne maîtresse. Quand la boulangerie industrielle locale recrute des étrangers, la population lance une pétition pour les renvoyer chez eux. L’apparente paix civile entre communautés roumaine, hongroise et allemande du village s’en trouve brisée.
Dans tous ses films, Cristian Mungiu explore la société roumaine. Après l’avortement, les années Ceaușescu, la religion et l’éducation, il s’attaque aujourd’hui à la xénophobie qui gangrène le pays suite à la vague migratoire de ces dernières années. Le titre R.M.N. (I. R. M. en roumain) désigne l’imagerie médicale du cerveau du père de Mathias qu’il consulte régulièrement sur son portable. Cette représentation d’un cerveau dégénérescent pourrait renvoyer au logiciel roumain déréglé. Mais l’acronyme du titre fait aussi penser à celui de la Roumanie, comme sur une plaque minéralogique. Il évoquerait alors une Roumanie globale, à travers le cas particulier de ce village roumain. Le bilan n’est pas glorieux.
Déséquilibre
Commençant sur la mystérieuse vision d’un enfant effrayé dans la forêt, R.M.N. suit ensuite Mathias qui retrouve son monde et surtout son fils auquel il veut se consacrer. Mais il est embarrassé par la mère du petit, sa compagne, alors qu’il lui préfère une ex-maîtresse. Le film s’enlise quelque peu dans la chronique de ce village enneigé, traversé d’anecdotes successives anodines dont il ressort une dramaturgie assez pauvre. Pourquoi pas ? Mais l’on se demande où Mungiu veut en venir avec ce collier de perles, aux épisodes répétitifs. Jusqu’à ce que le sujet de fond émerge enfin : l’opposition radicale de la population à la présence de trois étrangers dans le village.
C’est la partie la plus intéressante du film, avec une scène de réunion municipale remarquable, jouée par des acteurs non professionnels qui improvisent leur texte. Mais quel déséquilibre dans la construction et le rythme du film. La scène finale, avec des acteurs grimés en ours est assez ridicule, et donne le coup de grâce à ce qui s’avère le moins bon film d’un cinéaste par ailleurs passionnant.
Voir de plus:
Notre critique de R.M.N, de Cristian Mungiu: il était une fois dans les Carpates
Etienne Sorin
Le Figaro
18/10/2022
Matthias est Roumain. Il est de retour dans son village natal quelques jours avant Noël. Un village de Transylvanie, multiethnique, où l’on parle roumain, hongrois et allemand. Son fils Rudi, lui, ne parle plus depuis qu’il a vu «quelque chose de mal» dans la forêt. Le Figaro
CRITIQUE – Fort d’un plan séquence de dix-sept minutes, le nouveau film du Roumain Cristian Mungiu, portrait acéré de la société roumaine en forme de western contemporain, confirme qu’il est un cinéaste passionnant.
Depuis sa palme d’or avec 4 mois, 3 semaines, 2 jours, en 2007, le Roumain Cristian Mungiu est toujours revenu du Festival de Cannes bardé de prix. En 2012, il est récompensé du prix du meilleur scénario et d’un double prix d’interprétation féminine pour Au-delà des collines. En 2016, il obtient le prix du meilleur scénario pour Baccalauréat . De retour cette année en compétition avec R.M.N., Mungiu est reparti bredouille. Son absence au palmarès interroge car il signe peut-être là son meilleur film. Il confirme en tout cas qu’il est un cinéaste passionnant. Un grand moraliste, le contraire d’un donneur de leçons. Et avant tout un vrai raconteur d’histoire.
Matthias quitte l’abattoir où il travaille en Allemagne sur un coup de tête. Au propre comme au figuré. Il se fait traiter de «Gitan». L’insulte revient dans la bouche de plusieurs protagonistes de R.M.N., et change de cible selon le pays, la communauté, la position sociale. Chacun est le Gitan d’un autre. Matthias est Roumain. Il est de retour dans son village natal quelques jours avant Noël. Un village de Transylvanie, multiethnique, où l’on parle roumain, hongrois et allemand. Son fils Rudi, lui, ne parle plus depuis qu’il a vu «quelque chose de mal» dans la forêt. Son père aussi est mutique, de plus en plus impotent. Matthias retrouve son ancienne maîtresse, Csilla. Elle gère une usine qui fabrique du pain, parle anglais, joue du violoncelle. Elle peine à trouver des employés, les habitants refusant de travailler pour des salaires aussi bas. Elle finit par recruter trois Sri-Lankais qui débarquent sous la neige. Les premières tensions affleurent dans la communauté. Les forums internet déversent des torrents de haine à l’encontre de ces hommes à la peau sombre.
Joute verbale
R.M.N. n’est pas sans rapport avec As Bestas. L’Espagnol Rodrigo Sorogoyen mettait en scène Denis Ménochet et Marina Foïs en couple de bobos français pétris de bons sentiments dans un village isolé de Galice, affrontant une famille autochtone décidée à vendre sa ferme à un projet d’éoliennes pour ne pas crever de faim. Les meilleures scènes prenaient la forme de joutes verbales dans un café, purs moments de rhétorique. C’est aussi le cas ici, notamment dans la séquence de dix-sept minutes tournée en un seul plan. La scène n’est pas qu’un morceau de bravoure. Dans la salle des fêtes du village où se rassemble la communauté, 26 personnages prennent la parole. Dans ce laboratoire de la mondialisation malheureuse et du populisme, on entend 26 nuances d’intolérance et de xénophobie. De bonne conscience et d’hypocrisie aussi.
L’Union européenne est incarnée par un Français candide, membre d’une ONG pour la préservation des ours. «Je viens vous aider à protéger votre belle diversité», assène la belle âme aux travailleurs qui ont vu leur mine fermer à cause des écologistes. Il se fait rembarrer: «Vous n’avez plus d’ours chez vous, on ne veut pas être le zoo de l’Europe!» Ou encore: «Vous n’avez rien appris de Charlie Hebdo, vous n’avez rien de sacré!» Matthias ne sait pas vraiment quoi penser de tout cela. Il chevauche sa moto, son fusil en bandoulière. Tempête sous un crâne. Entre les beaux yeux de Csilla et le poids des préjugés, son cœur balance. Comme le corps d’un pendu dans une forêt sombre de Transylvanie.
Voir encore:
« R.M.N. », déprime de précarité
Pessimiste et pesant, le film de Cristian Mungiu suit l’arrivée de travailleurs immigrés dans un village roumain.
Didier Péron
Libération
19 octobre 2022
Après la longue et lente reptation dans les canalisations sans fin de la pandémie de Covid, masqués, confinés, la guerre déclenchée par Vladimir Poutine est venue sèchement couper court aux optimistes qui avaient cru entrevoir quelque chose qui ressemblait à une lumière au bout du tunnel. La crise économique, les menaces climatiques, la conflictualité omniprésente et sur des échelles d’antagonismes toujours plus vastes et incessants, on n’en finirait pas de lister tout ce qui, décidément, ne va pas, ne va plus. Cristian Mungiu, qui avait reçu la palme d’or en 2007 pour 4 mois, 3 semaines et 2 jours et qui n’est pas connu pour sa puissance comique, sans doute parce qu’il a grandi dans un pays qui a connu la morne déliquescence d’une dictature grotesque et qu’il s’est forgé la certitude qu’il n’y a rien de bon à attendre de quelque organisation humaine que ce soit, nous offre avec R.M.N. une parenthèse de noirceur morale et de constats accablants.
Peaux de bêtes et virilisme gueulard
Le personnage principal est un type antipathique, Matthias, roumain travaillant dans un abattoir en Allemagne. Un contremaître le rappelle à l’ordre en le traitant de «gitan», ce qu’il prend très mal, secouant le mec et prenant la fuite. Il s’en revient dans sa Transylvanie natale où il avait laissé sa femme et son fils qui n’ont pas l’air particulièrement ravis de le voir rentrer. Le gamin ne parle plus depuis quelque temps, apparemment saisi d’horreur dans la forêt voisine qu’il doit traverser pour se rendre à l’école. Matthias, lui, est surtout pressé de renouer le contact très charnel avec son ex, devenue gérante d’une boulangerie industrielle qui tourne à plein régime mais doit recruter des travailleurs migrants pour le coup de pression des fêtes de fin d’année puisque apparemment les Roumains du secteur ne répondent pas aux petites annonces d’emplois trop mal payés.
En rentrant dans sa Transylvanie natale, Matthias retrouve sa femme et son fils. (Mobra Films)
Trois Sri-Lankais débarquent dans le village où ils sont bien accueillis par une partie de la population mais aussi en butte à une coalition fortement organisée au sein de l’église locale qui veut les éjecter. Une longue scène de réunion publique tournée en plan-séquence montre les arguments des différents membres d’un bled traversé par le racisme, la haine de tout ce qui vient de l’Ouest associé à une forme de décadence morale, les conséquences jugées délétères de la construction européenne et de son libéralisme. Parmi les habitants, certains revendiquent toutes sortes de lubies folkloriques de défense d’une identité locale en peau de bêtes et virilisme gueulard, toujours prompt à sortir le fusil de chasse. Il faut savoir que la Transylvanie est composée d’une mosaïque de populations entre Roumains, Hongrois, Roms, Allemands…
Grand désordre des points de vue
Il s’agit évidemment d’orchestrer la cacophonie contemporaine, ce grand désordre des points de vue, des opinions, des affects qui prend la forme d’un fascisme en gésine dont la petite musique terrifiante et mesquine contamine peu à peu le moindre espace de ce biotope asphyxié. La pesanteur démonstrative de l’ensemble qui ne laisse vraiment que peu d’espace aux personnages pour qu’ils puissent se sauver de ce traquenard (d’ailleurs à la fin, l’un d’eux se pend) rend finalement le film aussi peu aimable que ce qu’il entend dénoncer.
R.M.N. de Cristian Mungiu, avec Marin Grigore, Judith State, Macrina Barladeanu… 2h05.
Voir aussi:
Première
Thierry Chèze
Théo Ribeton
Deuxième film de Cristian Mungiu coproduit par les Dardenne (entre palmés, on s’entraide), R.M.N. se démarque pourtant nettement du thriller sociopolitique en flux tendu qu’était Baccalauréat (2016) pour aller vers une forme plus édifiante, sans doute la plus somptuaire jamais entreprise par le réalisateur de 4 Mois, 3 semaines et 2 jours (2007).Très dense, le film est essentiellement structuré par une unité de lieu, un petit village de Transylvanie complètement marginalisé et pourtant métonymique de l’Europe tout entière : scannant (le titre signifie “IRM”, appréciez la prétention) les déchirures d’un tissu social mêlant une population roumaine, une forte minorité hongroise, un petit groupe d’immigrés sri lankais et même un jeune chercheur français dandy, R.M.N. ressemble à une tour de Babel à deux doigts de s’écrouler – et aussi, un peu, à une conférence-spectacle de BHL.Tribunal populaireLe film navigue certes avec beaucoup de virtuosité dans son décor complexe et mouvant, où rôdent les fantômes d’une Europe déclassée et tentée par la violence, comme notamment dans son grand plan-séquence central (une espèce de tribunal populaire nocturne). Mais il peine à nous offrir un point d’ancrage émotionnel, un personnage accessible et aimable. En ressort une sorte de gros traité, très foisonnant, brillant par endroits, mais trop imperméable.R.M.N. de Cristian Mungiu, avec Marin Grigore, Judith State (Fr., Rou., 2022, 2 h 05). En salle le 19 octobre.
Quelques jours avant Noël, Matthias est de retour dans son village natal, multiethnique, de Transylvanie, après avoir quitté son emploi en Allemagne. Il s’inquiète pour son fils, Rudi, qui grandit sans lui, pour son père, Otto, resté seul et il souhaite revoir Csilla, son ex-petite amie. Il tente de s’impliquer davantage dans l’éducation du garçon qui est resté trop longtemps à la charge de sa mère, Ana, et veut l’aider à surpasser ses angoisses irrationnelles. Quand l’usine que Csilla dirige décide de recruter des employés étrangers, la paix de la petite communauté est troublée, les angoisses gagnent aussi les adultes. Les frustrations, les conflits et les passions refont surface, brisant le semblant de paix dans la communauté.
SYNOPSIS
R.M.N. se déroule en Transylvanie, la province plus occidentale de Roumanie, dans un petit village multi-ethnique, peu avant la pandémie de covid-19, entre Noël 2019 et le début de l’année 2020. L’histoire est celle de Matthias, qui revient d’Allemagne où il travaillait en usine, et de Csilla, qui est la numéro 2 d’une boulangerie industrielle installée au village.La TransylvanieJe me rappelle avoir vu dans les années 80 FRANKENSTEIN JUNIOR, de Mel Brooks. Le film était drôle et encore plus pour nous, Roumains : le héros prend un train à New York pour arriver à Bucarest, qui est présentée comme la capitale de la Transylvanie. La Transylvanie était alors cet endroit du bout du monde, le pays des vampires et des monstres.Je ne m’étendrai pas trop sur l’histoire réelle de la Transylvanie : c’est une région qui a été disputée entre deux pays et qui est passée de l’un à l’autre. Un peu comme l’Alsace et la Lorraine. Dans notre cas, c’est entre la Roumanie et la Hongrie, ou plutôt entre la Roumanie et l’Empire Austro-Hongrois. Ainsi, des Roumains et des Hongrois cohabitent en Transylvanie. Mais ils n’en sont pas les seuls habitants. Il y a environ 700 ans, les Saxons ont reçu des terres dans cette région, aux confins de l’Europe, près des Carpates. On trouve donc aussi des Allemands. La plupart d’entre eux sont partis dans les années 70, lorsque Ceausescu les a vendus à la République Fédérale Allemande pour 5000 Deutsche Mark par tête. Les autres sont partis après la chute du communisme. Mais leurs maisons, leurs églises fortifiées, leurs cimetières et leurs villages aux hautes clôtures sont toujours là. Il y a aussi beaucoup de Roms en Transylvanie. Les premiers sont arrivés en tant qu’esclaves ou en tant que domestiques il y a environ 200 ans et beaucoup se sont ensuite installés dans les maisons abandonnées par les Allemands après leur départ. Avec autant d’ethnies, la Transylvanie est devenue le terrain de jeu favori des mouvements populistes ou nationalistes de toutes sortes.
NOTE D’INTENTION DU RÉALISATEUR
Dans les années 90, de violentes tensions ont éclaté, faisant plusieurs victimes. Ensuite, les choses se sont calmées : beaucoup de gens sont partis travailler à l’étranger pour échapper à la pauvreté, qui touchait toutes les ethnies. De temps en temps, le nationalisme se ravive, surtout avant les élections.Mais ne vous méprenez pas : le film ne traite pas d’une situation spécifique à la Transylvanie, ni même du fait que Roumains, Hongrois et Allemands partagent le même territoire. Il parle aussi des Russes et des Ukrainiens, des Blancs et des Noirs, des Sunnites et des Chiites, des riches et des pauvres, voire des grands et des petits…Dès qu’apparaît un autre individu, il est tout de suite perçu comme appartenant à un autre clan et donc comme un ennemi potentiel.Langues, religions, drapeaux (et autres petites différences pour lesquelles les gens s’entretuent) Dans le film, les Hongrois parlent le hongrois, les Roumains parlent le roumain, les Allemands parlent l’allemand. Néanmoins, tous se comprennent. Ils parlent tous anglais, puisqu’il s’agit aussi d’une histoire sur la mondialisation et ses effets secondaires. Les personnages les plus sophistiqués parlent même français. Et, bien sûr, le Français parle anglais, tandis que les gens qui viennent de loin parlent leur langue, que personne ne comprend. En tant que spectateur, si vous comprenez toutes ces langues, bravo. Sinon, il y a des sous-titres : ils ont parfois des couleurs distinctes pour marquer les différentes langues, tandis que d’autres fois, ce sera à vous de trouver qui parle quoi. Les Roumains ont un drapeau rouge-jaune-bleu. Les Hongrois de Hongrie ont un drapeau rouge-blanc-vert. Les Hongrois de Transylvanie, eux, ont un drapeau bleu et jaune : le drapeau du comté autoproclamé de Székely (Tinutul Secuiesc en roumain, Pays Sicule en français), qui milite pour l’autonomie. Curieusement, pour des raisons historiques, ce comté ne se trouve pas à la frontière avec la Hongrie, mais au beau milieu de la Roumanie.
Les Roumains sont majoritairement orthodoxes, les Hongrois sont majoritairement catholiques et les Allemands sont majoritairement luthériens. Mais ce n’est pas si simple : certains Hongrois sont unitariens, certains Roumains sont gréco-catholiques, certains Allemands sont calvinistes. Ainsi, chaque village possède plusieurs églises, différentes les unes des autres ; même les cloches sonnent différemment. Aujourd’hui, avec tant de gens partis travailler à l’étranger, beaucoup d’églises ont perdu la plupart de leurs paroissiens. Les églises protestantes sont fermées. Pourtant, il y a souvent quelqu’un dans le village qui détient la clé de l’église pour ceux qui souhaitent la visiter. Lorsque quelqu’un du village meurt à l’étranger, parfois à des milliers de kilomètres, un membre de sa famille appelle afin que les cloches de son village natal sonnent pour lui.
Ces différences peuvent sembler mineures et elles sont certainement compliquées à suivre. Pourtant, tout au long de l’histoire, des guerres ont été menées à cause de ces particularités et des personnes ont tué d’autres personnes pour des différences encore plus petites.
MIORITZA et les autres inspirations du film
Je n’avais pas réalisé que MIORITZA était une source d’inspiration pour ce film avant de remarquer combien de moutons et autres animaux y figurent. Comment vous expliquer MIORITZA ? MIORITZA (qui signifie « agnelle ») est un poème populaire du folklore roumain qui raconte l’histoire de trois bergers et de leurs troupeaux. Ces bergers viennent de régions différentes, l’un d’entre eux a plus de moutons et il est plus riche ; alors les deux autres décident tout simplement de le tuer et de s’emparer de son troupeau. Ses moutons bien-aimés, son chien fidèle et la nature en général tentent de l’avertir, mais il croit au destin : si tel est son destin, qu’il en soit ainsi. Chez nous, il existe une sorte de philosophie de la vie associée à MIORITZA, à la mentalité du berger et à la géographie roumaine : il s’agit de suivre le rythme des montées et des descentes, selon le relief des collines et des vallées. Nous étudions tous MIORITZA à l’école et dans le film, les enfants le récitent pour la fête de Noël. Le chien fidèle de Matthias le prévient en cas de danger et ses moutons tiennent à lui peut-être plus que quiconque. Outre MIORITZA, il y a bien sûr l’histoire réelle : avant la pandémie, certains propriétaires d’usines du Comté de Székely ont envisagé d’embaucher des travailleurs venus de loin – étant donné que les locaux étaient partis travailler en Europe occidentale. Mais les personnages de R.M.N. et les relations entre eux sont fictifs, tout comme les motivations et les attitudes de chacun, ainsi que les événements du récit lui-même.Une autre source d’inspiration lointaine est l’histoire des mines d’or de Rosia Montana, en Transylvanie. En gros, il s’agit du dilemme suivant : faut-il donner du travail à des gens qui extraient de l’or (et en utilisent du cyanure qui détruit l’environnement) ou préserver l’environnement et les magnifiques paysages pour les générations futures, tandis que les habitants vivront dans un état de pauvreté permanent ?Et puis, il y a eu les reportages réguliers sur la présence d’animaux sauvages et leurs effets collatéraux, puisque la Roumanie possède apparemment la plus grande population d’ours et de loups d’Europe.Les Traditions Les traditions signifient que les gens font quelque chose parce que d’autres personnes l’ont fait avant eux. Cet acte a d’abord été accompli dans un certain but, très souvent pour «chasser le mauvais œil». Vous devez convenir que même cette explication a plus de sens que de faire quelque chose parce que «c’est la tradition». Dans le film, nous dépeignons plusieurs traditions se répétant autour de Noël : certains s’habillent en peaux de mouton ou de chèvre et dansent, d’autres portent des peaux d’ours et se font fouetter, d’autres encore s’habillent comme nos ancêtres, les Daces, appréciés pour s’être opposés à la conquête romaine. Dans certaines autres régions de Roumanie, les hommes portent simplement pour le Nouvel An des masques et un énorme casque sur la tête. Ils se retrouvent ensuite le premier jour de l’année et se battent entre eux, « jusqu’à ce que mort s’en suive ». Ils ne viennent même pas de villages différents : ce sont souvent ceux des collines contre ceux de la vallée – et parfois certains sont vraiment tués. Ne les jugez pas : au moins, c’est un combat équitable. Pas très différent de tous les sports et compétitions qui résultent du même instinct d’engager son clan contre un autre.
Stéréotypes et récits
On explique souvent la position actuelle de la Roumanie au sein de l’Europe par l’idée suivante : si nous n’avons pas réussi à nous développer autant que les sociétés occidentales c’est parce que nous étions occupés à combattre les envahisseurs sur leur route pour piller l’Europe. Pendant que nous les retenions à l’Est, les Occidentaux ont eu le temps de se développer – et ériger leurs opulentes cathédrales.Mais il y a beaucoup d’autres récits plus actuels pour expliquer l’état du monde d’aujourd’hui : la mondialisation est la nouvelle Babel, un signe que le monde arrive à sa fin ; lorsque les maladies seront elles aussi « mondialisées », la fin suivra rapidement. Le réchauffement de la planète est encore un autre signe de la fin imminente : bientôt les ressources surexploitées seront épuisées et les gens se battront pour survivre. Pendant des siècles, il était facile d’identifier les envahisseurs. Les habitants vivaient dans de petits villages au milieu des forêts et dès que quelqu’un à cheval arrivait de l’autre côté de la colline, c’était un ennemi potentiel (le tourisme est venu plus tard). Aujourd’hui, avec les avions, les choses sont devenues plus complexes.Un stéréotype dit aussi que les Huns, ancêtres des Hongrois, arrivaient à cheval et mangeaient de la viande crue qu’ils avaient attendrie sous leur selle. Cette croyance est si courante que personne ne la met en doute. Il y a une trentaine d’années, le Conseil européen a recommandé l’utilisation du terme Roms au lieu de Gitans – perçu comme offensant. La Roumanie a tenté de s’opposer à cette initiative pour la confusion qu’elle générait entre Roms et Roumains, mais sans succès, si bien que la confusion s’est accentuée. Pour les Roumains, le fait d’être considéré comme Rom est la plus grande offense, tandis que les Occidentaux perçoivent notre volonté de faire la distinction comme une attitude discriminatoire inappropriée.
Les Thèmes
R.M.N. questionne les dilemmes de la société actuelle : la solidarité face à l’individualisme, la tolérance face à l’égoïsme, le politiquement correct face à la sincérité. Il interroge aussi ce besoin atavique d’appartenance, de s’identifier à son groupe ethnique, à son clan et de considérer naturellement les autres (qu’ils soient d’une autre ethnie, d’une autre religion, d’un autre sexe ou d’une autre classe sociale) avec réserve et suspicion. C’est une histoire sur les temps anciens (perçus comme dignes de confiance) et les temps actuels (perçus comme chaotiques) ; sur la sournoiserie et la fausseté d’un ensemble de valeurs européennes qui sont davantage revendiquées qu’elles ne sont appliquées en réalité. C’est une histoire d’intolérance et de discrimination, de préjugés, de stéréotypes, d’autorité et de liberté. C’est une histoire de lâcheté et de courage, d’individu face à la foule, de destin personnel face au destin collectif. C’est aussi une histoire de survie, de pauvreté, de peur face à un avenir sombre.
Le film évoque les effets de la mondialisation sur une petite communauté enracinée dans des traditions séculaires : les valeurs d’autrefois se sont dissipées, l’accès à l’internet n’a pas apporté à ces gens de nouvelles valeurs, mais les a plutôt accablés par la difficulté de distinguer la vérité de leurs opinions personnelles dans le chaos informationnel et moral actuel.R.M.N. aborde également les effets secondaires du politiquement correct : les gens ont appris qu’il valait mieux ne pas s’exprimer à haute voix quand leurs opinions diffèrent de la norme actuelle. Seulement le politiquement correct n’est pas un processus formateur et il n’a pas changé les opinions en profondeur ; il a juste fait en sorte que les gens expriment moins ce qu’ils pensent. Mais les choses finissent par s’accumuler et, à un moment donné, elles débordent. Le film n’associe pas les opinions «politiquement incorrectes» à une ethnie ou un groupe en particulier : les opinions et les actions étant toujours individuelles, elles ne dépendent pas de l’identité d’un groupe mais de facteurs beaucoup plus complexes.Au-delà des connotations sociales, l’histoire se situe à un niveau humain plus profond : elle parle de la façon dont nos croyances peuvent façonner nos choix, de nos instincts, de nos pulsions irrationnelles et de nos peurs, des animaux enfouis en nous, de l’ambiguïté de nos sentiments, de nos actions et de l’impossibilité de les comprendre pleinement.Les choses que j’aime le plus dans le film sont celles qui ne peuvent être mises en mots.
Les Fils rouges visuels
Il y a plusieurs images et motifs visuels récurrents dans le film. Si vous avez un jour la patience de regarder le film deux fois, vous aurez quelque chose de plus à découvrir.
Le Style
Tourner chaque scène en plan séquence (quelle que soit sa longueur ou sa complexité) est une décision qui a défini le style de ce film. Par conséquent, en tant que réalisateur, je dois mettre en scène la situation de manière aussi crédible et véridique que possible, puis enregistrer ce moment. Le rythme ne vient pas du montage, mais il est inhérent à la scène. Les ellipses n’ont lieu qu’entre les scènes – la situation se déroule en temps réel, rien n’est coupé.Cette décision a conduit à tourner en une seule prise une scène collective de 17 minutes avec 26 personnages qui parlent.
Tournage
Le scénario a été écrit au printemps 2021, le financement et la production ont suivi rapidement. Le tournage a eu lieu de novembre 2021 à janvier 2022. Nous avons préféré ne pas tourner dans le comté de Székely, mais à Rimetea, un ancien village de Transylvanie qui a été classé au patrimoine de l’UNESCO. Les rôles principaux sont interprétés par des acteurs professionnels, les rôles secondaires par des non-professionnels. Chaque acteur a reçu ses dialogues mais pas les scènes concernant des situations que leurs personnages ne connaissent pas. Les dialogues étaient entièrement écrits.Le film a été tourné en numérique, dans des lieux existants, à l’exception de la maison de Csilla qui a été construite de toutes pièces sur place.
Le Titre
Apparemment, l’empathie et d’autres compétences sociales sont générées à la surface du cortex cérébral, tandis que les instincts plus primaires qui ont permis aux humains de survivre occupent les 99 % restants du cerveau. R.M.N. signifie Rezonanta Magnetica Nucleara. En anglais, c’est N.M.R. – Nuclear Magnetic Resonance. Et en français, c’est I.R.M., Imagerie par Résonance Magnétique. Plus largement, il s’agit d’une investigation du cerveau, un scanner cérébral qui tente de détecter des choses sous la surface. En lisant le scénario, quelqu’un a suggéré que le film pourrait s’appeler Europe 2.0. Pendant le tournage, je suis tombé sur une photo de la fin du 19e siècle dans l’un des lieux de tournage, intitulée : L’Agneau de Dieu. J’ai pensé que ça ferait un bon titre.
Cristian Mungiu est né en 1968 à Iaşi en Roumanie. Son premier film OCCIDENT est invité à la Quinzaine des Réalisateurs en 2002 et fait un triomphe en Roumanie. En 2007, son deuxième long métrage 4 MOIS, 3 SEMAINES, 2 JOURS est récompensé de la Palme d’or au Festival de Cannes. Il reçoit l’éloge des critiques et de nombreuses autres distinctions dont celles du Meilleur Film et Meilleur Réalisateur de l’Académie européenne du Cinéma. En 2009, il revient à Cannes en tant que scénariste-coréalisateur-producteur du film à sketches CONTES DE L’ÂGE D’OR, ainsi qu’en 2012 en tant que scénariste-réalisateur avec AU-DELÀ DES COLLINES récompensé du Prix du meilleur scénario et d’un double Prix d’Interprétation Féminine. En 2016, il obtient le Prix de la mise en scène lors du 69ème Festival de Cannes pour son cinquième film BACCALAURÉAT. Il signe son retour en 2022 avec R.M.N. Le film est présenté pour la première fois au Festival de Cannes, en sélection officielle, en compétition.
CRISTIAN MUNGIU BIOGRAPHIE RÉALISATEUR











 Publié par jcdurbant
Publié par jcdurbant 
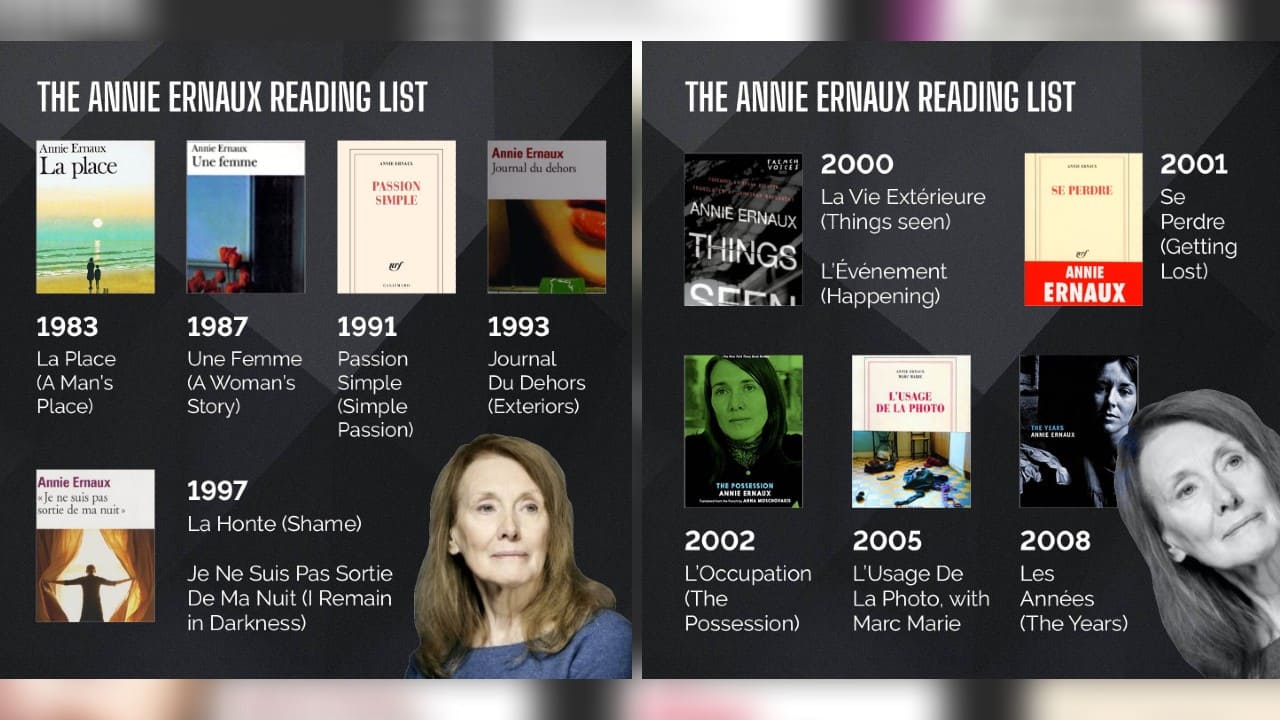




 Soyez fils de votre Père qui est dans les cieux (qui) fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons et (…) pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Jésus (Matthieu 5: 45)
Soyez fils de votre Père qui est dans les cieux (qui) fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons et (…) pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Jésus (Matthieu 5: 45)