Il est dans votre intérêt qu’un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Caïphe (Jean 11: 50)
Louis doit mourir pour que la patrie vive. Robespierre
L’arbre de la liberté doit être revivifié de temps en temps par le sang des patriotes et des tyrans. Jefferson
Je crois qu’il a la possibilité d’entrer dans l’histoire comme un très grand président, parce que (…) voici un nouveau président qui pose beaucoup de questions inconnues. (…) Je pense qu’il opère par une sorte d’instinct qui est une forme d’analyse différente de la mienne, plus académique. Mais il a soulevé un certain nombre de questions que j’estime importantes, très importantes. Henry Kissinger (20.12.2016)
Je pense que l’une des grandes réussites de l’administration précédente a été de s’aligner, de réaliser deux choses au Moyen-Orient. Premièrement, séparer le problème palestinien de tous les autres problèmes afin qu’il ne devienne pas un veto sur tout le reste – et deuxièmement, aligner les États sunnites en combinaison réelle ou potentielle contre les États chiites, c’est-à-dire l’Iran, qui développait une capacité à les menacer. Je pense que c’était un concept brillant. Nous n’en étions qu’au début. C’était comme le début de l’ouverture de la Chine. L’évolution n’en était qu’à ses débuts. Ainsi, dans la situation actuelle, il est important que nous ne glissions pas dans un – dans la dilution de ce modèle qui a été créé et qui devrait être – qui, à un moment approprié, peut même conduire à des discussions avec l’Iran. Nous ne devrions pas abandonner les pressions exercées sur l’Iran tant que nous ne savons pas où elles vont. Et je pense que c’est quelque chose que nous devons examiner attentivement dans la période actuelle. Si nous séparons la question iranienne de la question globale du Moyen-Orient, nous risquons de perdre les deux acquis, à savoir la séparation de la question palestinienne, qui lui ôte son caractère de veto sur tout le reste, et la coopération sunnite avec Israël, qui est unique par son ouverture. C’est donc ainsi que j’aborderais la question.
Henry Kissinger
Se poser la question de la fin du populisme est aussi absurde que se poser la question de la fin du peuple. Christophe Guilluy
In defeat, Donald Trump embodies the original role of the tragic protagonist in such a way as to teach us more about tragedy than we can learn from the usual readings of Shakespeare or Sophocles. (…) Aristotle defined tragedy as “an imitation of persons above the common level,” in Greek “better than ourselves” (beltionon hemas). But in Aristotle’s vocabulary, these are not merely relative terms. The tragic protagonist is not “better” because he is smarter or richer than the anonymous citizens watching the play, but because his role is central to the welfare of the state. He is in a position of sacred centrality, yet ontologically, merely a human being among others. Thus he is forced to function, as Barack Obama once put it, “above my pay grade,” solving transcendental problems on the fallible basis of individual intuition. If any modern political role fits the original description of a potential tragic protagonist, it is that of the American president, who combines the roles of monarch/head of state and parliamentary leader/prime minister, which remain separated in most other liberal democracies. Our republic has its roots in the Athenian agon, and it is no coincidence that its most agonistic recent moment has produced its most tragic political figure. No president in the entire history of the American republic has been so unsparingly vilified as Donald Trump, throughout the 2016 nomination process and campaign, and the nearly four years of his presidency. His tenure in office has been marked by an unprecedented degree of virulent hostility from all corners of the federal establishment, as well as from members of the public who, habituated since Reagan to Republican “derangement syndromes,” have surpassed themselves in his case. To have sustained a “Resistance” that began with his election and denied his legitimacy throughout his entire tenure in office, to have been impeached on trivial evidence after sustaining nearly three years of congressionally approved investigation on the absurd charge of “complicity” with Russia, while meeting with hostile silence from many in his own party who abstained from actual abuse, is far from the normal status of a political figure even in a pugnacious democracy. What then was the key to Trump’s anomalous success? As I have pointed out since the beginning, Trump was the sole candidate, other than the impressive but insufficiently political Dr. Ben Carson, who was truly invulnerable to “PC,” as victimary thinking was then called before it graduated to “wokeness.” This resistance has in fact been Trump’s most significant distinction, although neither his detractors nor his supporters tend to refer to it. It was not a product of theoretical reflection, but of his faithfulness to the attitudes which reigned in his youth—attitudes which I largely share. That the current “woke” generation is capable of tearing down or defacing statues of virtually all the great men of American history is viscerally offensive to both of us, yet none of Trump’s rivals for the nomination presented any real resistance to the perspective that anticipated these actions. Were we to seek an embodiment of our timeless model of the ideal president, wise and forbearing, Trump would hardly qualify. Trump is not a political thinker, but a man of action, and as his detractors in both camps never fail to insist, he is not afraid to exaggerate, to bluster, to repeat quite dubious ideas. Trump was able to beat out his many primary competitors and win the 2016 election because, more even than his ability to make “deals,” his show-business experience gave him supreme confidence in his “instincts,” whether as entertainer or president, for occupying the center of the stage. And these instincts, these political intuitions, were hostile to victimary thinking, not because Trump is obsessed with it, but simply because Trump is untouched by it. But what mattered in 2016 and still matters today has been Trump’s consistency in resisting the mimetic pressure that drives the respectable members of Charles Murray’s “Belmont” class to symbolically flagellate themselves in penance for their “white privilege”—all the while feathering the nests of the most privileged members of society, including themselves. No doubt there are more sophisticated ways than Trump’s of resisting the power of White Guilt. But its virtually total domination of the academic world and of those formed by it, such as the elementary school teachers whose antipatriotic lessons are diametrically opposed to the ones I learned in these classes, has made virtually the entire educated class incapable of firm resistance to this tendency, the product of our enforced “awokening” to the model of originary moral equality to the exclusion of all other social considerations. Only someone whose social instincts had been developed before the current constitution of the Belmont world could credibly oppose this configuration, and only someone with considerable personal—rather than institutional—resources would have the freedom to do so. At the start of his campaign in 2015, Trump’s chief source of popular visibility was his presence in the Reality TV show The Apprentice, highly popular among the “deplorable” lower-middle-class audience that would put him in office in the face of the open contempt of establishment politicians in his own party as well as the Democrats. After his 2016 election victory, many hoped that Trump’s bull-in-the-china-shop tweeting and expostulating would disappear, or at least diminish. And indeed, whenever he makes the effort, Trump has shown himself perfectly capable of delivering a cogent address in a perfectly dignified manner. Yet he has continued with the behavior that, even if effective as “trolling” in enraging his enemies, has done nothing to repair his estrangement from the Belmont class. I think for Trump this is a matter of principle, even if the principle is not articulated as a proposition. What makes it tragic is that, although this behavior may well have cost him reelection, it is inseparable from his sense of self. It seems clear that someone who had viewed these antics merely as a political stratagem would not have had the chutzpah to flaunt from the very beginning his disdain for victimary thinking in the face of the respectable majority. The grain of truth in the calumnious accusations of “white supremacy” and even “antisemitism” is that, alone among the politicians of his generation, Trump viscerally understood that the prior censorship exercised by White Guilt is the real culprit that must be cast out. Thus even when in 2016 Trump scandalously denounced US-born judge Gonzalo Curiel as a “Mexican” by way of attacking his impartiality in the matter of the “Wall,” his very sense that this did not damn him as indelibly “racist” affirmed in his own mind his frequently repeated contention that he “is the least racist person in the room.” And indeed, the one incidence of “racism” unceasingly cited by his political enemies has been his statement about “good people on both sides” at Charlottesville in reference to the removal of the statue of Robert E. Lee, as proof, despite his explicit statements to the contrary, of his endorsing neo-Nazis. Yet the fact remains that many of those unmoved by these spurious accusations have been put off by Trump’s “unpresidential” behavior. And so Trump lost an election that he might well have won, even in the face of the Covid19 pandemic. No one can claim to know what formula he should have followed. But what makes him a tragic figure is the fact that he would no longer have been Trump had he sought any other formula than just being Trump. (…) The tragic protagonist assumes leadership in a crisis in which he is obliged to make decisions that cannot be deduced from prior social norms. Once a human being comes to occupy the social center originally reserved for the sacred, he is tasked with a responsibility both necessary and impossible to fulfill en connaissance de cause. Hence every leader is potentially a tragic figure: Uneasy lies the head that wears the crown. But real-life and even legendary tragic figures are few. (…) Tragedy depends on crisis. And although, objectively speaking, the United States has traversed many far more serious crises—wars and economic depressions—we are currently witnessing the most serious breakdown of our political system since the Civil War, one that the current election, whatever its outcome, is most unlikely to fully resolve. Recently Michigan Democratic Rep. Elissa Slotkin gave an appreciation of Trump that should be heeded by the “respectable” members of both parties: (…) « Trump speaks to them, because he includes them. » Slotkin’s point is that, like old Harry Truman, but unlike today’s Democrats, Trump speaks to ordinary people. It might seem peculiar for the party that has always presumed to represent the “common man” to be accused by one of its own of “talking down” to its constituency, while the Republicans, supposedly the party of plutocracy, field a candidate whose refusal of a lofty register wins her esteem despite her presumed disagreement with his policies. But what Slotkin means by “talking down” is not so much affecting an intellectual (“wonky”) but a moral (“woke”) superiority. It is less treating people as stupid than as morally obtuse, un-woke. In a word, it is telling “deplorable” white voters to exhibit, to virtue-signal, their White Guilt. Which leads us back to our point of departure. As the only candidate in 2016 who was able to resist the victimary pressure that dominates the Left but also paralyses the Right, Trump rightly saw his candidacy as a mission, one figured by descending the escalator in Trump Tower (now faced by the “mural” of Black Lives Matter painted on the street). Trump had a mission and, Wall or no Wall, he has largely carried it out. Even if he fails to obtain a second term, his example will have a lasting effect on American politics. And I hope it will one day receive the historical respect it deserves. That the mediocre Biden was able to call Trump “clown,” “racist,” “worst president ever” demonstrates the tragic vulnerability of the latter’s denial of PC. And those on the Right who persist in seeing Trump as a vulgarian, judging him by what they call his “character” rather than his achievements, are if anything less excusable. It was Trump who revived the American economy, reduced unemployment to its long-term minimum, and raised the salaries of minorities despite their (diminishing!) fidelity to the Democrats. It is Trump who got rid of Soleimani and Al Baghdadi, moved the American Embassy to Jerusalem, and has begun building a coalition of Arab states along with Israel to counter Iran’s influence. If Trump still refuses to concede (…) this is but one more manifestation of the pertinacity without which he would never have been elected in the first place. May at least the members of his own party have the good grace to recognize that Trump achieved what none of them could have, and, whatever their own personal style, seek to learn from the healthy core of Trump’s “instincts.” Donald Trump saw more clearly than anyone the danger that Rep. Slotkin recognizes in the “woke” faith in resentment that has been building since the 1960s. A virus far more virulent than SARS-CoV-2, this victimary faith has infested our educational, informational, entertainment, and governmental institutions, and unless promptly and firmly checked, risks handing our hard-won democracy to the barbarians. Eric Gans
Le rejet de la légitimité de l’élection de Trump en 2016, par des moyens institutionnels, a préparé le rejet de la légitimité de l’élection de Biden en 2020. Jacob Siegel
Si Trump en est venu à être viscéralement convaincu d’avoir été spolié de l’élection, c’est que durant quatre ans, l’opposition démocrate s’est comportée comme s’il était un président illégitime, une marionnette du Kremlin qui aurait usurpé, par le biais d’une ténébreuse collusion russe, la victoire de Hillary Clinton (en 2019, cette dernière parlait encore d’avoir été «volée»). L’idée obsessionnelle d’une excommunication du «diable Trump», entretenue par le camp libéral, a alimenté la conviction du président d’alors d’être assiégé par un État profond prêt à tout pour l’écarter. Même chose pour ses partisans. (…) l’ensemble du camp démocrate, que seule la haine de Trump a jusqu’ici uni, acceptera-t-il le compromis vis-à-vis des vaincus? Rien n’est moins sûr. Car à côté du volcan trumpien, dont on a vu surgir une «rage blanche» extrémiste très inquiétante le 6 janvier avec force slogans antisémites et drapeaux confédérés que Biden a promis de combattre, bouillonne en Amérique le volcan de la rage identitariste de la gauche radicale, qui a embrasé le pays pendant près de huit mois l’été dernier au nom de la justice sociale et de la défense des minorités ; transformant des manifestations pacifiques de protestation contre des violences policières en entreprise de pillage et destruction du patrimoine architectural et littéraire de l’Amérique, au motif qu’il est entaché de «racisme systémique». «Cette aile gauche du Parti démocrate, qui rêve d’une détrumpification combattante, aura-t-elle gain de cause?», s’interroge Joshua Mitchell, qui observe avec inquiétude «la culture de l’annulation» prônée par les milieux progressistes se déployer depuis le 6 janvier. L’expulsion de Trump de Twitter et celle du réseau social conservateur Parler des plateformes américaines sont des signaux peu encourageants, de même que l’appel lancé par la revue Forbes aux corporations américaines pour qu’elles refusent d’embaucher d’anciens membres de l’Administration Trump, sous peine d’être blacklistées. (…) Le grand historien de la Grèce antique Victor Davis Hanson, qui a pris parti pour Trump contre les élites depuis quatre ans, met, quant à lui, en garde contre un acharnement sur le «cadavre politique» de l’ex-président, comparant l’idée d’une destitution post-présidentielle à l’acharnement d’Achille sur le corps mort d’Hector pendant la guerre de Troie. Poignardé et traîné derrière un char, celui qui n’était qu’un «vaincu fanfaron» allait devenir une figure mythique… Laure Mandeville
Il est toujours tentant de qualifier d’irrationnels ceux qui ne votent pas comme nous, en particulier si ce sont des étrangers. À leur contact, on se sentirait tellement sages, supérieurs. On ne ferait pas le moindre effort pour les écouter et les comprendre. Certains, même s’ils reconnaissent aux trumpistes une sorte de bon sens primitif, les jugent avec paternalisme et attribuent leurs opinions à une forme d’ignorance aussi crasse qu’autodestructrice : des pauvres types. Nous ferions bien de reconnaître au contraire, du moins hypothétiquement, que bon nombre des électeurs de Trump sont aussi intelligents, rationnels et idéalistes que nos voisins. Ni plus, ni moins. Ce qui les distingue, ce sont leurs objectifs et la conviction que le président Trump est le plus à même de les aider à les défendre. (…) Pendant les trois premières années du mandat de Trump, les revenus moyens des foyers sont passés de 63 000 à plus de 68 500 dollars par an, les salaires horaires des classes inférieures ont augmenté de 7 % au total et le chômage est descendu à des seuils jamais vus depuis les années 1960. Parallèlement, la croissance économique que Trump a stimulée par ses baisses d’impôts en 2018 n’a guère modifié les écarts de revenus entre les différentes catégories de population. Et les baisses de revenus ont été très également partagées, ce qui a évité qu’une catégorie ne se sente particulièrement lésée. Mais comment est-ce possible que l’électorat trumpiste n’ait pas tourné le dos à son champion avec la terrible récession provoquée par la pandémie dans le pays ? Une chose est sûre, après ce que nous avons vu dans nos pays, il ne serait pas très étonnant que les partisans de Trump finissent par faire valoir que la crise n’est pas la faute du gouvernement fédéral, ou qu’ils estiment que les gouvernements antérieurs sont coresponsables de la mauvaise gestion, au même titre que les autorités régionales et locales. Sans parler des puissances étrangères comme la Chine, qui a trop tardé à informer sur la gravité du coronavirus et des contaminations. (…) En 2018, Trump a réussi à renégocier l’Alena, le traité de libre-échange avec le Mexique et le Canada, et à arracher à ces deux pays de modestes concessions qui favorisent les géants américains de l’automobile et des produits laitiers. (…) Selon l’institut Pew Research Center, les Américains qui ont une opinion négative de la Chine ne sont plus 47 % comme en 2017, mais désormais 66 % en 2020, et ils s’inquiètent notamment de la puissance de ses multinationales d’innovation technologique. De plus, la moitié des Américains qualifie de “très grave” la disparition d’emplois, délocalisés, et le déficit commercial des États-Unis par rapport à la Chine. Eh bien, le déficit commercial des États-Unis avec la Chine s’est effondré de près de 20 % entre 2018 et 2019, et de presque 30 % pendant les quatre premiers mois de 2020. De plus, au pic de la guerre commerciale (de janvier 2018 à janvier 2020), 300 000 emplois dans l’industrie ont été créés aux États-Unis, et, ne l’oublions pas, le chômage est tombé à un niveau aussi bas que dans les années 1960. Et les salaires des plus pauvres ont nettement augmenté. Il ne sera pas difficile pour des millions d’Américains de faire, à tort, un lien entre la guerre commerciale et leur bonne fortune. (…) Enfin, Trump a non seulement nommé plus de 50 juges dans les cours d’appel du pays, mais il a aussi réussi à placer trois juges conservateurs (Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh et Amy Coney Barrett) à la Cour suprême. À partir de maintenant, que Joe Biden soit ou non vainqueur de la présidentielle, il faudra vivre avec la majorité conservatrice la plus écrasante qu’ait connue la plus haute juridiction depuis les années 1950. Et les électeurs républicains savent à qui exprimer leur gratitude dans les urnes. Gonzalo Toca (Esglobal, Madrid, 06/11/2020)
Il y avait là des voyous, c’est indéniable. Mais laissez-moi vous parler un peu de ces manifestants que je connais personnellement. Tous sont, sans exception, des Américains ordinaires et des individus honnêtes, qui n’ont pas participé à l’invasion du Capitole et jamais n’oseraient désobéir à un officier de police. Certains parmi eux, mais pas tous, jugent que l’élection a été volée. Ils se trompent, mais cela ne fait pas d’eux des suprémacistes blancs, des terroristes de l’intérieur, des extrémistes religieux – ils ne méritent aucun des noms d’oiseaux lancés depuis une semaine. Ceux que je connais personnellement sont aujourd’hui terrifiés à l’idée d’être identifiés sur les réseaux (par des gauchistes vengeurs qui diffuseraient leurs informations personnelles), voire licenciés si jamais leur participation à la manifestation à Washington venait à se savoir. Certains ne voient aucun problème à ce que les personnes ayant enfreint la loi [le 6 janvier] soient arrêtées et poursuivies en justice. Selon un sondage Reuters/Ipsos, seuls 9 % des Américains considèrent les émeutiers comme des “citoyens inquiets” et 5 % les tiennent pour des “patriotes”. Il y a dans les 90 % restants des millions d’électeurs de Trump. Certes, parmi ces millions de personnes ayant choisi le bulletin Trump, certains, nombreux peut-être, croient à des théories du complot et ne font pas confiance à leur gouvernement. Mais comment cela s’explique-t-il ? Cela aurait-il à voir avec le fait qu’ils entendent de grands médias déclarer fièrement qu’ils ne feront pas même l’effort d’être impartiaux dans leur couverture de Trump et ensuite alimenter, eux aussi, une théorie complotiste, selon laquelle le président serait un agent à la solde des Russes ? Faut-il s’étonner que les gens aillent puiser dans d’autres sources d’information, douteuses pour certaines ? Faut-il s’étonner que la méfiance envers l’État ait augmenté, quand les Américains ont découvert que de hauts responsables du FBI et du ministère de la Justice ont abusé de leurs pouvoirs de police pour interférer dans le résultat d’une élection puis saper la légitimité d’un président élu ? William McGurn
La première fraude provient de la manipulation des électeurs par les médias. Jamais on n’avait vu une telle collusion entre un candidat, d’une part et les grands médias et médias sociaux, d’autre part. On avait cru atteindre le summum en 2016 lorsque par exemple CNN transmettait à l’avance à Hillary Clinton les questions des débats. C’était en réalité bien peu de choses par rapport à 2020. Jamais les sondages commandités par les grands médias n’auront été truqués à ce point en faveur de Joe Biden. Jamais n’avait-on assisté à un tel degré de propagande anti-Trump et pro-Biden tout au long de la campagne. Tout ce qui était positif à propos de Trump et tout ce qui était négatif à propos de Biden aura été caché au public, alors que tout ce qui était négatif à propos de Trump et tout ce qui était positif à propos de Biden aura fait l’objet d’un matraquage médiatique. Sans parler de la fabrication purement et simplement d’histoires mensongères à n’en plus finir contre le président sortant et son entourage. Le point culminant est intervenu lorsque, le 14 octobre 2020, à deux semaines de l’élection, le New York Post révéla le scandale de la corruption de la famille Biden (« the Biden crime family » comme l’appelle Donald Trump). Facebook et Twitter bloquent alors immédiatement les comptes et les pages du quotidien, pour éviter la propagation. « Une erreur de jugement », admettra par la suite Jack Dorsey, le patron de Twitter, qui n’en pense sans doute pas un mot. Les autres médias enterrent l’affaire, s’assurant que le scandale reste confiné. Et pourtant, les preuves sont accablantes. Hunter Biden, le fils de Joe Biden, décrit en détail dans ses emails obtenus par le « New York Post » le modus operandi : 50 % des sommes collectées étaient reversées au « big guy ». Les sondages réalisés après l’élection dévoileront par la suite que 13 % des électeurs de Joe Biden n’auraient pas voté pour lui s’ils avaient été informés de l’existence du scandale en question. Ce qui représente plus de 10 millions de voix ! Quand on sait que Joe Biden a remporté l’élection in fine grâce à un peu moins de 50.000 voix d’avance dans trois États-clefs… (…) La deuxième fraude aura consisté pour la gauche américaine à contourner les lois électorales applicables aux bulletins par correspondance dans les principaux États-clefs, et ce, sous le prétexte de la crise du coronavirus. Par exemple en Géorgie, il a été décidé que les bulletins par correspondance, envoyés à toute la population, seraient pris en compte sans vérification appropriée de la signature des électeurs, alors que la loi est on ne peut plus claire à ce sujet : les bulletins par correspondance doivent, sous peine de nullité, faire l’objet de contrôles stricts. En pratique, cette « relaxation » des standards de contrôle a permis à n’importe qui (des morts, des mineurs, des prisonniers, des non-résidents, des étrangers…) d’envoyer des bulletins, sans grand risque de rejet du vote. Du reste, le taux de rejet des bulletins par correspondance est passé de 3,5 % en 2016 (ce qui correspondait à 90.000 votes) à 0,3 % en 2020, et ce, alors même que le nombre de bulletins par correspondance reçus en 2020 a été multiplié par 5 comparé à 2016. Autrement dit, des dizaines de milliers de bulletins par correspondance illégaux ont été comptabilisés cette année en Géorgie. Qui plus est, ces bulletins ont pu être déposés par les électeurs dans des boîtes (« drop boxes » financées par Mark Zuckerberg, le patron de Facebook), installées spécifiquement dans certains quartiers populaires des grandes villes de l’État afin d’éviter aux électeurs d’acquitter un timbre. Bien évidemment, la collecte des bulletins déposés dans ces boîtes n’a pas pu être supervisée par les assesseurs républicains… Une vidéo prise par des caméras de surveillance a fait sensation. Elle montre comment les employés de la ville d’Atlanta ont géré le dépouillement de ces bulletins dans le centre le plus important de la ville (State Farm Arena). A 23h le soir du 3 novembre, la presse et les assesseurs des deux partis, sous le prétexte d’une fuite d’eau empêchant la poursuite du dépouillement, sont priés de rentrer chez eux et de revenir le lendemain matin. Une fois la scène vidée de ses témoins gênants, quatre employés municipaux extirpent des dizaines de milliers de bulletins de quatre valises qui avaient été placées et cachées dans la salle le matin même, pour être scannés, à de multiples reprises, dans les machines. Au total, 24 000 bulletins comptabilisés en toute illégalité, comme attesté en direct sur le site du New York Times (real time tabulations). Joe Biden a finalement emporté l’État avec… 11 779 voix d’avance. En Pennsylvanie, la loi était claire. Les bulletins par correspondance ne pouvaient être acceptés que si l’électeur apposait sa signature sur l’enveloppe. Mais cette année, le gouverneur démocrate a autorisé les centres de dépouillement à comptabiliser les bulletins sans enveloppe (« naked ballots »), ouvrant ainsi la voie à de la fraude massive. On comprend mieux pourquoi les assesseurs républicains se sont vus barrer l’accès aux centres de dépouillement à Philadelphie, et ce, même en dépit d’injonction obtenues en référé auprès des juges locaux. Par ailleurs, la loi prévoyait que les bulletins par correspondance reçus par la poste après 20h le mardi 3 novembre étaient nuls et ne pouvaient être comptabilisés. Qu’à cela ne tienne, les bulletins collectés jusqu’au vendredi 6 novembre ont été pris en compte, y compris ceux reçus sans cachet de la poste sur l’enveloppe ! N’importe qui a donc pu voter en Pennsylvanie dans les jours qui ont suivi le jour de l’élection … On précisera que 75% des 630 000 bulletins par correspondance « magiques » reçus après le 3 novembre ont été en faveur de Joe Biden. Qui plus est, dans certains comtés en Pennsylvanie, plus de voix ont été comptabilisées que d’inscrits sur les listes électorales ayant voté – 205 000 plus précisément d’après un rapport du Sénat de Pennsylvanie du 29 décembre 2020 dénonçant ce phénomène de « over votes », c’est-à-dire de bulletins comptabilisés qui n’ont pas été imprimés par le gouvernement de la Pennsylvanie. Dans le Wisconsin, la loi prévoyait que seules les personnes bénéficiant du statut de personne confinée indéfiniment (typiquement des personnes grabataires) pouvaient voter par correspondance sans avoir à se déplacer au préalable au bureau de vote pour chercher un bulletin en montrant sa pièce d’identité (un bulletin leur est alors envoyé par la poste chez eux). Mais pour l’occasion, sur ordre du gouverneur (démocrate), le statut a été largement étendu, passant de 70.000 personnes environ aux élections précédentes à 200 000 cette année, en raison du coronavirus. 130 000 votes de plus que les années précédentes ont donc été comptabilisés sans contrôle d’identité à l’échelle de l’État (un peu comme si les bureaux de vote avaient accepté que 200 000 électeurs qui venaient en personne voter ne présentent pas leur pièce d’identité). Précisons que ces 200 000 bulletins furent largement favorables à Joe Biden, lequel a remporté l’État avec 20 682 voix. Les avocats de Donald Trump ont réuni plus de mille témoignages sous serment de personnes attestant d’irrégularités importantes constatées lors des élections du 3 novembre. Chacune de ces personnes risque 5 ans de prison si elle présente un témoignage mensonger. Ainsi, des assesseurs racontent comment ils ont été expulsés des centres de dépouillement du Michigan par la police locale, sous les applaudissements des employés municipaux en train de procéder au dépouillement, des conducteurs de camion expliquent qu’ils ont conduit des chargements de centaines de milliers de bulletins fraîchement imprimés de New York jusqu’en Pennsylvanie, des employés municipaux confirment qu’ils scannaient dans les machines des bulletins par correspondance qui n’avaient pas été pliés (c’est-à-dire qui ne sortaient pas d’enveloppes) ou encore confirment qu’on leur demandait de comptabiliser des bulletins par correspondance sans vérifier les signatures, des postiers révèlent que leur hiérarchie leur demandait d’anti-dater des bulletins par correspondance reçus hors délais, des « white hat hackers » témoignent qu’ils ont réussi à se connecter aux machines des bureaux de vote en Géorgie (dans le comté de Fulton à Atlanta), des électeurs racontent que, se rendant aux urnes pour voter, ils se sont entendus dire qu’ils avaient déjà voté et qu’ils pouvaient rentrer chez eux, etc. Par ailleurs, ces mêmes avocats ont réuni des études et témoignages d’experts en probabilités identifiant les anomalies statistiques du 3 novembre. Par exemple (…) Jamais un candidat républicain n’a perdu l’élection alors qu’il a emporté la Floride et l’Ohio (qui plus avec 5 points de plus qu’en 2016). « Les résultats sont aberrants et absurdes » martèlent les mathématiciens. « Les taux de participation supérieurs à 85 % sont impossibles. Les votes en provenance de bureaux de vote à plus de 75 % en faveur d’un candidat sont la marque d’une fraude » expliquent-ils. Surtout lorsque ces anomalies arithmétiques ne sont constatées que dans les grandes villes des six États-clefs, où Joe Biden a réalisé des scores époustouflants en comparaison aux scores inférieurs de Biden par rapport à Hillary Clinton observés dans les autres grands centres urbains du pays, à commencer par New York City ou Los Angeles… Ainsi, dans le comté de Fulton, à Atlanta en Géorgie, 161 bureaux de vote ont reporté entre 90 % et 100 % de votes en faveur de Joe Biden, totalisant 152 000 voix pour le candidat démocrate. Idem à Philadelphie ou 278 bureaux de vote (16 % des bureaux de la ville), ont reporté 97 % ou plus de voix pour Joe Biden, totalisant 100 200 voix pour Joe Biden contre 2.100 voix pour Donald Trump. Même à New York City, Donald Trump n’a pas été crédité de scores aussi déséquilibrés. Toujours en Pennsylvanie, dans l’un des bureaux de vote du comté d’Allegheny, en Pennsylvanie, 93 % des bulletins par correspondance furent en faveur de Joe Biden, ce qui n’est pas possible d’un point de vue statistique, Joe Biden recevant 23 000 voix contre 1300 pour Donald Trump. Dans le comté de Wayne, le plus important du Michigan, 71 bureaux de vote ont reporté plus de votes que d’inscrits sur les listes électorales, le gouverneur (démocrate) passant outre le refus du comté de certifier les résultats… Par ailleurs, les parlementaires locaux (républicains) d’Arizona, de Géorgie, du Nevada ou encore en Pennsylvanie, qui eux, ont pu enquêter et auditionner de nombreux témoins au cours des mois de novembre et décembre 2020, ont rédigé des rapports accablants contre leurs propres gouverneurs, attestant l’ampleur de la fraude dans leurs États respectifs. En parallèle, on rappellera que le Sénat à Washington DC a lui-même organisé le 16 décembre 2020 des auditions de témoins sur le thème des irrégularités de l’élection du 3 novembre, les avocats de Donald Trump ayant alors eu l’occasion de détailler d’innombrables irrégularités, notamment concernant l’Arizona, le Nevada et le Wisconsin. A l’issue des présentations, plusieurs sénateurs durent reconnaître que de sérieux doutes pesaient sur la légitimité de l’élection de Joe Biden. Mais en dépit de cette montagne de preuves, les juges du pays ont refusé d’écouter les multiples requêtes en annulation des résultats des élections des États concernés. Aucune enquête n’a été diligentée, aucune procédure de « discovery » n’a été intentée (forçant la partie défenderesse de transmettre des informations), aucune saisie de bulletins ou des scans des machines n’a été ordonnée par les juges. Les avocats démocrates bataillèrent furieusement en justice pour qu’aucun audit ne puisse être ordonné, la plupart des requêtes ayant été écartées pour des questions de procédure. Et lorsque les juges ont décidé d’entendre les affaires sur le fond, les débats furent bâclés. La cour suprême du Nevada a par exemple rendu son jugement après avoir accepté seulement 15 dépositions (par écrit, aucun témoin en personne), et a jugé sans enquête, sans délibération, après seulement 2 heures de plaidoirie un dossier constitué de 8 000 pages portant sur 130 000 votes contestés. En fait, les rares juges de différents États qui ont accepté d’écouter les affaires sur le fond ont rapidement conclu – par un raisonnement contestable – que le remède demandé (l’annulation de l’élection) était disproportionné, constatant que les électeurs avaient voté en bonne foi et que ce n’était pas de leur faute si les lois électorales étaient irrégulières… Ce refus du pouvoir judiciaire de s’immiscer dans le contrôle à posteriori des élections culmina lorsque, le 7 décembre 2020, la Cour suprême fut saisie par 18 États et 126 membres de la Chambre des représentants, lui demandant de constater l’illégalité des élections tenues en Arizona, dans le Michigan, en Pennsylvanie et dans le Wisconsin. Quelques jours après, ce fut le coup de grâce. La cour rejeta la requête, considérant que les plaignants n’avaient pas démontré leur intérêt à agir… La messe était dite. Les juges ont créé un précédent qui restera dans l’histoire : il est désormais possible au pouvoir exécutif des 50 États des États-Unis d’organiser des élections à portée fédérale en toute violation des lois électorales adoptées par les parlements de chacun de ces États. Et ce, en contradiction directe avec l’article II section 1 de la Constitution américaine, lequel confie aux seules législatures des États le soin de déterminer les règles du déroulement des élections. Joe Biden sera bien, le 20 janvier 2021, le 46ème président « miraculé » des États-Unis. Il peut compter sur l’appui des médias sociaux, qui veillent au grain. Les posts et vidéos qui évoquent la fraude électorale sont désormais évincés de Facebook et de Youtube, la contestation des résultats étant assimilée à de la sédition. Le compte Twitter de Donald Trump est bloqué, l’interdisant de communiquer avec ses 85 millions de followers. La purge est en cours. Comme l’écrivit l’homme politique anglais Edmund Burke à la fin du XVIII° siècle, « la seule chose nécessaire pour que le mal triomphe, c’est que les hommes du bien ne fassent rien ». En l’occurrence, rien n’a été fait et maintenant, il n’y a plus rien à faire. Anthony Lacoudre
Surtout, nous avons réaffirmé l’idée sacrée qu’en Amérique, le gouvernement répond au peuple. Notre lumière directrice, notre étoile du Nord, notre conviction inébranlable a été que nous sommes ici pour servir les nobles citoyens américains de tous les jours. Notre allégeance ne va pas aux intérêts spéciaux, aux sociétés ou aux entités mondiales; c’est pour nos enfants, nos citoyens et notre nation elle-même. Ma priorité absolue, ma préoccupation constante, a toujours été l’intérêt supérieur des travailleurs américains et des familles américaines. Je n’ai pas cherché le cours le plus facile; de loin, c’était en fait le plus difficile. Je n’ai pas cherché le chemin qui recevrait le moins de critiques. J’ai engagé les batailles les plus difficiles, les combats les plus durs, les choix les plus difficiles parce que c’est pour cela que vous m’avez élu. (…) Nous avons promu une culture où nos lois seraient respectées, nos héros honorés, notre histoire préservée et les citoyens respectueux des lois jamais méprisés (…) Aucune nation ne peut prospérer longtemps si elle perd la foi en ses propres valeurs, son histoire et ses héros, car ce sont là les sources mêmes de notre unité et de notre vitalité. (…) La clé de la grandeur nationale réside dans le maintien et la transmission de notre identité nationale commune. Cela signifie se concentrer sur ce que nous avons en commun: le patrimoine que nous partageons tous. Au centre de cet héritage se trouve également une solide croyance en la liberté d’expression, la liberté d’expression et le libre débat. Seul l’oubli de qui nous sommes et comment nous sommes arrivés où nous sommes que nous nous nous abandonnerons à la censure politique et à la mise sur liste noire en Amérique. Ce n’est même pas pensable. Mettre fin au débat libre et contradictoire viole nos valeurs fondamentales et nos traditions les plus durables. En Amérique, nous n’insistons pas sur la conformité absolue et n’imposons pas des orthodoxies rigides et une police de la pensée ou de la parole. Ce n’est tout simplement pas ce que nous faisons. L’Amérique n’est pas une nation timide d’âmes dociles qui ont besoin d’être protégées de ceux avec qui nous sommes en désaccord. Ce n’est pas qui nous sommes. Ce ne sera jamais qui nous sommes. (…) En repensant aux quatre dernières années, une image me vient à l’esprit au-dessus de toutes les autres. Chaque fois que je parcourais le parcours du cortège, il y avait des milliers et des milliers de personnes. Ils étaient sortis avec leurs familles pour pouvoir tenir et agiter fièrement à notre passage notre grand drapeau américain. Cela n’a jamais manqué de m’émouvoir profondément. Je savais qu’ils ne venaient pas simplement me montrer leur soutien; ils venaient me montrer leur soutien et leur amour pour notre pays. C’est une république de fiers citoyens unis par notre conviction commune que l’Amérique est la plus grande nation de toute l’histoire. Nous sommes, et devons toujours être, une terre d’espoir, de lumière et de gloire pour le monde entier. C’est le précieux héritage que nous devons sauvegarder à chaque tournant. C’est exactement ce pourquoi j’ai oeuvré ces quatre dernières années, ça et rien d’autre. D’une grande salle de dirigeants musulmans à Riyad à une grande place de Polonais à Varsovie; d’un discours à l’Assemblée coréenne à la tribune de l’Assemblée générale des Nations Unies; et de la Cité Interdite de Pékin à l’ombre du Mont Rushmore, j’ai combattu pour vous, je me suis battu pour votre famille, je me suis battu pour notre pays. Par-dessus tout, je me suis battu pour l’Amérique et tout ce qu’elle représente – c’est-à-dire sûre, forte, fière et libre. Maintenant, alors que je me prépare à remettre le pouvoir à une nouvelle administration mercredi à midi, je veux que vous sachiez que le mouvement que nous avons lancé ne fait que commencer. Il n’y a jamais rien eu de tel. La conviction qu’une nation doit servir ses citoyens ne diminuera pas, mais ne fera au contraire que se renforcer de jour en jour. Président Trump
Le roi est mort, vive le roi !
En cette triste journée où 227 ans, presque jour pour jour, après la France …
Fondant sa république sur le sacrifice rituel de son roi …
La moitié de l’Amérique et une bonne partie du monde …
S’apprêtent à célébrer la formidable parce qu’universelle puissance …
De l’expulsion réussie d’un bouc émissaire …
Devinez comment …
Entre propagande massive des médias et contournement des lois électorales …
Un candidat quasi-sénile ayant mené une campagne virtuelle depuis le sous-sol de sa maison loin des journalistes et de la population …
Et ayant survécu à des accusations d’agression sexuelle …
Comme à des soupçons d’extorsion en Ukraine et de trafic d’influence avec la Chine….
Tout en en apportant sa caution à des mois d’émeutes et de pillages …
Arrive-t-il à défaire – ironie tragique de l’affaire – le candidat de la loi et de l’ordre …
Pour se voir finalement investi… sous la même protection militaire digne d’un Etat policier ..
Que tout au long de l’année précédente il avait refusé…
Quand les grandes métropoles du pays étaient livrées aux flammes et au pillage des Black Lives Matter et antifas ?
My fellow Americans: Four years ago, we launched a great national effort to rebuild our country, to renew its spirit, and to restore the allegiance of this government to its citizens. In short, we embarked on a mission to make America great again — for all Americans. As I conclude my term as the 45th President of the United States, I stand before you truly proud of what we have achieved together. We did what we came here to do — and so much more. This week, we inaugurate a new administration and pray for its success in keeping America safe and prosperous. We extend our best wishes, and we also want them to have luck — a very important word. I’d like to begin by thanking just a few of the amazing people who made our remarkable journey possible. (…) Most of all, I want to thank the American people. To serve as your President has been an honor beyond description. Thank you for this extraordinary privilege. And that’s what it is — a great privilege and a great honor. We must never forget that while Americans will always have our disagreements, we are a nation of incredible, decent, faithful, and peace-loving citizens who all want our country to thrive and flourish and be very, very successful and good. We are a truly magnificent nation. All Americans were horrified by the assault on our Capitol. Political violence is an attack on everything we cherish as Americans. It can never be tolerated. Now more than ever, we must unify around our shared values and rise above the partisan rancor, and forge our common destiny. Four years ago, I came to Washington as the only true outsider ever to win the presidency. I had not spent my career as a politician, but as a builder looking at open skylines and imagining infinite possibilities. I ran for President because I knew there were towering new summits for America just waiting to be scaled. I knew the potential for our nation was boundless as long as we put America first. So I left behind my former life and stepped into a very difficult arena, but an arena nevertheless, with all sorts of potential if properly done. America had given me so much, and I wanted to give something back. Together with millions of hardworking patriots across this land, we built the greatest political movement in the history of our country. We also built the greatest economy in the history of the world. It was about “America First” because we all wanted to make America great again. We restored the principle that a nation exists to serve its citizens. Our agenda was not about right or left, it wasn’t about Republican or Democrat, but about the good of a nation, and that means the whole nation. With the support and prayers of the American people, we achieved more than anyone thought possible. Nobody thought we could even come close. We passed the largest package of tax cuts and reforms in American history. We slashed more job-killing regulations than any administration had ever done before. We fixed our broken trade deals, withdrew from the horrible Trans-Pacific Partnership and the impossible Paris Climate Accord, renegotiated the one-sided South Korea deal, and we replaced NAFTA with the groundbreaking USMCA — that’s Mexico and Canada — a deal that’s worked out very, very well. Also, and very importantly, we imposed historic and monumental tariffs on China; made a great new deal with China. But before the ink was even dry, we and the whole world got hit with the China virus. Our trade relationship was rapidly changing, billions and billions of dollars were pouring into the U.S., but the virus forced us to go in a different direction. (…) We reignited America’s job creation and achieved record-low unemployment for African Americans, Hispanic Americans, Asian Americans, women — almost everyone. Incomes soared, wages boomed, the American Dream was restored, and millions were lifted from poverty in just a few short years. It was a miracle. The stock market set one record after another, with 148 stock market highs during this short period of time, and boosted the retirements and pensions of hardworking citizens all across our nation. 401(k)s are at a level they’ve never been at before. (…) When our nation was hit with the terrible pandemic, we produced not one, but two vaccines with record-breaking speed, and more will quickly follow. They said it couldn’t be done but we did it. They call it a “medical miracle,” and that’s what they’re calling it right now: a “medical miracle.” Another administration would have taken 3, 4, 5, maybe even up to 10 years to develop a vaccine. We did in nine months. We grieve for every life lost, and we pledge in their memory to wipe out this horrible pandemic once and for all. (…) We confirmed three new justices of the United States Supreme Court. We appointed nearly 300 federal judges to interpret our Constitution as written. For years, the American people pleaded with Washington to finally secure the nation’s borders. I am pleased to say we answered that plea and achieved the most secure border in U.S. history. (…) We proudly leave the next administration with the strongest and most robust border security measures ever put into place. This includes historic agreements with Mexico, Guatemala, Honduras, and El Salvador, along with more than 450 miles of powerful new wall. We restored American strength at home and American leadership abroad. The world respects us again. Please don’t lose that respect. We reclaimed our sovereignty by standing up for America at the United Nations and withdrawing from the one-sided global deals that never served our interests. And NATO countries are now paying hundreds of billions of dollars more than when I arrived just a few years ago. It was very unfair. We were paying the cost for the world. Now the world is helping us. And perhaps most importantly of all, with nearly $3 trillion, we fully rebuilt the American military — all made in the USA. We launched the first new branch of the United States Armed Forces in 75 years: the Space Force. And last spring, I stood at Kennedy Space Center in Florida and watched as American astronauts returned to space on American rockets for the first time in many, many years. We revitalized our alliances and rallied the nations of the world to stand up to China like never before. We obliterated the ISIS caliphate and ended the wretched life of its founder and leader, al Baghdadi. We stood up to the oppressive Iranian regime and killed the world’s top terrorist, Iranian butcher Qasem Soleimani. We recognized Jerusalem as the capital of Israel and recognized Israeli sovereignty over the Golan Heights. As a result of our bold diplomacy and principled realism, we achieved a series of historic peace deals in the Middle East. Nobody believed it could happen. The Abraham Accords opened the doors to a future of peace and harmony, not violence and bloodshed. It is the dawn of a new Middle East, and we are bringing our soldiers home. I am especially proud to be the first President in decades who has started no new wars. Above all, we have reasserted the sacred idea that, in America, the government answers to the people. Our guiding light, our North Star, our unwavering conviction has been that we are here to serve the noble everyday citizens of America. Our allegiance is not to the special interests, corporations, or global entities; it’s to our children, our citizens, and to our nation itself. As President, my top priority, my constant concern, has always been the best interests of American workers and American families. I did not seek the easiest course; by far, it was actually the most difficult. I did not seek the path that would get the least criticism. I took on the tough battles, the hardest fights, the most difficult choices because that’s what you elected me to do. Your needs were my first and last unyielding focus. This, I hope, will be our greatest legacy: Together, we put the American people back in charge of our country. We restored self-government. We restored the idea that in America no one is forgotten, because everyone matters and everyone has a voice. We fought for the principle that every citizen is entitled to equal dignity, equal treatment, and equal rights because we are all made equal by God. Everyone is entitled to be treated with respect, to have their voice heard, and to have their government listen. You are loyal to your country, and my administration was always loyal to you. (…) We promoted a culture where our laws would be upheld, our heroes honored, our history preserved, and law-abiding citizens are never taken for granted. (…) Now, as I leave the White House, I have been reflecting on the dangers that threaten the priceless inheritance we all share. As the world’s most powerful nation, America faces constant threats and challenges from abroad. But the greatest danger we face is a loss of confidence in ourselves, a loss of confidence in our national greatness. A nation is only as strong as its spirit. We are only as dynamic as our pride. We are only as vibrant as the faith that beats in the hearts of our people. No nation can long thrive that loses faith in its own values, history, and heroes, for these are the very sources of our unity and our vitality. What has always allowed America to prevail and triumph over the great challenges of the past has been an unyielding and unashamed conviction in the nobility of our country and its unique purpose in history. We must never lose this conviction. We must never forsake our belief in America. The key to national greatness lies in sustaining and instilling our shared national identity. That means focusing on what we have in common: the heritage that we all share. At the center of this heritage is also a robust belief in free expression, free speech, and open debate. Only if we forget who we are, and how we got here, could we ever allow political censorship and blacklisting to take place in America. It’s not even thinkable. Shutting down free and open debate violates our core values and most enduring traditions. In America, we don’t insist on absolute conformity or enforce rigid orthodoxies and punitive speech codes. We just don’t do that. America is not a timid nation of tame souls who need to be sheltered and protected from those with whom we disagree. That’s not who we are. It will never be who we are. For nearly 250 years, in the face of every challenge, Americans have always summoned our unmatched courage, confidence, and fierce independence. These are the miraculous traits that once led millions of everyday citizens to set out across a wild continent and carve out a new life in the great West. It was the same profound love of our God-given freedom that willed our soldiers into battle and our astronauts into space. As I think back on the past four years, one image rises in my mind above all others. Whenever I traveled all along the motorcade route, there were thousands and thousands of people. They came out with their families so that they could stand as we passed, and proudly wave our great American flag. It never failed to deeply move me. I knew that they did not just come out to show their support of me; they came out to show me their support and love for our country. This is a republic of proud citizens who are united by our common conviction that America is the greatest nation in all of history. We are, and must always be, a land of hope, of light, and of glory to all the world. This is the precious inheritance that we must safeguard at every single turn. For the past four years, I have worked to do just that. From a great hall of Muslim leaders in Riyadh to a great square of Polish people in Warsaw; from the floor of the Korean Assembly to the podium at the United Nations General Assembly; and from the Forbidden City in Beijing to the shadow of Mount Rushmore, I fought for you, I fought for your family, I fought for our country. Above all, I fought for America and all it stands for — and that is safe, strong, proud, and free. Now, as I prepare to hand power over to a new administration at noon on Wednesday, I want you to know that the movement we started is only just beginning. There’s never been anything like it. The belief that a nation must serve its citizens will not dwindle but instead only grow stronger by the day. As long as the American people hold in their hearts deep and devoted love of country, then there is nothing that this nation cannot achieve. Our communities will flourish. Our people will be prosperous. Our traditions will be cherished. Our faith will be strong. And our future will be brighter than ever before. I go from this majestic place with a loyal and joyful heart, an optimistic spirit, and a supreme confidence that for our country and for our children, the best is yet to come. Thank you, and farewell. God bless you. God bless the United States of America.
President Trump
Voir aussi:
L’élection miraculeuse de Joe Biden- – partie 1
Anthony Lacoudre
France Soir
19/01/2021
« I’m sorry you can’t believe in miracles. » Lance Armstrong
Mercredi 20 janvier, au pied du Capitole à Washington DC, Joe Biden prêtera serment, la main posée sur la Bible. Il sera intronisé comme le nouveau président des États-Unis, ayant battu le président sortant Donald Trump. Il pourra effectivement remercier Dieu car son élection relève tout simplement du miracle.
Comment a-t-il fait en effet pour obtenir plus de 81 millions de voix lors de l’élection du 3 novembre dernier, c’est-à-dire plus de voix que n’importe quel autre candidat l’ayant précédé dans l’histoire du pays, y compris Barack Obama ? Comment a-t-il fait pour obtenir 15 millions de voix de plus qu’Hillary Clinton en 2016 ?
Et cela après avoir mené une campagne virtuelle depuis le sous-sol de sa maison du Delaware, en évitant soigneusement les contacts avec les journalistes et avec la population ? Comment a-t-il pu survivre aux accusations d’agression sexuelle contre une fonctionnaire du Sénat et aux soupçons d’extorsion en Ukraine et de trafic d’influence, notamment avec des pays comme la Chine ? Comment a-t-il fait, au cours de cette campagne, pour surpasser ses errements, ses diverses gaffes, ses propos maladroits, incohérents, parfois franchement racistes ?
En réalité, son élection ne relève pas d’un miracle, elle relève de la fraude.
La propagande des médias
La première fraude provient de la manipulation des électeurs par les médias. Jamais on n’avait vu une telle collusion entre un candidat, d’une part et les grands médias et médias sociaux, d’autre part. On avait cru atteindre le summum en 2016 lorsque par exemple CNN transmettait à l’avance à Hillary Clinton les questions des débats. C’était en réalité bien peu de choses par rapport à 2020. Jamais les sondages commandités par les grands médias n’auront été truqués à ce point en faveur de Joe Biden. Jamais n’avait-on assisté à un tel degré de propagande anti-Trump et pro-Biden tout au long de la campagne. Tout ce qui était positif à propos de Trump et tout ce qui était négatif à propos de Biden aura été caché au public, alors que tout ce qui était négatif à propos de Trump et tout ce qui était positif à propos de Biden aura fait l’objet d’un matraquage médiatique. Sans parler de la fabrication purement et simplement d’histoires mensongères à n’en plus finir contre le président sortant et son entourage.
Le scandale de la « Biden crime family » étouffé
Le point culminant est intervenu lorsque, le 14 octobre 2020, à deux semaines de l’élection, le New York Post révéla le scandale de la corruption de la famille Biden (« the Biden crime family » comme l’appelle Donald Trump). Facebook et Twitter bloquent alors immédiatement les comptes et les pages du quotidien, pour éviter la propagation. « Une erreur de jugement », admettra par la suite Jack Dorsey, le patron de Twitter, qui n’en pense sans doute pas un mot.
Les autres médias enterrent l’affaire, s’assurant que le scandale reste confiné. Et pourtant, les preuves sont accablantes. Hunter Biden, le fils de Joe Biden, décrit en détail dans ses emails obtenus par le « New York Post » le modus operandi : 50 % des sommes collectées étaient reversées au « big guy ».
Les sondages réalisés après l’élection dévoileront par la suite que 13 % des électeurs de Joe Biden n’auraient pas voté pour lui s’ils avaient été informés de l’existence du scandale en question. Ce qui représente plus de 10 millions de voix ! Quand on sait que Joe Biden a remporté l’élection in fine grâce à un peu moins de 50.000 voix d’avance dans trois États-clefs…
Le contournement des lois électorales
La deuxième fraude aura consisté pour la gauche américaine à contourner les lois électorales applicables aux bulletins par correspondance dans les principaux États-clefs, et ce, sous le prétexte de la crise du coronavirus.
Par exemple en Géorgie, il a été décidé que les bulletins par correspondance, envoyés à toute la population, seraient pris en compte sans vérification appropriée de la signature des électeurs, alors que la loi est on ne peut plus claire à ce sujet : les bulletins par correspondance doivent, sous peine de nullité, faire l’objet de contrôles strictes. En pratique, cette « relaxation » des standards de contrôle a permis à n’importe qui (des morts, des mineurs, des prisonniers, des non-résidents, des étrangers…) d’envoyer des bulletins, sans grand risque de rejet du vote. Du reste, le taux de rejet des bulletins par correspondance est passé de 3,5 % en 2016 (ce qui correspondait à 90.000 votes) à 0,3 % en 2020, et ce, alors même que le nombre de bulletins par correspondance reçus en 2020 a été multiplié par 5 comparé à 2016. Autrement dit, des dizaines de milliers de bulletins par correspondance illégaux ont été comptabilisés cette année en Géorgie.
Qui plus est, ces bulletins ont pu être déposés par les électeurs dans des boîtes (« drop boxes » financées par Mark Zuckerberg, le patron de Facebook), installées spécifiquement dans certains quartiers populaires des grandes villes de l’État afin d’éviter aux électeurs d’acquitter un timbre. Bien évidemment, la collecte des bulletins déposés dans ces boîtes n’a pas pu être supervisée par les assesseurs républicains…
Une vidéo prise par des caméras de surveillance a fait sensation. Elle montre comment les employés de la ville d’Atlanta ont géré le dépouillement de ces bulletins dans le centre le plus important de la ville (State Farm Arena). A 23h le soir du 3 novembre, la presse et les assesseurs des deux partis, sous le prétexte d’une fuite d’eau empêchant la poursuite du dépouillement, sont priés de rentrer chez eux et de revenir le lendemain matin. Une fois la scène vidée de ses témoins gênants, quatre employés municipaux extirpent des dizaines de milliers de bulletins de quatre valises qui avaient été placées et cachées dans la salle le matin même, pour être scannés, à de multiples reprises, dans les machines. Au total, 24 000 bulletins comptabilisés en toute illégalité, comme attesté en direct sur le site du New York Times (real time tabulations). Joe Biden a finalement emporté l’État avec… 11 779 voix d’avance.
En Pennsylvanie, la loi était claire. Les bulletins par correspondance ne pouvaient être acceptés que si l’électeur apposait sa signature sur l’enveloppe. Mais cette année, le gouverneur démocrate a autorisé les centres de dépouillement à comptabiliser les bulletins sans enveloppe (« naked ballots »), ouvrant ainsi la voie à de la fraude massive. On comprend mieux pourquoi les assesseurs républicains se sont vus barrer l’accès aux centres de dépouillement à Philadelphie, et ce, même en dépit d’injonction obtenues en référé auprès des juges locaux.
Par ailleurs, la loi prévoyait que les bulletins par correspondance reçus par la poste après 20h le mardi 3 novembre étaient nuls et ne pouvaient être comptabilisés. Qu’à cela ne tienne, les bulletins collectés jusqu’au vendredi 6 novembre ont été pris en compte, y compris ceux reçus sans cachet de la poste sur l’enveloppe ! N’importe qui a donc pu voter en Pennsylvanie dans les jours qui ont suivi le jour de l’élection … On précisera que 75% des 630 000 bulletins par correspondance « magiques » reçus après le 3 novembre ont été en faveur de Joe Biden.
Qui plus est, dans certains comtés en Pennsylvanie, plus de voix ont été comptabilisées que d’inscrits sur les listes électorales ayant voté – 205 000 plus précisément d’après un rapport du Sénat de Pennsylvanie du 29 décembre 2020 dénonçant ce phénomène de « over votes », c’est-à-dire de bulletins comptabilisés qui n’ont pas été imprimés par le gouvernement de la Pennsylvanie.
Dans le Wisconsin, la loi prévoyait que seules les personnes bénéficiant du statut de personne confinée indéfiniment (typiquement des personnes grabataires) pouvaient voter par correspondance sans avoir à se déplacer au préalable au bureau de vote pour chercher un bulletin en montrant sa pièce d’identité (un bulletin leur est alors envoyé par la poste chez eux). Mais pour l’occasion, sur ordre du gouverneur (démocrate), le statut a été largement étendu, passant de 70.000 personnes environ aux élections précédentes à 200 000 cette année, en raison du coronavirus. 130 000 votes de plus que les années précédentes ont donc été comptabilisés sans contrôle d’identité à l’échelle de l’État (un peu comme si les bureaux de vote avaient accepté que 200 000 électeurs qui venaient en personne voter ne présentent pas leur pièce d’identité). Précisons que ces 200 000 bulletins furent largement favorables à Joe Biden, lequel a remporté l’État avec 20 682 voix.
Anthony Lacoudre est avocat à New York.
L’élection miraculeuse de Joe Biden – partie 2
Anthony Lacoudre
France Soir
19/01/2021
Des preuves de fraude accablantes
Les avocats de Donald Trump ont réuni plus de mille témoignages sous serment de personnes attestant d’irrégularités importantes constatées lors des élections du 3 novembre. Chacune de ces personnes risque 5 ans de prison si elle présente un témoignage mensonger.
Ainsi, des assesseurs racontent comment ils ont été expulsés des centres de dépouillement du Michigan par la police locale, sous les applaudissements des employés municipaux en train de procéder au dépouillement, des conducteurs de camion expliquent qu’ils ont conduit des chargements de centaines de milliers de bulletins fraîchement imprimés de New York jusqu’en Pennsylvanie, des employés municipaux confirment qu’ils scannaient dans les machines des bulletins par correspondance qui n’avaient pas été pliés (c’est-à-dire qui ne sortaient pas d’enveloppes) ou encore confirment qu’on leur demandait de comptabiliser des bulletins par correspondance sans vérifier les signatures, des postiers révèlent que leur hiérarchie leur demandait d’anti-dater des bulletins par correspondance reçus hors délais, des « white hat hackers » témoignent qu’ils ont réussi à se connecter aux machines des bureaux de vote en Géorgie (dans le comté de Fulton à Atlanta), des électeurs racontent que, se rendant aux urnes pour voter, ils se sont entendus dire qu’ils avaient déjà voté et qu’ils pouvaient rentrer chez eux, etc.
Par ailleurs, ces mêmes avocats ont réuni des études et témoignages d’experts en probabilités identifiant les anomalies statistiques du 3 novembre. Par exemple, dans l’histoire du pays, jamais six États n’ont interrompu en même temps leur dépouillement à partir de 23h le soir de l’élection. Jamais des pics d’enregistrement de voix par centaines de milliers en faveur d’un candidat en pleine nuit n’ont été constatés en l’espace de seulement quelques heures. Jamais un candidat républicain n’a perdu l’élection alors qu’il a emporté la Floride et l’Ohio (qui plus avec 5 points de plus qu’en 2016).
« Les résultats sont aberrants et absurdes » martèlent les mathématiciens. « Les taux de participation supérieurs à 85 % sont impossibles. Les votes en provenance de bureaux de vote à plus de 75 % en faveur d’un candidat sont la marque d’une fraude » expliquent-ils.
Surtout lorsque ces anomalies arithmétiques ne sont constatées que dans les grandes villes des six États-clefs, où Joe Biden a réalisé des scores époustouflants en comparaison aux scores inférieurs de Biden par rapport à Hillary Clinton observés dans les autres grands centres urbains du pays, à commencer par New York City ou Los Angeles…
Ainsi, dans le comté de Fulton, à Atlanta en Géorgie, 161 bureaux de vote ont reporté entre 90 % et 100 % de votes en faveur de Joe Biden, totalisant 152 000 voix pour le candidat démocrate. Idem à Philadelphie ou 278 bureaux de vote (16 % des bureaux de la ville), ont reporté 97 % ou plus de voix pour Joe Biden, totalisant 100 200 voix pour Joe Biden contre 2.100 voix pour Donald Trump. Même à New York City, Donald Trump n’a pas été crédité de scores aussi déséquilibrés.
Toujours en Pennsylvanie, dans l’un des bureaux de vote du comté d’Allegheny, en Pennsylvanie, 93 % des bulletins par correspondance furent en faveur de Joe Biden, ce qui n’est pas possible d’un point de vue statistique, Joe Biden recevant 23 000 voix contre 1300 pour Donald Trump. Dans le comté de Wayne, le plus important du Michigan, 71 bureaux de vote ont reporté plus de votes que d’inscrits sur les listes électorales, le gouverneur (démocrate) passant outre le refus du comté de certifier les résultats…
Par ailleurs, les parlementaires locaux (républicains) d’Arizona, de Géorgie, du Nevada ou encore en Pennsylvanie, qui eux, ont pu enquêter et auditionner de nombreux témoins au cours des mois de novembre et décembre 2020, ont rédigé des rapports accablants contre leurs propres gouverneurs, attestant l’ampleur de la fraude dans leurs États respectifs.
En parallèle, on rappellera que le Sénat à Washington DC a lui-même organisé le 16 décembre 2020 des auditions de témoins sur le thème des irrégularités de l’élection du 3 novembre, les avocats de Donald Trump ayant alors eu l’occasion de détailler d’innombrables irrégularités, notamment concernant l’Arizona, le Nevada et le Wisconsin. A l’issue des présentations, plusieurs sénateurs durent reconnaître que de sérieux doutes pesaient sur la légitimité de l’élection de Joe Biden.
La justice se dérobe
Mais en dépit de cette montagne de preuves, les juges du pays ont refusé d’écouter les multiples requêtes en annulation des résultats des élections des États concernés. Aucune enquête n’a été diligentée, aucune procédure de « discovery » n’a été intentée (forçant la partie défenderesse de transmettre des informations), aucune saisie de bulletins ou des scans des machines n’a été ordonnée par les juges. Les avocats démocrates bataillèrent furieusement en justice pour qu’aucun audit ne puisse être ordonné, la plupart des requêtes ayant été écartées pour des questions de procédure.
Et lorsque les juges ont décidé d’entendre les affaires sur le fond, les débats furent bâclés. La cour suprême du Nevada a par exemple rendu son jugement après avoir accepté seulement 15 dépositions (par écrit, aucun témoin en personne), et a jugé sans enquête, sans délibération, après seulement 2 heures de plaidoirie un dossier constitué de 8 000 pages portant sur 130 000 votes contestés. En fait, les rares juges de différents États qui ont accepté d’écouter les affaires sur le fond ont rapidement conclu – par un raisonnement contestable – que le remède demandé (l’annulation de l’élection) était disproportionné, constatant que les électeurs avaient voté en bonne foi et que ce n’était pas de leur faute si les lois électorales étaient irrégulières…
Ce refus du pouvoir judiciaire de s’immiscer dans le contrôle à posteriori des élections culmina lorsque, le 7 décembre 2020, la Cour suprême fut saisie par 18 États et 126 membres de la Chambre des représentants, lui demandant de constater l’illégalité des élections tenues en Arizona, dans le Michigan, en Pennsylvanie et dans le Wisconsin. Quelques jours après, ce fut le coup de grâce. La cour rejetta la requête, considérant que les plaignants n’avaient pas démontré leur intérêt à agir…
La messe était dite. Les juges ont créé un précédent qui restera dans l’histoire : il est désormais possible au pouvoir exécutif des 50 États des États-Unis d’organiser des élections à portée fédérale en toute violation des lois électorales adoptées par les parlements de chacun de ces États. Et ce, en contradiction directe avec l’article II section 1 de la Constitution américaine, lequel confie aux seules législatures des États le soin de déterminer les règles du déroulement des élections.
Joe Biden sera bien, le 20 janvier 2021, le 46ème président « miraculé » des États-Unis. Il peut compter sur l’appui des médias sociaux, qui veillent au grain. Les posts et vidéos qui évoquent la fraude électorale sont désormais évincés de Facebook et de Youtube, la contestation des résultats étant assimilée à de la sédition. Le compte Twitter de Donald Trump est bloqué, l’interdisant de communiquer avec ses 85 millions de followers. La purge est en cours.
Comme l’écrivit l’homme politique anglais Edmund Burke à la fin du XVIII° siècle,
« la seule chose nécessaire pour que le mal triomphe, c’est que les hommes du bien ne fassent rien ».
En l’occurrence, rien n’a été fait et maintenant, il n’y a plus rien à faire.
Anthony Lacoudre est avocat à New York.
Voir également:
Respectons les 74 millions d’électeurs de Trump, ils ne sont pas “pitoyables”
The Wall Street Journal
15/01/2021
Donald Trump est fini, mais son sort n’est plus une priorité, observe ce chroniqueur conservateur du Wall Street Journal. Si Biden veut guérir l’Amérique, il va devoir apaiser les partisans de son adversaire, qui ont le sentiment que le mépris et la haine dont leur candidat est l’objet les visent eux aussi.
Si Donald Trump avait envisagé un avenir politique, c’est bel et bien terminé. Il a largement contribué à l’hypothéquer lui-même lors de la campagne pour les sénatoriales en Géorgie, en faisant passer sa petite personne devant l’intérêt d’une majorité républicaine au Sénat. Ce qui a achevé de lui boucher toute perspective, c’est la foule de ses partisans qui, mercredi [6 janvier], ont envahi le Capitole et, ce faisant, fait plus de tort à leur favori qu’aucun de ses ennemis n’y était jamais parvenu.
Washington se perd en conjectures sur le niveau d’humiliation qui sera infligé au président sortant. Après le lancement [et le vote] d’une deuxième procédure de destitution contre lui, on évoque même un procès devant le Sénat après la fin de son mandat.
Mais pour qui est attaché à l’unité et à la guérison, le sort de Donald Trump n’est plus une priorité. Il y a plus grave : ce qui va advenir de cette moitié de l’Amérique qui l’a soutenu. Beaucoup sont tentés de mettre dans le même sac les 74 millions d’Américains qui ont voté Trump et les auteurs de l’attaque du Capitole, et de les considérer désormais tous inaptes à la vie civique.
Voyous et Américains ordinaires
Il y avait là des voyous, c’est indéniable. Mais laissez-moi vous parler un peu de ces manifestants que je connais personnellement. Tous sont, sans exception, des Américains ordinaires et des individus honnêtes, qui n’ont pas participé à l’invasion du Capitole et jamais n’oseraient désobéir à un officier de police.
Certains parmi eux, mais pas tous, jugent que l’élection a été volée. Ils se trompent, mais cela ne fait pas d’eux des suprémacistes blancs, des terroristes de l’intérieur, des extrémistes religieux – ils ne méritent aucun des noms d’oiseaux lancés depuis une semaine. Ceux que je connais personnellement sont aujourd’hui terrifiés à l’idée d’être identifiés sur les réseaux (par des gauchistes vengeurs qui diffuseraient leurs informations personnelles), voire licenciés si jamais leur participation à la manifestation à Washington venait à se savoir.
Certains ne voient aucun problème à ce que les personnes ayant enfreint la loi [le 6 janvier] soient arrêtées et poursuivies en justice. Selon un sondage Reuters/Ipsos, seuls 9 % des Américains considèrent les émeutiers comme des “citoyens inquiets” et 5 % les tiennent pour des “patriotes”. Il y a dans les 90 % restants des millions d’électeurs de Trump.
Certes, parmi ces millions de personnes ayant choisi le bulletin Trump, certains, nombreux peut-être, croient à des théories du complot et ne font pas confiance à leur gouvernement.
Mais comment cela s’explique-t-il ? Cela aurait-il à voir avec le fait qu’ils entendent de grands médias déclarer fièrement qu’ils ne feront pas même l’effort d’être impartiaux dans leur couverture de Trump et ensuite alimenter, eux aussi, une théorie complotiste, selon laquelle le président serait un agent à la solde des Russes ? Faut-il s’étonner que les gens aillent puiser dans d’autres sources d’information, douteuses pour certaines ?
Trump n’a aucun talent pour apaiser les passions
Faut-il s’étonner que la méfiance envers l’État ait augmenté, quand les Américains ont découvert que de hauts responsables du FBI et du ministère de la Justice ont abusé de leurs pouvoirs de police pour interférer dans le résultat d’une élection puis saper la légitimité d’un président élu ? [Selon un autre article du Wall Street Journal, un rapport du Sénat américain détaillant la vulnérabilité de la campagne Trump 2016 à l’espionnage russe a également trouvé des failles dans l’enquête menée par le FBI.]
Donald Trump n’a aucun talent pour apaiser les passions, d’ailleurs aujourd’hui en plein emballement, et dans tous les cas il sera incessamment hors jeu. Mais si Joe Biden entend être, comme il l’a dit, le président de tous les Américains, qu’ils aient ou non voté pour lui, il a du pain sur la planche. Il [aurait été] bien avisé, pour commencer, de demander aux démocrates d’annuler la procédure d’impeachment qui ne fera que jeter du sel sur la plaie, et de faire comprendre aux républicains anti-Trump que, par leur volonté de mettre sur liste noire quiconque a exercé des fonctions au sein de l’administration Trump, ils ne feront qu’accentuer la rancœur et la division.
À lire aussi Opinion. Présidentielle 2020 : “pourquoi je ne pardonne pas aux électeurs de Trump”
Pourquoi serait-ce à Joe Biden d’aller apaiser des partisans de Trump désenchantés ? pourrait-on demander. C’est que Biden sera [le 20 janvier] le chef de cette nation, et que c’est une promesse qu’il a déjà faite. Dans son discours de victoire, il a dit qu’il était temps de “cesser de traiter nos adversaires en ennemis”. Il a tout à fait raison – mais il faut de l’autorité pour que ces mots se concrétisent pour ces millions d’électeurs de Trump qui ont le sentiment, non sans raison, que la haine et le mépris dont leur candidat est l’objet les visent eux aussi.
“L’État les a laissés tomber, l’économie les a laissés tomber”
Hillary Clinton n’avait pas dit autre chose lorsqu’elle avait, fort malheureusement, qualifié ces Américains de “pitoyables”. Ironie de l’histoire, dans ses propos, l’ancienne candidate démocrate ne rangeait dans sa “bande de pitoyables” que la moitié des partisans de Donald Trump.
L’autre moitié, avait-elle estimé, est faite de “gens qui ont le sentiment que l’État les a laissés tomber, que l’économie les a laissés tomber, que plus personne ne s’intéresse à eux, que plus personne ne se préoccupe de leur quotidien, ni de leur avenir.” Et d’ajouter :
Ces gens-là sont des gens que nous devons comprendre, dans leur raisonnement et dans leur ressenti.”
Hillary Clinton était prête à penser qu’au moins la moitié des supporters de Trump méritaient compréhension et empathie. Aujourd’hui, cela ferait d’elle une modérée.
William McGurn
All Donald Trump’s Deplorables
Even Hillary Clinton consigned only half of Trump supporters to her infamous ‘basket.’
Whatever political future Donald Trump might have envisioned for himself is now dead. He squandered a good chunk of it in the Georgia runoffs, when he made them all about himself instead of about keeping Republican control over the Senate. But it was finished off by the mob of his own supporters who stormed the Capitol this past Wednesday and inflicted more lasting damage on their man than anything his enemies ever managed.
At the moment, Washington is consumed with just how humiliating Mr. Trump’s exit will be—with a second impeachment, with the 25th Amendment invoked, with his resignation. There’s even talk of holding a Senate trial when he’s no longer president.
But for anyone who cares about unity and healing, the president’s fate is no longer the primary concern. More important is the future for the half of America that supported him. Because there is an effort to lump the 74 million Americans who voted for Mr. Trump with those who rampaged through the Capitol—thus rendering them unfit for polite society going forward.
There’s no denying the reality of the thugs. But let me tell you about the people I know who attended that rally. To a person, they are decent, ordinary Americans who didn’t enter the Capitol and wouldn’t dream of disobeying a police officer.
These are also people who have no problem with arresting and prosecuting those who did break the law that Wednesday. A Reuters/Ipsos poll reports that only 9% of Americans consider the rioters “concerned citizens” and 5% call them “patriots.” The remaining 90% includes millions of Trump voters.
True, those millions include some, perhaps many, who believe in conspiracy theories and don’t trust their government.
But where could that have come from? Might it have something to do with watching leading media outlets proudly declare they wouldn’t even try to be fair in reporting about Mr. Trump, and then go on to promote the conspiracy theory that the president was a Russian agent? Is it any surprise that people might then look to other sources of information, some of which are dubious? Or that distrust in government grew as people learned how leaders at the FBI and Justice Department abused their police powers to interfere in an election and then undermine an elected president?
Everywhere a Trump voter turns, he sees ostensibly apolitical organizations enlisting in the “resistance.” Here’s an email just sent to every kid in America applying to college through the Common App:
“We witnessed a deeply disturbing attack on democracy on Wednesday, when violent white supremacist insurrectionists stormed the U.S. Capitol in an attempt to undo a fair and legal election. The stark differences between how peaceful Black and brown protesters have been treated for years relative to Wednesday’s coup again call attention to the open wound of systemic racism.”
Mr. Trump’s power to cool passions, now running at a fever pitch, is almost nil, and in any event his time is running out. But if Joe Biden means what he says about being president for all Americans, including those who didn’t vote for him, he has work to do. A healthy start would be to ask his fellow Democrats to call off the impeachment that will only rub raw an open wound, or make clear to the anti-Trump Republicans in the Lincoln Project that their effort to blacklist anyone who served in the Trump administration is a prescription for more rancor and division.
Some ask: Why is it on Mr. Biden to soothe disenchanted Trump followers? The answer is because in a week he will be the nation’s leader—and he’s already promised as much. In his victory speech he said it was time to “stop treating our opponents as enemies.” He’s right, but it will take leadership to make these words real for millions of Trump voters who feel, with reason, that the hatred and contempt directed at Mr. Trump is also meant for them.
Hillary Clinton admitted this when she infamously labeled these voters “deplorables.” But funny thing about that: In her original remarks, she made clear she was consigning only half of Mr. Trump’s supporters to her “basket of deplorables.”
The other half, she said, are “people who feel that the government has let them down, the economy has let them down, nobody cares about them, nobody worries about what happens to their lives and their futures.” She went on to advise that “those are people we have to understand and empathize with as well.”
She was willing to consider at least half of Mr. Trump’s supporters worthy of understanding and empathy. Today, this would make Mrs. Clinton the moderate.
Esglobal – Madrid
Quel que soit le résultat final de l’élection, demandons-nous pourquoi des millions de sympathisants républicains sont restés fidèles au président sortant, écrit ce journaliste économique espagnol sur le site d’analyse des relations internationales Esglobal.Il est toujours tentant de qualifier d’irrationnels ceux qui ne votent pas comme nous, en particulier si ce sont des étrangers. À leur contact, on se sentirait tellement sages, supérieurs. On ne ferait pas le moindre effort pour les écouter et les comprendre.
Certains, même s’ils reconnaissent aux trumpistes une sorte de bon sens primitif, les jugent avec paternalisme et attribuent leurs opinions à une forme d’ignorance aussi crasse qu’autodestructrice : des pauvres types.
Nous ferions bien de reconnaître au contraire, du moins hypothétiquement, que bon nombre des électeurs de Trump sont aussi intelligents, rationnels et idéalistes que nos voisins. Ni plus, ni moins.
Ce qui les distingue, ce sont leurs objectifs et la conviction que le président Trump est le plus à même de les aider à les défendre.
Mais quels sont ces objectifs ? Et par quelles motivations (et demi-vérités) sont mus tant de millions de gens qui continuent à croire en Trump au bout de quatre ans ?
1) Économie et classe moyenne : mieux qu’en 2016 ?
Pendant les trois premières années du mandat de Trump, les revenus moyens des foyers sont passés de 63 000 à plus de 68 500 dollars par an, les salaires horaires des classes inférieures ont augmenté de 7 % au total et le chômage est descendu à des seuils jamais vus depuis les années 1960.
Parallèlement, la croissance économique que Trump a stimulée par ses baisses d’impôts en 2018 n’a guère modifié les écarts de revenus entre les différentes catégories de population. Et les baisses de revenus ont été très également partagées, ce qui a évité qu’une catégorie ne se sente particulièrement lésée.
Mais comment est-ce possible que l’électorat trumpiste n’ait pas tourné le dos à son champion avec la terrible récession provoquée par la pandémie dans le pays ?
Une chose est sûre, après ce que nous avons vu dans nos pays, il ne serait pas très étonnant que les partisans de Trump finissent par faire valoir que la crise n’est pas la faute du gouvernement fédéral, ou qu’ils estiment que les gouvernements antérieurs sont coresponsables de la mauvaise gestion, au même titre que les autorités régionales et locales.
Sans parler des puissances étrangères comme la Chine, qui a trop tardé à informer sur la gravité du coronavirus et des contaminations.
2) Donald, avons-nous gagné les guerres commerciales ?
En 2018, Trump a réussi à renégocier l’Alena, le traité de libre-échange avec le Mexique et le Canada, et à arracher à ces deux pays de modestes concessions qui favorisent les géants américains de l’automobile et des produits laitiers. Son électorat a pu y voir une victoire, mais ce n’était qu’une broutille. Il fallait qu’il s’en prenne à la Chine.
Selon l’institut Pew Research Center, les Américains qui ont une opinion négative de la Chine ne sont plus 47 % comme en 2017, mais désormais 66 % en 2020, et ils s’inquiètent notamment de la puissance de ses multinationales d’innovation technologique.
De plus, la moitié des Américains qualifie de “très grave” la disparition d’emplois, délocalisés, et le déficit commercial des États-Unis par rapport à la Chine.
Eh bien, le déficit commercial des États-Unis avec la Chine s’est effondré de près de 20 % entre 2018 et 2019, et de presque 30 % pendant les quatre premiers mois de 2020.
De plus, au pic de la guerre commerciale (de janvier 2018 à janvier 2020), 300 000 emplois dans l’industrie ont été créés aux États-Unis, et, ne l’oublions pas, le chômage est tombé à un niveau aussi bas que dans les années 1960. Et les salaires des plus pauvres ont nettement augmenté. Il ne sera pas difficile pour des millions d’Américains de faire, à tort, un lien entre la guerre commerciale et leur bonne fortune.
3) Nous, les Américains
Enfin, la défense de la supposée identité traditionnelle des États-Unis dont se réclame Trump est un sac de nœuds qui englobe des relations interraciales, la lutte contre l’immigration clandestine, l’élimination des impôts et de la bureaucratie (À bas le Léviathan !) et la promotion des valeurs conservatrices dans les tribunaux.
Trump a multiplié les détentions de migrants clandestins à la frontière avec le Mexique, au point qu’elles ont atteint en 2019 leur nombre le plus élevé depuis 2007.
Enfin, Trump a non seulement nommé plus de 50 juges dans les cours d’appel du pays, mais il a aussi réussi à placer trois juges conservateurs (Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh et Amy Coney Barrett) à la Cour suprême.
À partir de maintenant, que Joe Biden soit ou non vainqueur de la présidentielle, il faudra vivre avec la majorité conservatrice la plus écrasante qu’ait connue la plus haute juridiction depuis les années 1950. Et les électeurs républicains savent à qui exprimer leur gratitude dans les urnes.
https://www.courrierinternational.com/article/vu-despagne-cessons-de-mepriser-les-electeurs-de-trump
Voir enfin:
La défaite de Donald Trump signe-t-elle la fin du populisme?
ENQUÊTE – Le président sortant quitte la Maison-Blanche ce mercredi. Il aura été l’incarnation du «populisme», phénomène qui traverse la plupart des démocraties occidentales.
Ce mercredi, Donald Trump quittera la Maison-Blanche. Selon les règles établies par le 20e amendement de la Constitution américaine, à midi, son mandat prendra fin tandis que celui de Joe Biden commencera. Refusant de reconnaître sa défaite, Trump n’assistera pas à la prestation de serment de son successeur. Son bilan est certes moins mauvais que celui que ses adversaires dénoncent, mais l’envahissement récent du Capitole par ses sympathisants laisse une tache indélébile sur un mandat déjà scandé par les frasques et les polémiques.
Et pourtant, tout se passe comme si l’Amérique et le monde devaient encore être hantés longtemps par Donald Trump. Censuré par Twitter et Facebook, il est désormais en butte à la vindicte de Hollywood qui veut l’effacer: une pétition exige que son apparition dans le film Maman j’ai raté l’avion 2 soit supprimée (Trump a souvent été montré au cinéma comme un personnage positif, de M. Popper et ses pingouins, avec Jim Carrey, à Die Hard 3, avec Bruce Willis). Mais, au-delà du personnage de Donald Trump, c’est aussi l’avenir du trumpisme et plus largement du «populisme» à l’échelle mondiale qui est en jeu.
Il y a peu encore, beaucoup d’observateurs espéraient qu’une éventuelle défaite de Trump, qu’ils imaginaient large, marquerait le reflux de la vague de révolte qui déferle, élection après élection, depuis la victoire du Brexit en 2015. Celle-ci n’aurait été qu’une parenthèse avant un retour à la situation antérieure… Dans un roman dystopique paru quinze jours avant l’élection américaine du 3 novembre, l’écrivain écossais John Niven imaginait, au contraire, Ivanka Trump présidente en 2026! Si nous n’en sommes pas là, plus personne n’ose désormais pronostiquer une «normalisation» de la vie politique.
Le catalyseur et le réceptacle d’un malaise
«On aurait pu avoir le sentiment de la fin d’un cycle ou d’une page qui se tourne avec sa défaite, mais il faut prendre en compte la progression de Trump de 11 millions de voix entre 2016 et 2020, analyse le directeur général de la Fondation pour l’innovation politique, Dominique Reynié. Le camp trumpiste s’est élargi. Malgré la défaite, on est loin du schéma de l’effondrement.» Un point de vue que rejoint la chercheuse Chloé Morin, auteur d’un livre à paraître, intitulé Le Populisme au secours de la démocratie? (Gallimard): «La victoire de Biden n’est pas le résultat d’un triomphe idéologique car lorsqu’on enlève le facteur Trump, avec tout ce qu’il a d’irritant et qui a contribué à mobiliser les démocrates, on voit bien que le rapport de force est très équilibré. On peut même se dire qu’avec une personnalité moins exubérante il est probable que les républicains auraient gagné.»
Pour Laure Mandeville, grand reporter au Figaro et auteur d’un essai remarqué sur Trump, s’il reste une grosse interrogation sur son avenir personnel après «le point d’orgue chaotique du Capitole», le trumpisme, et de manière plus générale le populisme dans le monde, vont perdurer parce que la manière dont se termine cette présidence montre que les problèmes qui ont fait gagner Trump restent entiers. Elle prédit la survivance d’un certain nombre de thèmes majeurs mis en avant par Trump et qui devraient être récupérés par d’autres: «Le retour à la nation, la régulation de l’économie globalisée, la remise en cause du rôle de gendarme du monde des États-Unis, le rejet du politiquement correct…»
«C’est probablement la fin de Trump, certainement pas celle du trumpisme, en aucun cas celle du populisme», résume l’ancien ministre des Affaires étrangères, Hubert Védrine. Si le journaliste américain conservateur Christopher Caldwell concède qu’au niveau mondial «une bonne relation avec les États-Unis reste un atout, et qu’il sera plus difficile pour Marine Le Pen ou Marion Maréchal, ainsi que pour Matteo Salvini, Viktor Orban, et autres, de renforcer la confiance des électeurs dans les prochaines années», pour le géographe Christophe Guilluy, «se poser la question de la fin du populisme est aussi absurde que se poser la question de la fin du peuple».
Tous s’accordent en effet sur un point: le populisme n’est pas une maladie spontanée ou créée par Trump, mais une tentative de réponse à des maux bien réels dont souffrent les «déplorables», qu’ils portent une casquette rouge aux États-Unis ou un «gilet jaune» en France.
Le détachement croissant des «élites»
Le milliardaire new-yorkais, comme d’autres en Europe, a su capter ce malaise, en être le catalyseur et le réceptacle, mais celui-ci l’a précédé et le dépasse. Il est le fruit de quatre décennies de globalisation qui auront permis aux pays émergents de sortir de la pauvreté et même de prospérer, mais qui auront aussi vu le niveau de vie des classes populaires et moyennes occidentales stagner, voire décliner, tandis que leur mode de vie était bouleversé par l’immigration de masse et la montée en puissance du multiculturalisme comme «religion politique» (Mathieu Bock-Côté).
À ce double déclassement économique et culturel est venu s’ajouter un sentiment de dépossession démocratique. Déjà, en 1995, dans son chef-d’œuvre posthume, La Révolte des élites et la Trahison de la démocratie, le sociologue américain Christopher Lasch pointait le détachement croissant des «élites», toujours plus mobiles et hors-sol, des préoccupations de la majorité des gens ordinaires qu’elles étaient censées représenter.
25 ans plus tard, pour l’historien Éric Anceau, auteur des Élites françaises des Lumières au grand confinement, aux Éditions de l’Observatoire, la fracture démocratique entre les élites et le peuple n’a fait que s’accroître: «Les États-Unis étant le cœur du système globalisé, il n’est pas un hasard que la crise éclate là-bas, analyse-t-il, mais la construction d’une Union européenne technocratique et supranationale alimente aussi la défiance des peuples européens.»
Un constat partagé par Marcel Gauchet, qui déplore que les politiques menées par l’ensemble «des pays dit démocratiques» ne répondent plus aux vœux populaires massifs sur toute une série de questions: sécurité, immigration, mondialisation économique… «Si vous faites un référendum sur chacun de ces points, le résultat ne fait pas mystère et pourtant cela ne se traduit pas du tout, ou très peu, dans les politiques effectivement menées», explique-t-il. Et de voir dans le populisme, d’abord et avant tout, «une protestation contre des politiques antimajoritaires et une tentative pour les classes populaires de remettre le système démocratique au service de leurs besoins et de leurs aspirations».
La pandémie peut-elle rebattre les cartes en réhabilitant, au moins temporairement, une approche technocratique dite «raisonnable» de la politique? À court terme, comme semble l’indiquer la défaite de Trump, la crise sanitaire et la recherche de solutions consensuelles favorisent les dirigeants mesurés. Mais, à long terme, il est probable que la crise économique et sociale sur laquelle pourrait vraisemblablement déboucher la crise sanitaire exacerbera les fractures sur lesquelles prospèrent les populistes.
L’installation d’un chômage de masse, la multiplication des faillites d’entreprises, mais aussi de commerçants et d’artisans, l’ubérisation programmée du travail, y compris celui des cadres, devraient creuser les inégalités, accélérer la désagrégation de la classe moyenne ainsi que la défiance envers les dirigeants, les institutions et les corps intermédiaires.
Réconcilier les élites et les peuples
La crise du coronavirus, en révélant les failles de notre économie mondialisée, confirme une partie du diagnostic des populistes et légitime leur vision protectionniste. Les concepts d’État-nation, de contrôle des frontières, de souveraineté politique et économique, de relocalisation de la production, traditionnellement défendus par les «populistes», sont en train de revenir en grâce aux yeux de l’opinion, observe David Goodhart.
C’est pourquoi l’intellectuel britannique, dans son nouvel essai, La Tête, la Main et le Cœur (Les Arènes), plaide pour un «populisme décent» qui réconcilierait les élites et les peuples en prenant en compte à la fois les aspirations transnationales des premiers et celles, plus nationales et locales, des seconds. «C’est ce que tente de faire Boris Johnson en Grande-Bretagne en alliant une sorte de reconnaissance de la question nationale, en embrassant le Brexit, avec un virage à gauche spectaculaire pour le Parti conservateur sur les questions sociales», résume Laure Mandeville.
Le risque est que cette procédure d’impeachment acte l’idée que nous ne sommes plus dans le cadre d’un débat démocratiqu
Chloé Moirin, chercheuse
Le mot «réconciliation» a aussi été au cœur du discours de Joe Biden durant toute sa campagne. Reste que, comme le souligne Marcel Gauchet, «il ne suffit pas de prononcer le mot, il faudra incorporer dans les politiques les réponses aux aspirations dites populistes». D’autant que la procédure d’impeachment lancé contre Trump pourrait conforter l’idée que toute une partie du pays cherche à évacuer l’autre partie du débat public. «Le risque est que cette procédure acte l’idée que nous ne sommes plus dans le cadre d’un débat démocratique, mais dans un cadre où le droit, qui est censé être le garant des institutions, est instrumentalisé contre une partie de la population et de ses opinions.», confirme Chloé Moirin.
Pour tenter d’anticiper ce que pourrait être l’avenir des États-Unis, et plus largement du monde occidental, certains n’hésitent pas à puiser dans un passé très lointain. Ainsi de l’historien Raphael Doan, auteur de Quand Rome inventait le populisme, qui voit en Donald Trump le lointain héritier de Clodius, leader populiste connu pour ses frasques et ennemi juré de Cicéron. Lors de ses funérailles, en 52 avant J.-C., la foule incendia le Sénat, devenu pour une partie du peuple le symbole du pouvoir oligarchique. Un incident qui permit le retour revanchard de Cicéron, écarté par Clodius, en héraut du front républicain. Mais ce n’était que le début d’une longue guerre civile entre plébéiens et patriciens, populares et optimates, qui déchira Rome pendant vingt ans. Jusqu’à la victoire d’un certain Jules César…
COMPLEMENT:
La démocratie américaine dans les eaux dangereuses d’un temps révolutionnaire
ANALYSE – Après quatre ans de présidence Trump, l’Amérique tangue au-dessus d’un précipice. La politique est devenue une guerre de factions. Et des segments entiers du corps social semblent tentés par une forme de sécession mentale. Une situation volcanique qui laisse au nouveau président, Joe Biden, une bien faible marge de manœuvre pour rassembler le pays.
L’Amérique est entrée dans les eaux dangereuses et incertaines d’un temps révolutionnaire. Cela fait en réalité des années que ce processus est engagé, mais ce n’est que maintenant, confrontés à des faits trop éclatants pour être sous-estimés, que nous commençons à en prendre toute la mesure. Le 6 janvier, une foule en furie, chauffée à blanc par un président Trump persuadé de s’être fait voler l’élection présidentielle, s’est lancée, telle un taureau devenu fou, à l’assaut du Congrès, saint des saints de la démocratie américaine, pour en forcer portes et fenêtres. Ce coup de force a-t-il commencé un peu par hasard, comme cela est souvent le cas dans les insurrections, quand soudain tout s’embrase pour un détail, comme le suggérait un récent article de notre correspondant à Washington Adrien Jaulmes? Ou des fauteurs de troubles avaient-ils préparé leur manœuvre et planifié de déclencher l’émeute? Avaient-ils des complicités avec certains policiers, qui ont semblé fraterniser avec la foule selon certaines vidéos? Il est encore trop tôt pour le dire et il appartiendra à la minutieuse enquête du FBI de déterminer la chaîne des événements de cette effrayante journée.
Plaidant pour la première hypothèse, moult images de l’émeute ont laissé voir des «insurgés touristes», se promenant comme en visite guidée dans la salle des illustres du Capitole, plus occupés à prendre des selfies de leur coup d’éclat qu’à fomenter un coup d’État ; clairement surpris pour certains, d’être arrivés jusque-là. «Cela n’avait rien d’organisé», pense le rédacteur en chef de la revue Tablet, Jacob Siegel, qui évoque «l’aspect carnavalesque» de l’épisode, mettant en scène des individus vêtus de peau de fourrure et casques cornus, ou en tenues treillis. Dans les débuts de la Révolution française ou la prise du palais d’Hiver à Saint-Pétersbourg en 1917, ce même peuple bruyant et sans bonnes manières, fit irruption dans le monde «d’en haut», un peu impressionné au début, puis s’enhardissant pour piller et emporter les meubles, comme ce fut le cas pour un insurgé parti avec le «trophée» du podium du «speaker» de la Chambre. Mais à côté de la «farce grinçante», on a vu poindre aussi le visage de la meute violente: cinq morts, des policiers tabassés par des milices paramilitaires, les cris horrifiants de «Pendez Mike Pence» (le vice-président) scandés par des manifestants, des journalistes pris à partie violemment. Une rage collective soudain avait surgi. Elle soufflait, gonflait, se répandait. «On vous hait!», hurlaient les émeutiers aux policiers qui tentaient de les calmer.
Depuis, un pays abasourdi et traumatisé, qui vient d’investir Joe Biden président lors d’une belle cérémonie sans fausses notes mais tenue dans une ambiance de citadelle assiégée, s’interroge. Que nous arrive-t-il? Quelle est la signification profonde de ce coup de force? Assiste-t-on seulement à la fin tragique et calamiteuse d’une présidence Trump qui restera marquée d’un sceau d’infamie? Ou sommes-nous les témoins ébahis du premier soubresaut d’une révolution qui a commencé bien avant et qui est très loin d’être terminée? L’arrivée d’un politique centriste, expérimenté et soucieux de rassembler, comme Joe Biden, permettra-t-elle d’apaiser les ravages de la tornade Trump et de l’empoignade hystérique entre camp républicain et camp démocrate qui a suivi son entrée à la présidence, ou une sortie de route de la démocratie américaine plus grave encore est-elle à craindre?
«On entre dans des eaux inconnues», juge Linda Feldmann, correspondante du Christian Science Monitor à la Maison-Blanche, qui parle d’un «grave avertissement». «Je pense qu’on pourrait notamment avoir des explosions de violence anarchiques locales dans des États de tradition de milice comme le Michigan, si on ne parvient pas à une réconciliation», ajoute-t-elle, très inquiète, évoquant un possible scénario «à la nord-irlandaise».
Dans le camp démocrate qui est en train de prendre les rênes du pays et dans la presse libérale [de gauche, NDLR] qui le soutient, la lecture la plus fréquente des événements du 6 janvier est que ce moment de violence était «programmé» depuis le début par la personnalité incontrôlable de Trump, son mépris des formalités de l’exercice du pouvoir, et son appel aux «pires instincts» racistes de l’Amérique dont il aurait réveillé les démons. C’est notamment la thèse de l’éditorialiste Michelle Goldberg, qui écrit dans le New York Times avoir attendu en vain, la prise de conscience du danger trumpien «depuis le premier jour» de sa présidence. Pour elle, et pour une grande partie du camp démocrate, le milliardaire restera le grand «Diable ex machina» qui porte l’entière responsabilité de la crise démocratique que traverse le pays, et dont tout le bilan est à jeter sans discernement dans les poubelles de l’Histoire. Beaucoup d’observateurs, notamment en France, s’alignent sur cette interprétation. «Son caractère était sa destinée, et est devenu la nôtre», résume Thomas Friedman, dans le New York Times de ce mercredi.
S’il y a du vrai dans cette critique du caractère trumpien et du rôle catastrophique qu’a joué son ego, le problème reste que faire porter à Trump la responsabilité totale de ce qui s’est passé revient à regarder l’arbre sans voir la forêt, et donc à semer les germes d’une future catastrophe, répliquent d’autres observateurs généralement conservateurs. Oui, Trump a une écrasante responsabilité dans la fin pitoyable de sa présidence, qui disqualifie un bilan pourtant non négligeable. Incapable d’accepter honorablement sa défaite, il a mis en péril le processus de la transition pacifique du pouvoir, point capital de l’exercice démocratique. Mais ses graves manquements ne doivent pas occulter ceux de ses adversaires politiques et l’enchaînement tragique que leur empoignade infernale a engendré. Car si Trump en est venu à être viscéralement convaincu d’avoir été spolié de l’élection, c’est que durant quatre ans, l’opposition démocrate s’est comportée comme s’il était un président illégitime, une marionnette du Kremlin qui aurait usurpé, par le biais d’une ténébreuse collusion russe, la victoire de Hillary Clinton (en 2019, cette dernière parlait encore d’avoir été «volée»). L’idée obsessionnelle d’une excommunication du «diable Trump», entretenue par le camp libéral, a alimenté la conviction du président d’alors d’être assiégé par un État profond prêt à tout pour l’écarter. Même chose pour ses partisans. «Le rejet de la légitimité de l’élection de Trump en 2016, par des moyens institutionnels, a préparé le le rejet de la légitimité de l’élection de Biden en 2020, même si ce second rejet s’est exprimé de manière volatile et violente, beaucoup plus dangereuse», affirme Jacob Siegel, rédacteur en chef à la revue d’idées new-yorkaise Tablet. Un avis que partage Andrew Michta, doyen du Centre George-C-Marshall Center, qui s’exprime à titre privé. Pour lui, la grande erreur des élites américaines a été de refuser de reconnaître que Trump était «le symptôme d’une crise bien plus large et plus ancienne». «Son élection était un avertissement envoyé par le peuple aux élites, qui n’en ont pas tenu compte».
La crise démocratique se noue en réalité bien plus tôt, explique Michta, quand dans l’ivresse du triomphe de la démocratie libérale et de la chute du mur de Berlin en 1989-1990, l’Amérique opte pour l’ouverture des frontières et une logique de dénationalisation qui laisse ses grandes entreprises «brader tous les bijoux de famille industriels» de l’Amérique vers la Chine. «Notre classe oligarchique et politique n’a jamais accepté d’être tenue responsable pour les décisions qu’elle avait prises alors, telle que la délocalisation de notre industrie, et le déclenchement de guerres sans fin, accuse-t-il. Elle a opté pour des choix politiques qui n’avaient jamais été vraiment choisis par la population, et qui ont mené au déclin de la classe moyenne, “demos” de la nation américaine et âme de son succès.» Pour Michta, «cet abandon en rase campagne des classes populaires et moyennes par les élites, est la vraie raison de la gigantesque colère qui a grandi sans discontinuer jusqu’à la propulsion de Trump à la présidence». Il a scellé la rupture de ban entre l’establishment et le pays profond. «Il y a eu d’autres signaux avant Trump, le dégoût de voir l’Administration Obama sauver Wall Street et abandonner les gens simples à leurs faillites immobilières notamment», renchérit le professeur de théorie politique Joshua Mitchell. Un dégoût qui a donné la révolte des Tea Party de 2010 et à gauche le mouvement Occupy Wall Street, puis finalement le trumpisme et le sandérisme. «Nous n’aurions pas eu Trump pour président, si les démocrates étaient restés le parti des classes populaires», confiait récemment le professeur Bernard Grofman, de l’université California Irvine au New York Times, soulignant que dans un tiers des comtés passés d’Obama à Trump en 2016, on avait eu une hausse des résidents étranglés par des prêts immobiliers intenables.
À cette catastrophe socio-économique s’est ajoutée la déconstruction de la culture nationale menée par les élites libérales sous l’influence des théories critiques françaises exportées par l’école de Michel Foucault, dit Michta. «Comme l’a bien montré Samuel Huntington dans son livre “Qui sommes-nous?”, l’Amérique n’est pas seulement une nation d’immigrants, elle s’est construite dans le creuset de la culture nationale britannique, qui s’est enrichie d’ajouts successifs.» En défaisant ce creuset, et en soumettant la société au rouleau compresseur d’une critique qui a miné peu à peu toutes les institutions dites bourgeoises, comme la famille ou l’Église, le camp progressiste a fragilisé les liens entre les citoyens, qui ne se sont plus sentis appartenir à la même famille, et ont vu de nouveaux damnés de la terre, les minorités, prendre leur place dans le cœur des démocrates. «S’il n’y a plus de frontières ni de nation, il devient beaucoup plus facile de regarder ceux qui ne sont pas d’accord avec nous comme des ennemis ou des déplorables dont le sort nous importe peu», renchérit le professeur de théorie politique Joshua Mitchell, parlant du danger de la «tribalisation» que font surgir les excès de l’idéologie globaliste et l’obsession de l’identité raciale ou sexuelle. «Nous sommes divisés désormais entre pays des côtes et pays du milieu, selon des lignes géographiques qui correspondent à des fractures politiques et culturelles profondes», s’inquiète Andrew Michta, le «milieu» s’accrochant à l’idée d’une culture traditionnelle américaine qu’il faut absolument «sauver» tandis que les côtes prônent la diversité identitaire et l’art de la tolérance comme culture de remplacement. «Les élites ne communiquent plus avec le demos», poursuit-il. L’intellectuel américain pense que «la chimiothérapie imposée par Trump pour soigner le mal, n’a fait que consommer la rupture».
Comme les événements du 6 janvier et la manière dont ils ont été vécus l’ont révélé, une sorte de sécession mentale et politique s’est en effet amorcée, comme si une gigantesque partie du corps social était en train de «prendre congé» de la démocratie. Quelque 73 % des électeurs républicains (soit environ 40 % de la population) estiment que Trump n’a fait que défendre le processus constitutionnel en insistant sur les fraudes, une conviction qui les amène à conclure à l’illégitimité de Biden. Un déni effrayant, qui en dit long sur l’ampleur de la crise de confiance auquel ce dernier va devoir faire face. «La tyrannie n’est rien d’autre que la démocratie se mettant en congé d’elle-même», mettait en garde le philosophe Alexis de Tocqueville pour souligner la fragilité de cette dernière.
Comment dans ces conditions renouer les fils de la conversation nationale et rassembler le pays autour de faits acceptés, cette vibrante promesse faite «avec toute son âme» par le nouveau président Joe Biden à ses compatriotes, dans son adresse inaugurale? David French, intellectuel conservateur chrétien qui a fait la guerre d’Irak, appelle à «utiliser la méthode de la contre-insurrection pour reconstruire», en séparant les «insurgés» de la population. L’idée serait de poursuivre et punir durement les fauteurs de troubles, mais de tendre la main aux dizaines de millions d’électeurs trumpistes, qui ont droit à leurs convictions. «Nous devons négocier un moyen de vivre ensemble qui ne signifie pas l’obligation de reddition de l’une des parties», affirme le politologue William Galston dans le Wall Street Journal, invitant Biden à méditer les conseils d’Abraham Lincoln sur «l’importance de l’opinion publique sans laquelle rien ne peut réussir», et qu’il faut donc selon lui aujourd’hui rallier en renonçant à toute chasse aux sorcières.
C’est au fond déjà la voie qu’a dessinée Joe Biden en appelant «à prendre un nouveau départ, tous ensemble» au premier jour de sa présidence. «Entendons-nous, regardons-nous, a-t-il exhorté mercredi. La politique n’a pas à être une fournaise brûlante qui détruit tout sur son passage! Les désaccords ne doivent pas mener à la désunion.» Parmi ses nouveaux ministres, dont le secrétaire d’État Anthony Blinken, ou la secrétaire au Trésor Janet Yellen, on sent bien le désir d’aller vers des actions susceptibles de susciter un consensus chez les républicains et les oubliés de la globalisation: Yellen a proposé un plan d’aide aux classes moyennes, Blinken veut marcher sur les traces de Trump sur le dossier de la confrontation avec la Chine et sur celui de la réindustrialisation de l’Amérique. Quelque 17 élus républicains de la Chambre ont fait savoir qu’ils voulaient «coopérer», après l’investiture.
Mais l’ensemble du camp démocrate, que seule la haine de Trump a jusqu’ici uni, acceptera-t-il le compromis vis-à-vis des vaincus? Rien n’est moins sûr. Car à côté du volcan trumpien, dont on a vu surgir une «rage blanche» extrémiste très inquiétante le 6 janvier avec force slogans antisémites et drapeaux confédérés que Biden a promis de combattre, bouillonne en Amérique le volcan de la rage identitariste de la gauche radicale, qui a embrasé le pays pendant près de huit mois l’été dernier au nom de la justice sociale et de la défense des minorités ; transformant des manifestations pacifiques de protestation contre des violences policières en entreprise de pillage et destruction du patrimoine architectural et littéraire de l’Amérique, au motif qu’il est entaché de «racisme systémique». «Cette aile gauche du Parti démocrate, qui rêve d’une détrumpification combattante, aura-t-elle gain de cause?», s’interroge Joshua Mitchell, qui observe avec inquiétude «la culture de l’annulation» prônée par les milieux progressistes se déployer depuis le 6 janvier. L’expulsion de Trump de Twitter et celle du réseau social conservateur Parler des plateformes américaines sont des signaux peu encourageants, de même que l’appel lancé par la revue Forbes aux corporations américaines pour qu’elles refusent d’embaucher d’anciens membres de l’Administration Trump, sous peine d’être blacklistées. «Jusqu’où ira la purge?» insiste Mitchell, qui s’inquiète des deux rages identitaires qui soufflent de la gauche et de la droite, et de la manière dont elles se nourrissent l’une l’autre. Pour lui, une seule issue: retourner à la «politique des compétences», loin des passions identitaires et des logiques de factions, pour recréer «ces compromis patients et imparfaits entre citoyens» qui avaient tant émerveillé Tocqueville.
Le grand historien de la Grèce antique Victor Davis Hanson, qui a pris parti pour Trump contre les élites depuis quatre ans, met, quant à lui, en garde contre un acharnement sur le «cadavre politique» de l’ex-président, comparant l’idée d’une destitution post-présidentielle à l’acharnement d’Achille sur le corps mort d’Hector pendant la guerre de Troie. Poignardé et traîné derrière un char, celui qui n’était qu’un «vaincu fanfaron» allait devenir une figure mythique…

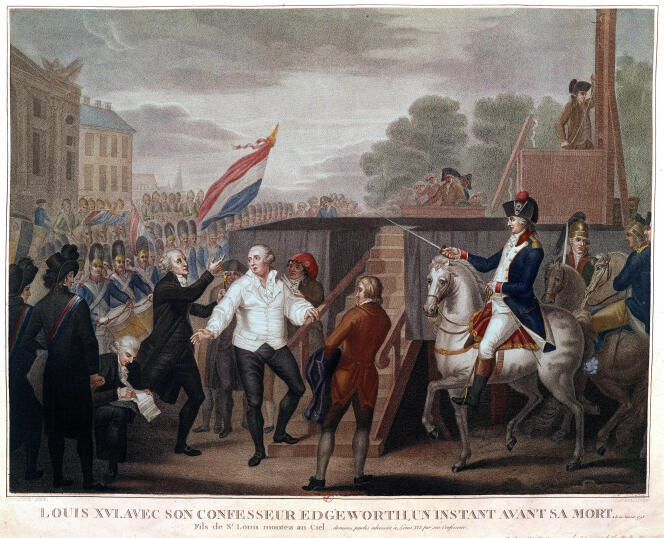



 Publié par jcdurbant
Publié par jcdurbant 




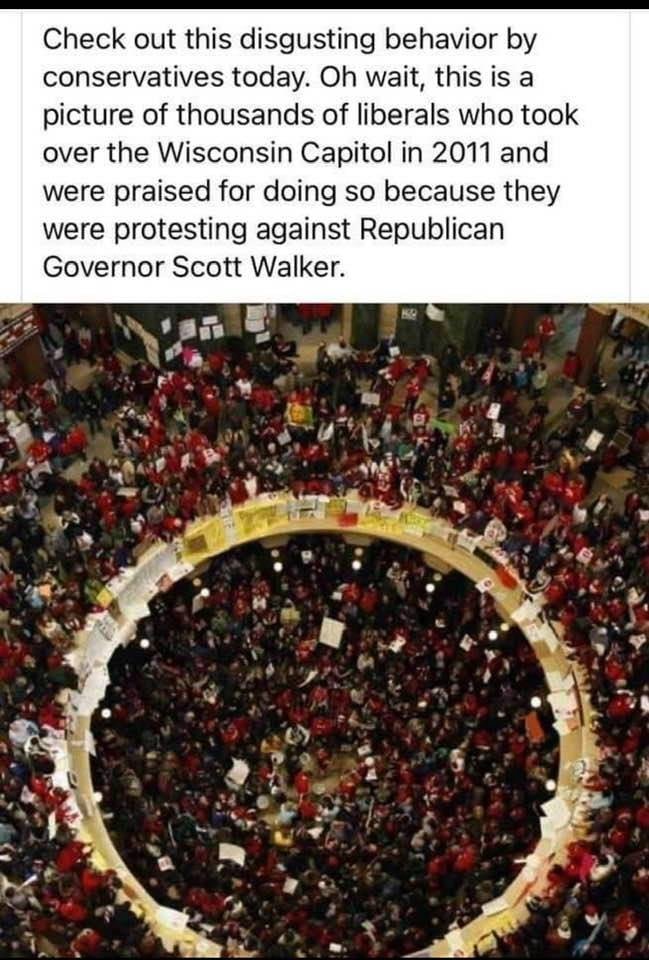










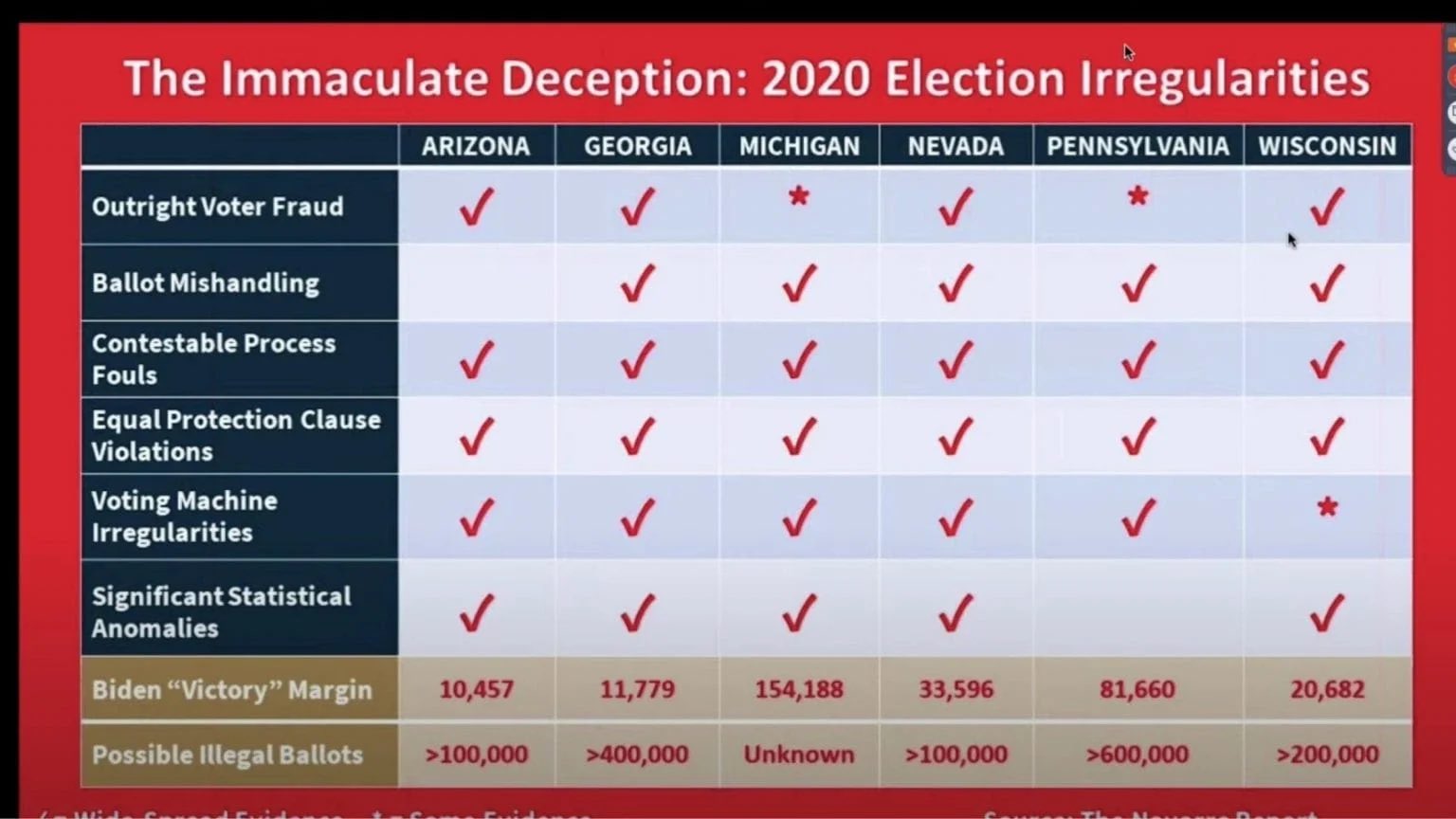




:no_upscale()/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_asset/file/6940165/police_killings_by_race.0.png)