 Si un homme a cent brebis, et que l’une d’elles s’égare, ne laisse-t-il pas les quatre-vingt-dix-neuf autres sur les montagnes, pour aller chercher celle qui s’est égarée? Et, s’il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les quatre-vingt-dix-neuf qui ne se sont pas égarées. Jésus (Matthieu 18: 12-13)
Si un homme a cent brebis, et que l’une d’elles s’égare, ne laisse-t-il pas les quatre-vingt-dix-neuf autres sur les montagnes, pour aller chercher celle qui s’est égarée? Et, s’il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les quatre-vingt-dix-neuf qui ne se sont pas égarées. Jésus (Matthieu 18: 12-13)
Je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n’ont pas besoin de repentance. Jésus (Luc 15: 7)
Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j’ai est à toi; mais il fallait bien s’égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et qu’il est revenu à la vie, parce qu’il était perdu et qu’il est retrouvé. Jésus (Luc 15: 31-32)
Une civilisation est testée sur la manière dont elle traite ses membres les plus faibles. Pearl Buck
Les paraboles de la brebis égarée (Mt 18, 12) et du fils prodigue (Lc 15, 11) soulignent encore plus directement l’inversion de la logique victimaire – sacrificielle: au « tous contre un » Jésus oppose le « tous pour un », l’amour préférentiel pour l’égaré, même lorsqu’il semble responsable de son errance. Bernard Perret
L’inauguration majestueuse de l’ère « post-chrétienne » est une plaisanterie. Nous sommes dans un ultra-christianisme caricatural qui essaie d’échapper à l’orbite judéo-chrétienne en « radicalisant » le souci des victimes dans un sens antichrétien. (…) Jusqu’au nazisme, le judaïsme était la victime préférentielle de ce système de bouc émissaire. Le christianisme ne venait qu’en second lieu. Depuis l’Holocauste, en revanche, on n’ose plus s’en prendre au judaïsme, et le christianisme est promu au rang de bouc émissaire numéro un. (…) Le mouvement antichrétien le plus puissant est celui qui réassume et « radicalise » le souci des victimes pour le paganiser. (…) Comme les Eglises chrétiennes ont pris conscience tardivement de leurs manquements à la charité, de leur connivence avec l’ordre établi, dans le monde d’hier et d’aujourd’hui, elles sont particulièrement vulnérables au chantage permanent auquel le néopaganisme contemporain les soumet. René Girard
De ce tour d’horizon, il ressort que 75 % des cas de persécution religieuse concernent les chrétiens, dont la condition se détériore en de nombreux endroits. En tête de liste, outre le Moyen-Orient, l’AED place la Corée du Nord, la Chine, le Vietnam, l’Inde, le Pakistan, le Soudan et Cuba. Si l’on tente de classer ces phénomènes de christianophobie en fonction de leur origine, il ressort que leur premier vecteur, à l’échelle de la planète, est constitué par l’islam politique ou le fondamentalisme musulman. (…) Même s’il est géographiquement limité, l’hindouisme constitue un deuxième facteur de persécution antichrétienne. Si cette idéologie politico-religieuse est rejetée par le gouvernement central de New Delhi, elle inspire des forces actives dans plusieurs États de la fédération indienne, provoquant des violences qui ont culminé en 2009, mais qui n’ont pas cessé depuis. Troisième vecteur antichrétien: le marxisme. En Corée du Nord, toute activité religieuse est qualifiée de révolte contre les principes socialistes, et des milliers de chrétiens sont emprisonnés. En Chine, le Parti communiste fait paradoxalement bon ménage avec le capitalisme, mais les vieux réflexes sont loin d’avoir disparu: l’État tient à contrôler les religions. (…) Le 10 décembre dernier a été publié, à Vienne, un rapport de l’Observatoire sur l’intolérance et les discriminations contre les chrétiens en Europe, concernant les années 2005-2010. Ce document recense les actes de vandalisme contre les églises et les symboles religieux, les manifestations de haine et les brimades contre les chrétiens observées sur le continent européen au cours des dernières années. La liste est impressionnante, mais les faits incriminés ont suscité une émotion bien discrète ici. Aux facteurs aggravants de la situation des chrétiens dans le monde, peut-être faudrait-il ajouter l’indifférentisme religieux en Occident: si les Européens ne respectent pas le christianisme chez eux, comment aideraient-ils les chrétiens persécutés aux quatre points de l’horizon? Jean Sévillia (Le Figaro)
Un des grands problèmes de la Russie – et plus encore de la Chine – est que, contrairement aux camps de concentration hitlériens, les leurs n’ont jamais été libérés et qu’il n’y a eu aucun tribunal de Nuremberg pour juger les crimes commis. Thérèse Delpech (2005)
L’idée d’une Chine naturellement pacifique et trônant, satisfaite, au milieu d’un pré carré qu’elle ne songe pas à arrondir est une fiction. L’idée impériale, dont le régime communiste s’est fait l’héritier, porte en elle une volonté hégémoniste. La politique de puissance exige de « sécuriser les abords ». Or les abords de la Chine comprennent plusieurs des grandes puissances économiques du monde d’aujourd’hui : la « protection » de ses abords par la Chine heurte de plein fouet la stabilité du monde. Et ce, d’autant qu’elle est taraudée de mille maux intérieurs qui sont autant d’incitations aux aventures extérieurs et à la mobilisation nationaliste. Que veut la République Populaire ? Rétablir la Chine comme empire du Milieu. (…) À cet avenir glorieux, à la vassalisation par la Chine, les Etats-Unis sont l’obstacle premier. La Chine ne veut pas de confrontation militaire, elle veut intimider et dissuader, et forcer les Etats-Unis à la reculade. (…) Pékin a récupéré Hong-Kong – l’argent, la finance, les communications. L’étape suivante, c’est Taïwan – la technologie avancée, l’industrie, d’énormes réserves monétaires. Si Pékin parvient à imposer la réunification à ses propres conditions, si un « coup de Taïwan » réussissait, aujourd’hui, demain ou après-demain, tous les espoirs seraient permis à Pékin. Dès lors, la diaspora chinoise, riche et influente, devrait mettre tous ses œufs dans le même panier ; il n’y aurait plus de centre alternatif de puissance. La RPC contrôlerait désormais les ressources technologiques et financières de l’ensemble de la « Grande Chine ». Elle aurait atteint la masse critique nécessaire à son grand dessein asiatique. Militairement surclassés, dénués de contrepoids régionaux, les pays de l’ASEAN, Singapour et les autres, passeraient alors sous la coupe de la Chine, sans heurts, mais avec armes et bagages. Pékin pourrait s’attaquer à sa « chaîne de première défense insulaire » : le Japon, la Corée, les Philippines, l’Indonésie. La Corée ? (…) Ce que les tenants, aujourd’hui déconfits, des « valeurs asiatiques », n’avaient pas compris, dans leurs plaidoyers pro domo en faveur d’un despotisme qu’ils prétendaient éclairé, c’est que les contre-pouvoirs, les contrepoids, que sont une opposition active, une presse libre et critique, des pouvoirs séparés selon les règles d’un Montesquieu, l’existence d’une société civile et de multitudes d’organisations associatives, font partie de la nécessaire diffusion du pouvoir qui peut ainsi intégrer les compétences, les intérêts et les opinions différentes. Mais, pour ce faire, il convient de renoncer au modèle chinois, c’est-à-dire au monolithisme intérieur. La renonciation au monolithisme extérieur n’est pas moins indispensable : la Chine doit participer à un monde dont elle n’a pas créé les règles, et ces règles sont étrangères à l’esprit même de sa politique multimillénaire. La Chine vit toujours sous la malédiction de sa propre culture politique. La figure que prendra le siècle dépendra largement du maintien de la Chine, ou de l’abandon par elle, de cette culture, et de sa malédiction. Laurent Murawiec (2000)
Tout se passe comme si, à l’heure actuelle, s’effectuait une distribution des rôles entre ceux qui pratiquent le repentir et l’autocritique – les Européens, les Occidentaux – et ceux qui s’installent dans la dénonciation sans procéder eux-mêmes à un réexamen critique analogue de leur propre passé – en particulier les pays arabes et musulmans. Tout indique même que notre mauvaise conscience, bien loin de susciter l’émulation, renforce les autres dans leur bonne conscience. Jacques Dewitte (L’exception européenne, 2009)
Comme au XXe siècle, une guerre a été déclarée contre l’Occident. Certes, elle est différente dans le sens où il s’agit d’une guerre culturelle destinée à combattre la tradition occidentale. Mais, un peu comme lors de la guerre froide, c’est le camp de la démocratie, des droits et des principes universels, de la raison qui se trouve menacé. Bien sûr, les attaques contre l’Occident en ce moment sont différentes de la plupart des conflits précédents. Parce que ce sont des attaques qui sont portées sur nous-mêmes PAR nous-mêmes. Il y a de nombreuses variantes de l’antioccidentalisme. Il y a l’antioccidentalisme chinois, l’antioccidentalisme arabe et bien d’autres encore. Mais celui qui me préoccupe est l’antioccidentalisme occidental, c’est-à-dire l’attaque de nos propres fondements civilisationnels par des personnes issues de nos propres sociétés. Il s’agit d’une remise en question radicale de notre histoire et des éléments qui constituent les bases de notre fierté, de notre identité et de nos valeurs. Même si des gens comme le Kremlin et le Parti communiste chinois (PCC) font tout pour en profiter, il s’agit d’abord d’une attaque que nous menons contre nous-mêmes. Alors qu’avant, nous étions fiers et que nous défendions notre culture occidentale, nous entendons désormais un discours acerbe selon lequel il faudrait la démanteler. On ne veut plus la transmettre, l’étudier, ou alors sous un angle biaisé et accusateur. En revanche, n’importe quelle culture qui n’est pas occidentale se retrouve célébrée et vénérée. (…) Si ce mépris de la culture occidentale se propage à grande échelle, c’est par ignorance : on n’apprend aux jeunes générations incultes que les parties sombres de son histoire, on en fait une lecture biaisée et on passe sous silence tous les apports qu’elle a pu donner à notre monde. Nous avons offert de considérables avancées scientifiques, économiques, musicales, etc. La culture occidentale est celle qui vit s’épanouir le Bernin, Vinci, Michel-Ange, Mozart, Bach, La Fontaine, Pascal et tant d’autres. Elle fit sortir de la misère des millions d’individus et fit briller les lumières de l’esprit. Mais on apprend aux écoliers son rôle dans l’esclavage et ses autres fautes sans contrebalancer par ses richesses. Les artisans de ce déséquilibre sont des idéologues qui voient le monde sous un rapport de domination et à travers la politique des identités. L’Occident est vu comme raciste et patriarcal et doit alors expier ses fautes. (…) le mal vient de l’intérieur, mais il est exploité de l’extérieur. Cette haine de soi est un mal typiquement occidental que certaines puissances sont ravies d’exploiter. Comme je le montre dans mon livre, les communistes chinois trouvent particulièrement commode d’être confrontés à un concurrent occidental qui ne cesse de répéter à quel point il est raciste. Pendant ce temps, le PCC peut s’en tirer notamment en envoyant au bas mot 1 million de personnes dans des camps de concentration. Par exemple, au cours d’une session du Conseil des droits de l’homme de l’ONU, au cours de l’été 2021, Zhao Lijian, porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois, a déclaré devant la presse internationale que le monde occidental devait faire un « examen de conscience profond » pour lutter contre le « racisme systémique » et « la discrimination raciale ». Et ce, alors qu’un certain racisme décomplexé existe en Chine… Le Parti communiste chinois transforme ainsi les faiblesses occidentales en armes. J’ai parlé à des personnes qui ont souffert des régimes de Corée du Nord, de Chine, de Russie et de bien d’autres pays, et elles sont tout simplement stupéfaites que les pays les plus libres – les nôtres, en Occident – soient les plus obsédés par cette autocritique qui mène à l’autodénigrement, au dégoût de soi et finalement à l’automutilation. Obsédés par nos fautes, nous sommes incapables de voir les atteintes aux droits de l’homme qui ont lieu dans certains pays et toute une compréhension du monde nous échappe. Douglas Murray
Il faut tordre le cou du poulet pour faire peur aux singes. Proverbe chinois
Quand il n’y a pas assez de nourriture, les gens meurent de faim. Il est préférable de laisser mourir la moitié d’entre eux pour que l’autre moitié mange à sa faim. Mao
Il faut du sang. Yang Shangkun (président chinois,1989)
De tout ce qui est sous le Ciel, il n’est rien qui ne soit le territoire du roi. Shijing
Le parti est comme Dieu, il est partout, mais vous ne pouvez pas le voir. Universitaire chinois
Statues of hated Chinese historical figures that are replaced when destroyed could help other countries address their controversial pasts (…) Statues of a treacherous Song dynasty politician and his wife in Hangzhou that were built for public vilification have been replaced 11 times since 1475. For Belgium, which is considering what to do with a statue of the brutal King Leopold II, simply melting it down might be letting him off too easily. In China, the most infamous purpose-built statues for public vilification were those of the Song dynasty politician Qin Hui (1090-1155) and his wife. In the epic tale of Chinese national hero Yue Fei (1103-1142), who valiantly defended the Southern Song dynasty against invasions from the Jurchen-ruled Jin dynasty, and whose loyalty to emperor and country was rewarded with treachery, betrayal and his own death, Qin was cast as the consummate villain. For abetting her husband in causing Yue’s death, Qin’s wife Madam Wang has also been hated by generations of Chinese. Statues of Qin and Wang, some of which depicted them in various states of undress, always show them kneeling in contrition. Presently, their statues can be found in about half a dozen locations in China, but the most famous ones are found in the Yue Fei Temple in Hangzhou, on the banks of the beautiful West Lake. The first pair of statues was erected here in 1475. Since then, the images of Qin and Wang have been subjected to all manner of physical abuse. At various times in the past, they were thrown into the lake or irrevocably damaged, but each time new statues reappear and the cycle of abuse resumes. The present statues, the 12th iteration, date from 1979. It’s up to the Belgians, of course, to decide what they want to do with King Leopold’s statue, but just toppling it would be letting him off too easy. South China Morning Post
De nombreux ménages pauvres ont plongé dans la pauvreté pour cause de maladie dans la famille. Certains ont recours à la foi en Jésus pour guérir leurs maladies. Mais nous avons essayé de leur dire que tomber malade est une chose physique et que les personnes qui peuvent vraiment les aider sont le Parti communiste et le secrétaire général Xi. Beaucoup de ruraux sont ignorants. Ils pensent que Dieu est leur sauveur… Après le travail de nos cadres, ils se rendent compte de leurs erreurs et pensent : nous ne devons plus compter sur Jésus, mais sur le parti pour obtenir de l’aide. (…) Nous leur avons seulement demandé de retirer les affiches [religieuses] au centre de la maison. Ils peuvent toujours les accrocher dans d’autres pièces, nous n’interférerons pas avec cela. Ce que nous exigeons, c’est qu’ils n’oublient pas la gentillesse du parti au centre de leur salon. Ce n’est pas une offre à prendre ou à laisser. Ils ont toujours la liberté de croire en la religion, mais dans leur esprit, il faut qu’ils fassent [aussi] faire confiance à notre parti. Qi Yan(président de l’assemblée populaire de Huangjinbu)
Certaines familles mettent des couplets évangéliques sur leurs portes d’entrée lors du Nouvel An lunaire, certaines accrochent également des tableaux de la croix. Mais ils ont tous été démolis. Ils ont tous leur conviction et, bien sûr, ils n’étaient pas d’accord. Mais il n’y a pas d’issue. S’ils n’acceptent pas, ils ne recevront pas leur quote-part du fonds de lutte contre la pauvreté. Liu
Des milliers de chrétiens d’un comté pauvre du sud-est rural de la Chine ont troqué leurs affiches de Jésus contre des portraits du président Xi Jinping dans le cadre d’un programme de lutte contre la pauvreté du gouvernement local qui vise à « transformer les croyants en la religion en croyants dans le parti ». Situé sur le bord du Poyang, le plus grand lac d’eau douce de Chine, le comté de Yugan dans la province du Jiangxi est connu aussi bien pour sa pauvreté que pour sa grande communauté chrétienne. Plus de 11% de ses 1 million d’habitants vivent en dessous du seuil de pauvreté officiel du pays, tandis que près de 10% de sa population est chrétienne, selon les données officielles. Mais alors que le gouvernement local redouble d’efforts pour réduire la pauvreté, de nombreux croyants ont été invités à retirer les images de Jésus, les croix et les couplets évangéliques qui forment les pièces maîtresses de leurs maisons, et à accrocher des portraits de Xi à la place – une pratique qui marque un retour à l’ère du culte de la personnalité autour du défunt président Mao Zedong, dont les portraits étaient autrefois omniprésents dans les foyers chinois. Sous Xi, le Parti communiste au pouvoir a fait de l’élimination de la pauvreté d’ici 2020 une priorité absolue. La campagne est non seulement cruciale pour l’héritage politique du dirigeant le plus puissant du pays depuis Mao, mais sert également à consolider le contrôle du parti sur les racines de la société, qui, malgré leur grand nombre, ont été largement négligées pendant les décennies de poursuite de la croissance économique par la Chine. À Yugan, le parti officiellement athée rivalise d’influence avec le christianisme, qui s’est rapidement répandu dans les villages ruraux pauvres et les villes prospères depuis la fin de la Révolution culturelle il y a plus de 40 ans. Selon certaines estimations, les chrétiens en Chine sont maintenant plus nombreux que les 90 millions de membres du parti. Un reportage sur les réseaux sociaux locaux a rapporté ce week-end que dans le canton de Huangjinbu de Yugan, des cadres ont rendu visite à des familles chrétiennes pauvres pour promouvoir les politiques de lutte contre la pauvreté du parti et les ont aidées à résoudre leurs problèmes matériels. Les responsables ont réussi à « faire fondre la glace dure de leur cœur » et à les « faire passer de la croyance en la religion à la croyance dans le parti », indique le reportage. En conséquence, plus de 600 villageois se sont «volontairement» débarrassés des textes religieux et des peintures qu’ils avaient chez eux, et les ont remplacés par 453 portraits de Xi. L’article avait disparu lundi après-midi, mais l’existence de la campagne a été confirmée par des villageois et des responsables locaux contactés par le South China Morning Post. Qi Yan, président de l’assemblée populaire de Huangjinbu et responsable de la campagne de lutte contre la pauvreté du canton, a déclaré que la campagne était en cours dans tout le comté depuis mars. Il a déclaré qu’il visait à enseigner aux familles chrétiennes tout ce que le parti avait fait pour aider à éradiquer la pauvreté et à quel point Xi s’était soucié de leur bien-être. Il a déclaré que le gouvernement du canton avait distribué plus de 1 000 portraits de Xi, et que tous avaient été accrochés dans les maisons des habitants. Un habitant d’un autre canton de Yugan, prénommé Liu, a déclaré que ces derniers mois, nombre de ses concitoyens avaient reçu l’ordre de retirer les objets religieux de leurs maisons. (…) [Mais] Beaucoup de croyants ne l’ont pas fait volontairement. (…) Mais Qi a rejeté les allégations selon lesquelles les fonds dépendaient du retrait des affiches religieuses. (…) Sous Xi, le parti a resserré son emprise sur la liberté religieuse dans tout le pays, allant de la suppression des croix sur les églises chrétiennes de l’est de la Chine à la suppression des pratiques islamiques dans le cœur ouïghour du Xinjiang au nom de la lutte contre le terrorisme et le séparatisme. Dans le Jiangxi, outre le retrait des affiches religieuses des habitations, plusieurs croix ont été retirées des églises depuis l’été – dont celle du comté de Yugan – poursuivant la tendance amorcée dans la province du Zhejiang. South China Morning Post
Cela fait des années que nous entendons ou lisons que la Constitution chinoise interdit l’enseignement de la religion aux jeunes de moins de 18 ans. La bonne nouvelle, comme nous pouvons le constater, est que ce n’est pas vrai. La Constitution chinoise ne dit rien de tel. La mauvaise nouvelle, en revanche, est que cette interdiction figure bien dans le « Document n° 19 – Point de vue fondamental et politique relatif aux questions religieuses au cours de la période socialiste de notre pays », diffusé par le Conseil des affaires d’Etat (le gouvernement) en 1982. (…) En d’autres termes, les Chinois peuvent croire ce qu’ils veulent, mais l’Etat se réserve le droit de mettre des limites à la pratique de leur religion. Joann Pittmann
Certains articles ont rapporté que des villes et des universités avaient « interdit Noël », ce qui a attiré l’attention de certains médias étrangers. Ceux-ci ont exagéré cette information, expliquant que la Chine interdisait Noël pour des considérations politiques et pour résister à l’invasion culturelle occidentale. Les membres du Parti communiste de Chine dans les villes majeures comme Beijing et Shanghai n’ont été informés d’aucune notification interdisant Noël. Cette interdiction dans certains lieux et certaines institutions avait pour but de préserver la sécurité publique et en aucun cas de « boycotter » Noël. France.China
It is like Taliban/ISIS style of persecution against a peaceful church. It was primarily destroyed because it refused to register. Bob Fu (China Aid)
Ces dernières années, une dizaine d’églises ont été détruites dans le pays, et de nombreuses croix ont été démontées. Dans le Jiangxi, dans le sud du pays, les portraits de Jésus ont même dû être remplacés par ceux du président Xi Jinping. RFI.
Les autorités chinoises ont démoli à l’explosif la monumentale église évangélique Jindengtai, située à Linfen, dans la province du Shanxi, « dans le cadre d’une campagne municipale visant à éliminer les constructions illégales », a précisé un responsable de la ville au journal Global Times, cité par l’AFP. « Un chrétien a donné son terrain agricole à une association chrétienne locale, et ils ont construit secrètement une église, prétextant construire un entrepôt », a indiqué la source municipale, qui a ajouté que les autorités avaient fait stopper la construction du lieu de culte en 2009. À l’époque, des fidèles avaient été arrêtés, des Bibles confisquées et des leaders religieux condamnés à de longues peines de prison. « Une nuée de policiers militaires ont été mobilisés et ont réalisé la démolition grâce à une grande quantité d’explosifs placés sous l’église », s’est insurgé de son côté Bob Fu, président de China Aid, un groupe de défense des droits religieux basé aux États-Unis. « Cette persécution est digne de l’État islamique et des talibans », a-t-il même dénoncé. (…) Le pouvoir communiste de Pékin, qui redoute l’influence des organisations religieuses, les surveille de très près. La Chine, qui compterait 60 millions de chrétiens, fait partie des 50 pays qui les persécutent le plus dans le monde, selon l’index 2018 de l’ONG Portes ouvertes. Valeurs actuelles
Les hommes des Lumières remettaient tout en cause dans la société européenne ; rien dans la société chinoise. Leur esprit critique, si aigu d’un côté, s’émoussait de l’autre. Le paradis raisonnable de la Chine athée leur permettait de dénoncer l’enfer de l’Europe soumise à l’Infâme” – au clergé. Ainsi comptèrent-ils pour rien les cruautés des empereurs, les séismes des changements de dynastie, les autodafés de livres, les supplices d’opposants, les rébellions toujours renaissantes et toujours noyées dans le sang. Alain Peyrefitte (1989)
La nouvelle guerre froide est créée en très grande majorité par les États-Unis. À partir de 2015 environ, les responsables néoconservateurs de la politique étrangère américaine ont conclu que l’hégémonie américaine était menacée par la montée en puissance de la Chine. Depuis lors, le gouvernement américain a mis en place un ensemble croissant d’outils – barrières commerciales, sanctions, contrôles des exportations, contrôle des investissements et nouvelles alliances militaires en Asie – pour tenter de « contenir » la Chine. Cette approche pourrait conduire à une guerre pure et simple, par exemple à propos de Taïwan. Les États-Unis tentent d’enrôler l’Europe dans leur effort pour contenir la Chine. Pourtant, l’intérêt profond de l’Europe n’est pas l’hégémonie américaine, mais plutôt un véritable ordre multilatéral dans lequel l’Europe et la Chine jouent toutes deux des rôles actifs et responsables – tout comme les États-Unis, bien sûr. L’Europe devrait donc résister à la nouvelle guerre froide menée par les États-Unis et poursuivre à la place des relations diplomatiques, économiques et financières actives avec la Chine. (…) Et l’opinion selon laquelle la Chine représente une grave menace pour la sécurité des États-Unis est alarmiste. Oui, la Chine est un pays grand et puissant, mais pas un pays intrinsèquement militariste ou belliqueux. La Chine n’a pas mené une seule guerre au cours des 40 dernières années, tandis que les États-Unis ont mené d’innombrables (et apparemment perpétuels) conflits. (…) Les États-Unis devraient cesser de jouer sur la peur, s’engager dans une diplomatie renforcée, rester attachés à la politique d’une seule Chine, cesser de provoquer un affrontement à propos de Taïwan et mettre fin aux mesures commerciales, technologiques et financières unilatérales qui entravent l’économie chinoise. La Chine devrait elle aussi s’engager avec les États-Unis et l’Union européenne dans une diplomatie renforcée, pour résoudre les problèmes d’intérêt commun. Je crois que la Chine est tout à fait prête à le faire. (…) Cette guerre [de Poutine avec l’Ukraine] aurait pu être évitée si les États-Unis n’avaient pas poussé à l’élargissement de l’Otan à l’Ukraine et à la Géorgie, et n’avaient pas participé au renversement de Viktor Ianoukovitch en 2014. La France et l’Allemagne auraient également dû pousser l’Ukraine à se conformer aux accords de Minsk II. Il y a déjà plusieurs centaines de milliers de morts en Ukraine à cause de cette guerre. Si l’Ukraine tente de reprendre la Crimée, je pense que nous assisterons à une escalade massive, voire à une guerre nucléaire. L’idée que l’Ukraine vaincra la Russie est un pari imprudent sur l’apocalypse. Les États-Unis et les Ukrainiens auraient dû signer la neutralité de l’Ukraine, le contrôle de facto de la Russie sur la Crimée et la mise en œuvre des accords de Minsk II. Au lieu de cela, ils parient imprudemment sur la victoire militaire contre un pays qui a 1 600 armes nucléaires. (…) Dans les deux cas [de l’origine de la pandémie et du sabotage de Nord Stream], le gouvernement américain maintient et manipule un récit invraisemblable, et le fait avec une acceptation remarquable en Europe. Sur le Covid-19, il est clair que les États-Unis ont financé des recherches très dangereuses en Chine basées sur la manipulation génétique avancée de virus de la famille du Sars. Et il est également clair que le gouvernement américain a refusé d’enquêter sur ses propres programmes de recherche qui auraient pu contribuer à la création du Sars-CoV-2. Au lieu de cela, le gouvernement américain a encouragé l’histoire scientifiquement faible d’une épidémie « naturelle » sur le marché de Huanan, à Wuhan. Sur Nord Stream, Joe Biden a promis le 7 février que si la Russie envahissait l’Ukraine, Nord Stream serait terminé. Lorsqu’on lui a demandé comment les États-Unis feraient cela, il a répondu : « Je vous promets que nous serons en mesure de le faire. » Même la Suède cache les résultats de son enquête sur Nord Stream à l’Allemagne et au Danemark, au nom de la sécurité nationale ! Je crois que les dirigeants européens savent que les États-Unis et d’autres alliés ont fait cela, mais ils ne commenteront ou n’expliqueront tout simplement pas la vérité au public. Nous ne savons pas avec certitude que le Sars-CoV-2 est venu d’un laboratoire et que les États-Unis ont fait sauter le pipeline, mais nous savons que le public n’a pas encore été informé des faits réels concernant ces deux cas. Jeffrey Sachs
Pourquoi l’Union soviétique s’est-elle désintégrée ? Pourquoi le Parti communiste soviétique s’est effondré ? Une raison importante était que leurs idéaux et leurs convictions vacillaient. Finalement, il a suffi d’un mot silencieux de Gorbatchev pour déclarer la dissolution du Parti communiste soviétique, et un grand parti a disparu. En fin de compte, personne ne s’est comporté en homme, personne n’a osé résister. Xi Jinping
L’épidémie est un démon. Nous ne permettrons pas au démon de rester caché. Xi Jinping
Si vous vivez en Chine, peu importe la taille de votre domicile, ce n’est qu’une sorte de cellule, un substitut de prison. Les méthodes carcérales de ce pouvoir totalitaire sont bien pires que l’épidémie. La Chine tout entière n’est qu’une grande prison d’où sont exclues toute information et toute pensée. Chaque coin de rue, chaque station de métro pullule de caméras et de policiers, et il n’existe aucun endroit où l’on puisse se rencontrer et communiquer librement. Les gens traitent donc leurs amis et voisins comme des virus dont ils doivent se garder. (…) Je repense aux cinq dieux des épidémies qui sont vénérés en Chine depuis des millénaires. Cinq démons à l’origine, qui régissaient les saisons et leurs terrifiants maux respectifs. Selon la légende, les anciens ont dompté ces esprits pernicieux, les ont transformés en divinités, les « cinq commissaires des miasmes », et les ont placés dans des temples où l’on pouvait, en leur faisant des offrandes, obtenir leur protection contre les maladies. Le démon qui contrôlait les maux du printemps s’appelait Zhang Yuanbo. Le Covid s’étant déclaré au printemps, à Wuhan comme à Shanghai, le dieu des miasmes du printemps s’appelle aujourd’hui Xi Jinping : Xi est devenu un démon maléfique qui, tout comme Zhang Yuanbo, devrait être dompté. (…) Tout comme en 1958, lors du Grand Bond en avant, quand Mao Zedong a ordonné aux Chinois d’exterminer les moineaux accusés de picorer les semences. La stratégie « zéro moineaux » a été couronnée de succès, mais à quel prix : les insectes se sont multipliés, entraînant une catastrophe écologique. C’est le modèle institutionnel du Parti communiste chinois, Xi Jinping a juste remplacé les moineaux par le Covid. Le bouclage intégral de Shanghai signe en réalité une défaite pour Xi Jinping. Il y a deux ans, il avait ordonné la fermeture totale du pays tout en maintenant les vols internationaux, et ainsi permis au virus de se propager dans le monde. Cette fois, il voulait empêcher le retour en Chine du virus qui avait pourtant perdu en virulence. Quoi que fasse le dieu de la peste Xi, il montre que les virus dictatoriaux sont plus dangereux que les virus de chauve-souris. Les potentats sont bien incapables de contrôler la diffusion des maladies contagieuses, mais contrôlent parfaitement la transmission de la vérité. Il suffit que leurs propres virus se dissolvent dans un mensonge pour se glisser dans les esprits des personnes qui ne connaissent pas la vérité. Tout comme une balle ne tue que lorsqu’elle a été insérée dans le barillet d’un revolver. Xi Jinping est un dieu de la peste qui brandit un « pistolet à mensonges ». S’il n’avait pas tout fait pour dissimuler la vérité au moment où le coronavirus a surgi à Wuhan, sa propagation aurait pu être contenue, comme cela a été le cas pour le virus Ebola. A l’ère de la mondialisation, le camouflage de la vérité sur l’épidémie a eu comme conséquence que le monde entier est devenu un grand Wuhan. Absolument aucune ville n’y a échappé. A Londres, où je suis exilé, quatre membres de ma famille ont été contaminés. 160 millions de personnes dans le monde ont été infectées, des millions sont mortes. Malgré ce coût écrasant en vies humaines, nous ne connaissons toujours pas le vrai visage du fléau dissimulé sous des mensonges politiques. Cette vérité est entre les mains du commandant en chef de la peste, Xi Jinping. Mais la Chine sous le joug communiste est un pays sans vérité. Du massacre d’étudiants sur la place Tiananmen en 1989 à l’emprisonnement de millions de personnes dans les camps de concentration du Xinjiang, la vérité est toujours cachée. Les responsables des démocraties européennes devraient savoir que laisser ces mensonges se diffuser revient à tuer la vérité une deuxième fois. Et qu’oublier les victimes de ces mensonges nous rend incapables de nous en protéger. Nous vivons en un temps qui a perdu le sens du bien et du mal, réduits à assister en spectateurs aux assauts de cette calamiteuse machine à fabriquer des « mensonges rouges » contre nos vies et nos libertés. Nous sommes en 2022, mais nous nous sommes rapprochés du « 1984 » d’Orwell. Ce n’est pas seulement en Chine, à Hongkong ou au Xinjiang que l’on voit, sous l’effet du totalitarisme, le désir de changement social peu à peu remplacé par l’attrait pour le fric et le besoin de sécurité. L’espèce humaine tout entière est en train de s’engourdir et ne sait plus distinguer le vrai du faux. A cause de ce flou, dans de nombreux pays, il n’est même pas possible de vacciner la population. Et il y a tant de personnes qui développent des anticorps contre les droits humains et la démocratie, et s’habituent à vivre en symbiose avec le virus totalitaire. Car oui, trente-trois ans après le massacre de la place Tiananmen, les gens évitent de parler du carnage qui a eu lieu sur cette place, et c’est là une victoire du mensonge. L’Union européenne a même ouvert un boulevard au régime de Xi Jinping en lui permettant de faire miroiter le « rêve chinois » aux yeux de la planète. Pendant ce temps, le Covid né à Wuhan se propageait, entraînant une hécatombe des millions de fois supérieure au massacre de Tiananmen. Oui, il y a trente-trois ans, les démocraties ont vu tomber le mur de Berlin et tout le monde a cru que le communisme s’était éteint avec le XXe siècle. Mais le plus grand Parti communiste du monde, le PC chinois, n’est pas tombé ; il a envoyé 200 000 soldats réprimer le mouvement pro-démocratie sur la place Tiananmen, après quoi il a nettoyé les taches de sang, rebouché les trous laissés par les balles sur les monuments de la place, et imprégné de mensonges le cerveau de 1,3 milliard de personnes. Et le PC chinois est devenu, sous le manteau, le protecteur de Poutine et de Kim troisième du nom. Avec ses « gènes » communistes et sa pensée restée bloquée à l’époque de l’empire soviétique, Poutine est naturellement devenu un pion dans le jeu du prince rouge Xi Jinping. Ces deux dictateurs unissent désormais leurs forces en vue de dominer le monde. L’invasion de l’Ukraine montre quelle est l’ambition de Poutine. Et comment Xi Jinping manœuvre. Aujourd’hui comme il y a trente-trois ans, les pays démocratiques doivent se battre contre ces deux super-hégémons rouges. Oui, après trente-trois ans de mensonges, on finit par penser que la vérité est elle aussi indigne de confiance. Après Tiananmen, la Chine communiste s’est lancée dans le développement capitalistique, devenant vite le nouveau Big Brother. Aujourd’hui, elle ne cache plus son désir d’écraser les démocraties afin de réaliser le « rêve chinois » – la domination de l’Empire rouge sur le monde. Le virus du rêve chinois, tout comme le coronavirus de Wuhan, a besoin de se transmettre pour survivre et se perpétuer. Pour ce faire, la Chine est devenue une boîte de Pandore qui produit sans trêve des mutations et contamine tous les pays. Face à elle, nous ne sommes plus que des prisonniers enfermés dans un labyrinthe de mensonges, contraints à aspirer ses miasmes. Oui, si le Parti communiste chinois s’était désintégré en même temps que les régimes communistes de l’Est, et si les responsables politiques occidentaux ne s’étaient pas empressés d’oublier le massacre qui a eu lieu à Pékin en 1989, la pandémie qui se promène aujourd’hui dans l’air que nous respirons n’existerait pas. Mais le Parti communiste chinois a profité du Covid pour démolir à nouveau la statue de la Liberté qui avait été érigée sur Tiananmen : il a abattu le phare de liberté qu’était Hongkong. Et on a revu les mêmes scènes qu’il y a trente-trois ans : des étudiants et des enseignants en grève de la faim pour défendre la démocratie et la liberté ; des étudiantes ligotées, écrasées sous les bottes de la police militaire ; des mamies aux cheveux blancs tentant de raisonner les policiers ; des danseuses et des chanteuses se battant jusqu’à la mort… Le dieu des miasmes Xi a décrété que la vérité était « fake ». Et nous des « mensonges » qu’il veut effacer. Aujourd’hui, les Ukrainiens meurent sous les bombes de Poutine, les habitants du Xinjiang sont emprisonnés et « rééduqués » par Xi Jinping, les Taïwanais risquent à tout moment l’invasion. Ces deux dictateurs sont en train de propager une épidémie sanglante, ouvrant une époque où le glas sonne tous les jours. Souvenons-nous du poète anglais John Donne qui a écrit au tournant des XVIe et XVIIe siècles :« Nul homme n’est une île, entière en elle-même ; tout homme est un morceau du continent, une partie de l’ensemble. […] La mort de tout homme me diminue, parce que je fais partie du genre humain, aussi n’envoie jamais demander pour qui sonne le glas ; il sonne pour toi. » Quand pourrons-nous sonner le glas des dictateurs qui répandent la peste ? Notre inquiétude au XXIe siècle, c’était que la technologie, l’internet et les divertissements bouleversent trop la société, que nos enfants regardent trop la télévision et jouent trop aux jeux vidéo. Nous étions loin de nous douter que la peste rouge venue de Chine allait surgir dans nos vies, prendre la vie de nos amis et de nos proches, puis s’atteler à « purifier » nos esprits, effacer notre conscience, nos valeurs, transformer nos façons de communiquer, de nous déplacer, nos services publics et notre vie culturelle, comme elle l’a fait à Wuhan ou à Shanghai. La civilisation politique de l’Europe est d’ores et déjà endommagée. Allons-nous continuer à regarder sans réagir les moines tibétains s’immoler l’un après l’autre, les habitants du Xinjiang, des personnes âgées aux enfants, être jetés dans des camps de concentration, leurs familles être détruites, et mes amis écrivains de Hongkong être arrêtés et disparaître les uns après les autres ? Je prie pour que, quand la grande souffrance du Covid prendra fin, les pays démocratiques auront réussi à construire une cage indestructible et y auront enfermé les dieux des miasmes. Que le rêve chinois du démon de la peste Xi reste à jamais un rêve. Ou qu’il soit enfermé, en compagnie de milliers d’autres virus, dans le laboratoire de Wuhan construit avec l’aide des Français. Allons-nous laisser la civilisation humaine régresser et tomber dans le piège du rêve chinois ? Ma Jian
La publication d’un manuel scolaire contenant une histoire biblique déformée et détournée a suscité la colère parmi les fidèles de la communauté catholique en Chine continentale. Le manuel en question a été publié pour enseigner « l’éthique professionnelle et le respect de la loi ». Le manuel scolaire, publié par le service d’édition de l’Université des sciences et technologies électroniques de Chine, qui dépend du gouvernement, contient un texte évoquant le récit de Jésus et de la femme adultère pardonnée. Dans la publication, le récit évangélique (Jean 8, 1-11) est déformé et affirme que Jésus Christ a lapidé une femme pécheresse afin de respecter la loi de son temps. Le texte reprend le passage décrivant la foule voulant lapider une femme selon la loi, et Jésus leur répondant « Celui d’entre vous qui est sans péché, qu’il soit le premier à lui jeter une pierre ». Pourtant, la fin du récit diffère radicalement, le texte ajoutant qu’une fois la foule dispersée, Jésus se serait mis à lapider la femme à mort en ajoutant « Moi aussi je suis pécheur, mais si la loi ne devait être exécutée que par des hommes sans faute, la loi serait vaine ». Un paroissien a publié le passage en question sur les réseaux sociaux, en dénonçant la falsification d’un texte biblique à des fins politiques comme une insulte à l’Église catholique. (…) Mathew Wang, un enseignant chrétien dans une école professionnelle, confirme le contenu du texte controversé, tout en ajoutant que la publication exacte varie selon les lieux en Chine. Mathew Wang précise que le texte publié par le manuel scolaire a été relu par le Comité de contrôle des manuels scolaires pour l’éducation morale, dans le cadre de l’enseignement professionnel dans le secondaire. Il déplore que les auteurs aient utilisé un tel exemple erroné pour justifier les lois socialistes chinoises. Selon certains catholiques chinois, les auteurs du manuel auraient voulu souligner que la loi est sacrée en Chine, et que son respect absolu est essentiel. Missions étrangères
Nous avons assez remarqué ailleurs combien il est téméraire et maladroit de disputer à une nation telle que la chinoise ses titres authentiques. Nous n’avons aucune maison en Europe dont l’antiquité soit aussi bien prouvée que celle de l’empire de la Chine. (…) Laissez tous les lettrés chinois, tous les mandarins, tous les empereurs reconnaître Fo-hi pour un des premiers qui donnèrent des lois à la Chine, environ deux mille cinq ou six cents ans avant notre ère vulgaire. Convenez qu’il faut qu’il y ait des peuples avant qu’il y ait des rois. Convenez qu’il faut un temps prodigieux avant qu’un peuple nombreux, ayant inventé les arts nécessaires, se soit réuni pour se choisir un maître. Si vous n’en convenez pas, il ne nous importe. Nous croirons toujours sans vous que deux et deux font quatre. Dans une province d’Occident, nommée autrefois la Celtique, on a poussé le goût de la singularité et du paradoxe jusqu’à dire que les Chinois n’étaient qu’une colonie d’Égypte (…) Les Égyptiens allumaient des flambeaux quelquefois pendant la nuit ; les Chinois allument des lanternes : donc les Chinois sont évidemment une colonie d’Égypte. (…) Confutzée, nommé parmi nous Confucius (…) ne faisait point le prophète ; il ne se disait point inspiré ; il n’enseignait point une religion nouvelle ; il ne recourait point aux prestiges ; il ne flatte point l’empereur sous lequel il vivait, il n’en parle seulement pas. C’est enfin le seul des instituteurs du monde qui ne se soit point fait suivre par des femmes. J’ai connu un philosophe qui n’avait que le portrait de Confucius dans son arrière-cabinet (…) J’ai lu ses livres avec attention ; j’en ai fait des extraits ; je n’y ai trouvé que la morale la plus pure, sans aucune teinture de charlatanisme. Il vivait six cents ans avant notre ère vulgaire. Ses ouvrages furent commentés par les plus savants hommes de la nation. (…) Ce n’est pas ici la peine d’opposer le monument de la grande muraille de la Chine aux monuments des autres nations, qui n’en ont jamais approché ; ni de redire que les pyramides d’Égypte ne sont que des masses inutiles et puériles en comparaison de ce grand ouvrage ; ni de parler de trente-deux éclipses calculées dans l’ancienne chronique de la Chine, dont vingt-huit ont été vérifiées par les mathématiciens d’Europe ; ni de faire voir combien le respect des Chinois pour leurs ancêtres assure l’existence de ces mêmes ancêtres ; ni de répéter au long combien ce même respect a nui chez eux aux progrès de la physique, de la géométrie, et de l’astronomie. (…) Mais on peut être un fort mauvais physicien et un excellent moraliste. Aussi c’est dans la morale et —dans l’économie politique, dans l’agriculture, dans les arts nécessaires, que les Chinois se sont perfectionnés. Nous leur avons enseigné tout le reste ; mais dans cette partie nous devions être leurs disciples. Humainement parlant, et indépendamment des services que les jésuites pouvaient rendre à la religion chrétienne, n’étaient-ils pas bien malheureux d’être venus de si loin porter la discorde et le trouble dans le plus vaste royaume et le mieux policé de la terre ? Et n’était-ce pas abuser horriblement de l’indulgence et de la bonté des peuples orientaux, surtout après les torrents de sang versés à leur occasion au Japon ? scène affreuse dont cet empire n’a cru pouvoir prévenir les suites qu’en fermant ses ports à tous les étrangers. (…) L’empereur céda bientôt après aux cris de la Chine entière ; on demandait le renvoi des jésuites, comme depuis en France et dans d’autres pays on a demandé leur abolition. Tous les tribunaux de la Chine voulaient qu’on les fît partir sur-le-champ pour Macao, qui est regardé comme une place séparée de l’empire, et dont on a laissé toujours la possession aux Portugais avec garnison chinoise. Yong-tching eut la bonté de consulter les tribunaux et les gouverneurs, pour savoir s’il y aurait quelque danger à faire conduire tous les jésuites dans la province de Kanton. En attendant la réponse il fit venir trois jésuites en sa présence, et leur dit ces propres paroles, que le P. Parennin rapporte avec beaucoup de bonne foi : « Vos Européans dans la province de Fo-Kien voulaient anéantir nos lois, et troublaient nos peuples ; les tribunaux me les ont déférés ; j’ai dû pourvoir à ces désordres ; il y va de l’intérêt de l’empire… Que diriez-vous si j’envoyais dans votre pays une troupe de bonzes et de lamas prêcher leur loi? » (….) On abattit leurs maisons et leurs églises dans toutes les autres provinces. Enfin les plaintes contre eux redoublèrent. Ce qu’on leur reprochait le plus, c’était d’affaiblir dans les enfants le respect pour leurs pères, en ne rendant point les honneurs dus aux ancêtres ; d’assembler indécemment les jeunes gens et les filles dans les lieux écartés qu’ils appelaient églises ; de faire agenouiller les filles entre leurs jambes, et de leur parler bas en cette posture. Rien ne paraissait plus monstrueux à la délicatesse chinoise. L’empereur Yong-tching daigna même en avertir les jésuites ; après quoi il renvoya la plupart des missionnaires à Macao, mais avec des politesses et des attentions dont les seuls Chinois peut-être sont capables. (…) Le célèbre Wolf, professeur de mathématiques dans l’université de Hall, prononça un jour un très-bon discours à la louange de la philosophie chinoise ; il loua cette ancienne espèce d’hommes, qui diffère de nous par la barbe, par les yeux, par le nez, par les oreilles, et par le raisonnement ; il loua, dis-je, les Chinois d’adorer un Dieu suprême, et d’aimer la vertu ; il rendait cette justice aux empereurs de la Chine, aux colaos, aux tribunaux, aux lettrés. (…) Il ne faut pas être fanatique du mérite chinois : la constitution de leur empire est à la vérité la meilleure qui soit au monde ; la seule qui soit toute fondée sur le pouvoir paternel ; la seule dans laquelle un gouverneur de province soit puni quand, en sortant de charge, il n’a pas eu les acclamations du peuple ; la seule qui ait institué des prix pour la vertu, tandis que partout ailleurs les lois se bornent à punir le crime ; la seule qui ait fait adopter ses lois à ses vainqueurs, tandis que nous sommes encore sujets aux coutumes des Burgundiens, des Francs et des Goths, qui nous ont domptés. Mais on doit avouer que le petit peuple, gouverné par des bonzes, est aussi fripon que le nôtre ; qu’on y vend tout fort cher aux étrangers, ainsi que chez nous ; que dans les sciences, les Chinois sont encore au terme où nous étions il y a deux cents ans ; qu’ils ont comme nous mille préjugés ridicules ; qu’ils croient aux talismans, à l’astrologie judiciaire, comme nous y avons cru longtemps. (…) mais tout cela n’empêche pas que les Chinois, il y a quatre mille ans, lorsque nous ne savions pas lire, ne sussent toutes les choses essentiellement utiles dont nous nous vantons aujourd’hui. La religion des lettrés, encore une fois, est admirable. Point de superstitions, point de légendes absurdes, point de ces dogmes qui insultent à la raison et à la nature, et auxquels des bonzes donnent mille sens différents, parce qu’ils n’en ont aucun. Le culte le plus simple leur a paru le meilleur depuis plus de quarante siècles. Ils sont ce que nous pensons qu’étaient Seth, Énoch et Noé ; ils se contentent d’adorer un Dieu avec tous les sages de la terre, tandis qu’en Europe on se partage entre Thomas et Bonaventure, entre Calvin et Luther, entre Jansénius et Molina. Voltaire
La Chine, autrefois entièrement ignorée, longtemps ensuite défigurée à nos yeux, et enfin mieux connue de nous que plusieurs provinces d’Europe, est l’empire le plus peuplé, le plus florissant et le plus antique de l’univers (…) On nous assure encore que cette vaste étendue de pays n’est point gouvernée despotiquement, mais par six tribunaux principaux qui servent de frein à tous les tribunaux inférieurs. La religion y est simple, et c’est une preuve incontestable de son antiquité. Il y a plus de quatre mille ans que les empereurs de la Chine sont les premiers pontifes de l’empire ; ils adorent un Dieu unique, ils lui offrent les prémices d’un champ qu’ils ont labouré de leurs mains. (…) Cette religion de l’empereur, de tous les colaos, de tous les lettrés, est d’autant plus belle qu’elle n’est souillée par aucune superstition. Toute la sagesse du gouvernement n’a pu empêcher que les bonzes ne se soient introduits dans l’empire, de même que toute l’attention du maître-d’hôtel ne peut empêcher que les rats ne se glissent dans les caves et dans les greniers. L’esprit de tolérance, qui faisait le caractère de toutes les nations asiatiques, laissa les bonzes séduire le peuple ; mais, en s’emparant de la canaille, on les empêcha de la gouverner. On les a traités comme on traite les charlatans : on les laisse débiter leur orviétan dans les places publiques ; mais s’ils ameutent le peuple, ils sont pendus. Les bonzes ont été tolérés et réprimés. L’empereur Kang-hi avait accueilli avec une bonté singulière les bonzes jésuites ; ceux-ci, à la faveur de quelques sphères armillaires, des baromètres, des thermomètres, des lunettes, qu’ils avaient apportés d’Europe, obtinrent de Kang-hi la tolérance publique de la religion chrétienne. On doit observer que cet empereur fut obligé de consulter les tribunaux, de les solliciter lui-même, et de dresser de sa main la requête des bonzes jésuites pour leur obtenir la permission d’exercer leur religion : ce qui prouve évidemment que l’empereur n’est point despotique, comme tant d’auteurs mal instruits l’ont prétendu, et que les lois sont plus fortes que lui. Les querelles élevées entre les missionnaires rendirent bientôt la nouvelle secte odieuse. Les Chinois, qui sont gens sensés, furent étonnés et indignés que des bonzes d’Europe osassent établir dans leur empire des opinions dont eux-mêmes n’étaient pas d’accord ; les tribunaux présentèrent à l’empereur des mémoires contre tous ces bonzes d’Europe et surtout contre les jésuites, ainsi que nous avons vu depuis peu les parlements de France requérir et ensuite ordonner l’abolition de cette société. (…) ces bonzes, sous prétexte de religion, faisaient un commerce immense, qu’ils prêchaient une doctrine intolérante ; qu’ils avaient été l’unique cause d’une guerre civile au Japon, dans laquelle il était péri plus de quatre cent mille âmes ; qu’ils étaient les soldats et les espions d’un prêtre d’Occident, réputé souverain de tous les royaumes de la terre ; que ce prêtre avait divisé le royaume de la Chine en évêchés ; qu’il avait rendu des sentences à Rome contre les anciens rites de la nation, et qu’enfin, si l’on ne réprimait pas au plus tôt ces entreprises inouïes, une révolution était à craindre. Voltaire
Sans éblouir le monde, éclairant les esprits, il ne parla qu’en sage, et jamais en prophète ; cependant on le crut, et même en son pays. Voltaire (sur Confucius)
Confucius : d’autant plus grand qu’il ne fut point prophète, car qui est envoyé de Dieu doit l’être pour les deux hémisphères. Voltaire
Confucius ne recommande que la vertu ; il ne prêche aucun mystère […] pour apprendre à gouverner il faut passer tous ses jours à se corriger. Voltaire
L’empereur est, de temps immémorial, le premier pontife : c’est lui qui sacrifie au Tien, au souverain du ciel et de la terre. Il doit être le premier philosophe, le premier prédicateur de l’empire : ses édits sont presque toujours des instructions et des leçons de morale. Voltaire
L’Empereur nous apparaît ainsi comme le juge universel du bien et du mal (…), en lui se réalise l’étroite union de la politique, de la morale et de la religion, principe fondamental du gouvernement chinois ; il est véritablement le Fils du Ciel, et son omnipotence absolue et sacrée provient de ce qu’il est le mandataire du Ciel sur la terre. Edouard Chavannes (1904 )
Le feu sacré est étranger également au formidable ramassis de préjugés gauchistes, tiers-mondistes, multiculturalistes, politiquement corrects, etc. ; qui, depuis les années soixante, ont pris le relais des anciennes excuses pour ligoter plus que jamais la recherche, au nom de la protection dont les civilisations non occidentales, même défuntes, auraient besoin, face à l’impérialisme occidental. Passer son temps à déblatérer l’impérialisme, c’est se donner plus d’importance politique que nous en avons. Tous les mouvements gauchistes minimisent les violences archaïques pour protéger ce qu’on ne peut guère appeler autrement que la “vanité culturelle” des sociétés défavorisées, pas plus respectable en fin de compte que la vanité des peuples privilégié. René Girard
Le Père Noël a été sacrifié en holocauste. A la vérité le mensonge ne peut réveiller le sentiment religieux chez l’enfant et n’est en aucune façon une méthode d’éducation. Cathédrale de Dijon (communique de presse aux journaux, le 24 décembre 1951)
Comme ces rites qu’on avait cru noyés dans l’oubli et qui finissent par refaire surface, on pourrait dire que le temps de Noël, après des siècles d’endoctrinement chrétien, vit aujourd’hui le retour des saturnales. André Burguière
Grâce à l’autodafé de Dijon, voici donc le héros reconstitué avec tous ses caractères, et ce n’est pas le moindre des paradoxes de cette singulière affaire qu’en voulant mettre fin au Père Noël, les ecclésiastiques dijonnais n’aient fait que restaurer dans sa plénitude, après une éclipse de quelques millénaires, une figure rituelle dont ils se sont ainsi chargés, sous prétexte de la détruire, de prouver eux-mêmes la pérennité. (…)La croyance où nous gardons nos enfants que leurs jouets viennent de l’au-delà apporte un alibi au secret mouvement qui nous incite, en fait, à les offrir à l’au-delà sous prétexte de les donner aux enfants […] Les cadeaux de Noël restent un sacrifice véritable à la douceur de vivre, laquelle consiste d’abord à ne pas mourir. (…) Les cadeaux seraient donc une prière adressée aux petits enfants – incarnation traditionnelle des morts, pour qu’ils consentent, en croyant au Père Noël, « à nous aider à croire en la vie ». Claude Lévi-Strauss
Nous avons mis en ligne des e-mails jusqu’alors inédits, montrant que le Dr Fauci a dissimulé des informations à propos d’une origine du Covid-19 en provenance du laboratoire de Wuhan, et intentionnellement minimisé la thèse d’une fuite de laboratoire. Parti républicain américain
En développant massivement un programme de modification des conditions météorologiques, le pays pourra, d’ici 2025, infléchir la météo grâce aux avancées spectaculaires de la recherche en matière « d’ensemencement » des nuages, rapporte CNN. Si cette technologie n’est pas nouvelle, l’ampleur du programme impressionne : la zone concernée couvrira une surface de 5,5 millions de kilomètres carrés, soit une fois et demi la superficie de l’Inde. Le concept d’ensemencement des nuages, déjà connu, consiste à injecter de petites quantités d’iodure d’argent dans les nuages qui comportent un taux d’humidité élevé, ce qui provoque la condensation des particules, puis des précipitations. Pékin est familière de cette technologie, utilisée notamment lors des JO de 2008 pour assurer un ciel dégagé pendant les épreuves sportives, ou encore lors des grandes exhibitions politiques dans la capitale. À l’heure où le dérèglement climatique menace, la maîtrise de cette technologie permettrait à la Chine de préserver ses régions agricoles des chutes de grêle, de lutter plus efficacement contre les grands feux de forêt, ou encore de parer aux périodes de sécheresse. L’année dernière, l’agence de presse chinoise Chine nouvelle annonçait en effet que la manipulation météorologique avait permis de réduire de 70% les dommages provoqués par la grêle sur les cultures dans le Xinjiang. Cette technologie a toutefois nécessité un investissement massif de la part du gouvernement chinois qui a, au total, déboursé pas moins de 1,34 milliard de dollars entre 2012 et 2017. Cet engouement fait cependant tiquer certains pays, comme l’Inde justement. Les deux pays, qui partagent une frontière le long de l’Himalaya, s’y étaient confrontés lors de violents heurts en juin 2020. L’Inde se demande depuis plusieurs années si la modification météorologique et les chutes de neige artificielles ne pourraient pas donner l’ascendant à la Chine en cas de conflit futur dans cette zone montagneuse où les mouvements de troupes sont essentiels. Capital
Nous avions déjà connu dans les années précédentes des demandes pour retirer les sapins de Noël, car ce serait un signe ostentatoire. Je trouve la décision du tribunal très agressive vis-à-vis du président du conseil général, surtout en Vendée. Bientôt, il faudra supprimer le mot Dieu de tout notre vocabulaire. C’est un peu insensé. Il faut arrêter les provocations. (…Toutes les mairies mettent des sapins de Noël partout. Ou alors on décide d’enlever toutes les églises du pays, car c’est aussi un signe ostentatoire religieux. Il faut arrêter de répondre à quelques babas cool écervelés à un moment où tout ça est très crispant dans la société. On prend la décision de retirer une crèche juste avant Noël, alors que cette fête est uniquement féérique. Ça n’a rien à voir avec la religion. On devrait se demander si on supprime Noël dans ce cas. La connerie n’a pas de limites… (…) Il faut du discernement. C’est ça le vivre ensemble. La réponse du ministre de l’Intérieur à une question écrite en mars 2007 l’explique tout a fait. (NDLR : à une question de Jean-Luc Mélenchon, alors sénateur, au sujet d’une crèche installée par une mairie, le ministère de l’Intérieur, dirigé à l’époque par Nicolas Sarkozy, répond que « le principe de laïcité n’impose pas aux collectivités territoriales de méconnaître les traditions issues du fait religieux qui, sans constituer l’exercice d’un culte, s’y rattachent néanmoins de façon plus ou moins directe. Tel est le cas de la pratique populaire d’installation de crèches, apparue au XIIIe siècle. Tel est le cas aussi de la fête musulmane de l’Aïd-el-Adha ».) Sans discernement, on supprime tout. L’Hôtel-Dieu doit changer de nom dans ce cas… Les musulmans ne le demandent même pas. Ceux qui demandent cela sont des ramassis de gens hors-sol et anti-calotin. Il ne faut pas y céder. (…) C’est une erreur. C’est souffler sur des braises. (…) au moment où les chrétiens sont martyrisés dans une partie du monde, je crois qu’il faut arrêter. On ne va pas brûler les minarets et faire sauter les synagogues. Arrêtons les bêtises. Noël, c’est féérique et je crois qu’on doit croire au Père-Noël le plus longtemps possible. Pierre Charon (sénateur UMP de Paris)
Le Parti, la politique, le militaire, le civil, l’université, l’Est, l’Ouest, le Sud, le Nord et le Centre, le Parti dirige tout. Mao Zedong
Pourquoi l’Union soviétique s’est-elle désintégrée ? Pourquoi le Parti communiste soviétique s’est effondré ? Une raison importante était que leurs idéaux et leurs convictions vacillaient. Finalement, il a suffi d’un mot silencieux de Gorbatchev pour déclarer la dissolution du Parti communiste soviétique, et un grand parti a disparu. En fin de compte, personne ne s’est comporté en homme, personne n’a osé résister. Xi Jinping
President Xi Jinping managed to offend Buddhists more deeply through his visit in Hebei last week than he did when visiting Tibet in July, in a trip that was mostly devoted to geopolitical issues and the question of water. That Xi Jinping’s visit to Chengde, in Hebei province, on August 24 did not create an international scandal only proves how easily history, including history of genocides, is forgotten. In fact, the Chinese president visited and honored a temple built to commemorate a genocide. The Puning Temple in Chengde is inextricably connected with the 18th-century extermination of the Dzungar Buddhists, which virtually all non-Chinese historians recognize as genocide. The Dzungars were a confederation of Mongol tribes that converted to Buddhism and established a powerful Khanate in the 17th century in present-day Xinjiang. The beautiful temples and monasteries they built there were all destroyed during the Cultural Revolution. Tibetans do not have a good memory of the Dzungars. Although the Fifth Dalai Lama and the founder of the Dzungar Khanate, Erdenu Batur, were allies, by the 18th century the Khanate had become so powerful that they invaded Tibet and conquered and looted Lhasa in 1717. The Tibetans, perhaps making a mistake justified by their difficult predicament, called the Chinese for help. The Dzungars defeated the Chinese army in 1718 (something the Chinese never forgot), but a second Chinese expedition was more successful, and the Dzungars were expelled from Tibet in 1720. The defeat of 1718 was avenged in 1755, when China moved decisively to annihilate the Dzungar Khanate and exterminate the Dzungar people. Between 500,000 and 800,000 Dzungars (650,000 being the figure advanced by some recent historians) were killed, men, women, and children. Only a few thousand descendants from the Dzungars survive in present-day Mongolia. Although the Dzungar invasion of Tibet was an act of aggression, nothing can justify the genocide perpetrated by the Qianlong Emperor, the worst mass massacre of the 18th century in the world. The same Qianlong Emperor built in 1755 the Puning Temple to celebrate what he called his “pacification” of the Dzungars, which was in effect extermination and genocide. (…) On August 24, Xi Jinping came to the Puning Temple. The visit was prepared by a video the CCP produced to explain to a Chinese audience the historical significance of the event. The video explained the conquest of the Dzungar Khanate and extermination of the Dzungars by claiming that the Qianlong Emperor “put down the rebellion of the Mongol Dzungar tribe.” The temple was presented as “one temple, two styles” (Chinese and Tibetan), a symbol of “Han-Tibetan unity and national unity.” (…) This is the usual jargon for total submission of religion to the CCP, but even more significant is that from the Puning Temple Xi went on to visit at the Chengde Museum an exhibition called “Inside and Outside of the Great Wall of Hope: Records of National Unity in the Qing Dynasty,” which is a blatant celebration of the genocidal policies of the Qianlong Emperor, who is praised for having promoted “ethnic unity, border stability, and national unity.” That he did so by killing hundreds of thousands of Dzungars is not explained. In such a significant location, Xi warned ethnic minorities that they should “adhere to the leadership of the CCP, adhere to the correct path of solving ethnic problems with Chinese characteristics, fully implement the Party’s ethnic theory and ethnic policies, and constantly consolidate and develop socialist ethnic relations.” They are, Xi said, inscribed in “historical laws” —one of which seems to be that either you submit or you are exterminated through genocide. Bitter winter
Aucune religion n’interdit le cannibalisme. Je ne trouve pas non plus de loi qui nous empêche de manger les gens. J’ai profité de l’espace entre la morale et la loi et c’est là-dessus que j’ai basé mon travail. Zhu Yu
It is worth trying to understand why China is producing the most outrageous, the darkest art, of anywhere in the world. Waldemar Januszczak (Times art critic)
Le sinologue français Robert des Rotours (…), dans son article « Quelques notes sur l’anthropophagie en Chine », indique que la consommation de viande humaine se pratique dans quatre buts principaux : pour survivre (en période de famine), dans un but de vengeance (sur un ennemi défini), pour satisfaire ses goûts culinaires, et enfin dans un but médical. J’ajouterais une cinquième catégorie, à savoir le témoignage de la piété filiale, rattaché à deux des catégories précédentes (famine et maladie), mais dont la pratique est singulière puisqu’il se pratique sur des personnes vivantes et volontaires (don de soi). Après avoir épluché longuement l’historiographie chinoise, le Professeur Key Ray Chong (…) a dénombré pas moins de 1219 évocations d’une pratique cannibale entre l’Antiquité et 1912 : 780 motivés par la piété filiale, 329 liés à la famine, 82 à la haine et à la guerre, et une infime minorité motivée par des penchants culinaires. A tout cela, il faudra ajouter les faits qui se sont déroulés au xxe siècle, avec un cannibalisme pratiqué dans un but idéologique. (…) nous avons présenté les différentes motivations poussant à la consommation de chair humaine en Chine : guerres, vengeances, famines, idéologie, piété filiale, croyances médicales, rituels ancestraux, penchants culinaires. (…) Existe-t-il réellement dans la société chinoise des faits de cannibalisme ? Historiquement, c’est sûr. Prenez l’exemple de Yi Ya à l’époque des Royaumes Combattants, qui a donné son fils à manger au duc Huan de Qi. D’autres faits sont attestés à l’époque féodale ; la piété filiale contraignait à donner sa propre chair pour soigner ses parents ; Lu Xun et son Journal d’un fou qui se termine par l’appel « Sauvez les enfants » ; les témoignages de Zheng Yi à l’époque de la Révolution culturelle sur des actes de cannibalisme dans le sud du pays. Tout prouve que le cannibalisme a existé. Solange Cruveillé
[L’hypothèse de l’accident de laboratoire] est basée, entre autres, sur le fait que le virus le plus proche actuellement connu, donc le RaTG13, a été échantillonné par un laboratoire de virologie localisé dans la zone où les premiers cas de Sars-CoV-2 ont été détectés, et où des travaux sur ces coronavirus émergents sont conduits. Des projets de recherche importants visaient à comprendre le mécanisme de franchissement de barrières d’espèces, c’est-à-dire justement à collecter des virus chez les chauves-souris, récolter des échantillons de manière à séquencer ces virus, essayer de mettre en culture ces virus dans des cellules et essayer de comprendre comment ces virus sont potentiellement capables d’infecter des cellules d’autres mammifères, incluant des cellules humaines. (…) Chez les coronavirus, par exemple, il y a une protéine qui joue un rôle majeur dans le franchissement de la barrière des espèces, c’est la protéine Spike qui est à la surface de la particule virale et donne l’aspect en couronne des virus. Il se trouve que les laboratoires de virologie de Wuhan ont démontré, à partir de 2016, qu’il existe chez certaines chauves-souris des virus avec des protéines Spike potentiellement capables d’infecter directement des cellules humaines sans nécessiter pour autant de passer par des hôtes intermédiaires. (…) Il est crucial, de mon point de vue, de comprendre l’origine de cette pandémie, parce qu’il y a des décisions collectives et mondiales à prendre qui seront complètement différentes si l’origine est zoonotique ou accidentelle. S’il y a eu passage par tel ou tel hôte intermédiaire, il faudra prendre des mesures de surveillance chez les animaux potentiellement infectés, donc potentiellement vecteurs de ces virus, avec à la clef des abattages systématiques, comme c’est le cas régulièrement pour la grippe aviaire. Et s’il s’avère que c’est un accident dû à des manipulations, alors il faut mieux encadrer les conditions expérimentales dans lesquelles sont faites les expériences dont on vient de parler. Par ailleurs, quelle que soit l’origine du virus, avec l’avancée rapide des nouveaux outils de biologie moléculaires, il est peut-être urgent de réfléchir de manière collective aux expériences qu’il est nécessaire de faire dans les laboratoires et à celles qu’il ne faut pas faire parce qu’elles sont trop dangereuses. Est-il raisonnable de construire dans des laboratoires, des virus potentiellement pandémiques chez l’homme qui, au départ, n’existent pas naturellement ? Ce débat éthique existe depuis les années 2010-12, quand des équipes américaines et hollandaises ont cherché à construire des virus de la grippe, potentiellement pandémiques, et cette fois-ci à partir d’un virus qui n’était pas particulièrement adapté à la transmission par aérosol. Le bénéfice qu’on escomptait de ces expériences était-il si important qu’on pouvait s’affranchir du risque de sa diffusion ? Ou, est-ce que, éthiquement, ces travaux devaient être considérés comme trop dangereux et donc interdits ? Voilà ce qui a conduit les États-Unis à décréter à partir de 2014 un moratoire sur ce type d’expérience. (…) l’une des conséquences de cette nouvelle politique a été l’arrêt des expériences sur les coronavirus par les grands laboratoires sur le territoire américain. Ce qui a conduit, à la place, à l’intensification de ces recherches dans les laboratoires de Wuhan, par exemple, avec des financements américains… notamment, entre autres, via la EcoHealth Alliance ! Paradoxalement, le moratoire américain, qui pourrait être jugé comme une décision limitant les risques biologiques, a donc peut-être eu des effets pervers, en favorisant le déploiement de recherche dans des pays ou le contrôle des risque biologiques est moindre. Étienne Decroly
Moi aussi je suis pécheur, mais si la loi ne devait être exécutée que par des hommes sans faute, la loi serait vaine. Jésus (réécrit par un manuel scolaire chinois)
Il faut une évaluation complète des traductions existantes de classiques religieux. Pour les contenus non conformes, il faut des modifications et il faut retraduire les textes. Communiqué du parti communiste chinois (6 novembre 2019)
Le régime communiste est une secte et il voit le bouddhisme tibétain, le catholicisme ou l’islam comme des idéologies rivales. Le contrôle accru sur les religions trahit en réalité la peur de voir la société lui échapper. Zhang Lifan (historien chinois)
En Chine, un manuel scolaire destiné à l’enseignement professionnel dans le secondaire, publié par un service d’édition dépendant du gouvernement, a choisi de reprendre le passage biblique concernant la femme adultère afin d’enseigner aux élèves « l’éthique professionnelle et le respect de la loi ». On aurait pu s’en féliciter dans la mesure où Jésus, dans ce texte (Jn 8, 1-11), prend la défense de la femme adultère et empêche sa lapidation avec ces mots : « Celui d’entre vous qui est sans péché, qu’il soit le premier à lui jeter une pierre ». Mais loin d’encourager une telle charité et l’amour de son prochain, le passage biblique cité dans le manuel scolaire assure que Jésus se serait mis lui-même à lapider la femme adultère en ajoutant : « Moi aussi je suis pécheur, mais si la loi ne devait être exécutée que par des hommes sans faute, la loi serait vaine ». (…) Ce n’est pas la première fois que le gouvernement chinois s’en prend aux catholiques du pays de manière plus ou moins insidieuse. Dans la province de l’Anhui (est du pays), près de Shanghai, depuis la mi-avril, plus de 500 croix appartenant à des lieux de culte chrétiens, que ce soit des églises catholiques ou des temples protestants, ont été enlevées des clochers. Cette répression qui émane du parti communiste n’est pas nouvelle et des milliers de croix ont déjà été retirées dans les provinces du Zhejiang, du Henan, du Hebei et du Guizhou, parfois sous prétexte de respecter les règles d’urbanisme. Alteia
L’État chinois contrôle de plus en plus profondément les nouvelles diffusées dans les médias officiels, et ce qui n’est pas validé en haut lieu est souvent qualifié de rumeur, comme cela a été le cas pour les premiers messages non officiels à propos de ce nouveau virus. Dès le 30 décembre 2019, le docteur Li Wenliang, ophtalmologue à l’hôpital central de Wuhan, diffuse l’information d’une nouvelle maladie, grave et transmissible d’homme à homme, auprès de quelques collègues. Questionné par la police le 3 janvier 2020, il est accusé d’avoir propagé de fausses rumeurs. Dans la culture communiste chinoise, il doit se rétracter en signant une « lettre d’admonestation », nouvelle formule des autocritiques en vigueur dans les années 1940 avec un paroxysme pendant la Révolution culturelle, par laquelle il s’engage à ne pas recommencer sous peine de poursuites. Avec le recul et vue de nos rives occidentales, cette menace à l’encontre de la diffusion de l’existence d’une maladie qui va rapidement devenir une pandémie paraît incroyable. Pourtant, cela est courant en Chine et n’étonne personne là-bas. (…) En effet, c’est d’abord la glorification du peuple chinois réussissant sa lutte contre le virus qui doit dorénavant circuler, comme cela transparaît dans une bande dessinée de propagande nommée « Grande illustration de la lutte contre le coronavirus », publiée sur le site du Quotidien du peuple le 2 avril. (…) L’arrivée du virus est imputée au « ciel », à travers des éclairs et des coups de tonnerre soudains, malmenant la sérénité des voyageurs se préparant à rentrer en famille fêter le Nouvel An. Le ciel, dans la tradition chinoise, est la puissance cosmique fondamentale. Ciel et destin sont souvent synonymes, et une traduction courante de la maxime ci-dessus (« le ciel avait un autre plan ») est « le destin est imprévisible ». L’apparition du « ciel/destin » en tant que moteur cosmique surplombant les hommes est assez originale dans un journal communiste. S’ensuit cette parole si anodine du virus : « Je suis arrivé tout doucement » – soudaine, impromptue, insidieuse, hors de tout contrôle, cette venue enlève toute responsabilité aux humains. Car c’est bien cela qu’il faut retenir : rien n’a pu être fait pour contenir cette épidémie que personne n’a vue venir, parce qu’elle a été orchestrée par le ciel. Dès lors, il appartient aux humains de se liguer pour combattre la maladie, heureusement avec l’aide du dieu du feu et du dieu du tonnerre, qui nomment les hôpitaux bâtis en un temps record. La teneur globale du message semble être la suivante : le ciel a envoyé un défi aux hommes qui, malgré quelques pertes, l’ont relevé victorieusement. L’avenir est dans le rêve chinois, représenté par les bulles d’une petite fille solitaire, volant sous des arbres en fleur vers le ciel. Bien sûr, on peut faire d’autres interprétations : d’abord, la fresque représente évidemment une réécriture de la bataille contre le virus du point de vue des dominants ; paradoxalement, ces derniers sont absents, et c’est bien le peuple lui-même qui est glorifié pour ses sacrifices. Ensuite, on peut être frappé par les accents religieux, voire mystiques, se manifestant dans l’évocation du ciel, dans celle des dieux du feu et du tonnerre nommant les hôpitaux parce qu’ils sont traditionnellement des dieux exorcistes pourfendeurs des maladies, dans les nombreuses colombes blanches voletant – symboles universels de paix et de pureté –, et enfin dans la pagode bouddhiste, présente au début et à la fin. Comment se fait-il que la propagande chinoise doive recourir à des clichés religieux et cacher le communisme et le Parti, les commanditaires de cette fresque ? Comment peut-on interpréter la petite fille solitaire du dernier dessin ? Ne pourrait-on pas y voir signifié le souhait chinois profond d’atteindre à l’individuation loin des foules pour vivre dans un monde idéal, en accord avec une nature bienveillante, sous une protection divine ? Cependant, la douceur extérieure relative de cette fresque disparaît avec fracas dans des caricatures d’une violence extrême livrées sans retenue en ligne fin avril, critiquant la romancière Fang Fang et le docteur Zhang Wenhong. Le journal du confinement de Wuhan de Fang Fang, publié chaque soir en ligne, a été le seul récit relatant librement les sentiments d’une écrivaine confinée. (…) les éditions chinoises ayant rejeté toute publication en Chine, Fang Fang a conclu un contrat avec des éditions non chinoises. Dès lors, considérée comme traître, elle est traitée dans des termes abjects datant de l’époque de la Révolution culturelle. Sur le dessin, travestie comme un chien, objet de haine et de mépris, elle est accusée par trois jeunes gens la pointant avec un doigt, un pinceau et une plume, la jeune fille tenant une lampe rouge, le tout sur un fond de drapeaux rouges. C’est bien l’écriture libre qui est dénoncée unilatéralement par les tenants d’un communisme rouge revenant sur le devant de la scène par les « nationalistes maoïstes » via les réseaux sociaux. Une deuxième caricature dénonce également l’esprit libre d’une autorité scientifique, le docteur Zhang Wenhong, représenté un peu comme un moustique à écraser, tenu par une main rouge – communiste donc. La raison de cette attaque ? Zhang Wenhong, directeur du service de maladies infectieuses d’un hôpital de Shanghai, est extrêmement populaire, bien plus que l’officiel Zhong Nanshan, représenté dans la fresque du Quotidien du peuple, pour ses prises de paroles réalistes et parfois humoristiques. II est violemment attaqué sur les réseaux sociaux, parce qu’il a proposé aux parents chinois de donner à leurs enfants du lait et des œufs pour le petit-déjeuner, à la place de la traditionnelle bouillie de riz, pour renforcer leur immunité. Ces propos ont été considérés comme une traîtrise vis-à-vis de la culture chinoise. Quels que soient les arguments et leur validité, ces attaques visent des personnes populaires, parce qu’elles ont révélé au grand jour ce qui n’aurait pas dû l’être. La Chine actuelle reste une société du secret, où la parole publique officielle travestit ou utilise le mensonge pour cacher ce qui ne doit pas être dit. Malheur à ceux qui transgressent les consignes ! (…) Ce qui se passe actuellement en Chine revient certainement en arrière sur tous les combats pour la liberté et la démocratie entamés depuis le début du xxe siècle, portés par de nombreux acteurs, y compris le Parti communiste chinois à son origine. Depuis l’ère des réformes, dans une Chine apaisée, nombreux encore sont ceux qui ont continué sur cette lancée, malgré Tian’anmen en 1989. Bien qu’aujourd’hui, la société numérique développe encore plus la surveillance de masse et favorise la circulation d’images terribles, elle n’a pourtant pas encore réussi à entraver ces espérances. Catherine Capdeville-Zeng
Le régime communiste veut que les religions servent les objectifs du Parti communiste, et donc la construction du socialisme. Xi Jinping sait qu’il ne peut pas faire disparaître la religion par une persécution massive, donc il poursuit la mise en œuvre d’une politique de contrôle et d’instrumentalisation de la foi chrétienne et de la religion musulmane. C’est une politique qui vise l’Église catholique mais aussi les autres religions, comme le protestantisme et l’islam. Ce n’est pas une annonce spectaculaire dans le sens où c’est la suite logique cohérente d’une volonté politique de sinisation de la société, que Xi Jinping a exprimé il y a déjà des années. Lorsqu’il a employé le terme de « sinisation » pour la première fois en 2011, il l’a appliqué au marxisme. Depuis 2015, il estime que cela doit aussi s’appliquer aux religions présentes en Chine. Pour lui, les religions doivent s’adapter à la culture et aux valeurs chinoises, et donc être un relais des valeurs marxistes. (…) C’est un contrôle de plus en plus étroit et quotidien, à la fois sur tous les édifices mais également sur toutes les activités religieuses en général. En Chine, aucun journal chrétien ni revue de théologie ne peut exister. Il y a parfois quelques bulletins d’une église ou d’un temple, mais ils sont contrôlés par le régime. Pour la période de Noël, cela va encore plus loin : les autorités ont mis en place une campagne de boycott, car ils considèrent que cette fête trahit la culture chinoise. Dans les écoles, toutes les décorations de Noël sont interdites. Dans plusieurs établissements, des enfants ont été punis car ils ont dit qu’ils allaient se rendre à la messe de Noël. Cela est dû à une réglementation adoptée il y a deux ans, qui interdit aux enfants de moins de 18 ans d’aller dans les églises ou dans les temples. (…) Dans l’idéologie marxiste, la religion est « l’opium du peuple », une superstructure qu’il faut faire disparaître. Mais le régime est conscient que dans les faits, ce n’est pas possible dans l’immédiat. A défaut de détruire la religion, il cherche dont à la transformer. Cette politique de sinisation s’est traduite par exemple par une récente campagne d’affichage dans les églises. Les autorités politiques essayaient de montrer par des citations que les douze grandes valeurs du socialisme ont une correspondance directe dans la Bible, donc que la Bible annonce le socialisme. (…) À mon sentiment, c’est la suite logique de la politique engagée par Xi Jinping depuis 2013. Mais dans la décennie 1966-1976, pendant ce que l’on a appelé la Révolution culturelle, la situation était encore plus dramatique. Aucun culte religieux n’était autorisé : même les églises « officielles » (celles qui sont reconnues par le régime, ndlr) ont été fermées de force, ainsi que les temples protestants… Aucun culte religieux n’existait en Chine. Aujourd’hui, même si la liberté de pratique religieuse est gravement entravée, des églises officielles sont ouvertes, et la religion n’est pas interdite. (…) [Avoir une croyance religieuse en Chine] C’est possible, dans la mesure où aucun pays à aucune époque n’a réussi à empêcher les gens de croire. L’objectif du régime à long terme serait de supprimer la religion en Chine, mais évidemment, il n’y parviendra pas. (…) Les différentes mesures prises par les autorités chinoises depuis la signature de l’accord [avec le Vatican] sont en contradiction avec cet accord. Le régime a toujours pour objectif de contrôler davantage l’Église catholique, et d’instrumentaliser la doctrine religieuse à des fins politiques. Évidemment, en signant cet accord, le Pape essayait de préserver la liberté de l’Église et assurer sa continuité en Chine, où de nombreux diocèses étaient sans évêques… Il avait des raisons de signer cet accord. Mais la Chine et le Saint-Siège poursuivent des intérêts différents. Il est peu probable que le Vatican réagisse à cette nouvelle offensive du régime. Le Pape sait bien que 11 millions de catholiques chinois vont déjà fêter Noël dans des conditions très difficiles. Il ne voudra pas aggraver la situation. Yves Chiron
Il est impossible de comprendre la forme de la gouvernance chinoise actuelle sans s’intéresser à la Chine archaïque et à la Chine impériale. Et, quand on se livre à cet exercice, on constate combien la théorie du philosophe René Girard sur le bouc émissaire est pertinente. L’homme fonctionne toujours sur le mode mimétique : il désire ce que veut son voisin, d’où les conflits. Lorsque ceux qui déchirent une communauté finissent par converger vers un seul de ses membres, rendu responsable de tout le mal, sa mise à mort ramène l’ordre et l’harmonie. C’est un phénomène anthropologique universel que les Évangiles ont subverti en racontant ce lynchage non pas du point de vue de la foule persécutrice, mais du point de vue de la victime innocente. Cependant, ce phénomène reste particulièrement présent dans la Chine actuelle, où il structure la religion comme la politique. (…) Les mythes de la Chine la plus archaïque sont nombreux à mettre en scène un meurtre fondateur. Ainsi, Tang le Victorieux, fondateur de la dynastie Shang, est à la fois considéré comme celui qui mit à mort Jie, le dernier souverain des Xia – la première dynastie chinoise – il y a trois millénaires, et, après son arrivée au pouvoir, comme une victime émissaire, accusée d’exactement les mêmes maux que Jie en son temps. Lors d’une sécheresse, les conflits se multiplièrent et Tang s’offrit en sacrifice pour faire tomber la pluie. Tang et Yu le Grand, le fondateur des Xia, furent tous deux des infirmes portant les marques d’élection propres aux victimes émissaires. Tang était « desséché », comme les sorciers au cœur des rites de faiseurs de pluie, et Yu le Grand boitait. Le « pas de Yu » reste aujourd’hui un des principaux rituels taoïstes. (…) c’est par les sacrifices que l’empereur pouvait faire régner l’ordre et l’harmonie ! Avant d’être un politique, l’empereur était « fils du Ciel ». Le sacrifice au Ciel, qui était son apanage jusqu’en 1912 et la fondation de la République, était un rituel sanglant auquel aucun étranger ne pouvait assister. Si les sacrifices étaient correctement effectués, cela signifiait que le monde était en ordre. Si l’empereur s’agitait pour tenter de résoudre les problèmes auxquels le pays était confronté, il risquait au contraire de semer le désordre dans la communauté. Le « décret du Ciel », une notion dont la première occurrence apparaît en 998 avant notre ère, sous la dynastie des Zhou, permettait de justifier le pouvoir en place. L’empereur devait sans cesse faire face aux risques de subversion et inspirer une peur plus grande que celle qu’il éprouvait lui-même à l’égard de la violence collective. Le regard menaçant des « dix mille êtres » (la foule) pesait constamment sur l’« être unique » qu’était l’empereur, « plus à plaindre qu’un lépreux », comme le disait le légiste Han Feizi. Pour Mencius [Mengzi], le tyran déchu doit faire face à la volonté commune du Ciel, du peuple et de celui qui l’a chassé, lequel devient le nouveau détenteur du décret du Ciel mais peut être demain une nouvelle victime sacrifiée. N’est-il pas intéressant de voir comment, lors du XXe Congrès, Hu Jintao, le prédécesseur de Xi Jinping, a été, en public, exclu de l’assemblée ? Son successeur n’a pas bougé un cil. Depuis l’avènement du Parti communiste, le « décret du Ciel » s’appelle « mission historique » et fonde la légitimité du Parti. Si la dénomination change, c’est toujours du Ciel que vient la légitimité. Tant qu’ils ont le pouvoir, les dirigeants sont légitimes. (…) la théologie joue toujours son rôle dans la Chine d’aujourd’hui. Le sinologue Joël Thoraval a démontré que souvent, dans les campagnes, les souverains occupent la place centrale sur les autels domestiques et lors des rites, aux côtés du Ciel, de la Terre, des ancêtres et des maîtres. La politique chinoise est intimement liée à la religion. Dans les années 1980 et 1990, après la fin du culte de la personnalité, décrétée par Deng Xiaoping, des empereurs autoproclamés, suivis parfois de milliers de fidèles, sont apparus partout en Chine. Le retour d’une figure impériale avec Xi Jinping marque au fond un retour à la normale. (…) [Mais] présente en Chine depuis le XVIIe siècle, [la religion chrétienne] rend plus difficile la fermeture sacrificielle sur le bouc émissaire. Le christianisme est synonyme de liberté. C’est grâce à lui que les femmes ont pu avoir accès à l’éducation et commencer à se libérer de la coutume des pieds bandés, progrès d’ailleurs revendiqué par le Parti communiste. Aujourd’hui, malgré les persécutions parfois sanglantes contre les chrétiens jusqu’aux années 1970 et les mesures prises aujourd’hui pour interdire l’accès au culte, les conversions vont croissant. Nous manquons de statistiques fiables, mais les chrétiens seraient environ 100 millions, en majorité des protestants. C’est dans ce vivier que se recrutent nombre de militants des droits de l’homme. Ce n’est donc pas un hasard si le pouvoir veut « siniser » le christianisme. En 2019, il a annoncé un projet de réécriture de la Bible, qui devrait être terminé d’ici dix ans. Il a renoncé toutefois à inclure dans un manuel d’éducation civique sa version de l’épisode de la femme adultère (Évangile de Jean), dans laquelle le Christ participe lui aussi à la lapidation ! (…) [L’historiographie chinoise] n’est pas fondée sur la vérité, mais sur l’autojustification du pouvoir, lequel est toujours pacificateur alors que les victimes sont des « fauteurs de troubles » responsables de ce qui leur arrive. Le massacre des Dzoungars, commis par les Qing au milieu du XVIIIe siècle, est ainsi présenté dans les annales comme une expédition punitive contre des brigands rebelles au fils du Ciel. Les Dzoungars ont été exterminés ; leur principauté est devenue pour partie la province du Xinjiang, peuplée par les Ouïgours, alors alliés des Chinois, et aujourd’hui par de plus en plus de Hans. Mais ce génocide est commémoré en toute bonne conscience par le pouvoir chinois en tant que moment privilégié de l’unité entre les Hans et les Tibétains, qui les avaient alors aidés. A contrario, la Chine ne peut être que victime des Occidentaux et des Japonais, qui l’auraient humiliée, sans que le pouvoir accepte de prendre en compte le fait que c’est grâce aux « barbares » étrangers qu’elle s’est pour une part ouverte à la modernité. Elle-même d’ailleurs n’aurait jamais fait de guerres de conquête, elle se serait contentée d’unifier le territoire du Ciel… Emmanuel Dubois de Prisque
Il apparaît (…) que la Chine actuelle, malgré son « athéisme » officiel, partage avec la Chine impériale un même tropisme qui la porte à ne pas distinguer le politique du religieux. Le Parti communiste chinois agit de plus en plus comme une institution qui se pose en gardienne de ce qui est sacré pour la Chine et que des forces extérieures, politiques ou religieuses, viennent en permanence menacer, de la même façon que la « bureaucratie céleste de l’Empire était la gardienne d’un dogme contre les hérésies » qui le menaçaient. Du point de vue du rapport du politique avec le religieux, la situation actuelle se rapproche de celle que décrivait Édouard Chavannes en 1904 : « L’Empereur nous apparaît ainsi comme le juge universel du bien et du mal […], en lui se réalise l’étroite union de la politique, de la morale et de la religion, principe fondamental du gouvernement chinois ; il est véritablement le Fils du Ciel, et son omnipotence absolue et sacrée provient de ce qu’il est le mandataire du Ciel sur la terre. » (…) La « grande renaissance de la nation chinoise » (…) est le cœur du métarécit de la Chine contemporaine selon lequel la Chine a refermé en 1949 une parenthèse d’un long siècle qui s’étend du début de la première guerre de l’Opium, en 1839, à la création de la « nouvelle Chine », siècle au cours duquel elle a été « humiliée » par les puissances occidentales et japonaise qui ont tiré profit de sa faiblesse, de son ingénuité et d’un pacifisme intrinsèque à sa culture. Sans renoncer à ce qu’elle est essentiellement, une civilisation pacifique et harmonieuse, elle ne répétera pas les erreurs du passé et saura se défendre si elle est agressée. (…) La posture parfois agressive et irascible de la Chine contemporaine s’explique ainsi paradoxalement par le sentiment que la civilisation chinoise est plus pacifique que les autres. Il lui faut donc devenir forte pour redevenir ce qu’elle imagine qu’elle fut : un modèle de vertu pour elle-même et pour le monde. (…) Depuis, au moins, le traité de Westphalie en 1648, les nations européennes ont de facto renoncé à incarner la totalité de la Chrétienté, c’est-à-dire à se considérer comme un avatar de l’empire universel des Romains et ont, de ce fait, sécularisé et territorialisé leur pouvoir. La Chine, quant à elle, n’a jamais été contrainte à cette kénose politico-religieuse. L’Empereur est resté jusqu’au terme de l’Empire non seulement souverain politique, mais aussi maître des rites et des sacrifices. Plus encore, les deux aspects de sa pratique politico-religieuse n’étaient qu’une seule et même chose. Comme l’écrit Jean Levi à propos de la Chine antique, « gouverner revient à sacrifier ». Malgré l’émergence progressive dans l’histoire chinoise de religions non directement politiques, diffusant leurs doctrines plus ou moins à l’écart du pouvoir, le bouddhisme et le taoïsme, le pouvoir impérial continuera à jouir d’un monopole sur la légalité et la légitimité du phénomène religieux dans le corps social. C’est l’administration qui définit, sur la base d’une loi fondamentale, ce qui est « correct » et ce qui est « hérétique » dans les pratiques religieuses. Pendant plus de cinq siècles, une loi Ming du xive siècle, reprise par la dynastie sino-mandchoue Qing jusqu’au début du xxe, prévoit la mort par strangulation ou l’administration de cent coups de bâton suivie (s’ils survivent) du bannissement de ceux qui pratiquent des cultes « hérétiques », c’est-à-dire non conformes aux pratiques considérées comme « correctes » par la bureaucratie. Pour reprendre les termes de J. J. M. De Groot, « l’Empereur aussi bien que le Ciel est seigneur et maître de tous les dieux, et délègue cette dignité à ses mandarins, chacun pour sa juridiction. C’est d’eux que relève la décision de savoir quels dieux sont susceptibles d’être objets de culte, et quels dieux ne le sont pas. S’il faut prendre la volonté de « restauration » de Pékin au sérieux, comme cela est vraisemblable, il convient d’envisager que ce processus puisse avoir une dimension religieuse et que cette dimension religieuse soit même centrale dans le projet des autorités chinoises. Depuis 2016, Pékin applique une politique de « sinisation » des religions qui non seulement réprime les « superstitions », mais soumet l’ensemble des cinq religions « officielles » (taoïsme, bouddhisme, islam, protestantisme, catholicisme) à une tutelle pesante. Des mosquées, des églises et mêmes des temples bouddhiques sont détruits ; le prosélytisme est sévèrement réprimé, l’accès aux églises ou aux mosquées est parfois interdit aux mineurs, tout comme l’enseignement religieux, tandis que le Parti promeut sa propre « spiritualité » de façon de plus en plus insistante. La « pureté » de l’idéal révolutionnaire est mise en avant et, dans certaines régions, les autorités locales remplacent jusque dans les domiciles les effigies religieuses par des portraits de Xi Jinping. Sur les lieux de culte qui restent tolérés, les inscriptions religieuses sont parfois effacées pour être remplacées par des slogans du Parti. Les autorités religieuses sont ainsi engagées dans un vaste projet visant à supplanter les religions existantes par une « spiritualité » indistinctement politique et religieuse qui s’appuie sur la doctrine marxiste-léniniste pour neutraliser non seulement les « religions étrangères » (christianisme et islam), mais aussi les religions considérées comme chinoises (taoïsme et bouddhisme) dans la mesure où ces dernières impliquent, pour les fidèles, un ordre de loyauté concurrent de l’ordre politique. En outre, les autorités situent parfois délibérément la vocation du religieux et celle du politique sur le même plan. Le catholicisme, notamment, est critiqué pour son inefficacité dans la lutte contre la pauvreté et la maladie, tandis que le Parti vante ses résultats dans ces deux domaines. Les autorités prétendent ainsi « transformer les fidèles des religions en fidèles du Parti . C’est aussi dans ce contexte que doit se comprendre la politique menée à l’égard de l’islam ouïghour au Xinjiang. Lorsque le Parti prétend, pour répondre aux accusations occidentales, se contenter de « rééduquer » les foules musulmanes du Xinjiang plutôt que de les enfermer dans des camps de concentration, cela n’a rien de rassurant car se manifeste ainsi une foi profonde dans la vertu civilisatrice de cette abstraction qu’est « la Chine ». Mais aussi abstraite soit-elle, cette Chine conçue comme centre de civilisation exerce des effets puissants sur les cadres du Parti communiste, qui y trouvent les ressources symboliques nécessaires à la légitimation de la mise en œuvre de politiques de plus en plus coercitives à l’égard des populations qui leur sont soumises. Mais plus profondément encore que dans ses rapports avec les religions, la nature religieuse, ou plus exactement sacrificielle, du régime chinois se révèle dans sa structuration fondamentale. En se faisant le gardien et le défenseur de l’orthodoxie spirituelle et de la foi dans les idéaux révolutionnaires de ses membres, le Parti s’inscrit dans les pas du pouvoir politico-religieux chinois traditionnel, dont un des rôles essentiels était de distinguer ce qui est « correct » de ce qui est « hérétique » dans le foisonnement des rites et cultes chinois. Aujourd’hui, c’est dans sa capacité de purification du corps social, à travers l’expulsion des ennemis de la Chine ou de la Révolution, que le Parti manifeste sa puissance, de la même manière qu’autrefois la puissance de l’Empereur se manifestait dans sa capacité à respecter les rites, au premier rang desquels le grand sacrifice au Ciel. Avec lui, l’ordre social et cosmique était produit et garanti. (…) Comme nombre d’autres empereurs avant lui, Mao fut déifié après sa mort par une partie de la population chinoise, malgré la vive hostilité à la religion traditionnelle qu’il manifesta durant son existence. Ou, plutôt, cette déification se produisit en raison même de cette hostilité : sa capacité magique à chasser les esprits et les fantômes de l’ancien monde faisait de Mao un esprit d’une puissance supérieure à celle des esprits et fantômes auxquels la Chine devait faire face jusqu’alors. Aujourd’hui encore, Mao occupe parfois la place centrale dans les autels domestiques, celle du souverain, alors même que son mausolée occupe le cœur de la place centrale (Tiananmen) de la capitale chinoise. La politique actuelle de « sinisation » des religions et d’expulsion de tout ce qui dans ces religions les rattache aux puissances étrangères renoue ainsi avec la longue tradition chinoise, malgré les soubresauts de l’histoire politique de ce pays au xxe siècle. Sur au moins un temple bouddhique chinois, on pouvait lire en 2018 un slogan frappant : « Sans parti communiste, il n’y a pas de bouddha », qui établit très clairement la nature de la hiérarchie entre le pouvoir du Parti et celui des autres organisations religieuses. Pas plus que dans la Chine d’ancien régime, il n’existe dans la Chine contemporaine un ordre politique et un ordre religieux qui existeraient parallèlement et exerceraient leurs compétences chacun sur son « royaume » qui serait celui de la terre, pour le premier, et celui des cieux, pour le second. La Chine est le « pays des dieux » ou le « pays sacré », selon une de ses appellations traditionnelles, ce qui signifie que les dieux sont indistinctement d’en bas et d’en haut. Selon un principe tout à la fois taoïste (Zhuangzi) et confucéen (Dong Zhongshu), « le Ciel et l’Humanité ne font qu’un ». Le contraste est frappant entre les rapports du politique et du religieux tels qu’ils se sont établis en Occident au cours de son histoire et ce qu’ils sont en Chine : alors que pour le christianisme la Chute a pour conséquence une séparation de Dieu d’avec sa créature et qu’en conséquence le royaume du « fils de Dieu » n’est « pas de ce monde ». En Chine le royaume du « fils du Ciel » n’est rien d’autre que le monde Tianxia : tout ce qui est sous le Ciel. « De tout ce qui est sous le Ciel, il n’est rien qui ne soit le territoire du roi », dit aussi le Shijing. (…) Autrefois du ressort du souverain et de sa « bureaucratie céleste », ces rites antiques de production, de structuration et de purification du corps sociopolitique ont été modernisés et prennent aujourd’hui des formes diverses (lutte contre la corruption, contre la « pollution spirituelle », mise en place, enfin, d’un « système de crédit social » d’évaluation et de sanction des citoyens…) : ils sont aujourd’hui du ressort du « grand dirigeant » et de sa bureaucratie moderne que sont respectivement Xi Jinping et le Parti. La nature religieuse du projet chinois se manifeste jusque dans le vocabulaire employé pour le décrire. Un chercheur officiel prétend ainsi que l’évaluation du « crédit » des individus (c’est-à-dire de la confiance qu’on peut leur accorder) sera comme la « main invisible » qui disciplinera les citoyens et assurera l’harmonie de la société [19][19]Dai Mucai, « Poursuivre en même temps le gouvernement par la…. Ainsi, à la « main invisible » du marché qui ordonne la société selon les libéraux anglo-saxons, succède la « main invisible » de l’État chinois. Un autre déclare de façon plus explicite encore que le système de crédit social sera le « dieu » de l’ère du big data. Le système participera en outre à la répression des « cultes hérétiques ». À titre d’exemple, dans la ville pilote de Roncheng, où un système de notation est déjà en place, des bonus de points sont accordés à ceux qui dénoncent aux autorités des membres des organisations religieuses non autorisées par le gouvernement, comme à ceux qui financent de façon substantielle les bonnes œuvres du Parti. Quant à ceux qui participent aux activités de ces « cultes hérétiques », ils sont rétrogradés au « niveau d’alerte C » (juste avant le niveau le plus bas, le niveau « D », celui des criminels), le niveau de ceux qui, par exemple, refusent de remplir leurs obligations militaires. Dans un ouvrage qui reflète, semble-t-il, le point de vue du pouvoir chinois, l’ancien interprète de Deng Xiaoping, Zhang Weiwei, présente le « Ciel » chinois (le Tian de Tianxia) de façon très éclairante. Selon Zhang, le « concept chinois traditionnel de Tian ou de Ciel […] signifie les intérêts vitaux ou la conscience de la société chinoise ». Et, affirme Zhang, lorsque cette conscience ou ces intérêts vitaux sont violés, il est légitime de s’affranchir des contraintes de l’État de droit pour punir des coupables, même si ceux-ci n’apparaissent pas comme tels aux yeux de la loi. (…) Le niveau religieux est en effet celui qui permet le mieux d’appréhender ce qui se joue ici. Pékin l’a bien compris : la volonté de restaurer l’Empire emporte avec elle une forme politique qui fait de l’empereur potentiel Xi Jinping et de sa bureaucratie les figures sacrées du pouvoir. Celles-ci ne sauraient souffrir la concurrence d’organisations religieuses pleinement libres. Pour le Parti l’alternative est claire : les religions devront se soumettre, en se sinisant, ou disparaître. Du point de vue de Pékin, ces organisations religieuses ne peuvent en effet subsister que comme supplétifs du Parti, c’est-à-dire en devenant de simples ressources spirituelles que le régime devra pouvoir détourner à son profit. Emmanuel Dubois de Prisque
Les étrangers, lorsqu’ils critiquent le régime chinois, s’en prennent à des idéologies ou à des systèmes sociopolitiques, capitalisme ou communisme, qui trouvent leur origine en Occident, comme si effectivement la culture chinoise était intouchable. Se dégage un étrange consensus pour ne pas rechercher précisément les liens qui seraient susceptibles d’exister entre la gouvernance de plus en plus totalitaire du régime chinois et la civilisation chinoise. Parallèlement, (…) l’Occident (…) devient un bouc émissaire universel (…) attaqué à la fois sur le front intérieur et sur le front extérieur, accusé d’être la cause à peu près unique de tous les malheurs du monde contemporain. (…) les anciens empires musulman et chinois assistent avec une joie mauvaise et mal dissimulée à la lente mise à mort de la bête blessée. (…) Alors même qu’elles sont le fait de civilisations profondément hiérarchisées et inégalitaires, ces dénonciations s’appuient avec habileté, et même perversité, sur les « valeurs » de l’Occident : liberté politique, liberté d’expression, égalité des conditions, et, dernière-née de ces valeurs dont nous verrons la fortune en Chine : « inclusivité ». Si son régime est soumis au feu de féroces critiques, en particulier dans les pays occidentaux, la Chine pour sa part, en tant que civilisation, fait l’objet d’une étrange complaisance, comme si l’esclavage, les guerres de religion, les génocides et le colonialisme étaient étrangers à la culture chinoise. (…) En outre, (…) un mythe, datant des Lumières, et qui est allé jusqu’à infecter les dirigeants chinois actuels, tout comme certains des commentateurs les plus influents de la Chine contemporaine, affirme que la civilisation chinoise est intrinsèquement pacifique et tolérante. Si elle s’arme aujourd’hui à une vitesse impressionnante, ce serait seulement parce qu’elle serait contrainte de se mettre au diapason des idéologies occidentales qui font du rapport de force l’alpha et l’oméga des relations internationales. (…) En évitant de nous pencher sur les sources culturelles du sino-totalitarisme, nous nous privons de comprendre vraiment ce qui se passe en Chine. Le « système de crédit social » d’évaluation de la vertu des personnes morales et privées, la volonté de la Chine de « siniser » les religions, son obsession de la « pureté » idéologique et de la lutte contre la corruption ou contre le « démon » de la pandémie, le mélange déconcertant de bonne conscience et de férocité qui caractérise sa gouvernance, sa conception de la guerre et des conflits commerciaux, la nature de ses relations avec ses pays voisins, la forme prise par sa volonté de domination, tous ces éléments, et d’autres encore, ne peuvent se comprendre que si nous acceptons de regarder sans pudeur ce qu’est la culture traditionnelle de ce pays et la façon dont elle informe la Chine contemporaine. (…) Tous les dirigeants chinois ont affirmé sous une forme ou sous une autre ces dernières années leur conviction que le « gène de l’agression » était étranger à l’ADN chinois. Au contraire des pays occidentaux, naturellement portés à la conquête et à l’expansionnisme territorial, les Chinois n’auraient, « au cours de leur histoire de cinq mille ans », « jamais colonisé personne » et se seraient contentés, dans un esprit d’ouverture pacifique, de rendre de temps en temps visite à leurs voisins sans jamais les envahir, ni même les menacer. (…) la vanité culturelle chinoise, qui campe pour l’éternité la Chine dans le rôle de la victime bafouée par la violence des barbares, est le reflet inversé de la vanité occidentale qui se voit pour l’éternité comme la cause unique de tous les malheurs du monde. La rencontre de ces deux vanités (…) contribue à créer ce monstre surpuissant qu’est la Chine contemporaine, gavé de technologie et de bonne conscience. (…) [et] explique bien des renoncements : il est plus facile de céder sa technologie lorsqu’on a le sentiment de le faire pour la bonne cause du développement des pays du Sud que nos pères auraient hier exploités. (…) C’est aussi la vanité culturelle chinoise, alimentée par la culpabilité occidentale, qui nous a trop longtemps entravés dans une recherche libre de l’origine de la pandémie qui a bouleversé le monde en 2020. Dès les premières semaines de la propagation du virus, des scientifiques courageux se posaient des questions parfaitement légitimes sur la possibilité d’un échappement du nouveau virus d’un laboratoire wuhanais. Cependant, le 19 février 2020, vingt-sept scientifiques de premier plan bénéficiaient de l’autorité de la revue The Lancet pour dénoncer sur un ton moralisateur fort éloigné de la sérénité d’esprit qui devrait caractériser la recherche scientifique « les théories du complot qui suggèrent que le Covid-19 n’a pas une origine naturelle ». Ils échouèrent de peu à tuer dans l’œuf la recherche sur l’origine du virus. Il est apparu que le scientifique à l’origine de cet article, Peter Daszak, était un proche collaborateur des chercheurs de l’Institut de virologie de Wuhan, avec lesquels il a publié une vingtaine d’études. Il faisait également partie du groupe d’experts de l’OMS chargé à l’automne 2020 d’enquêter sur l’origine du SARS-CoV-2. Quand on connaît la mainmise exercée par la Chine sur l’organisation de Genève, il n’est guère surprenant que cette enquête n’ait pu porter ses fruits… (…) les chercheurs sont de plus en plus nombreux a estimé que certaines caractéristiques du virus semblent indiquer qu’il a pu faire l’objet d’une manipulation en laboratoire, sous la forme d’expérience de « gains de fonction ». Nous savons aujourd’hui que ce type de recherche, visant à rendre plus contagieux des coronavirus afin de mieux en étudier la possible transmission à l’homme, était mené dans plusieurs laboratoires de Wuhan. Rappelons aussi que la Chine a connu plusieurs échappements accidentels de laboratoire. La plupart des spécialistes estiment aujourd’hui que l’épidémie mondiale de grippe H1N1 en 1977 fut causée par un échappement d’un laboratoire soviétique ou chinois. (…) Il aura fallu la présidence de l’outsider Donald Trump aux États-Unis pour que l’Occident commence à prendre vraiment conscience de l’ampleur du désastre provoqué par notre cécité volontaire à l’égard de la nature du régime chinois. Quels que soient les nombreux défauts de l’ex-président américain, Trump a hâté la fin d’une politique complaisante à l’égard d’un régime qu’il faut bien qualifier de totalitaire. Le traitement par la Chine des opposants politiques, des minorités ethniques et religieuses, des intellectuels qui veulent continuer à réfléchir, ou de toute autre forme, si fragmentaire soit-elle, de société civile susceptible d’exister à l’écart du pouvoir, montre quelle est la nature de la gouvernance chinoise. Son emprise sur la société se veut totale. Avec le crédit social, la vidéosurveillance, le recueil de l’ADN de la population, sa volonté intacte d’éradiquer la puissance spirituelle des religions qui lui échappent, le pouvoir chinois met en œuvre un ensemble de solutions technologico-politiques à même de lui permettre de réaliser l’idéal traditionnel du souverain : tandis qu’il se rend opaque pour l’extérieur, l’extérieur doit lui être rendu transparent (…) Depuis quelques années, le régime chinois (…) s’est lancé dans une campagne de lutte contre les influences étrangères qui passe par une « sinisation » du christianisme [qui] passe par une réécriture de la Bible dont un manuel officiel d’éducation éthique et de morale professionnelle publié par une université publique nous a donné un avant-goût : la femme adultère sera finalement lapidée par Jésus, car c’est la loi qui le veut, et personne, y compris le Christ, n’est au-dessus de la loi. Autant dire que, pour le Parti, le seul christianisme qui tienne est un christianisme « sinisé », c’est-à-dire, semble-t-il, un christianisme lapidateur, afin que la Chine elle-même soit débarrassée de cet empêcheur de lyncher en rond qu’est le Christ : un christianisme sans le Christ…(…) la modernité occidentale est devenue pour le régime chinois un épouvantail dont l’expulsion hors de la communauté nationale constitue l’acte central de sa gouvernance. En « purifiant » le corps politique chinois de ce qui vient le corrompre de l’extérieur, le Parti renoue, par-dessus la modernité chinoise qu’il prétend incarner, avec la tradition indistinctement politique et religieuse de l’empire. Emmanuel Dubois de Prisque
Attention, un Noël interdit peut en cacher un autre !
Boycott et floutage de décorations de Noël, remplacement de portraits de la Vierge et l’Enfant par ceux de Xi Jinping dans les églises, réécriture de la Bible, destructions de croix et d’églises …
A l’heure où avec sa fausse trêve de Noël et après son prédécesseur Staline et avec le patriarche Kiril …
Le nouveau Führer de Moscou réquisitionne à son tour la religion pour sa guerre sainte contre l’Ukraine et l’Occident qui la soutient …
Et où après les philosophes de Lumières à la Voltaire, nos actuels petits télégraphistes de Moscou et de Pékin appellent à ne pas humilier une Russie et une Chine essentiellement pacifiques et victimes face au bellicisme américain …
Pendant qu’avec la fiction mensongère du Père Noël remplaçant un Saint Nicolas trop chrétien, l’éjection du petit Jésus de nos crèches et les nouveaux tabous lingusitiques, se poursuit la guerre contre Noël en Occident même …
Comment ne pas voir avec le dernier livre du sinologue, tout récemment disparu, Emmanuel Dubois de Prisque …
Derrière le peu de réactions que semblent susciter les restrictions et les menaces qui se précisent contre le christianisme et les traditions occidentales comme Noël …
Dans le pays officiellement athée et prétendument républicain d’un XI Jinping qui, en prolongeant indéfiniment son « Mandat du Ciel » du haut de sa « Cité interdite » 30 ans après le massacre de la « Place de la porte de la Paix céleste », vient de s’offrir un poste de « Fils du Ciel » à vie …
Sur fond d’exorcismes, entre crédit social et prix de vertu ou centres de quarantaine, camps de rééducation et hôpitaux aux noms d’anciennes divinités traditionnelles, contre les démons étrangers et leurs pestilences …
Sans compter, pour nos nouveaux faiseurs de pluie, l’ensemencement des nuages ou les plus dangereuses des expériences de gain de fonction dans des laboratoires construits ou financés par la France ou les Etats-unis …
Ou, entre deux souvenirs de cannibalisme (y compris à but médical ou comme témoignage de piété filiale ou idéologique !), la célébration de génocides …
L’étrange aveuglement occidental devant le retour à une fusion du politique et du religieux …
Qui n’a en fait jamais complètement quitté les deux seules puissances …
A n’avoir toujours pas eu comme par hasard…
Leur Nuremberg depuis la fin de la 2e guerre mondiale …?
‘Les États-Unis tentent d’enrôler l’Europe contre la Chine’
ENTRETIEN. Invité à s’exprimer à l’occasion du G20, l’économiste controversé Jeffrey Sachs défend la Chine et la Russie. Et dénonce l’hégémonie américaine.
Propos recueillis par Jérémy André
Le Point
15/11/2022
Les dirigeants des grandes puissances sont réunis cette semaine à Bali, en Indonésie, pour leur sommet annuel du G20. Invité par Djakarta pour une conférence inaugurale, l’économiste américain Jeffrey Sachs, professeur à l’université Columbia et conseiller du secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, pour les objectifs du développement durable, conteste sévèrement l’hégémonie des États-Unis et se fait l’écho des critiques formulées par les puissances rivales, Chine et Russie en tête. Dans les années 1990, Jeffrey Sachs avait conseillé les pays de l’ex-bloc de l’Est pour rejoindre la mondialisation libérale. Cependant, depuis la fin des années 2010, ses commentaires sur la politique extérieure des États-Unis sont devenus de plus en plus tranchants.
Jeffrey Sachs se fait désormais l’« avocat du diable », refusant de qualifier de génocide la répression contre les Ouïghours en Chine ou de condamner Vladimir Poutine pour son invasion de l’Ukraine. La presse américaine l’étiquette « propagandiste de Xi Jinping » et « apologiste du Kremlin ». Ses dernières prises de position ont encore accentué la polémique. En tant que président de la Commission sur le Covid, créée par la revue The Lancet, il a accusé les scientifiques d’avoir étouffé l’hypothèse d’un accident de laboratoire comme origine de la pandémie. Quant au sabotage du gazoduc Nord Stream, il accuse, sans preuve et au diapason de Moscou, Washington et ses alliés. Entretien
Le Point : Joe Biden et Xi Jinping se sont rencontrés, ici, à Bali, pour la première fois depuis que le président américain a pris ses fonctions, en janvier 2021. Peuvent-ils encore échapper à une nouvelle guerre froide ?
Jeffrey Sachs : La nouvelle guerre froide est créée en très grande majorité par les États-Unis. À partir de 2015 environ, les responsables néoconservateurs de la politique étrangère américaine ont conclu que l’hégémonie américaine était menacée par la montée en puissance de la Chine. Depuis lors, le gouvernement américain a mis en place un ensemble croissant d’outils – barrières commerciales, sanctions, contrôles des exportations, contrôle des investissements et nouvelles alliances militaires en Asie – pour tenter de « contenir » la Chine. Cette approche pourrait conduire à une guerre pure et simple, par exemple à propos de Taïwan.
Les États-Unis tentent d’enrôler l’Europe dans leur effort pour contenir la Chine. Pourtant, l’intérêt profond de l’Europe n’est pas l’hégémonie américaine, mais plutôt un véritable ordre multilatéral dans lequel l’Europe et la Chine jouent toutes deux des rôles actifs et responsables – tout comme les États-Unis, bien sûr. L’Europe devrait donc résister à la nouvelle guerre froide menée par les États-Unis et poursuivre à la place des relations diplomatiques, économiques et financières actives avec la Chine. Trois domaines sont essentiels pour la coopération euro-chinoise : la décarbonation de l’énergie, les infrastructures eurasiennes et le soutien coordonné au développement à long terme de l’Afrique. Les États-Unis, de leur côté, devraient rétablir la relation avec la Chine. Je ne suis pas optimiste cependant. Leur politique étrangère reste entre les mains des néoconservateurs.
D’autres observateurs pensent que le tournant de la politique américaine vis-à-vis de la Chine n’est pas néoconservateur mais transpartisan, et qu’il a été causé par une politique étrangère plus agressive de Xi Jinping. Quel genre de compromis les États-Unis et la Chine pourraient-ils accepter ?La politique antichinoise des États-Unis est en effet transpartisane. Cela reflète deux idées. La première est que la Chine « a volé des emplois américains ». Après la victoire de Trump en 2016, les deux parties en sont venues à croire que le protectionnisme antichinois permettrait de gagner des voix dans les États pivots du Midwest. La seconde est que l’ascension de la Chine menace l’hégémonie américaine et qu’elle doit donc être ralentie ou arrêtée, ce qui reflète la prédominance de l’idéologie néoconservatrice dans les deux partis. Ces opinions sur la Chine sont cependant éloignées de la vérité.
Le commerce avec la Chine a probablement entraîné des pertes – modérées – d’emplois dans le secteur manufacturier, mais aussi des gains d’emplois compensatoires dans d’autres secteurs. Dans l’ensemble, le commerce bilatéral a été bénéfique pour les États-Unis et la Chine, et les effets secondaires négatifs pour les États-Unis (tels que la perte d’emplois dans certains secteurs) devraient être résolus par le biais de politiques intérieures (reconversion professionnelle, protection sociale, etc.) plutôt que par le protectionnisme. Et l’opinion selon laquelle la Chine représente une grave menace pour la sécurité des États-Unis est alarmiste. Oui, la Chine est un pays grand et puissant, mais pas un pays intrinsèquement militariste ou belliqueux. La Chine n’a pas mené une seule guerre au cours des 40 dernières années, tandis que les États-Unis ont mené d’innombrables (et apparemment perpétuels) conflits.
Alors que préconisez-vous ?
Les États-Unis devraient cesser de jouer sur la peur, s’engager dans une diplomatie renforcée, rester attachés à la politique d’une seule Chine, cesser de provoquer un affrontement à propos de Taïwan et mettre fin aux mesures commerciales, technologiques et financières unilatérales qui entravent l’économie chinoise. La Chine devrait elle aussi s’engager avec les États-Unis et l’Union européenne dans une diplomatie renforcée, pour résoudre les problèmes d’intérêt commun. Je crois que la Chine est tout à fait prête à le faire.
Vous avez conseillé à plusieurs reprises aux dirigeants occidentaux de ne pas humilier Vladimir Poutine. Son invasion de l’Ukraine ressemble de plus en plus à un désastre militaire, surtout après la défaite de Kherson. Pourquoi ne pas le laisser face au principe éternel de la guerre : « vae victis », « malheur aux vaincus » ?
Cette guerre aurait pu être évitée si les États-Unis n’avaient pas poussé à l’élargissement de l’Otan à l’Ukraine et à la Géorgie, et n’avaient pas participé au renversement de Viktor Ianoukovitch en 2014. La France et l’Allemagne auraient également dû pousser l’Ukraine à se conformer aux accords de Minsk II. Il y a déjà plusieurs centaines de milliers de morts en Ukraine à cause de cette guerre. Si l’Ukraine tente de reprendre la Crimée, je pense que nous assisterons à une escalade massive, voire à une guerre nucléaire. L’idée que l’Ukraine vaincra la Russie est un pari imprudent sur l’apocalypse. Les États-Unis et les Ukrainiens auraient dû signer la neutralité de l’Ukraine, le contrôle de facto de la Russie sur la Crimée et la mise en œuvre des accords de Minsk II. Au lieu de cela, ils parient imprudemment sur la victoire militaire contre un pays qui a 1 600 armes nucléaires. Récemment, le général Mark A. Milley, chef d’état-major des armées américaines, a déclaré qu’il était temps de négocier, mais la Maison-Blanche a semblé rejeter ses sages conseils.
Pourquoi maintenez-vous une position prorusse ?
Je suis pro-Ukraine et pro-paix. Je reconnais également les objections légitimes de la Russie contre l’élargissement de l’Otan, objections qui remontent à plus de trente ans. Je veux aider à accélérer la fin des souffrances et des destructions massives en Ukraine causées par la guerre par procuration entre les États-Unis et la Russie. Plus important encore, les États-Unis devraient cesser d’insister sur l’élargissement de l’Otan. Les dirigeants européens ont depuis longtemps reconnu les dangers des actions américaines sur l’Otan, mais malheureusement ils ne combattent pas les positions américaines.
Que peut accomplir cette réunion du G20, en l’absence de Vladimir Poutine ?
Le G20 devrait s’accorder sur la mise en place d’une nouvelle architecture financière mondiale pour aider les pays en développement à financer le développement durable, y compris l’adaptation au climat et la transformation énergétique. Le programme économique peut et doit aller de l’avant.
Xi Jinping peut-il aider à résoudre la crise ukrainienne ?
Oui, bien sûr. La Chine aiderait à garantir la sécurité de l’Ukraine en tant que pays neutre. La Chine n’a aucun intérêt à soutenir l’élargissement de l’Otan, d’autant plus que les États-Unis construisent des alliances militaires en Asie contre la Chine, et engagent même dangereusement l’Otan dans la politique antichinoise des États-Unis.
Selon votre dernier rapport sur les objectifs du développement durable, les efforts pour les atteindre à l’horizon 2030 sont sous-financés et sont ralentis par les crises qui s’accumulent. Ressentez-vous suffisamment d’urgence dans ce G20 pour rétablir le cap ?
Non, hélas, il n’y a aucun sentiment d’urgence. Le système politique américain, notamment les membres du Congrès, ne se soucie pas vraiment du développement économique mondial. L’élite politique se concentre plutôt sur l’hégémonie américaine. Tout au plus, l’intérêt des États-Unis pour l’Afrique s’est un peu ragaillardi pour concurrencer la Chine.
Trois ans après son déclenchement, l’origine de la pandémie est encore inconnue. Près de deux mois après le sabotage de Nord Stream, l’enquête n’a pas nommé ceux qui l’ont commis. Comment la communauté internationale peut-elle rester si divisée face à des événements majeurs ?
Dans les deux cas, le gouvernement américain maintient et manipule un récit invraisemblable, et le fait avec une acceptation remarquable en Europe. Sur le Covid-19, il est clair que les États-Unis ont financé des recherches très dangereuses en Chine basées sur la manipulation génétique avancée de virus de la famille du Sars. Et il est également clair que le gouvernement américain a refusé d’enquêter sur ses propres programmes de recherche qui auraient pu contribuer à la création du Sars-CoV-2. Au lieu de cela, le gouvernement américain a encouragé l’histoire scientifiquement faible d’une épidémie « naturelle » sur le marché de Huanan, à Wuhan.
Sur Nord Stream, Joe Biden a promis le 7 février que si la Russie envahissait l’Ukraine, Nord Stream serait terminé. Lorsqu’on lui a demandé comment les États-Unis feraient cela, il a répondu : « Je vous promets que nous serons en mesure de le faire. » Même la Suède cache les résultats de son enquête sur Nord Stream à l’Allemagne et au Danemark, au nom de la sécurité nationale ! Je crois que les dirigeants européens savent que les États-Unis et d’autres alliés ont fait cela, mais ils ne commenteront ou n’expliqueront tout simplement pas la vérité au public. Nous ne savons pas avec certitude que le Sars-CoV-2 est venu d’un laboratoire et que les États-Unis ont fait sauter le pipeline, mais nous savons que le public n’a pas encore été informé des faits réels concernant ces deux cas.
La Chine et la Russie ont un problème de transparence et de désinformation. Comment faire en sorte que les grandes puissances mettent fin à ce cycle de postvérité et de tromperie ?
Nous avons besoin d’une diplomatie structurée, systématique et renforcée entre les États-Unis, l’UE, la Russie et la Chine. La diplomatie s’est presque effondrée, emportée par une vague d’accusations, de désignation de coupables et, bien sûr, à cause de la guerre en Ukraine. Des diplomates de haut rang en Europe affirment que la diplomatie avec Poutine est impossible. Ce n’est pas vrai. La Russie a fait plusieurs tentatives diplomatiques valables ces dernières années (par exemple, pour arrêter l’élargissement de l’Otan à l’Ukraine et à la Géorgie, pour mettre en œuvre l’accord de Minsk II, etc.), mais celles-ci ont été repoussées par les États-Unis et l’Europe. De même, les États-Unis ont réduit leur diplomatie avec la Chine lorsque Joe Biden est arrivé au pouvoir. Cela aussi était une erreur.
Voir aussi:
« La politique chinoise est intimement liée à la religion »
ENTRETIEN. Pour Emmanuel Dubois de Prisque, le Parti communiste fonde, comme les anciens empereurs, sa légitimité sur le Ciel et la religion du sacrifice.
Propos recueillis par Laurence Moreau
Le Point
13/11/2022
Si moderne que cela, la Chine de Xi Jinping ? Celle qui est dirigée par un parti oligarchique dont la gouvernance ressemble fort à celle des anciens empereurs, celle qui privilégie le collectif sur l’individu, celle qui se présente volontiers comme la victime des Occidentaux mais aussi de tous ceux qui contestent son emprise, qu’il s’agisse des Tibétains, des Ouïgours ou des Taïwanais, quitte à utiliser les « faits alternatifs » pour mieux appréhender sa propre lecture de l’Histoire, cette Chine-là ne fonctionne-t-elle pas inlassablement et depuis des millénaires selon le modèle archaïque du sacrifice du bouc émissaire ? C’est la thèse du sinologue Emmanuel Dubois de Prisque, chercheur à l’Institut Thomas More et grand lecteur de l’anthropologue René Girard, l’auteur du livre culte La Violence et le Sacré (1972). Pour lui, l’opposition irréductible entre la Chine et l’Occident est le rapport à la religion, notamment le conflit sous-jacent avec le christianisme qui concurrence le culte traditionnel depuis cinq siècles.
Le Point : Dans La Chine et ses démons (Odile Jacob), votre nouveau livre, vous affirmez que la source du totalitarisme chinois repose sur le fondement sacrificiel du pouvoir. Pourquoi ?
Emmanuel Dubois de Prisque : Il est impossible de comprendre la forme de la gouvernance chinoise actuelle sans s’intéresser à la Chine archaïque et à la Chine impériale. Et, quand on se livre à cet exercice, on constate combien la théorie du philosophe René Girard sur le bouc émissaire est pertinente. L’homme fonctionne toujours sur le mode mimétique : il désire ce que veut son voisin, d’où les conflits. Lorsque ceux qui déchirent une communauté finissent par converger vers un seul de ses membres, rendu responsable de tout le mal, sa mise à mort ramène l’ordre et l’harmonie. C’est un phénomène anthropologique universel que les Évangiles ont subverti en racontant ce lynchage non pas du point de vue de la foule persécutrice, mais du point de vue de la victime innocente. Cependant, ce phénomène reste particulièrement présent dans la Chine actuelle, où il structure la religion comme la politique.De quelle manière ?
Les mythes de la Chine la plus archaïque sont nombreux à mettre en scène un meurtre fondateur. Ainsi, Tang le Victorieux, fondateur de la dynastie Shang, est à la fois considéré comme celui qui mit à mort Jie, le dernier souverain des Xia – la première dynastie chinoise – il y a trois millénaires, et, après son arrivée au pouvoir, comme une victime émissaire, accusée d’exactement les mêmes maux que Jie en son temps. Lors d’une sécheresse, les conflits se multiplièrent et Tang s’offrit en sacrifice pour faire tomber la pluie. Tang et Yu le Grand, le fondateur des Xia, furent tous deux des infirmes portant les marques d’élection propres aux victimes émissaires. Tang était « desséché », comme les sorciers au cœur des rites de faiseurs de pluie, et Yu le Grand boitait. Le « pas de Yu » reste aujourd’hui un des principaux rituels taoïstes.
Le confucianisme n’insiste-t-il pas sur la notion de Voie royale, un modèle d’État où le roi vertueux tire sa légitimité du « décret (ou mandat) du Ciel » pour faire régner l’ordre et l’harmonie ? Rien à voir avec les sacrifices sanglants…
Bien au contraire, c’est par les sacrifices que l’empereur pouvait faire régner l’ordre et l’harmonie ! Avant d’être un politique, l’empereur était « fils du Ciel ». Le sacrifice au Ciel, qui était son apanage jusqu’en 1912 et la fondation de la République, était un rituel sanglant auquel aucun étranger ne pouvait assister. Si les sacrifices étaient correctement effectués, cela signifiait que le monde était en ordre. Si l’empereur s’agitait pour tenter de résoudre les problèmes auxquels le pays était confronté, il risquait au contraire de semer le désordre dans la communauté. Le « décret du Ciel », une notion dont la première occurrence apparaît en 998 avant notre ère, sous la dynastie des Zhou, permettait de justifier le pouvoir en place. L’empereur devait sans cesse faire face aux risques de subversion et inspirer une peur plus grande que celle qu’il éprouvait lui-même à l’égard de la violence collective. Le regard menaçant des « dix mille êtres » (la foule) pesait constamment sur l’« être unique » qu’était l’empereur, « plus à plaindre qu’un lépreux », comme le disait le légiste Han Feizi. Pour Mencius [Mengzi], le tyran déchu doit faire face à la volonté commune du Ciel, du peuple et de celui qui l’a chassé, lequel devient le nouveau détenteur du décret du Ciel mais peut être demain une nouvelle victime sacrifiée. N’est-il pas intéressant de voir comment, lors du XXe Congrès, Hu Jintao, le prédécesseur de Xi Jinping, a été, en public, exclu de l’assemblée ? Son successeur n’a pas bougé un cil. Depuis l’avènement du Parti communiste, le « décret du Ciel » s’appelle « mission historique » et fonde la légitimité du Parti. Si la dénomination change, c’est toujours du Ciel que vient la légitimité. Tant qu’ils ont le pouvoir, les dirigeants sont légitimes.
Le culte du chef communiste a-t-il quelque chose à voir avec celui des empereurs ?
Oui, car la théologie joue toujours son rôle dans la Chine d’aujourd’hui. Le sinologue Joël Thoraval a démontré que souvent, dans les campagnes, les souverains occupent la place centrale sur les autels domestiques et lors des rites, aux côtés du Ciel, de la Terre, des ancêtres et des maîtres. La politique chinoise est intimement liée à la religion. Dans les années 1980 et 1990, après la fin du culte de la personnalité, décrétée par Deng Xiaoping, des empereurs autoproclamés, suivis parfois de milliers de fidèles, sont apparus partout en Chine. Le retour d’une figure impériale avec Xi Jinping marque au fond un retour à la normale.
Selon vous, ce ne sont pas les « cinq poisons » – que sont les résistants ouïgours et tibétains, les indépendantistes taïwanais, les militants pour la démocratie ou les membres de la secte Falun Gong – qui gênent vraiment le Parti communiste chinois, mais le christianisme. Pourquoi ?
Cette religion, présente en Chine depuis le XVIIe siècle, rend plus difficile la fermeture sacrificielle sur le bouc émissaire. Le christianisme est synonyme de liberté. C’est grâce à lui que les femmes ont pu avoir accès à l’éducation et commencer à se libérer de la coutume des pieds bandés, progrès d’ailleurs revendiqué par le Parti communiste. Aujourd’hui, malgré les persécutions parfois sanglantes contre les chrétiens jusqu’aux années 1970 et les mesures prises aujourd’hui pour interdire l’accès au culte, les conversions vont croissant. Nous manquons de statistiques fiables, mais les chrétiens seraient environ 100 millions, en majorité des protestants. C’est dans ce vivier que se recrutent nombre de militants des droits de l’homme. Ce n’est donc pas un hasard si le pouvoir veut « siniser » le christianisme. En 2019, il a annoncé un projet de réécriture de la Bible, qui devrait être terminé d’ici dix ans. Il a renoncé toutefois à inclure dans un manuel d’éducation civique sa version de l’épisode de la femme adultère (Évangile de Jean), dans laquelle le Christ participe lui aussi à la lapidation !
La règle du bouc émissaire a-t-elle une influence sur l’historiographie chinoise ?
Bien sûr. Celle-ci n’est pas fondée sur la vérité, mais sur l’autojustification du pouvoir, lequel est toujours pacificateur alors que les victimes sont des « fauteurs de troubles » responsables de ce qui leur arrive. Le massacre des Dzoungars, commis par les Qing au milieu du XVIIIe siècle, est ainsi présenté dans les annales comme une expédition punitive contre des brigands rebelles au fils du Ciel. Les Dzoungars ont été exterminés ; leur principauté est devenue pour partie la province du Xinjiang, peuplée par les Ouïgours, alors alliés des Chinois, et aujourd’hui par de plus en plus de Hans. Mais ce génocide est commémoré en toute bonne conscience par le pouvoir chinois en tant que moment privilégié de l’unité entre les Hans et les Tibétains, qui les avaient alors aidés. A contrario, la Chine ne peut être que victime des Occidentaux et des Japonais, qui l’auraient humiliée, sans que le pouvoir accepte de prendre en compte le fait que c’est grâce aux « barbares » étrangers qu’elle s’est pour une part ouverte à la modernité. Elle-même d’ailleurs n’aurait jamais fait de guerres de conquête, elle se serait contentée d’unifier le territoire du Ciel…
Voir également:
Tiananmen: 30 ans après, la Chine assume tout
La violence fondatrice de Tiananmen
Emmanuel Dubois de Prisque
Causeur
12 juin 2019

La violence de Tiananmen se comprend difficilement avec des yeux d’Occidentaux
Il y a un mystère Tiananmen. Alors qu’à l’extérieur de la Chine, ce massacre est toujours considéré comme une tache indélébile sur l’uniforme de l’Armée populaire de libération, le pouvoir chinois semble pour sa part de mieux en mieux l’assumer.
Cette répression par l’armée chinoise de manifestations étudiantes pacifiques, qui s’est soldée selon les sources par un bilan allant de quelques centaines à quelques milliers de morts, a longtemps été occultée par le pouvoir. Mais aujourd’hui, trente ans après les faits, le ton change à Pékin. Loin de disparaître de la conscience du Parti comme une mauvaise action qu’il s’agirait de refouler à jamais, cet acte de violence, ce coup d’État au sens premier du terme, est dorénavant revendiqué par le pouvoir comme un acte « correct » qui a mis la Chine « sur le chemin de la stabilité et du développement » (selon le ministre chinois de la Défense), ou encore comme un « incident » qui tel un vaccin « immunise la société chinoise contre les désordres politiques les plus importants » (selon le journal officiel Global Times). Un acte bénéfique en somme, que le Parti défend aujourd’hui ouvertement, tandis qu’il se persuade que l’Occident en crise n’a plus aucune leçon à lui donner.
“Il faut du sang”
L’analogie entre vaccination et répression pourra sembler saugrenue, voire blasphématoire aux yeux d’Européens habitués à considérer toute violence, même d’État, sinon comme illégitime, au moins comme une forme d’aveu d’échec. Pourtant, ce n’est pas un auteur chinois, mais un auteur occidental qui nous permet peut-être de comprendre le mieux ce que le Global Times entend par cette analogie. Dans La Violence et le Sacré, René Girard décrit le processus de vaccination sur le modèle du sacrifice. « Que dire des procédés modernes d’immunisation et de vaccination ? (…) L’intervention médicale consiste à inoculer « un peu » de la maladie, exactement comme dans les rites qui injectent « un peu » de la violence dans le corps social pour le rendre capable de résister à la violence ». Quelques jours avant le déclenchement de la répression, fin mai 1989, alors que la direction du Parti semble plus divisée que jamais, le président de la République Yang Shangkun aura cette injonction glaçante : « il faut du sang ».
Ce qui est moderne en Chine, ce sont donc, tout autant que les pratiques de la médecine contemporaine, les procédés archaïques du sacrifice et de la violence, qui visent par la violence à mettre à distance la violence. Mais que la violence puisse porter des fruits, qu’elle puisse devenir fondatrice d’un ordre politique pérenne, cela n’est possible, à suivre René Girard, qu’à la condition qu’elle fasse l’objet d’une méconnaissance, c’est-à-dire que la responsabilité de la violence qui traverse la communauté soit attribuée non à ses auteurs véritables, mais à un bouc émissaire qui par là même mérite, aux yeux de la communauté, le sort qui lui est fait par le pouvoir. C’est ainsi que des dissidents chinois réfugiés à l’étranger peuvent aujourd’hui se voir reprocher par des étudiants éduqués en Chine d’avoir « cruellement tué des soldats de l’armée populaire » (Le Monde des 2 et 3 juin 2019).
Victimes sacrificielles
C’est seulement en mettant en lumière la logique sacrificielle qui sous-tend son discours que nous pouvons comprendre comment le pouvoir chinois peut simultanément mettre en avant son souci de l’harmonie et mettre en œuvre une répression féroce. En effet, dans cette logique, l’un ne va pas sans l’autre, car c’est en exerçant une répression féroce contre ceux qui sont accusés de répandre la discorde que l’harmonie est préservée. Ainsi, depuis des décennies, le pouvoir chinois organise de rituelles « luttes contre la corruption » ou contre la « pollution spirituelle » qui visent à fournir au système les victimes sacrificielles dont il a besoin.
René Girard pensait que partout dans le monde, les mécanismes sacrificiels de la politique avaient été rendus inefficaces par leur dévoilement progressif au cours de la période moderne. La Chine est peut-être en train de nous prouver qu’il avait tort.
La Violence et le Sacré, René Girard (Fayard/Pluriel)
Voir de même:
Le dieu chinois de la peste, par l’écrivain Ma Jian
Le courageux auteur de « China Dream », exilé à Londres, est l’un des meilleurs analystes de la propagande de Pékin et de ses mythes. Il dit, pour « l’Obs », ce que lui inspire la politique sanitaire mise en œuvre par Xi Jinping.
Le Nouvel Obs
Au début du printemps 2020, lorsque l’épidémie de Covid-19 a submergé Wuhan, une avocate de Shanghai, Zhang Zhan, arpentait la ville pestiférée. Elle savait que le plus effrayant n’était pas que le virus se propage, mais que la vérité soit étouffée. Elle voulait fournir aux personnes vivant hors de cette zone des informations non contaminées par le virus du mensonge. Résultat : elle a été arrêtée, ramenée à Shanghai et condamnée à quatre années de détention. Prisonnière du gouvernement chinois.
Au début du printemps 2022, après deux ans pendant lesquels il a fait le tour du monde, le Covid est arrivé à Shanghai, et les gens se sont de nouveau retrouvés enfermés chez eux. Prisonniers du gouvernement chinois. La même chose se reproduira prochainement à Pékin, à Tianjin, dans d’autres villes encore. Si vous vivez en Chine, peu importe la taille de votre domicile, ce n’est qu’une sorte de cellule, un substitut de prison. Les méthodes carcérales de ce pouvoir totalitaire sont bien pires que l’épidémie. La Chine tout entière n’est qu’une grande prison d’où sont exclues toute information et toute pensée. Chaque coin de rue, chaque station de métro pullule de caméras et de policiers, et il n’existe aucun endroit où l’on puisse se rencontrer et communiquer librement. Les gens traitent donc leurs amis et voisins comme des virus dont ils doivent se garder.
Zhang Zhan a été la première personne à être publiquement condamnée par le Parti communiste chinois pour avoir dévoilé l’épidémie de Wuhan. J’ai vu Zhang Zhan à la télévision, en fauteuil roulant, affaiblie par une grève de la faim de près de sept mois. J’ai vu aussi les images de ces Shanghaïens tellement affamés qu’ils se disputaient une botte d’ail dans un magasin. Et de ces habitants strictement confinés dans leur appartement au quatrième étage, qui descendaient par la fenêtre leur chien attaché à une corde pour qu’il puisse gambader un peu, avant de le remonter par la même voie. J’ai même vu un type qui rampait à quatre pattes dans la rue, cherchant à se faire passer pour un chien… L’absurde et l’humour noir ont toujours été omniprésents en Chine, mais j’ai le sentiment désormais que les Chinois se sont habitués à vivre sans liberté ni dignité.
Je repense aux cinq dieux des épidémies qui sont vénérés en Chine depuis des millénaires. Cinq démons à l’origine, qui régissaient les saisons et leurs terrifiants maux respectifs. Selon la légende, les anciens ont dompté ces esprits pernicieux, les ont transformés en divinités, les « cinq commissaires des miasmes », et les ont placés dans des temples où l’on pouvait, en leur faisant des offrandes, obtenir leur protection contre les maladies. Le démon qui contrôlait les maux du printemps s’appelait Zhang Yuanbo. Le Covid s’étant déclaré au printemps, à Wuhan comme à Shanghai, le dieu des miasmes du printemps s’appelle aujourd’hui Xi Jinping : Xi est devenu un démon maléfique qui, tout comme Zhang Yuanbo, devrait être dompté.
En cas d’épidémie, il est courant que les gens s’enferment quelques jours afin d’empêcher la propagation du virus, et que les gouvernements organisent ce confinement. Mais après deux années de mutations constantes, le Covid sous sa forme actuelle Omicron est devenu semblable à la grippe. Confiner strictement les villes, les quartiers et les familles revient à utiliser un canon pour écraser un moustique. Pourtant, si le commandant en chef Xi Jinping veut appliquer le « zéro Covid », la Chine tout entière doit être bouclée. Tout comme en 1958, lors du Grand Bond en avant, quand Mao Zedong a ordonné aux Chinois d’exterminer les moineaux accusés de picorer les semences. La stratégie « zéro moineaux » a été couronnée de succès, mais à quel prix : les insectes se sont multipliés, entraînant une catastrophe écologique. C’est le modèle institutionnel du Parti communiste chinois, Xi Jinping a juste remplacé les moineaux par le Covid.
« Pistolet à mensonges »
Le bouclage intégral de Shanghai signe en réalité une défaite pour Xi Jinping. Il y a deux ans, il avait ordonné la fermeture totale du pays tout en maintenant les vols internationaux, et ainsi permis au virus de se propager dans le monde. Cette fois, il voulait empêcher le retour en Chine du virus qui avait pourtant perdu en virulence. Quoi que fasse le dieu de la peste Xi, il montre que les virus dictatoriaux sont plus dangereux que les virus de chauve-souris. Les potentats sont bien incapables de contrôler la diffusion des maladies contagieuses, mais contrôlent parfaitement la transmission de la vérité. Il suffit que leurs propres virus se dissolvent dans un mensonge pour se glisser dans les esprits des personnes qui ne connaissent pas la vérité. Tout comme une balle ne tue que lorsqu’elle a été insérée dans le barillet d’un revolver. Xi Jinping est un dieu de la peste qui brandit un « pistolet à mensonges ». S’il n’avait pas tout fait pour dissimuler la vérité au moment où le coronavirus a surgi à Wuhan, sa propagation aurait pu être contenue, comme cela a été le cas pour le virus Ebola.
A l’ère de la mondialisation, le camouflage de la vérité sur l’épidémie a eu comme conséquence que le monde entier est devenu un grand Wuhan. Absolument aucune ville n’y a échappé. A Londres, où je suis exilé, quatre membres de ma famille ont été contaminés. 160 millions de personnes dans le monde ont été infectées, des millions sont mortes. Malgré ce coût écrasant en vies humaines, nous ne connaissons toujours pas le vrai visage du fléau dissimulé sous des mensonges politiques. Cette vérité est entre les mains du commandant en chef de la peste, Xi Jinping. Mais la Chine sous le joug communiste est un pays sans vérité. Du massacre d’étudiants sur la place Tiananmen en 1989 à l’emprisonnement de millions de personnes dans les camps de concentration du Xinjiang, la vérité est toujours cachée. Les responsables des démocraties européennes devraient savoir que laisser ces mensonges se diffuser revient à tuer la vérité une deuxième fois. Et qu’oublier les victimes de ces mensonges nous rend incapables de nous en protéger.
Nous vivons en un temps qui a perdu le sens du bien et du mal, réduits à assister en spectateurs aux assauts de cette calamiteuse machine à fabriquer des « mensonges rouges » contre nos vies et nos libertés. Nous sommes en 2022, mais nous nous sommes rapprochés du « 1984 » d’Orwell. Ce n’est pas seulement en Chine, à Hongkong ou au Xinjiang que l’on voit, sous l’effet du totalitarisme, le désir de changement social peu à peu remplacé par l’attrait pour le fric et le besoin de sécurité. L’espèce humaine tout entière est en train de s’engourdir et ne sait plus distinguer le vrai du faux. A cause de ce flou, dans de nombreux pays, il n’est même pas possible de vacciner la population. Et il y a tant de personnes qui développent des anticorps contre les droits humains et la démocratie, et s’habituent à vivre en symbiose avec le virus totalitaire.
Protecteur de Poutine et de Kim troisième du nom
Car oui, trente-trois ans après le massacre de la place Tiananmen, les gens évitent de parler du carnage qui a eu lieu sur cette place, et c’est là une victoire du mensonge. L’Union européenne a même ouvert un boulevard au régime de Xi Jinping en lui permettant de faire miroiter le « rêve chinois » aux yeux de la planète. Pendant ce temps, le Covid né à Wuhan se propageait, entraînant une hécatombe des millions de fois supérieure au massacre de Tiananmen.
Oui, il y a trente-trois ans, les démocraties ont vu tomber le mur de Berlin et tout le monde a cru que le communisme s’était éteint avec le XXe siècle. Mais le plus grand Parti communiste du monde, le PC chinois, n’est pas tombé ; il a envoyé 200 000 soldats réprimer le mouvement pro-démocratie sur la place Tiananmen, après quoi il a nettoyé les taches de sang, rebouché les trous laissés par les balles sur les monuments de la place, et imprégné de mensonges le cerveau de 1,3 milliard de personnes. Et le PC chinois est devenu, sous le manteau, le protecteur de Poutine et de Kim troisième du nom. Avec ses « gènes » communistes et sa pensée restée bloquée à l’époque de l’empire soviétique, Poutine est naturellement devenu un pion dans le jeu du prince rouge Xi Jinping. Ces deux dictateurs unissent désormais leurs forces en vue de dominer le monde. L’invasion de l’Ukraine montre quelle est l’ambition de Poutine. Et comment Xi Jinping manœuvre. Aujourd’hui comme il y a trente-trois ans, les pays démocratiques doivent se battre contre ces deux super-hégémons rouges.
Oui, après trente-trois ans de mensonges, on finit par penser que la vérité est elle aussi indigne de confiance. Après Tiananmen, la Chine communiste s’est lancée dans le développement capitalistique, devenant vite le nouveau Big Brother. Aujourd’hui, elle ne cache plus son désir d’écraser les démocraties afin de réaliser le « rêve chinois » – la domination de l’Empire rouge sur le monde. Le virus du rêve chinois, tout comme le coronavirus de Wuhan, a besoin de se transmettre pour survivre et se perpétuer. Pour ce faire, la Chine est devenue une boîte de Pandore qui produit sans trêve des mutations et contamine tous les pays. Face à elle, nous ne sommes plus que des prisonniers enfermés dans un labyrinthe de mensonges, contraints à aspirer ses miasmes.
Oui, si le Parti communiste chinois s’était désintégré en même temps que les régimes communistes de l’Est, et si les responsables politiques occidentaux ne s’étaient pas empressés d’oublier le massacre qui a eu lieu à Pékin en 1989, la pandémie qui se promène aujourd’hui dans l’air que nous respirons n’existerait pas. Mais le Parti communiste chinois a profité du Covid pour démolir à nouveau la statue de la Liberté qui avait été érigée sur Tiananmen : il a abattu le phare de liberté qu’était Hongkong. Et on a revu les mêmes scènes qu’il y a trente-trois ans : des étudiants et des enseignants en grève de la faim pour défendre la démocratie et la liberté ; des étudiantes ligotées, écrasées sous les bottes de la police militaire ; des mamies aux cheveux blancs tentant de raisonner les policiers ; des danseuses et des chanteuses se battant jusqu’à la mort… Le dieu des miasmes Xi a décrété que la vérité était « fake ». Et nous des « mensonges » qu’il veut effacer.
Epidémie sanglante
Aujourd’hui, les Ukrainiens meurent sous les bombes de Poutine, les habitants du Xinjiang sont emprisonnés et « rééduqués » par Xi Jinping, les Taïwanais risquent à tout moment l’invasion. Ces deux dictateurs sont en train de propager une épidémie sanglante, ouvrant une époque où le glas sonne tous les jours. Souvenons-nous du poète anglais John Donne qui a écrit au tournant des XVIe et XVIIe siècles :
« Nul homme n’est une île,
entière en elle-même ;
tout homme est un morceau du continent,
une partie de l’ensemble. […]
La mort de tout homme me diminue,
parce que je fais partie du genre humain,
aussi n’envoie jamais demander pour qui sonne le glas ;
il sonne pour toi. »
Quand pourrons-nous sonner le glas des dictateurs qui répandent la peste ? Notre inquiétude au XXIe siècle, c’était que la technologie, l’internet et les divertissements bouleversent trop la société, que nos enfants regardent trop la télévision et jouent trop aux jeux vidéo. Nous étions loin de nous douter que la peste rouge venue de Chine allait surgir dans nos vies, prendre la vie de nos amis et de nos proches, puis s’atteler à « purifier » nos esprits, effacer notre conscience, nos valeurs, transformer nos façons de communiquer, de nous déplacer, nos services publics et notre vie culturelle, comme elle l’a fait à Wuhan ou à Shanghai. La civilisation politique de l’Europe est d’ores et déjà endommagée.
Allons-nous continuer à regarder sans réagir les moines tibétains s’immoler l’un après l’autre, les habitants du Xinjiang, des personnes âgées aux enfants, être jetés dans des camps de concentration, leurs familles être détruites, et mes amis écrivains de Hongkong être arrêtés et disparaître les uns après les autres ? Je prie pour que, quand la grande souffrance du Covid prendra fin, les pays démocratiques auront réussi à construire une cage indestructible et y auront enfermé les dieux des miasmes. Que le rêve chinois du démon de la peste Xi reste à jamais un rêve. Ou qu’il soit enfermé, en compagnie de milliers d’autres virus, dans le laboratoire de Wuhan construit avec l’aide des Français. Allons-nous laisser la civilisation humaine régresser et tomber dans le piège du rêve chinois ?
Né en 1953 à Qingdao, Ma Jian est poète, peintre et romancier. Il est notamment l’auteur de « Nouilles chinoises », « Beijing Coma », « la Route sombre » et « China Dream », tous traduits aux éditions Flammarion. Il a fui la Chine en 1997, et vit à Londres depuis 1999.
Voir de plus:
La publication d’un récit biblique déformé suscite la consternation des catholiques chinois
Missions étrangères
23/09/2020

Une partie de la page de couverture d’un manuel scolaire controversé, qui a suscité la consternation parmi la communauté catholique chinoise.
La publication d’un manuel scolaire contenant une histoire biblique déformée et détournée a suscité la colère parmi les fidèles de la communauté catholique en Chine continentale. Le manuel en question a été publié pour enseigner « l’éthique professionnelle et le respect de la loi ». Le manuel scolaire, publié par le service d’édition de l’Université des sciences et technologies électroniques de Chine, qui dépend du gouvernement, contient un texte évoquant le récit de Jésus et de la femme adultère pardonnée. Dans la publication, le récit évangélique (Jean 8, 1-11) est déformé et affirme que Jésus Christ a lapidé une femme pécheresse afin de respecter la loi de son temps. Le texte reprend le passage décrivant la foule voulant lapider une femme selon la loi, et Jésus leur répondant « Celui d’entre vous qui est sans péché, qu’il soit le premier à lui jeter une pierre ». Pourtant, la fin du récit diffère radicalement, le texte ajoutant qu’une fois la foule dispersée, Jésus se serait mis à lapider la femme à mort en ajoutant « Moi aussi je suis pécheur, mais si la loi ne devait être exécutée que par des hommes sans faute, la loi serait vaine ». Un paroissien a publié le passage en question sur les réseaux sociaux, en dénonçant la falsification d’un texte biblique à des fins politiques comme une insulte à l’Église catholique. « Je voudrais que tout le monde sache que le Parti communiste chinois a déjà essayé de déformer l’histoire de l’Église par le passé, de diffamer notre Église et d’attirer la haine du peuple sur notre Église », a-t-il souligné.
Mathew Wang, un enseignant chrétien dans une école professionnelle, confirme le contenu du texte controversé, tout en ajoutant que la publication exacte varie selon les lieux en Chine. Mathew Wang précise que le texte publié par le manuel scolaire a été relu par le Comité de contrôle des manuels scolaires pour l’éducation morale, dans le cadre de l’enseignement professionnel dans le secondaire. Il déplore que les auteurs aient utilisé un tel exemple erroné pour justifier les lois socialistes chinoises. Selon certains catholiques chinois, les auteurs du manuel auraient voulu souligner que la loi est sacrée en Chine, et que son respect absolu est essentiel. Un prêtre catholique, qui souhaite rester anonyme, affirme quant à lui que le texte publié « est lui-même immoral et illégal ». « Du coup, comment pouvons-nous encore enseigner l’éthique professionnelle avec un tel manuel ? », demande-t-il. « C’est un phénomène social bien triste que nous observons en Chine continentale », déplore-t-il. Paul, un catholique chinois, ajoute que des déformations similaires de récits chrétiens et de l’histoire de l’Église continuent d’être observées, mais il estime que les protestations des chrétiens n’auront aucun impact. « La même tendance se répète chaque année, mais l’Église ne riposte jamais, ou en tout cas elle ne reçoit jamais le respect et les excuses qu’elle mérite. » Kama, un catholique qui gère les contenus d’un groupe catholique sur les réseaux sociaux, souligne que le contenu publié par le manuel est une offense aux croyances religieuses des chrétiens. Il appelle les auteurs et les éditeurs concernés à présenter leurs excuses publiquement et corriger le texte. « Nous espérons que les autorités chrétiennes prendront la parole », ajoute-t-il.
(Avec Ucanews, Hong-Kong)
Le débat sur l’interdiction de Noël en Chine rate l’image d’ensemble
French.china.org.cn
26. 12. 2017
Lundi, c’était Noël. En Chine, de nombreux magasins lancent des promotions sur ce thème, remplissant les rues commerciales à travers le pays d’une atmosphère de Noël. Cette pratique est devenue courante dans les zones commerciales de Chine à chaque fin d’année.
Cependant, certains articles ont rapporté que des villes et des universités avaient « interdit Noël », ce qui a attiré l’attention de certains médias étrangers. Ceux-ci ont exagéré cette information, expliquant que la Chine interdisait Noël pour des considérations politiques et pour résister à l’invasion culturelle occidentale.
Les membres du Parti communiste de Chine dans les villes majeures comme Beijing et Shanghai n’ont été informés d’aucune notification interdisant Noël. Cette interdiction dans certains lieux et certaines institutions avait pour but de préserver la sécurité publique et en aucun cas de « boycotter » Noël.
Noël n’a cessé de se populariser en tant que fête commerciale. Au cours des dernières années, même les fêtes traditionnelles chinoises sont devenues plus populaires que jamais. La popularité de ces fêtes peut être attribuée aux améliorations dans la vie de la population. En effet, celle-ci a de plus grandes exigences en matière de loisirs et espère que ces fêtes pourront apporter une distraction dans leur vie bien remplie.
L’une des raisons pour la popularité des fêtes étrangères est que les jeunes Chinois les conçoivent comme un moment pour se détendre et s’amuser. Ils connaissent peu leurs origines ou leurs significations et ne ressentent pas d’obligation à suivre leurs rites.
Une autre de ces raisons est que le potentiel commercial de nombreuses fêtes traditionnelles chinoises n’a pas encore été pleinement exploré. La population montre également un intérêt de plus en plus grand dans les fêtes chinoises traditionnellement moins importantes, comme la fête de Qixi (l’équivalent chinois de la Saint-Valentin) ou encore la fête de Dongzhi (fête du solstice d’hiver), qui est célébrée avec un repas constitué de raviolis chinois, les jiaozi.
Dans cette ère de communications mondialisées et de partage interculturel, il est inévitable que les fêtes étrangères deviennent de plus en plus populaires. L’influence de la fête chinoise du Printemps devrait également se développer à travers le monde.
La culture occidentale s’est répandue en Chine pendant plus d’un siècle, tandis que la culture chinoise traditionnelle est en train de connaître un renouveau. A l’heure actuelle, il est compréhensible que la société chinoise souhaite promouvoir ses propres fêtes traditionnelles et que les officiels maintiennent une certaine distance avec les fêtes étrangères.
Certains médias occidentaux semblent très sensibles à la controverse sur Noël en Chine et l’observent sous un angle politique. La société chinoise en général n’a pas besoin de prendre cela trop au sérieux.
Voir également:
Chine : réactions en ligne après le floutage des images de Noël dans une célèbre émission de télévision
The Stand News
Véronique Danzé
12/01/2021
[Sauf mention contraire, tous les liens renvoient vers des pages en chinois, ndlt.]
La version originale du reportage a été publiée en chinois le 26 décembre 2020 par The Stand News. La version suivante, traduite de l’anglais, est publiée sur Global Voices dans le cadre d’un accord de partage de contenu.
Au cours des dernières années, la campagne politique de « boycott des festivités étrangères » a pris de l’ampleur en Chine. Sous la pression du gouvernement, la majorité des médias de Chine continentale se sont abstenus de produire des programmes de promotion des festivités étrangères. Ainsi, cette année, une télévision chinoise en ligne a dû brusquement flouter le décor de Noël de sa populaire émission de variétés, lors de la diffusion de sa première la veille de Noël, générant une réaction immédiate en ligne.
Depuis 2016, l’émission de variétés « Who’s the Murderer » [en], très en vogue auprès des jeunes en Chine et à l’étranger, est produite par la populaire chaîne en ligne « Mango TV », filiale de la télévision publique, Hunan Television. Le premier épisode de la sixième saison devait être diffusé la veille de Noël depuis un grand hôtel dont la décoration était inspirée du thème de Noël.
Bien que le contenu de l’épisode ne porte pas sur Noël, le décor risquait d’être interprété comme une promotion des « festivités occidentales ». L’équipe de production de la série a donc choisi de flouter tous les sapins de Noël, couronnes, cloches et autres décorations en vue de la diffusion en ligne de l’émission. Les accessoires présents sur la tête des personnages ont même été camouflés par des chapeaux de dessin animé en post-production.
Un utilisateur de Twitter, @Chenpingcong191, a filmé certaines des scènes de l’épisode du réveillon de Noël :
Pixellisation du sapin de Noël. C’est quoi ce bordel ?
[description image]
L’image est composée de 4 plans sur lesquels on distingue des extraits de l’émission « Who’s the Murderer » (Qui est le meurtrier ?), toutes les décorations et le sapin de Noël sont floutés.
Les fans de la série ont été consternés de découvrir les effets de la post-production. Les commentaires ont également inondé le compte officiel de la série sur les médias sociaux et le hashtag #明星大侦探将圣诞元素打码# (#PixellisationDesDécorsdeNoëlSurQuiEstLeMeurtrier#) est devenu viral sur Weibo le jour même. Vous trouverez ci-dessous quelques commentaires typiques sur Weibo :
Cette campagne de boycott des festivités étrangères s’est accélérée depuis janvier 2017, après que le Comité central du Parti communiste chinois et le Conseil d’État ont publié un document intitulé, « Suggestions sur la mise en œuvre de projets visant à promouvoir et à développer le patrimoine culturel traditionnel chinois », invitant tous les responsables gouvernementaux et les autorités à mettre en place des activités de promotion des fêtes chinoises afin de renforcer la confiance culturelle de la population et la puissance tranquille de la Chine.
L’Administration nationale de la radio et de la télévision chinoise représente désormais l’une des autorités clés dans la mise en œuvre de ce projet politico-culturel. Son rapport annuel en 2018 a mis en évidence ses accomplissements dans la lutte idéologique contre les valeurs occidentales et les influences religieuses par le biais de la censure, de l’orientation de l’opinion publique et via la promotion des fêtes et des valeurs éthiques chinoises.
Bien qu’aucun document officiel n’interdise les festivités occidentales, la répression des pratiques religieuses, dont le christianisme, dans tout le pays s’est élargie à une interdiction des décorations de Noël publiques. Ainsi, en 2018 [fr], le Bureau de l’administration urbaine et de l’application des lois de la ville de Langfang, dans la province de Hebei, a exigé le retrait des décorations de Noël placées dans les rues. Ces dernières années, certaines écoles chinoises ont banni les célébrations de Noël dans l’enceinte des établissements.
Autrefois, la majorité des Chinois pensaient que les mesures répressives pendant la période de Noël ciblaient une minorité d’activités chrétiennes et que le secteur commercial ne serait pas affecté. Cependant, la pixellisation des décorations de Noël dans l’émission de télévision mentionnée ci-dessus témoigne du fait que cette politique pourrait avoir un impact plus important sur la vie des gens. Un utilisateur de Weibo a évoqué les implications économiques de cette pratique :
Un autre utilisateur de Weibo a regretté le retard pris en matière de politique culturelle :
Sur Twitter, @HuangZhanghong s’est gaussé :
Toujours sur Twitter, le blogueur chinois @fangshimin a déploré la politique de deux poids deux mesures des autorités chinoises vis-à-vis de la célébration de Noël, en publiant sur Twitter une capture d’écran des vœux de Noël du porte-parole chinois, Hua Chunying [en] :
Comment se fait-il que le diplomate « guerrier-loup » puisse célébrer Noël alors que le simple citoyen chinois ne le peut pas ? Même les sapins de Noël doivent être pixellisés ? Les journalistes étrangers peuvent-ils poser cette question au « guerrier-loup », Hua Chunying ?
Suite au tweet de Hua Chunying [en], beaucoup ont soulevé des questions similaires et certains ont ajouté des remarques sarcastiques :
Suite au tollé en ligne survenu le 24 décembre, la pixellisation des décorations de Noël de l’émission a été retirée le lendemain.
Voir de même:
Le gouvernement chinois déforme totalement un évangile dans un manuel scolaire
En Chine, un manuel scolaire publié par une maison d’édition dépendant du gouvernement s’est autorisé à réécrire le passage de la Bible concernant la femme adultère afin de mieux « coller » à l’enseignement auquel il est destiné : « l’éthique professionnelle et le respect de la loi ».
Agnès Pinard Legry
Aleteia
Pourquoi Xi Jinping veut-il adapter la Bible à la ligne du Parti communiste ?
Les autorités chinoises ont demandé aux responsables religieux, lors d’une réunion qui s’est tenue le 6 novembre 2019, de veiller à la conformité des textes de référence avec les « exigences de la nouvelle époque ». Pour l’historien Yves Chiron, cette annonce est la suite logique de la politique de sinisation mise en place par Xi Jinping.
Timothée Dhellemmes
Aleteia
23/12/19
Yves Chiron : Le régime communiste veut que les religions servent les objectifs du Parti communiste, et donc la construction du socialisme. Xi Jinping sait qu’il ne peut pas faire disparaître la religion par une persécution massive, donc il poursuit la mise en œuvre d’une politique de contrôle et d’instrumentalisation de la foi chrétienne et de la religion musulmane. C’est une politique qui vise l’Église catholique mais aussi les autres religions, comme le protestantisme et l’islam.Ce n’est pas une annonce spectaculaire dans le sens où c’est la suite logique cohérente d’une volonté politique de sinisation de la société, que Xi Jinping a exprimé il y a déjà des années. Lorsqu’il a employé le terme de « sinisation » pour la première fois en 2011, il l’a appliqué au marxisme. Depuis 2015, il estime que cela doit aussi s’appliquer aux religions présentes en Chine. Pour lui, les religions doivent s’adapter à la culture et aux valeurs chinoises, et donc être un relais des valeurs marxistes.Quelles seraient les conséquences sur les relations, déjà très compliquées, entre les croyants et le régime ?
C’est un contrôle de plus en plus étroit et quotidien, à la fois sur tous les édifices mais également sur toutes les activités religieuses en général. En Chine, aucun journal chrétien ni revue de théologie ne peut exister. Il y a parfois quelques bulletins d’une église ou d’un temple, mais ils sont contrôlés par le régime.Pour la période de Noël, cela va encore plus loin : les autorités ont mis en place une campagne de boycott, car ils considèrent que cette fête trahit la culture chinoise. Dans les écoles, toutes les décorations de Noël sont interdites. Dans plusieurs établissements, des enfants ont été punis car ils ont dit qu’ils allaient se rendre à la messe de Noël. Cela est dû à une réglementation adoptée il y a deux ans, qui interdit aux enfants de moins de 18 ans d’aller dans les églises ou dans les temples.Le régime veut « graduellement former un système idéologique religieux aux caractéristiques chinoises ». Àterme, l’objectif est-t-il de se débarrasser de toutes les religions ?
Dans l’idéologie marxiste, la religion est « l’opium du peuple », une superstructure qu’il faut faire disparaître. Mais le régime est conscient que dans les faits, ce n’est pas possible dans l’immédiat. A défaut de détruire la religion, il cherche dont à la transformer. Cette politique de sinisation s’est traduite par exemple par une récente campagne d’affichage dans les églises. Les autorités politiques essayaient de montrer par des citations que les douze grandes valeurs du socialisme ont une correspondance directe dans la Bible, donc que la Bible annonce le socialisme.Le contrôle étroit des religions par le régime date de 1949, dès la fondation de laRépublique populaire. Cette décision, particulièrement grave, montre que le régime a franchi un nouveau palier ?
À mon sentiment, c’est la suite logique de la politique engagée par Xi Jinping depuis 2013. Mais dans la décennie 1966-1976, pendant ce que l’on a appelé la Révolution culturelle, la situation était encore plus dramatique. Aucun culte religieux n’était autorisé : même les églises « officielles » (celles qui sont reconnues par le régime, ndlr) ont été fermées de force, ainsi que les temples protestants… Aucun culte religieux n’existait en Chine. Aujourd’hui, même si la liberté de pratique religieuse est gravement entravée, des églises officielles sont ouvertes, et la religion n’est pas interdite.Est-il réellement possible d’avoir une croyance religieuse en Chine ?
C’est possible, dans la mesure où aucun pays à aucune époque n’a réussi à empêcher les gens de croire. L’objectif du régime à long terme serait de supprimer la religion en Chine, mais évidemment, il n’y parviendra pas.Le Vatican a signé un accord en 2018 reconnaissant sept évêques désignés par le régime. Certains catholiques avaient alors protesté, en particulier l’évêque émérite de Hongkong, le cardinal Joseph Zen Ze-kiun, qui avait dénoncé une « trahison ». Cette nouvelle offensive du régime lui donne-t-elle raison ?
Les différentes mesures prises par les autorités chinoises depuis la signature de l’accord sont en contradiction avec cet accord. Le régime a toujours pour objectif de contrôler davantage l’Église catholique, et d’instrumentaliser la doctrine religieuse à des fins politiques. Évidemment, en signant cet accord, le Pape essayait de préserver la liberté de l’Église et assurer sa continuité en Chine, où de nombreux diocèses étaient sans évêques… Il avait des raisons de signer cet accord. Mais la Chine et le Saint-Siège poursuivent des intérêts différents. Il est peu probable que le Vatican réagisse à cette nouvelle offensive du régime. Le Pape sait bien que 11 millions de catholiques chinois vont déjà fêter Noël dans des conditions très difficiles. Il ne voudra pas aggraver la situation.
Xi Jinping veut réécrire la Bible pour l’adapter à la ligne du Parti communiste
Sébastien Falletti
Le Figaro
22/12/2019
DÉCRYPTAGE – Les autorités chinoises ont exhorté les représentants des principaux cultes à modifier les traductions des textes de référence afin de les mettre en conformité avec «les exigences de la nouvelle époque».
De notre correspondant à Pékin
Désormais, l’Évangile devra se conformer à la vulgate marxiste-léniniste matinée de «caractéristiques chinoises», et les paraboles de Jésus-Christ, rester dans la ligne du Parti communiste, sous peine d’être expurgées des bibles à disposition des fidèles dans le pays le plus peuplé de la planète. Pékin lance une nouvelle offensive en faveur de la «sinisation» des religions, s’attaquant cette fois à la doctrine même, du Nouveau Testament au Coran en passant par les sutras bouddhistes. Les autorités ont exhorté les représentants des principaux cultes en Chine à modifier les traductions des textes de référence, lors d’une réunion le 6 novembre, afin de les mettre en conformité avec «les exigences de la nouvelle époque». Une formule codée qui fait référence à «l’ère du président Xi Jinping», dont la pensée a été inscrite dans la Constitution en 2018, dans la foulée d’un Congrès à sa gloire.
«Il faut une évaluation complète des traductions existantes de classiques religieux. Pour les contenus non conformes, il faut des modifications et il faut retraduire les textes», affirme le compte rendu en chinois, par l’agence officielle Xinhua, de ce symposium présidé par Wang Yang, l’un de sept membres du comité permanent du Politburo, le «saint des saints» du régime. «Cette réunion indique que le contrôle des religions va être encore plus strict», juge Ren Yanli, chercheur à l’Académie des sciences sociales de Chine, un centre de recherche public à Pékin.
Communautés souterraines
Les représentants des principaux cultes en Chine ont été convoqués pour mettre en application les décisions du 4e plénum du Parti, tenu fin octobre à Pékin, et qui a décrété le renforcement de sa mainmise idéologique sur la société, avec pour ambition d’affermir un contre-modèle à la démocratie occidentale. Face à ses interlocuteurs coiffés de calotte ou de costumes ethniques traditionnels, le cacique Wang a souligné «l’importance fondamentale de l’interprétation des doctrines et des règles religieuses» avec pour objectif de «graduellement former un système idéologique religieux aux caractéristiques chinoises».
Récemment un portrait de Xi Jinping a même remplacé la Vierge Marie et l’Enfant dans une église catholique
Depuis sa fondation en 1949, la République populaire surveille étroitement les religions, encadrées dans des organisations «patriotiques», auxquelles résistent nombre de fidèles réfugiés dans des communautés souterraines. Mais cette injonction à modifier la doctrine marque un seuil nouveau dans la volonté du président Xi Jinping d’étouffer toute vision alternative au Parti. Après avoir insisté sur le «patriotisme» des fidèles après son arrivée au pouvoir en 2013, Xi s’attaque désormais au message, lors de son second mandat à la tête de la seconde puissance mondiale. «La volonté de retoucher la Bible est une première», juge Ren.
Une mise au pas qui s’est illustrée par des levers de drapeaux rouges dans les temples, ou l’installation de banderoles de propagande dans les mosquées comme dans la région autonome hui du Ningxhia. Récemment un portrait de Xi Jinping a même remplacé la Vierge Marie et l’Enfant dans une église catholique à Ji’an, dans la province du Jiangxi, rapporte l’ONG Bitter Winter, qui milite pour la liberté religieuse à travers le monde. Dans la province rétive du Xinjiang, à majorité turcophone, la répression des croyants prend une dimension concentrationnaire, marquée par l’enfermement de plus d’un million de musulmans dans des «camps», selon Washington, présentés comme des «centres de formation professionnelle» par Pékin.
Effet boomerang
Cette reprise en main brutale s’inscrit dans la perspective d’une «lutte idéologique» décrétée par le dirigeant le plus autoritaire depuis Mao, sonnant la charge contre les «forces hostiles» manipulées par l’étranger et trahissant une crispation politique, selon certains observateurs. «Le régime communiste est une secte et il voit le bouddhisme tibétain, le catholicisme ou l’islam comme des idéologies rivales. Le contrôle accru sur les religions trahit en réalité la peur de voir la société lui échapper», juge Zhang Lifan, historien indépendant, dans la capitale chinoise, lui aussi sous surveillance.
Cette nouvelle offensive survient dans la foulée de l’accord conclu entre Pékin et le Vatican en 2018, marqué par la reconnaissance par le pape de sept évêques désignés par le régime et dénoncé comme une «trahison» par certains hauts responsables catholiques. Elle s’annonce comme un test de la capacité du Parti à s’immiscer étroitement au cœur de la société chinoise, selon le cap fixé par le Congrès, dans un contexte international et économique toujours plus tendu, marqué par un bras de fer stratégique avec l’Amérique de Donald Trump.
Certains mettent en garde contre les risques d’effet boomerang pour un Parti qui veut étendre son empire sur les consciences. «Le durcissement des contrôles sur les religions va s’avérer contre-productif, comme l’ont démontré les dernières décennies. Le pouvoir a pour mission de gouverner le pays, l’économie, la société, mais pas les croyances. Certains dirigeants semblent ne pas comprendre cela», juge Ren Yanli, expert dans un centre de recherche gouvernemental. La bataille pour la réécriture de l’Évangile selon Xi est lancée.
Voir aussi:
Chine : « Noël est interdit, c’est une fête occidentale »
fsspx.news
09 Février, 2022
Le 20 décembre 2021, l’Administration d’Etat pour les Affaires religieuses (SARA) a publié les nouvelles “Mesures administratives pour les services d’information religieuse sur Internet”. Adoptées conjointement avec le ministère de la Sécurité de l’Etat et d’autres ministères, ces nouvelles mesures entreront en vigueur le 1er mars 2022.
La « sinisation » des religions
Durant les sessions de travail de la dernière conférence nationale sur les Affaires religieuses, début décembre 2021, le président chinois Xi Jinping, secrétaire général du Parti communiste, a déclaré son intention de renforcer le contrôle « démocratique » sur les religions.
En d’autres termes, renforcer la répression religieuse du régime. Selon le nouveau « Grand Timonier », la masse des croyants de différentes confessions doit s’unir autour du Parti et du gouvernement, en rejetant toute influence étrangère.
L’objectif de Pékin est de poursuivre la « sinisation » des religions, un processus entamé officiellement en 2015. En février 2021, l’Administration d’Etat pour les Affaires religieuses avait rendu publiques les “Mesures administratives pour le personnel religieux”, sur l’administration du clergé, des moines, des prêtres, des évêques, etc.
Noël interdit
L’agence Asianews, des Missions étrangères italiennes, annonçait le 21 décembre les limitations et les interdictions imposées pour la célébration de Noël, dans les écoles de la province du Guangxi. L’agence Bitter Winter a publié le 24 décembre le document officiel diffusé dans le Guangxi, ainsi que dans différentes provinces et régions de Chine.
Les mesures ont été appliquées également dans les lieux de culte de l’Eglise des Trois-Autonomies contrôlée par le gouvernement (i.e. Eglise « patriotique » officielle), soit sous prétexte de Covid-19, soit en mettant en œuvre des directives sur la « sinisation » du christianisme qui interdisent les célébrations « occidentales » : « Cela nuit à notre culture traditionnelle chinoise. »
La source confidentielle qui a divulgué le document à Bitter Winter, a confirmé qu’il était non seulement interdit aux élèves et aux enseignants de célébrer Noël à l’école, mais aussi à la maison. De même, ceux qui connaissaient des personnes qui célèbrent Noël étaient priés de le signaler immédiatement à la sécurité publique, et un agent a été désigné pour gérer les délations.
Voir également:
Le gouvernement chinois déteste Noël, sa population adore
Xi Jinping voit dans cette fête une influence occidentale indésirable.
D’une célébration chrétienne, Noël est devenue une fête qui dépasse largement la naissance du Christ. C’est désormais une période commerciale et culturelle, davantage représentée par le Père Noël et des sapins décorés que par la messe de minuit. Ce mastodonte de soft power se propage donc dans les pays qui n’ont pas de tradition chrétienne. Les Japonais par exemple, célèbrent le 25 décembre en allant au KFC.
Toutefois, au moins un pays essaye par tous les moyens d’endiguer la contagion. Depuis quelques années, Xi Jinping, le secrétaire général du Parti communiste chinois, mène une politique identitaire forte en exacerbant le nationalisme et en rejetant les influences occidentales dans le pays. Cette politique se traduit par exemple par un rejet des arts martiaux modernes au profit du kung-fu traditionnel.
Le 15 décembre, la ville de Langfang, dans la province de Hebei, a interdit l’exposition de décorations de Noël dans les écoles, les magasins, les rues et les places de la ville, arguant d’une lutte contre la «propagande religieuse». L’année dernière, la ville de Hengyang avait demandé aux officiels du parti de «résister à ce festival d’occidentalisme rampant».
En Chine, Noël souffre en plus des restrictions imposées contre les libertés religieuses. Si les musulmans sont particulièrement réprimés, certaines églises chrétiennes sont sous surveillance et récemment, cent chrétiens d’une église clandestine ont été arrêtés. C’est autre chose que les gobelets Starbucks ou l’interdiction de mettre des crèches dans les mairies d’un pays laïque.
Popularité croissante
Toutefois, tout cela ne semble pas suffisant pour tenir le pays à l’écart de la magie de Noël. D’après Bloomberg, la fabrication de décorations de Noël est un gigantesque marché de 5,6 milliards de dollars pour la Chine. À titre d’exemple, 90% des décorations de Noël importées aux États-Unis viennent de Chine. Et on ne parle même pas de tous les cadeaux manufacturés dans le pays.
Aussi, malgré les efforts du gouvernement, la célébration de fin d’année est de plus en plus populaire chez les habitants et les habitantes. Pour le constater il suffit de se tourner vers Rovaniemi, la ville du Père Noël. Cette ville finlandaise de Laponie du nord abrite un village touristique entièrement dédié à la fête de Noël. D’après Visit Rovaniemi, la société qui y organise le tourisme, le nombre de touristes chinois est passé de 3.300 en 2010 à 32.349 l’année dernière. Et des centaines de lettres d’enfants écrites en chinois s’entassent dans le bureau de poste de la ville.
Voir surtout:
L’indistinction du politique et du religieux en Chine
Un problème contemporain
Emmanuel Dubois de Prisque
Le Débat
2020/1 (n° 208), pages 57 à 69
1Alors que le pouvoir chinois prétend aujourd’hui faire « renaître » la Chine éternelle et s’inscrire ainsi dans la continuité de « 5 000 ans d’histoire [1][1]Les « 5 000 ans d’histoire » de la Chine font partie intégrante… », qu’est-ce qui, exactement, relie le régime chinois actuel à l’antique tradition politique de ce pays ? En quoi « l’empire du Milieu » actuel serait-il l’héritier de la forme politique impériale qui fut celle de la Chine sous ses différents avatars dynastiques du iiie siècle avant J.-C. à la révolution de 1911, alors même que le régime se réclame toujours (et avec vigueur) du marxisme-léninisme, allant jusqu’à prétendre avoir créé ex nihilo, au moment de son avènement en 1949, une « nouvelle Chine » qui du passé faisait table rase ? Comment concilier restauration et modernité ? communisme et empire ? capitalisme et tradition ? « La Chine » serait-elle une pure illusion, un simple instrument aux mains de Pékin, sans véritable continuité historique ?
2Il apparaît pourtant que la Chine actuelle, malgré son « athéisme » officiel, partage avec la Chine impériale un même tropisme qui la porte à ne pas distinguer le politique du religieux. Le Parti communiste chinois agit de plus en plus comme une institution qui se pose en gardienne de ce qui est sacré pour la Chine et que des forces extérieures, politiques ou religieuses, viennent en permanence menacer, de la même façon que la « bureaucratie céleste [2][2]Étienne Balazs, La Bureaucratie céleste. Recherches sur la… » de l’Empire était la gardienne d’un dogme contre les « hérésies » qui le menaçaient.
3Du point de vue du rapport du politique avec le religieux, la situation actuelle se rapproche de celle que décrivait Édouard Chavannes en 1904 : « L’Empereur nous apparaît ainsi comme le juge universel du bien et du mal […], en lui se réalise l’étroite union de la politique, de la morale et de la religion, principe fondamental du gouvernement chinois ; il est véritablement le Fils du Ciel, et son omnipotence absolue et sacrée provient de ce qu’il est le mandataire du Ciel sur la terre [3][3]Édouard Chavannes, « Les prix de vertu en Chine », Comptes…. »
L’ère des transformations
4Avec le « Grand Bond en avant » grâce auquel Mao prétendait en quelques années transformer une société rurale en grande puissance industrielle, avec aussi la « grande révolution culturelle prolétarienne » visant à éradiquer de l’esprit des Chinois les « quatre vieilleries » (idées, culture, coutumes et habitudes), avec, surtout, les transformations induites par le capitalisme qui s’impose en Chine dès la fin du xxe siècle, bien des aspects de la société traditionnelle chinoise ont été bouleversés. Aujourd’hui, le capitalisme est la révolution continuée par d’autres moyens, tout aussi efficaces. Les transformations suscitées par l’ouverture économique voulue par Deng Xiaoping il y a quarante ans sont sans équivalent dans l’histoire de la Chine. La croissance a été favorisée par une augmentation de la productivité agricole qui a entraîné un exode rural massif ; en quelques décennies, cette antique société paysanne qu’était la Chine s’urbanise massivement. L’effondrement de la natalité transforme radicalement les liens entre les générations d’une société qui faisait de la « piété filiale » une de ses pratiques cardinales. L’ouverture sur le monde rend l’éducation à l’étranger possible et, de 1978 à 2018, le nombre d’étudiants chinois à l’étranger croît de façon exponentielle. L’émigration temporaire sous la forme, par exemple, de l’expatriation des cadres et des employés des entreprises chinoises devient chose banale. Les échanges de tous ordres entre la société chinoise et les sociétés étrangères, notamment occidentales, sont intenses et exercent nécessairement des effets durables. Ils se font sentir jusqu’au niveau le plus profond et le plus structurant, le niveau religieux. Les conversions au christianisme se multiplient, au point que certains voient dans la Chine de demain le premier pays chrétien du monde, en nombre de pratiquants.
« La grande renaissance de la nation chinoise »
5Cependant, parallèlement à ces évolutions dont l’irréversibilité est probable, Pékin est engagé dans un ambitieux projet de « grande renaissance » de, au choix, la nation, le peuple ou la race chinoise, trois traductions possibles du terme chinois minzu employé par Pékin dans son slogan officiel. La « grande renaissance de la nation chinoise » – contentons-nous de la traduction officielle – est le cœur du métarécit de la Chine contemporaine selon lequel la Chine a refermé en 1949 une parenthèse d’un long siècle qui s’étend du début de la première guerre de l’Opium, en 1839, à la création de la « nouvelle Chine », siècle au cours duquel elle a été « humiliée » par les puissances occidentales et japonaise qui ont tiré profit de sa faiblesse, de son ingénuité et d’un pacifisme intrinsèque à sa culture. Sans renoncer à ce qu’elle est essentiellement, une civilisation pacifique et harmonieuse, elle ne répétera pas les erreurs du passé et saura se défendre si elle est agressée. Le sentiment d’avoir été la victime de puissances agressives alimente une ferme volonté de ne pas « se laisser berner » une nouvelle fois sur la scène internationale. La posture parfois agressive et irascible de la Chine contemporaine s’explique ainsi paradoxalement par le sentiment que la civilisation chinoise est plus pacifique que les autres. Il lui faut donc devenir forte pour redevenir ce qu’elle imagine qu’elle fut : un modèle de vertu pour elle-même et pour le monde. Par-delà la modernité imposée par l’Occident, la Chine cherche à renouer avec un passé glorieux durant lequel elle aurait occupé « la première place ».
6La normalisation chinoise impulsée par la modernisation du pays trouve donc ses limites dans les ambitions de Pékin, ambitions qui s’appuient sur son projet de « grande renaissance » de la Chine d’avant le traumatisme de la rencontre avec la modernité occidentale. Si cette « restauration » n’est pas ouvertement un projet de restauration de la forme politique de la Chine impériale au sens strict, elle est un projet de restauration de la puissance symbolique de l’Empire et de sa place dans le monde. Ce projet porte avec lui non seulement une ambition pour la Chine, mais aussi une vision chinoise du monde : ce serait alors la restauration d’une Chine qui se concevait comme la seule et unique civilisation, une civilisation qui structurait et organisait le monde, en termes chinois : tout ce qui était sous le ciel, le Tianxia.
7Précisons la contradiction structurelle dans laquelle s’enfonce aujourd’hui la Chine : pour retrouver la place centrale qu’elle occupait autrefois, la Chine doit supplanter le pays qui lui semble occuper cette place aujourd’hui. Bien qu’elle s’en défende, elle est donc engagée avec les États-Unis dans une lutte pour la suprématie, une rivalité qui l’amène par un effet mimétique puissant à se calquer plus ou moins consciemment sur ce qui lui semble être le comportement de son rival. Mais ce mimétisme, visible dans de nombreux aspects de la vie contemporaine aujourd’hui en Chine, et qui contribue à banaliser ce pays et sa civilisation, contredit la volonté affichée de Pékin de renouer avec son passé impérial. Car c’est non seulement son identité culturelle qui est menacée par l’adoption de pratiques occidentales, mais la structure même de son être politique : la Chine impériale n’avait par définition pas de rival, étant « la » civilisation, elle était d’une essence différente des peuples barbares qui l’entouraient et sur lesquels l’Empereur et sa bureaucratie céleste avaient vocation à exercer leur action civilisatrice. Ainsi, en renouant avec son passé impérial, la Chine voudrait se situer au-dessus des débats et des rivalités, trouver la formule qui la garderait de la contagion de la violence qui caractérise, selon elle, le système international occidental. Lorsqu’elle est entrée malgré elle dans le concert des nations, la Chine impériale est tombée du piédestal depuis lequel elle organisait ses relations avec les pays qui l’entouraient, sous la forme de cette semi-fiction que le sinologue John King Fairbank qualifia de « système tributaire ». Au xixe siècle, la Chine, au fil de ses défaites, fut abaissée au niveau symbolique de ceux qui triomphaient d’elle. La véritable humiliation est sans doute celle-là : qu’un empire sans équivalent dans le monde, la seule et unique civilisation, celle qui se proposait de « civiliser » l’humanité, puisse être réduit au rang de nation parmi d’autres, contraint à exercer sa souveraineté dans les limites étroites d’un territoire précis.
La dimension religieuse de la restauration de la nation chinoise
8Avec le projet de « grande renaissance » de la nation chinoise, la Chine se propose donc de sortir de la rivalité et de la violence pour qu’advienne enfin un « monde harmonieux » au sein duquel elle jouerait un rôle central. Hantée par la puissance américaine qu’elle veut supplanter, la Chine continue cependant de s’imaginer d’une autre essence que celle de ses rivaux, ayant une vocation à ordonner le monde selon des critères étrangers à la bellicosité intrinsèque aux puissances occidentales. Tout en professant formellement le principe de l’« égalité de toutes les nations » contre l’« hégémonisme » qu’il prête aux États-Unis, le Parti communiste chinois s’efforce de faire en sorte que la Chine s’approche du « centre de la scène mondiale [4][4]C’est l’expression de Xi Jinping lors de son discours devant le… », renouant ainsi avec l’imaginaire politico-religieux de la « bureaucratie céleste ».
9Depuis, au moins, le traité de Westphalie en 1648, les nations européennes ont de facto renoncé à incarner la totalité de la Chrétienté, c’est-à-dire à se considérer comme un avatar de l’empire universel des Romains et ont, de ce fait, sécularisé et territorialisé leur pouvoir. La Chine, quant à elle, n’a jamais été contrainte à cette kénose politico-religieuse. L’Empereur est resté jusqu’au terme de l’Empire non seulement souverain politique, mais aussi maître des rites et des sacrifices. Plus encore, les deux aspects de sa pratique politico-religieuse n’étaient qu’une seule et même chose. Comme l’écrit Jean Levi à propos de la Chine antique, « gouverner revient à sacrifier [5][5]Jean Levi, « Le rite, la norme et le tao : philosophie du… ». Malgré l’émergence progressive dans l’histoire chinoise de religions non directement politiques, diffusant leurs doctrines plus ou moins à l’écart du pouvoir, le bouddhisme et le taoïsme, le pouvoir impérial continuera à jouir d’un monopole sur la légalité et la légitimité du phénomène religieux dans le corps social. C’est l’administration qui définit, sur la base d’une loi fondamentale, ce qui est « correct » et ce qui est « hérétique » dans les pratiques religieuses. Pendant plus de cinq siècles, une loi Ming du xive siècle, reprise par la dynastie sino-mandchoue Qing jusqu’au début du xxe, prévoit la mort par strangulation ou l’administration de cent coups de bâton suivie (s’ils survivent) du bannissement de ceux qui pratiquent des cultes « hérétiques », c’est-à-dire non conformes aux pratiques considérées comme « correctes » par la bureaucratie [6][6]Jan Jacob Maria De Groot, Sectarianism and Religious…. Pour reprendre les termes de J. J. M. De Groot, « l’Empereur aussi bien que le Ciel est seigneur et maître de tous les dieux, et délègue cette dignité à ses mandarins, chacun pour sa juridiction. C’est d’eux que relève la décision de savoir quels dieux sont susceptibles d’être objets de culte, et quels dieux ne le sont pas [7][7]Ibid., Introduction, p. 18. ».
10En 1670, l’empereur Kangxi publie un « édit sacré » dont le but est d’instiller de la vertu chez les sujets de l’Empire. L’édit est affiché dans chaque comté et village. Son article 7 demande à chaque citoyen de l’Empire d’« éradiquer les hérésies afin de respecter la doctrine correcte ». Les hérésies, ce pouvait être, selon les circonstances, n’importe lequel des rites locaux chinois, le bouddhisme, le chamanisme, le taoïsme ou le christianisme. Quant à la doctrine correcte, ce n’est rien d’autre que celle défendue par l’Empire, le confucianisme. Son respect est donc intimement lié à un processus d’éradication de ce qui n’est pas correct : chacun, jusqu’au plus humble villageois, doit régulièrement communier dans la mise à l’écart des cultes jugés hérétiques par le pouvoir. Ce processus d’expulsion des cultes hérétiques était sans cesse renouvelé par l’action « civilisatrice » des fonctionnaires locaux, du fait de la persistance de ces cultes sur le vaste territoire de l’Empire. Ce processus prenait la forme d’un rituel tout uniment politique et religieux de purification du corps social : l’édit sacré de Kangxi formait le cœur de la doctrine impériale et faisait l’objet d’homélies exégétiques régulières par les fonctionnaires locaux, auxquelles tous les membres des communautés locales étaient tenus d’assister.
« La sinisation des religions »
11S’il faut prendre la volonté de « restauration » de Pékin au sérieux, comme cela est vraisemblable, il convient d’envisager que ce processus puisse avoir une dimension religieuse et que cette dimension religieuse soit même centrale dans le projet des autorités chinoises. Depuis 2016, Pékin applique une politique de « sinisation » des religions qui non seulement réprime les « superstitions », mais soumet l’ensemble des cinq religions « officielles » (taoïsme, bouddhisme, islam, protestantisme, catholicisme) à une tutelle pesante. Des mosquées, des églises et mêmes des temples bouddhiques sont détruits ; le prosélytisme est sévèrement réprimé, l’accès aux églises ou aux mosquées est parfois interdit aux mineurs, tout comme l’enseignement religieux, tandis que le Parti promeut sa propre « spiritualité » de façon de plus en plus insistante. La « pureté » de l’idéal révolutionnaire est mise en avant et, dans certaines régions, les autorités locales remplacent jusque dans les domiciles les effigies religieuses par des portraits de Xi Jinping. Sur les lieux de culte qui restent tolérés, les inscriptions religieuses sont parfois effacées pour être remplacées par des slogans du Parti. Les autorités religieuses sont ainsi engagées dans un vaste projet visant à supplanter les religions existantes par une « spiritualité » indistinctement politique et religieuse qui s’appuie sur la doctrine marxiste-léniniste pour neutraliser non seulement les « religions étrangères » (christianisme et islam), mais aussi les religions considérées comme chinoises (taoïsme et bouddhisme) dans la mesure où ces dernières impliquent, pour les fidèles, un ordre de loyauté concurrent de l’ordre politique. En outre, les autorités situent parfois délibérément la vocation du religieux et celle du politique sur le même plan. Le catholicisme, notamment, est critiqué pour son inefficacité dans la lutte contre la pauvreté et la maladie, tandis que le Parti vante ses résultats dans ces deux domaines. Les autorités prétendent ainsi « transformer les fidèles des religions en fidèles du Parti [8][8]Nectar Gan, « Want to Escape Poverty ? Replace Pictures of… ». C’est aussi dans ce contexte que doit se comprendre la politique menée à l’égard de l’islam ouïghour au Xinjiang. Lorsque le Parti prétend, pour répondre aux accusations occidentales, se contenter de « rééduquer » les foules musulmanes du Xinjiang plutôt que de les enfermer dans des camps de concentration, cela n’a rien de rassurant car se manifeste ainsi une foi profonde dans la vertu civilisatrice de cette abstraction qu’est « la Chine ». Mais aussi abstraite soit-elle, cette Chine conçue comme centre de civilisation exerce des effets puissants sur les cadres du Parti communiste, qui y trouvent les ressources symboliques nécessaires à la légitimation de la mise en œuvre de politiques de plus en plus coercitives à l’égard des populations qui leur sont soumises.
Religieusement correct
12Mais plus profondément encore que dans ses rapports avec les religions, la nature religieuse, ou plus exactement sacrificielle, du régime chinois se révèle dans sa structuration fondamentale [9][9]J’utilise ici le mot « sacrificiel » au sens que lui a donné…. En se faisant le gardien et le défenseur de l’orthodoxie spirituelle et de la foi dans les idéaux révolutionnaires de ses membres, le Parti s’inscrit dans les pas du pouvoir politico-religieux chinois traditionnel, dont un des rôles essentiels était de distinguer ce qui est « correct » de ce qui est « hérétique » dans le foisonnement des rites et cultes chinois. Aujourd’hui, c’est dans sa capacité de purification du corps social, à travers l’expulsion des ennemis de la Chine ou de la Révolution, que le Parti manifeste sa puissance, de la même manière qu’autrefois la puissance de l’Empereur se manifestait dans sa capacité à respecter les rites, au premier rang desquels le grand sacrifice au Ciel. Avec lui, l’ordre social et cosmique était produit et garanti.
13Une histoire religieuse de la Chine contemporaine qui porterait son attention sur les avatars de la figure du souverain dans certains rites privés et publics de la Chine impériale, républicaine et communiste, frapperait sans doute par la continuité qui s’en dégagerait, au-delà des ruptures évidentes de l’histoire événementielle. Comme nombre d’autres empereurs avant lui, Mao fut déifié après sa mort par une partie de la population chinoise, malgré la vive hostilité à la religion traditionnelle qu’il manifesta durant son existence. Ou, plutôt, cette déification se produisit en raison même de cette hostilité : sa capacité magique à chasser les esprits et les fantômes de l’ancien monde faisait de Mao un esprit d’une puissance supérieure à celle des esprits et fantômes auxquels la Chine devait faire face jusqu’alors. Aujourd’hui encore, Mao occupe parfois la place centrale dans les autels domestiques, celle du souverain, alors même que son mausolée occupe le cœur de la place centrale (Tiananmen) de la capitale chinoise.
14La politique actuelle de « sinisation » des religions et d’expulsion de tout ce qui dans ces religions les rattache aux puissances étrangères renoue ainsi avec la longue tradition chinoise, malgré les soubresauts de l’histoire politique de ce pays au xxe siècle. Sur au moins un temple bouddhique chinois, on pouvait lire en 2018 un slogan frappant : « Sans parti communiste, il n’y a pas de bouddha », qui établit très clairement la nature de la hiérarchie entre le pouvoir du Parti et celui des autres organisations religieuses. Pas plus que dans la Chine d’ancien régime, il n’existe dans la Chine contemporaine un ordre politique et un ordre religieux qui existeraient parallèlement et exerceraient leurs compétences chacun sur son « royaume » qui serait celui de la terre, pour le premier, et celui des cieux, pour le second. La Chine est le « pays des dieux » ou le « pays sacré », selon une de ses appellations traditionnelles, ce qui signifie que les dieux sont indistinctement d’en bas et d’en haut. Selon un principe tout à la fois taoïste (Zhuangzi) et confucéen (Dong Zhongshu), « le Ciel et l’Humanité ne font qu’un ». Le contraste est frappant entre les rapports du politique et du religieux tels qu’ils se sont établis en Occident au cours de son histoire et ce qu’ils sont en Chine : alors que pour le christianisme la Chute a pour conséquence une séparation de Dieu d’avec sa créature et qu’en conséquence le royaume du « fils de Dieu » n’est « pas de ce monde » [10][10]« Mon Royaume n’est pas de ce monde » (Jean, XVIII, 36). Cette…, en Chine le royaume du « fils du Ciel » n’est rien d’autre que le monde Tianxia : tout ce qui est sous le Ciel. « De tout ce qui est sous le Ciel, il n’est rien qui ne soit le territoire du roi », dit aussi le Shijing.
15À la lumière de ce rapide détour théologique, la nature du rapport de la Chine impériale avec le monde s’éclaire : source sacrée (car fondée sur le sacrifice) d’organisation de l’ensemble de l’univers, la « bureaucratie céleste » qui incarne la Chine n’a, de son propre point de vue, aucun équivalent parmi les autres États. L’égalité de principe de tous les États-nations qui fonde le système international d’après guerre, bien que formellement défendue par la Chine, est au fond pour elle hérétique. La restauration de l’Empire ne va bien sûr pas de soi, mais, avec l’émergence géopolitique actuelle de la Chine, l’héritage classique, rejeté lors du mouvement « moderniste » de 1919 (dont un des slogans était « à bas la boutique de Confucius »), est à nouveau promu et valorisé par les autorités. Les dirigeants chinois ne cessent aujourd’hui de se réclamer d’une « histoire de 5 000 ans », prétendant ainsi se situer dans la continuité d’une société qu’il faut bien qualifier d’archaïque [11][11]Grâce à de récentes études archéologiques, il est avéré que… et qui, comme toutes les sociétés archaïques, est fondée sur une économie de la violence au cœur de laquelle opèrent les rites de purification du corps sociopolitique. Autrefois du ressort du souverain et de sa « bureaucratie céleste », ces rites antiques de production, de structuration et de purification du corps sociopolitique ont été modernisés et prennent aujourd’hui des formes diverses (lutte contre la corruption, contre la « pollution spirituelle », mise en place, enfin, d’un « système de crédit social » d’évaluation et de sanction des citoyens, sur lequel je reviendrai) : ils sont aujourd’hui du ressort du « grand dirigeant » et de sa bureaucratie moderne que sont respectivement Xi Jinping et le Parti.
16Mais si la Chine a été profondément transformée par sa période maoïste et continue de l’être par sa période capitaliste, en quoi, au-delà de la structuration du rapport du politique et du religieux, cette progressive restauration de la forme impériale informe-t-elle les pratiques politiques en Chine ? À travers l’analyse de trois phénomènes saillants de la Chine contemporaine, son rapport à la guerre, son usage des statistiques et son projet d’évaluer et de noter les individus, il est possible de mettre en lumière les effets concrets qu’exerce la structuration néo-impériale de l’État chinois sur le corps sociopolitique qui lui est soumis. Mais il faut immédiatement souligner que cette structuration se produit dans un rapport de forte tension, voire souvent de contradiction, avec la normalisation continue de la Chine sous l’effet à la fois de la rivalité mimétique avec les États-Unis et de son insertion dans un monde façonné par des pratiques pour l’essentiel étrangères à sa propre tradition politico-religieuse.
La guerre juste selon la Chine ou le sacrifice réinventé
17La contradiction entre une Chine qui est à la fois une nation parmi d’autres, engagée dans une rivalité de chaque instant avec d’autres nations, et une Chine qui se conçoit comme une civilisation unique est éclatante dans son appréhension du phénomène guerrier : tout en augmentant constamment son budget militaire, plus rapidement encore que ne croît la richesse du pays, les dirigeants chinois ne cessent d’affirmer qu’ils sont les représentants d’une « civilisation pacifique » dont le pacifisme est inscrit jusque dans son adn.
18Pour dénouer cette contradiction, il faut faire retour ici encore à la Chine antique. Comme le démontre Jean Levi, la condamnation de la guerre, « activité funeste » par excellence, n’est pas une innovation de la Chine contemporaine [12][12]La Chine en guerre. Vaincre sans ensanglanter la lame…. Il s’agit, au contraire, d’un passage obligé des traités militaires et stratégiques chinois « tout au long des siècles ». Il n’y a pas, dans ces traités, de valorisation d’un ethos guerrier puisque les soldats risquent à chaque instant de se faire tuer et d’éteindre leur lignée. Selon le Hanfeizi, Confucius estime même qu’il est très honorable de fuir les combats car la « piété filiale » exige de rester en vie pour prendre soin de la lignée de ses ancêtres [13][13]Ibid., p. 227. !
19Du point de vue historique, la violence politique, exercice rituel et cynégétique limité à l’aristocratie durant les dynasties Shang (1570-1045 av. J.-C.) et Zhou (1046-256 av. J.-C.), visant à procurer des victimes sacrificielles à la communauté, s’est progressivement transformée en une activité guerrière totale, mobilisant l’ensemble de la communauté dans des affrontements pouvant entraîner la mort de plusieurs centaines de milliers de personnes en une seule bataille. Ce dérèglement du processus sacrificiel n’est que l’autre face de la désagrégation de la Chine de la dynastie Zhou pendant la période des Royaumes combattants. Le territoire formellement sous la souveraineté du duc de Zhou se fractionne alors en royaumes rivaux mobilisant chacun d’immenses ressources humaines et techniques pour triompher de ses ennemis. Alors que la guerre, à travers sa fonction sacrificielle, avait pour vocation de souder la communauté, elle devient la cause du déchirement et de la dislocation du corps politique. C’est le sort de la violence, du fait de sa nature mimétique, de se propager à l’ensemble de la communauté, lorsque, comme se lamentait Confucius, les rites ne sont plus respectés et qu’ils n’exercent plus leur fonction qui est de la contenir, aux deux sens du mot contenir (de lui octroyer une place, mais une place limitée, au sein des institutions).
20Mais le plus remarquable est que jamais les stratèges ne perdront de vue la visée sacrificielle de l’activité militaire. Idéalement, pour tous les stratèges, l’activité guerrière doit s’abolir dans le sacrifice d’un seul. C’est ce qui se passe lors de l’« expédition punitive », autre nom de la guerre juste en Chine. L’Art du commandement du commandant Liao l’affirme de la façon la plus claire : « L’unique objectif [d’une juste guerre] est le châtiment d’un seul [14][14]Cité par Jean Levi, La Chine en guerre, op. cit., p. 126.. » C’est le mauvais prince qui doit être châtié par le bon. Le Lüshi chunqiu le prétend également : « Il n’est d’opération militaire qui n’ait pour but de détruire les mauvais princes et de châtier les seigneurs iniques. N’est-il plus grand bienfait que de détruire le vice et de châtier l’iniquité [15][15]Ibid., p. 127. ? » Ainsi, la guerre dans sa forme parfaite s’apparente à un acte de justice, à l’exécution d’une sentence tout uniment populaire et divine contre le mauvais prince. Mais dans les affrontements mimétiques qui caractérisent l’histoire chinoise, comment distinguer le mauvais prince et le bon ? Le bon prince est le vicaire du ciel, c’est-à-dire celui qui représente et agit pour l’Empereur ou celui qui a vocation à le devenir en chassant le tyran. C’est donc le seul jugement de l’Histoire, celui qui prend la forme de la victoire ou de la défaite, qui devient le critère de la guerre juste. Celle-ci s’apparente ainsi à une forme de sacrifice, l’ordalie. Le prince sur qui les yeux de la foule sont constamment fixés risque toujours de devenir l’objet de la violence collective. Il lui faut donc la maintenir à distance et la retourner vers l’extérieur, si possible contre un rival qui se trouve exactement dans la même situation que lui. Le prince est le maître de la guerre tant qu’il n’en devient pas la victime. La guerre peut être appelée « art du mensonge », car elle occulte l’identité des rivaux, en lui substituant une opposition radicale entre le Bien et le Mal, dans laquelle la différence est aussi fictive que revendiquée par celui qui, par la victoire, parvient à l’imposer.
21La guerre idéale prend donc la forme du sacrifice qui évacue la violence du groupe sur un seul et restaure ainsi la paix. A contrario, la rivalité et le conflit ouvert soulignent l’indécision quant à l’identité du souverain légitime. Cette indécision est profondément troublante et demande à être résolue, autant que faire se peut, par l’émergence d’un souverain universel qui, à la manière de l’empereur, « punit » ceux qui refusent de se soumettre à son autorité sacrée. Ce tropisme impérial se manifeste dans la politique étrangère chinoise par une forte tendance à utiliser le vocabulaire de la punition et de la sanction là où l’Occident utiliserait plutôt un vocabulaire guerrier ou, à l’époque contemporaine, un vocabulaire plus platement juridique. La dernière (et désastreuse) intervention militaire chinoise, en 1979, avait officiellement pour but de « donner une leçon » au Vietnam. Aujourd’hui encore, c’est de cette façon que Pékin aborde le problème géopolitique central qui est le sien, le problème de Taïwan. Ainsi, selon Xi Jinping, avec le pouvoir taïwanais actuel (opposé à un rapprochement politique avec Pékin), les « fondations » naturelles du monde commun deviennent instables, « la terre bouge et les montagnes tremblent ». Plus encore, en s’opposant au « sens de l’Histoire », le pouvoir taïwanais risque de subir une « punition » dont il faut donc penser qu’elle serait octroyée au nom de principes qui dépassent la simple volonté humaine. Selon Pékin, l’Armée populaire de libération, si elle use un jour de la force contre Taïwan, se fera l’instrument d’une puissance transcendante en harmonie avec le sens de l’Histoire, puissance dont la volonté est de rendre à la Chine sa juste place sur la scène mondiale.
Les statistiques, ou l’impossible kénose du pouvoir chinois
22À partir du xviie siècle, les trois grands États européens que sont la France, la Prusse et l’Angleterre développent à peu près en même temps des outils qui visent à mieux comprendre leurs populations. C’est la naissance de la « statistique » (mot dont l’étymologie est la même que celle du mot état) dans ses aspects les plus modernes. Cette évolution est contemporaine de la territorialisation et de la sécularisation des États européens qui se manifestent dans le traité de Westphalie (1648). La statistique procède du même phénomène général de désacralisation progressive du pouvoir. La statistique, écrit en effet Olivier Rey, se place « non du point de vue d’un Être omniscient supposé savoir […] mais de l’être humain dans ses conditions véritables d’existence [16][16]Quand le monde s’est fait nombre, Éd. du Seuil, 2017, p. 246. ». La statistique suppose donc une disponibilité à l’égard de ce que les chiffres peuvent nous apprendre. Avec les statistiques, l’État moderne renonce à l’illusion de toute-puissance d’un souverain qui vivrait en symbiose avec son corps politique. Par cette kénose intellectuelle, le pouvoir admet qu’il peut apprendre quelque chose sur (et de) la société qui lui fait face.
23La statistique procède, en outre, d’une volonté des souverains européens de comparer leurs territoires et leurs populations à ceux de leurs rivaux. Ce phénomène ne pourrait donc se produire sans l’idée préalable de comparabilité des États européens, idée parfaitement étrangère à la situation unique de l’Empire chinois, seule « civilisation » et même source de toute civilisation. Le développement de la statistique moderne peut être imputé aux effets de long terme de la sécularisation judéo-chrétienne et reste fondamentalement étranger à la tradition chinoise. Dans celle-ci, le souverain est, à travers son activité rituelle, le producteur et le garant non seulement du monde humain, mais encore du cosmos dans son ensemble. Sa parole a pour vocation non pas de refléter une réalité qui lui préexisterait et lui échapperait mais celle de structurer la réalité d’un monde qui sans lui serait sans forme. Le souverain par ses rites et ses rescrits produit le monde : son discours est performatif.
24Dans un tel contexte, on comprend ce que la pratique chinoise des statistiques peut avoir de problématique. Au début du Grand Bond en avant, en juin 1958, un des deux dirigeants du bureau des statistiques, Xu Muqiao, affirme : « Quelles que soient les statistiques que l’administration et le Parti demanderont, nous les leur fournirons, et nos chiffres iront dans la direction des campagnes politiques et de production, quelles qu’elles soient. » Quelques mois plus tard, en août, un éditorial du Quotidien du peuple prétend pousser les chiffres vers le haut et faire faire un « grand bond en avant » à la statistique. La folie criminelle qui consiste à écraser tout écart négatif entre prévision et évaluation occasionnera une des catastrophes les plus meurtrières de l’histoire de l’humanité. La performativité de la parole du pouvoir chinois rencontrait tragiquement le volontarisme forcené du Parti et les rêves de toute-puissance de Mao Zedong.
25Aujourd’hui encore, le statut des chiffres produits par le pouvoir chinois nous apparaît souvent dans une curieuse ambiguïté. Il n’arrive presque jamais que les prévisions du pouvoir soient démenties par la réalité des chiffres, comme si Pékin se devait de contenir la réalité chinoise dans ses discours. Sans que l’on sache toujours s’il s’agit de prévisions, d’objectifs ou d’évaluations, les chiffres chinois sont cependant toujours remarquablement lisses. Les évaluations de pib, par exemple, sont produites avec une célérité inconnue des pays occidentaux, malgré la taille du pays et les écarts depuis longtemps soulignés par les observateurs entre les chiffres fournis par les échelons régionaux et ceux fournis par le pouvoir central. Depuis quelques années, des études universitaires paraissent régulièrement pour contester la fiabilité des statistiques chinoises. Un exemple parmi bien d’autres : en 1998, après la crise financière asiatique, Pékin prétendait, en dépit de toute vraisemblance, que son économie avait connu un taux de croissance de 7,8 %, tout près des 8 % que le spécialiste Tom Orlik qualifie de « chiffre magique » que, pendant longtemps, la Chine se devait d’atteindre [17][17]Tom Orlik, Understanding China’s Economic Indicators.….
26La performativité des chiffres produits par le pouvoir chinois est, bien sûr, progressivement remise en question par l’ouverture au monde de la Chine, la diffusion des pratiques occidentales et la soumission contrainte et forcée des publications officielles chinoises au libre examen de la recherche universitaire et au journalisme d’investigation occidentaux (et parfois même chinois). Mais qu’en sera-t-il demain si la Chine poursuit son effort de restauration impériale et estime progressivement qu’elle n’a plus rien à apprendre du monde extérieur ?
Le système de crédit social : comment Pékin sonde les reins et les cœurs
27Lorsque la mise en place d’un « système de crédit social » par le gouvernement chinois a progressivement été divulguée dans les médias occidentaux à partir de 2015, l’incrédulité a rapidement fait place à la stupéfaction, puis à l’inquiétude. Le régime chinois, dont beaucoup espéraient encore naguère qu’il évoluerait progressivement vers un régime plus libéral sous l’effet de son ouverture économique au monde, faisait preuve d’une capacité d’innovation étonnante non pour se démocratiser, mais, au contraire, pour renforcer son emprise sur la société. Dans un projet s’inspirant des systèmes d’évaluation de la fiabilité des clients et emprunteurs des institutions de crédit occidentales, le pouvoir chinois prévoyait de mettre en place dès 2020 un système global d’évaluation des citoyens, des entreprises et même des administrations. Selon la propagande du gouvernement, ce système avait pour but d’augmenter le niveau de la « qualité humaine » des citoyens chinois afin de lutter contre les incivilités et la délinquance (notamment financière) et d’établir clairement, grâce à une évaluation objective fondée sur l’observation constante des comportements de chacun, en qui il est possible d’avoir confiance.
28Ce projet frappe moins par son caractère « orwellien » (adjectif souvent utilisé par les médias occidentaux) que par la continuité qu’il traduit avec le système impérial, système dans lequel le pouvoir prétendait aussi injecter de la vertu dans le corps social. Dès le début des années 2000, le pouvoir veut faire de la Chine, dans la tradition confucéenne, un pays « gouverné par la vertu ». Cette expression est utilisée par Xi Jinping lui-même, qui veut « promouvoir les vertus traditionnelles chinoises et élever le niveau éthique et moral de la population [18][18]Xi Jinping, « The Rule of Law and the Rule of Virtue »… », notamment grâce à l’exemple que les membres du Parti sont susceptibles d’offrir au public. Mais, outre les effets de l’exemplarité de leur conduite, les fonctionnaires et membres du Parti sont susceptibles d’agir sur le corps social d’une autre manière encore. Le mot qui signifie « vertu » signifie aussi « puissance », une puissance qui est d’abord ce qui émane des « saints » ou de ceux qui exercent un office sacré. Chez Confucius, cette vertu irradiante est l’un des attributs du souverain. C’est grâce à cette aura qui émane de sa personne que celui-ci sera en mesure de produire l’harmonie du corps social. Le système de crédit social vise donc, en s’appuyant sur cette puissance qui émane de la tête de l’État, à contrôler et à civiliser le corps social et à en expulser tout ce qui est susceptible d’en troubler l’harmonie. La juste évaluation des citoyens par la puissance publique participera à cette harmonisation d’au moins quatre manières. Le système de crédit social, en attribuant des récompenses et en infligeant des sanctions, incite chacun à bien se comporter ; il renforce, en outre, l’adhésion au système de ceux qui, inscrits sur des « listes rouges », sont distingués par le pouvoir pour leurs bonnes actions ; il justifie le souverain lui-même en lui octroyant la place inexpugnable de juge suprême, de juge des juges. Enfin, en établissant des « listes noires » de citoyens peu recommandables, il active une fois encore le mécanisme du bouc émissaire.
29Il faut mesurer tout ce qui sépare les pays occidentaux d’un tel projet. Celui-ci procède d’une conception de la vie commune qui fait du pouvoir politique le lieu d’un jugement sans appel sur les personnes. Dans un contexte judéo-chrétien, seul Dieu sonde les reins et les cœurs, et l’existence d’un ordre spirituel vient en quelque sorte relativiser les jugements du monde. S’il est glorieux d’être riche, il n’en reste pas moins qu’il est plus difficile pour un riche d’entrer dans le royaume des Cieux que pour un chameau de passer par le chas d’une aiguille. Tandis qu’avec son système de crédit social Pékin tend à faire du jugement porté sur les hommes par les hommes un jugement dernier, sans recours possible. Le système établira en outre peu à peu une forme d’équivalence entre jugement moral et réussite sociale : si les citoyens inscrits sur les listes noires ne peuvent plus acheter de billets d’avion en classe affaires, cela signifie que ceux qui voyagent en tête des avions sont à la fois riches et vertueux tandis que ceux qui doivent se contenter de la classe économique sont à la fois pauvres et peu recommandables.
30La nature religieuse du projet chinois se manifeste jusque dans le vocabulaire employé pour le décrire. Un chercheur officiel prétend ainsi que l’évaluation du « crédit » des individus (c’est-à-dire de la confiance qu’on peut leur accorder) sera comme la « main invisible » qui disciplinera les citoyens et assurera l’harmonie de la société [19][19]Dai Mucai, « Poursuivre en même temps le gouvernement par la…. Ainsi, à la « main invisible » du marché qui ordonne la société selon les libéraux anglo-saxons, succède la « main invisible » de l’État chinois. Un autre déclare de façon plus explicite encore que le système de crédit social sera le « dieu » de l’ère du big data. Le système participera en outre à la répression des « cultes hérétiques ». À titre d’exemple, dans la ville pilote de Roncheng, où un système de notation est déjà en place, des bonus de points sont accordés à ceux qui dénoncent aux autorités des membres des organisations religieuses non autorisées par le gouvernement, comme à ceux qui financent de façon substantielle les bonnes œuvres du Parti. Quant à ceux qui participent aux activités de ces « cultes hérétiques », ils sont rétrogradés au « niveau d’alerte C » (juste avant le niveau le plus bas, le niveau « D », celui des criminels), le niveau de ceux qui, par exemple, refusent de remplir leurs obligations militaires.
La guerre des dieux, avec des caractéristiques chinoises
31Dans un ouvrage qui reflète, semble-t-il, le point de vue du pouvoir chinois [20][20]Zhang Weiwei, The China Wave (World Century, 2012), ouvrage qui…, l’ancien interprète de Deng Xiaoping, Zhang Weiwei, présente le « Ciel » chinois (le Tian de Tianxia) de façon très éclairante. Selon Zhang, le « concept chinois traditionnel de Tian ou de Ciel […] signifie les intérêts vitaux ou la conscience de la société chinoise ». Et, affirme Zhang, lorsque cette conscience ou ces intérêts vitaux sont violés, il est légitime de s’affranchir des contraintes de l’État de droit pour punir des coupables, même si ceux-ci n’apparaissent pas comme tels aux yeux de la loi. Zhang reproche ainsi aux États-Unis d’avoir été incapables de punir les responsables de la crise financière de 2008 en raison d’un « légalisme » excessif. Ce que justifie ici Zhang et ce qu’il place au cœur de la gouvernance chinoise, c’est le phénomène du bouc émissaire et son instrumentalisation par le pouvoir politique. Lorsque la communauté réclame des coupables, il est du devoir du pouvoir de les lui fournir. « Les dieux ont soif », écrivait Anatole France à propos de la Révolution française. En effet, ce qui est intéressant dans ce contexte, c’est la forme religieuse que prend, sous la plume de Zhang, ce plaidoyer en faveur du lynchage d’État. La volonté du peuple de voir punir des coupables est ainsi gravée par Zhang dans le marbre de la tradition chinoise sous sa forme la moins discutable puisqu’elle se cristallise dans ce qu’il appelle le « Ciel ». Zhang, au-delà de sa rhétorique confucéenne, met ici en lumière le fond sacrificiel de la tradition chinoise qui lui est si chère. Le phénomène du bouc émissaire, c’est l’autre face, la face sombre, de la recherche d’harmonie qui caractérise, selon lui, la tradition chinoise : l’harmonie ne sera possible que lorsque les fauteurs de troubles seront châtiés ou, plus précisément, lorsqu’on aura trouvé des fauteurs de troubles à châtier.
32*
33La mise en lumière des continuités entre l’Empire et le régime actuel ne permet cependant pas d’affirmer qu’il n’y aurait rien de nouveau sous le soleil. Bien au contraire, la modernité et l’influence de l’Occident, je l’ai souligné, ont profondément transformé et transforment encore la Chine. Les conversions multiples au christianisme en sont le signe le plus évident et sans doute le plus dangereux pour le pouvoir, car le christianisme l’attaque dans son essence sacrificielle. Cependant, la force et la nature de la réaction de Pékin sont à la mesure de ces enjeux. Le niveau religieux est en effet celui qui permet le mieux d’appréhender ce qui se joue ici. Pékin l’a bien compris : la volonté de restaurer l’Empire emporte avec elle une forme politique qui fait de l’empereur potentiel Xi Jinping et de sa bureaucratie les figures sacrées du pouvoir. Celles-ci ne sauraient souffrir la concurrence d’organisations religieuses pleinement libres. Pour le Parti l’alternative est claire : les religions devront se soumettre, en se sinisant, ou disparaître. Du point de vue de Pékin, ces organisations religieuses ne peuvent en effet subsister que comme supplétifs du Parti, c’est-à-dire en devenant de simples ressources spirituelles que le régime devra pouvoir détourner à son profit.
Notes
- [1]
Les « 5 000 ans d’histoire » de la Chine font partie intégrante de la mythologie officielle de Pékin, mais n’ont pas de fondement historique. Les premières traces écrites remontent à la dynastie des Shang et guère au-delà de 1200 ans avant J.-C.
- [2]
Étienne Balazs, La Bureaucratie céleste. Recherches sur la société et l’économie de la Chine traditionnelle, Gallimard, « Tel », 1988.
- [3]
Édouard Chavannes, « Les prix de vertu en Chine », Comptes rendus des séances de l’Académie des inscriptions et belles lettres, 48e année, n° 6, 1904, pp. 667-691.
- [4]
C’est l’expression de Xi Jinping lors de son discours devant le XIXe congrès du Parti (18 octobre 2017).
- [5]
Jean Levi, « Le rite, la norme et le tao : philosophie du sacrifice et transcendance du pouvoir en Chine ancienne », in John Lagerwey (sous la dir. de), Religion et société en Chine ancienne et médiévale, Cerf, 2009, p. 166.
- [6]
Jan Jacob Maria De Groot, Sectarianism and Religious Persecution in China, Amsterdam, Johannes Müller, 1903, p. 137.
- [7]
Ibid., Introduction, p. 18.
- [8]
Nectar Gan, « Want to Escape Poverty ? Replace Pictures of Jesus with Xi Jinping, Christian Villagers Urged », South China Morning Post, 14 novembre 2017.
- [9]
J’utilise ici le mot « sacrificiel » au sens que lui a donné René Girard, notamment dans La Violence et le Sacré (Grasset, 1972). Pour Girard, la politique est sacrificielle dans son essence en ce que les communautés humaines sont fondées sur une institution, le sacrifice, qui reproduit un acte originel de mise à mort d’une victime émissaire, acte qui, par la violence, met la violence à distance. Pour Girard (Des choses cachées depuis la fondation du monde, Grasset, 1978), le judéo-christianisme est ce qui permet de dépasser cette violence fondatrice par la révélation biblique de ses mécanismes.
- [10]
« Mon Royaume n’est pas de ce monde » (Jean, XVIII, 36). Cette simple remarque sur l’articulation du politique et du religieux tel qu’il est informé par le christianisme est nécessairement, dans le cadre d’un article consacré à la Chine, très insuffisante. Il n’est sans doute pas incongru ici de renvoyer aux pages classiques et toujours éclairantes de Marcel Gauchet, Le Désenchantement du monde. Une histoire politique de la religion (Gallimard, 1985), en particulier le sous-chapitre intitulé « L’autre monde et l’appropriation du monde », pp. 92-113.
- [11]
Grâce à de récentes études archéologiques, il est avéré que l’institution du sacrifice (aussi bien humain qu’animal) était l’institution centrale de la dynastie semi-historique des Shang. Voir Gideon Shelach, « The Qiang and the Question of Human Sacrifice in the Late Shang Period », Asian Perspectives, vol. 35, n° 1 (été 1996), pp. 1-26. Et Roderick Campbell, « Transformations of Violence : On Humanity and Inhumanity in Early China », in R. Campbell (sous la dir. de), Violence and Civilization, Studies of Social Violence in History and Prehistory, Oxford, Oxbow Books, 2014, pp. 94-118. C’est durant cette période que le système d’écriture chinois (sorte de produit dérivé des rites sacrificiels) a été inventé.
- [12]
La Chine en guerre. Vaincre sans ensanglanter la lame (viiie–iiie avant J.-C.), arkhe, 2018.
- [13]
Ibid., p. 227.
- [14]
Cité par Jean Levi, La Chine en guerre, op. cit., p. 126.
- [15]
Ibid., p. 127.
- [16]
Quand le monde s’est fait nombre, Éd. du Seuil, 2017, p. 246.
- [17]
Tom Orlik, Understanding China’s Economic Indicators. Translating the Data into Investment Opportunities, Upper Saddle River (nj), ft Press, 2011.
- [18]
Xi Jinping, « The Rule of Law and the Rule of Virtue » (discours du 9 décembre 2016), in The Governance of China, t. 2, Pékin, Foreign Languages Press, 2017, p. 146.
- [19]
Dai Mucai, « Poursuivre en même temps le gouvernement par la loi et le gouvernement par la vertu », Le Quotidien du peuple (en chinois), 14 février 2017, p. 7.
- [20]
Zhang Weiwei, The China Wave (World Century, 2012), ouvrage qui évite d’aborder les aspects sombres de l’histoire chinoise et dont on dit qu’il a été lu et approuvé par Xi Jinping.
- Voir encore:
Que disent les nouveaux e-mails rendus publics sur l’origine du SARS-CoV-2 ?
La version non censurée de courriels de l’agence américaine de la santé confirme que la thèse d’une fuite de laboratoire a été sérieusement envisagée, avant de passer à l’arrière-plan.
Au début de la pandémie, les instances de santé américaines ont-elles caché au grand public que le SARS-CoV-2 pouvait provenir d’un laboratoire ? C’est la conclusion que certains tirent d’un document d’une dizaine de pages rendu public le 11 janvier 2022 par le Parti républicain, visant Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des maladies infectieuses américain (Niaid), principal responsable de la gestion de la pandémie aux Etats-Unis.
« Nous avons mis en ligne des e-mails jusqu’alors inédits, montrant que le Dr Fauci a dissimulé des informations à propos d’une origine du Covid-19 en provenance du laboratoire de Wuhan, et intentionnellement minimisé la thèse d’une fuite de laboratoire. »
Cette publication survient alors que le Dr Fauci, auditionné au Sénat américain, accuse les Républicains d’encourager les « détraqués » à le menacer de mort en propageant depuis des mois des accusations mensongères à son sujet.
Que contiennent ces documents ?
Le dossier mis en ligne contient neuf courriels, reçus ou émis par des responsables de l’Institut national américain de la santé (NIH), principale agence de recherche médicale, notamment le généticien Francis Collins. La plupart remontent au tout début de février 2020, quand plusieurs experts internationaux en virologie, immunologie, et biologie évolutionnaire se sont réunis en téléconférence pour discuter de l’origine possible du virus du SARS-CoV-2.
Ces courriels avaient déjà été obtenus par le Washington Post et Buzzfeed en juin 2020, mais une partie du contenu était alors caviardée : ils sont désormais partiellement ou complètement retranscrits. Deux éléments en ressortent :
- Comme le montraient déjà plusieurs e-mails rendus publics, la thèse d’un virus « sorti » d’un laboratoire était dès le début prise au sérieux par les experts, et même parfois jugée plus probable qu’une zoonose (maladie transmise d’un animal à l’homme). « Pour moi, c’est du 70-30 ou 60-40 », écrivait ainsi le virologue Michael Farzan, le 1er février 2020.
- Le NIH a fait pression pour que cette piste soit disqualifiée, par le truchement de publications scientifiques ou de communications de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Il l’a même réduite à une « théorie du complot très destructrice », estimant qu’elle causerait du tort à la recherche scientifique.
Que sait-on de l’authenticité de ces e-mails ?
Ils ont été obtenus dans le cadre du Freedom of Information Act, loi sur le droit à l’information qui oblige les agences fédérales américaines à partager leurs documents à quiconque en fait la demande…
‘Festival of shame’: Why China has cracked down on Christmas
Rising nationalism under Xi Jinping and tensions between China and the West has left little room for foreign culture that Beijing sees as an affront to Chinese values, writes Ahmed Aboudouh
The Independent
23 December 2021
Scorning it as ‘Western spiritual opium’ and the ‘Festival of Shame’, China has cracked down on Christmas in recent years as the Chinese Communist Party’s (CCP) increasingly vociferous brand of nationalism rejects any outside influence or ideas.
Christmas may not be traditional or officially recognised in China, but there are tens of millions of Christians in the country who celebrate the occasion while much of the general public enjoy festive rituals that are common worldwide – be it shopping for gifts or going out with friends.
Yet under the leadership of Xi Jinping – and since relations with the US soured under the presidency of Donald Trump – Beijing has sought to either downplay or exert control over Western culture or beliefs, and Christmas celebrations have been repeatedly denounced.
CCP notices have banned party members, government agencies, and even universities from taking part in any festivities while slogans urging citizens to boycott Christmas are common on social media platforms.
For example, in Hengyang city in Hunan province, authorities said in December 2018 that any Christmas activities or sales that blocked the streets would be removed. The previous December, a local government agency issued a letter warning CCP officials to avoid celebrating the occasion and instead promote traditional Chinese culture.
“Party members must observe the belief of communism and are forbidden to blindly worship the Western spiritual opium,” it read.
Under Mr Xi, the competition with the US and its allies emboldened nationalists at home who have become more vocal in urging society to focus on Chinese culture.
While Christmas around the world is celebrated by non-Christians and is often considered a cultural event as much as a religious one, academics said that the CCP was sensitive about China being open to any foreign influence as it espouses nationalism.
Rana Mitter, professor of history and politics in modern China at Oxford University, said Beijing was becoming more reluctant to allow the “free flow of what it regards as Western ideas”.
“This includes not just religious concepts but also ideas of liberal democracy and constitutionalism,” he told The Independent.
Speaking this month at a national conference on religious affairs, Mr Xi referred to the “sinicization of religion,” a catchphrase requiring all religions, faith, rituals and practices to align with Chinese culture and society.
Since its introduction in 2015, the concept has aimed to bring Christianity, Islam, Buddhism, Taoism and all other religions in China under the CCP’s control and in line with its tradition and ideology.
Mr Xi told the conference there was a need “to develop a religious theory of socialism with Chinese characteristics, work in line with the Party’s basic policy on religious affairs, and uphold the principle that religions in China must be Chinese in orientation.”
The Chinese government has faced global criticism and accusations of genocide from countries including the US for its treatment of the Uyghur population and other mostly-Muslim ethnic minorities in northwestern Xinjiang, where about a million people are estimated to have been detained and subjected to abuses.
By contrast, there are a relatively small number of Christians estimated to be living in China – around 38 million Protestants and 6 million Catholics – and although suffering from abuses related to their religious beliefs, they have not suffered similar targeted persecution.
“The government’s attitude toward Christians, as with other religions, is not necessarily against the religion per se but rather the potential for religion to become a political force and an alternative to the CCP,” said Xing Hang, an associate professor at Brandeis University.
“Government policy is essentially to ensure that churches put the party and state above the religion,” Mr Xing said, adding that Christians might come under greater scrutiny in the future due to growing Chinese nationalism.
This could also be affected by relations between China and the US, which have worsened in recent years after trade disputes with Mr Trump, arguments over military presence in the Indo-Pacific, and pressure put on Beijing over human rights issues by the administration of US President Joe Biden.

File photo: A person dressed as Santa Claus distributes gifts to people outside a shopping complex in Beijing, China, 25 December 2020
Some Chinese officials have tried to deflect attention from Christmas in the country by instead encouraging people to celebrate the birthday of Mao Zedong, the former leader and architect of modern China who was born on 26 December 1893 and died aged 82.
On Christmas Day in 2019, just before the world became aware of the coronavirus pandemic, officials in Linyi, a city in Shandong province, placed a cake with “Happy birthday to Mao” at the footstep of a statue of Mao in the Wangzishan Temple in Pingyi county.
And in Chinese schools, Christmas has been identified as one of the evils in a patriotic education campaign that places great emphasis on rejecting anything Western, according to Bitter Winter, a magazine focused on religious liberty.
For instance, it focuses on teaching students about the “Century of Humiliation” – an account of China’s history between the 19th and 20th centuries where China was “bullied” by Western powers and Japan.
Although any Christmas celebrations in China this year may well be curtailed by the Omicron outbreak, one can still see trees, lights and decorations adorning public spaces and shopping malls in major cities including Shanghai.
This year, one user on Weibo questioned China’s cultural influence abroad and called for promoting national festivals such as the Spring and Mid-Autumn festivals.
They asked: “Wouldn’t it be great if one day the influence of the Spring Festival can reach 1 per cent or even slightly higher than that of Christmas?”
China cancels Christmas: why Santa Claus is not coming to town for Chinese kids
- Options for Christmas celebrations beyond the malls and stores shrink as English-teaching centres shut down following a crackdown
- Rising online nationalism combined with a boycott of Western cultural values is making many parents choose to forgo the festivities to ‘avoid trouble’
Josie Wang and her family are not Christian. But they have celebrated Christmas every year since 2016.
That was the year her son William, then a toddler of three, started learning English with a private education company in Beijing.
Christmas then meant singing carols under the tree with his tutors. As Wang’s flat was too small to put up a Christmas tree and festive decorations, she would usually leave the boy a gift on behalf of Santa, to “reward his good behaviour”.
Xi visiting the Puning Temple. From Weibo.
President Xi Jinping managed to offend Buddhists more deeply through his visit in Hebei last week than he did when visiting Tibet in July, in a trip that was mostly devoted to geopolitical issues and the question of water.
That Xi Jinping’s visit to Chengde, in Hebei province, on August 24 did not create an international scandal only proves how easily history, including history of genocides, is forgotten. In fact, the Chinese president visited and honored a temple built to commemorate a genocide. The Puning Temple in Chengde is inextricably connected with the 18th-century extermination of the Dzungar Buddhists, which virtually all non-Chinese historians recognize as genocide.
The Dzungars were a confederation of Mongol tribes that converted to Buddhism and established a powerful Khanate in the 17th century in present-day Xinjiang. The beautiful temples and monasteries they built there were all destroyed during the Cultural Revolution.
Tibetans do not have a good memory of the Dzungars. Although the Fifth Dalai Lama and the founder of the Dzungar Khanate, Erdenu Batur, were allies, by the 18th century the Khanate had become so powerful that they invaded Tibet and conquered and looted Lhasa in 1717. The Tibetans, perhaps making a mistake justified by their difficult predicament, called the Chinese for help. The Dzungars defeated the Chinese army in 1718 (something the Chinese never forgot), but a second Chinese expedition was more successful, and the Dzungars were expelled from Tibet in 1720. The defeat of 1718 was avenged in 1755, when China moved decisively to annihilate the Dzungar Khanate and exterminate the Dzungar people. Between 500,000 and 800,000 Dzungars (650,000 being the figure advanced by some recent historians) were killed, men, women, and children. Only a few thousand descendants from the Dzungars survive in present-day Mongolia.
Although the Dzungar invasion of Tibet was an act of aggression, nothing can justify the genocide perpetrated by the Qianlong Emperor, the worst mass massacre of the 18th century in the world.

The Puning Temple (credits).
The same Qianlong Emperor built in 1755 the Puning Temple to celebrate what he called his “pacification” of the Dzungars, which was in effect extermination and genocide. He personally inscribed a tablet still venerated in the temple to commemorate his victory over the Dzungars. The architecture itself of the temple, modeled after the Samye Monastery in Tibet, is a powerful political statement of Chinese hegemony over Buddhist lands.
On August 24, Xi Jinping came to the Puning Temple. The visit was prepared by a video the CCP produced to explain to a Chinese audience the historical significance of the event. The video explained the conquest of the Dzungar Khanate and extermination of the Dzungars by claiming that the Qianlong Emperor “put down the rebellion of the Mongol Dzungar tribe.” The temple was presented as “one temple, two styles” (Chinese and Tibetan), a symbol of “Han-Tibetan unity and national unity.”

The video mentioned that Xi “came to Puning Temple to conduct field research on religious work.” We don’t know whether the visit was long enough (slightly more than one hour) to conduct “field research.” According to the official press release, Xi “carefully inspected the historical monuments, the Palace of Heavenly Kings, the Grand Hall, and other buildings, and listened to reports on religious work. Xi Jinping emphasized that we must adhere to the Party’s basic policy of religious work, adhere to the sinicization of our country’s religions, actively guide religions to adapt to the socialist society, […] manage religious affairs in accordance with laws and regulations, and promote religions to better conform to society, serve society, and fulfill social responsibilities.”
This is the usual jargon for total submission of religion to the CCP, but even more significant is that from the Puning Temple Xi went on to visit at the Chengde Museum an exhibition called “Inside and Outside of the Great Wall of Hope: Records of National Unity in the Qing Dynasty,” which is a blatant celebration of the genocidal policies of the Qianlong Emperor, who is praised for having promoted “ethnic unity, border stability, and national unity.” That he did so by killing hundreds of thousands of Dzungars is not explained.

Xi Jinping was right when he said in his speech at the Chengdu Museum that the CCP has continued the work of “the great unity of the Chinese nation” to which the Qianlong Emperor so powerfully contributed. Yes, the CCP continued with genocides against ethnic and religious minorities. Only, the CCP genocides may easily overcome the Qianlong Emperor record of brutality and murder.

In such a significant location, Xi warned ethnic minorities that they should “adhere to the leadership of the CCP, adhere to the correct path of solving ethnic problems with Chinese characteristics, fully implement the Party’s ethnic theory and ethnic policies, and constantly consolidate and develop socialist ethnic relations.” They are, Xi said, inscribed in “historical laws” —one of which seems to be that either you submit or you are exterminated through genocide.
Voir de plus:
La consommation de chair humaine en Chine
1Dans un récit du Youyang zazu 酉阳杂俎 (Miscellanées de Youyang)1, un général de la dynastie des Tang, réputé pour son habitude de manger tout et n’importe quoi, affirme : « Il n’y a rien qui ne puisse être mangé. Le secret réside dans la maîtrise du mode de cuisson, et dans l’art d’assaisonner. »2 Qu’en est-il de la chair humaine ? Quel rapport les Chinois entretiennent-ils avec la pratique du cannibalisme ?3 Le sujet est-il tabou dans l’Histoire de Chine ? Quelles traces en reste-t-il dans les ouvrages historiques et littéraires ?
- 4 Cf. Lin Ling 林翎, « Zhongguo lishishang zui beican de yi ye : chi renrou » 中国历史上最悲惨的一页:吃人肉 (« L’une (…)
- 5 Robert des Rotours, « Quelques notes sur l’anthropophagie en Chine », T’oung Pao, n° 50, 1963, p. (…)
2Pour reprendre les mots du chercheur taïwanais Lin Fu-shih 林富士 (pseudonyme Lin Ling 林翎) (1960 – ) : « L’expérience qu’ont les Chinois de la consommation de viande humaine est sans doute la plus riche du monde »4. Le sinologue français Robert des Rotours (1891 – 1980), dans son article « Quelques notes sur l’anthropophagie en Chine », indique que la consommation de viande humaine se pratique dans quatre buts principaux : pour survivre (en période de famine), dans un but de vengeance (sur un ennemi défini), pour satisfaire ses goûts culinaires, et enfin dans un but médical5. J’ajouterais une cinquième catégorie, à savoir le témoignage de la piété filiale, rattaché à deux des catégories précédentes (famine et maladie), mais dont la pratique est singulière puisqu’il se pratique sur des personnes vivantes et volontaires (don de soi).
- 6 Cf. Georges Guille-Escuret, Sociologie comparée du cannibalisme, vol. 2 : la consommation d’autrui (…)
3Après avoir épluché longuement l’historiographie chinoise, le Professeur Key Ray Chong (1933 – ) a dénombré pas moins de 1219 évocations d’une pratique cannibale entre l’Antiquité et 1912 : 780 motivés par la piété filiale, 329 liés à la famine, 82 à la haine et à la guerre, et une infime minorité motivée par des penchants culinaires6. A tout cela, il faudra ajouter les faits qui se sont déroulés au xxe siècle, avec un cannibalisme pratiqué dans un but idéologique.
- 7 Voir notamment les références présentées en notes 5 et 6. Voir aussi Huang Wenxiong 黃文雄,, Zhongguo (…)
4Les travaux de recherche étant déjà assez complets sur le sujet7, nous ne proposerons ici qu’un simple panorama, en nous appuyant sur diverses sources : recueils de contes fantastiques, ouvrages de pharmacopée, chroniques historiques, nouvelles, romans. Nous donnerons des exemples concrets de pratiques cannibales selon les axes préalablement cités : par plaisir, à des fins médicales, par piété filiale, pour survivre lors de périodes de famine, par vengeance et cruauté, et enfin par idéologie.
- 8 Sima Qian, Shiji, « Qi taigong shijia » 齐太公世家
- 9 Cf. Guanzi 管子, « 小称 » : « 易牙以厨艺服侍齐桓公。齐桓公说:“只有蒸婴儿肉还没尝过。”於是易牙将其长子蒸了献给齐桓公吃. » Voir aussi Han Fei zi 韩 (…)
5Les exemples de personnages historiques amateurs de viande humaine ne manquent pas en Chine. Le cas le plus connu est sans doute celui du quinzième souverain de l’Etat de Qi (Qi Heng gong 齐恒公), sous les Royaumes Combattants, qui régna de 685 à 643 avant notre ère. Dans ses Mémoires historiques (Shiji 史记), Sima Qian 司马迁 le présente comme un dirigeant lubrique et sans morale8. Une réputation due en partie à l’anecdote selon laquelle son fidèle ministre Yi Ya 易牙, pour satisfaire ses désirs, lui offrit la chair de son propre fils9.
- 10 Connu aussi sous le nom de Lushi zashuo 卢氏杂说, écrit par Lu Yan 卢言 sous la dynastie des Tang.
6Plus d’un millénaire après, le Lushi zaji 卢氏杂记10 raconte également :
- 11 Traduction personnelle. Texte original : « 唐张茂昭为节镇,频吃人肉,及除统军,到京。班中有人问曰:闻尚书在镇好人肉,虚实?”昭笑曰:“人肉腥而且肕,争堪 (…)
Le gouverneur militaire Zhang Maozhao [762-811] de la dynastie des Tang était connu pour manger de la viande humaine. Lorsqu’il rejoignit le haut commandement de l’armée impériale, il se rendit à la capitale. L’un de ses collègues officiers lui demanda alors : « On dit que vous mangez de la chair humaine. Est-ce vrai ? » Zhang Maozhao répondit avec un sourire : « Allons donc ! La chair humaine est bien trop dure et fétide ! »11
- 12 Cf. Chaoye qianzai 朝野佥载, in TPGJ, j. 267, rubrique « Actes de cruauté » 酷暴, récit « Dugu Zhuang » (…)
7Un autre récit mettant en avant la cruauté d’un gouverneur de province nommé Dugu Zhuang 独孤庄 explique qu’il termina sa vie fou, et que la seule pensée qui lui vint alors à l’esprit était de manger de la chair humaine. Par contre, il ne tua pas à dessein pour assouvir son désir : il se contenta de manger le cadavre d’une servante décédée12.
- 13 Recueil de biji composé par Zhang Zhuo 张鷟 (657-730) sous la dynastie des Tang.
8Si cette tendance à l’anthropophagie existe, les condamnations morales sont néanmoins courantes. Le souverain de l’Etat de Qi, cité plus haut, finira, ironiquement, par mourir de faim : on pourrait voir dans cette fin tragique une punition céleste. Dans le deuxième récit présenté, la réaction de l’officier prouve que la consommation de viande humaine choque l’opinion. Enfin, dans un texte tiré du Chaoye qianzai 朝野佥载 (Rapport complet sur les affaires à la cour et en dehors)13, un amateur de viande humaine est publiquement et sévèrement puni :
- 14 Traduction personnelle. Texte original : « 周杭州临安尉薛震好食人肉。有债主及奴诣临安,于客舍,遂饮之醉。杀而脔之,以水银和煎,并骨消尽。后又欲食其妇,妇 (…)
Sous la dynastie Zhou [690 – 705, fondée par l’Impératrice Wu Zetian], Xue Zhen, chef du district de Lin’an près de Hangzhou, adorait la chair humaine. Un jour, un de ses créanciers, accompagné d’un domestique, fit halte dans une auberge de Lin’an. Là, il burent jusqu’à l’ivresse. Xue Zhen en profita pour les tuer. Il les découpa en morceaux, arrosa le tout de mercure, les fit frire et s’en régala. Il n’en resta même pas les os. Par la suite, il projeta de manger également son épouse. En découvrant ses intentions, la femme prit la fuite. Le magistrat du district enquêta et fit un rapport aux autorités provinciales, qui elles-mêmes en référèrent aux autorités impériales. Xue Zhen fut condamné à être battu à mort.14
- 15 Cf. Des Rotours, « Quelques notes sur l’anthropophagie en Chine », op. cit., p. 397. L’auteur cite (…)
- 16 Cf. Marco Polo, La Description du monde, Pierre-Yves Badel (trad.), chapitre LXXIV. Paris : Le liv (…)
- 17 Ibidem, chapitre CLIV, p. 267.
- 18 Voir partie 5 du présent article, sur le cannibalisme guerrier.
9Mais l’exemple le plus horripilant concerne certainement la dynastie éphémère des Zhao postérieurs 后赵 (319-352), avec les habitudes du cruel dirigeant Shi Sui 石邃, qui succéda à son père Shi Hu 石虎, lui-même neveu de Shi Le石勒, brigand fondateur de la dynastie : une fois au pouvoir, il prit l’habitude de faire tuer et préparer en cuisines ses plus belles concubines, pour les offrir à ses invités lors de banquets, prenant soin de laisser sur la table la tête des belles15. Des rumeurs circulent également à propos de la dynastie mongole des Yuan. Marco Polo raconte notamment à propos de la ville de Shangdu 商都 (résidence d’été de Kubilai Khan, en Mongolie intérieure) que des devins originaires du Tibet et du Cachemire mangeaient la chair des condamnés à mort : « Quand un homme est condamné à mort et qu’il a été exécuté par le gouvernement, ils le prennent, le font cuire et le mangent. »16 Il écrit également à propos des habitants des villes et villages sous l’autorité de Fuzhou (province du Fujian) : « […] Ils mangent de toutes les viandes, je vous assure qu’ils mangent de la chair d’un homme avec plaisir dès lors qu’il n’est pas mort de mort naturelle : ceux qui sont tués, on les recherche et on les mange avec plaisir, car on les tient pour une bonne viande »17. Il s’agit néanmoins ici de la viande d’un ennemi : le plaisir se mêle à l’esprit de vengeance et de combat18.
10Pour conclure, même si elles sont avérées, les pratiques d’un véritable « cannibalisme jouissif » en tant que tel restent minoritaires dans l’Histoire de Chine, se limitent à quelques personnages historiques la plupart du temps fous ou cruels, et sont généralement moralement condamnées.
2. La consommation de viande humaine à des fins médicales
- 19 Chen Zangqi, après avoir étudié minutieusement le Classique de Materia medica du Divin laboureur ((…)
- 20 Chen Zangqi 陈藏器, Bencao shiyi 本草拾遗 : « 人肉疗羸瘵 ».
- 21 Cf. Xin Tangshu 新唐书, chap. 195. Cité in Des Rotours, « Quelques notes sur l’anthropophagie en Chin (…)
- 22 Cf. J. Becker, La grande famine de Mao (titre original : Hungry Ghosts, China’s secret Famine), Mi (…)
- 23 Cf. J. Becker, La grande famine de Mao, op. cit., p. 302.
11Dans son ouvrage de pharmacopée Bencao shiyi 本草拾遗19, le botaniste et médecin Chen Zangqi 陈藏器 (687-757) présente la chair humaine comme un reconstituant20. A la suite de cette annonce, « des fils pieux se firent couper des morceaux de chair pour la donner à leurs parents afin de guérir leur maladie »21. Li Shizhen 李时珍(1518-1593), médecin de l’époque des Ming, répertorie dans son Bencao gangmu 本草纲目 (Compendium de materia medica) « 35 parties ou organes du corps humain ainsi que les différentes maladies et douleurs que lesdites parties pouvaient servir à soigner. »22 Le journaliste britannique Jasper Becker (1956 – ) raconte encore que, toujours sous la dynastie des Ming, les eunuques mangeaient la cervelle de jeunes hommes vigoureux dans le but de « recouvrer leur puissance sexuelle »23.
- 24 « Le Journal d’un fou », in Cris, Sebastian Veg (trad.). Paris : Editions rues d’Ulm, 2010, p. 24.
- 25 Ibidem, note 7 p. 181.
- 26 Cf. Wells Williams, The Middle Kingdom. New York, (1847) 1899, vol. I, p. 514. Cité in Des Rotours (…)
12Ces vertus médicales ont traversé les siècles. Dans la nouvelle « Le journal d’un fou », le protagoniste cite d’ailleurs le Bencao gangmu en disant : « Dans l’Herbier quelque chose de leur maître à penser Li Shizhen, il est écrit clairement que la chair humaine peut être mangée grillée. »24 Sébastian Veg signale à ce sujet qu’une prescription du Bencao gangmu recommande en effet la consommation de chair humaine grillée pour traiter la tuberculose25. Il était également courant de se procurer le sang d’un supplicié pour se donner du courage ou augmenter sa virilité26. Lu Xun 鲁迅 (1881 – 1936) s’est d’ailleurs inspiré de cette croyance pour construire l’intrigue de sa nouvelle « Le remède » (« Yao » 药).
13Dans cette nouvelle, le vieux Shuan, propriétaire d’une maison de thé, sort discrètement à l’aube acheter contre une bourse pleine d’argent un petit pain à la vapeur imbibé du sang encore frais d’un supplicié. Il se sent mal à l’aise, mais heureux de le faire, car pour lui, cette marchandise est précieuse : il la destine à son fils unique, tuberculeux. Le jeune garçon l’engloutit, sans savoir ce que c’est. Ses parents, le vieux Shuan et la mère Hua, affirment que cela le guérira. Lu Xun construit bien sa nouvelle : ce n’est qu’au troisième chapitre qu’on apprend ce que contient réellement le petit pain ainsi que l’identité de celui qui l’a vendu au vieux Shuan, c’est-à-dire le bourreau, Sieur Kang. Ce dernier vient d’ailleurs fanfaronner dans la maison de thé et s’écrie : « C’est garanti, garanti ! Il faut l’avaler chaud. Un petit pain au sang humain, c’est un remède garanti contre toute tuberculose. » Mais en dépit du grand espoir placé en ce remède, le fils Shuan décède. La mère Hua se retrouve, le jour de la fête des Morts (Qingming jie 清明节), sur la tombe de son fils. Elle y rencontre la vieille mère du supplicié, dont son fils avait bu le sang à travers le petit pain. Ce n’est pas un hasard si Lu Xun a choisi d’écrire cette nouvelle, parallèlement au « Journal d’un fou », et qu’il y a intégré, dans l’une comme dans l’autre, des références au cannibalisme. Sebastian Veg, qui a traduit les deux nouvelles en 2010, commente :
- 27 Cf. Cris, op. cit., p. 214. Voir la traduction intégrale de la nouvelle p. 39-48.
Plusieurs raisons incitent à penser que la nouvelle forme un diptyque avec le « Journal d’un fou ». D’abord, l’intrigue du « Médicament » est annoncée à l’entrée X du « Journal » : « L’année dernière, quand on a exécuté un criminel en ville, un tuberculeux a utilisé un petit pain cuit à la vapeur pour le tremper dans son sang et le lécher. » Ensuite, les allusions historiques se complètent […]. On retrouve dans le « Médicament » les thèmes du cannibalisme, notamment à travers le petit pain trempé de sang, et de la médecine, avec un léger déplacement d’accent.27
- 28 Cf. Han Shaogong, Pa pa pa (N. Dutrait, Hu Sishe, trad.). La Tour d’Aigues : Editions de l’Aube, c (…)
- 29 Cf. Noël Dutrait, « Le pays de l’alcool de Mo Yan [Entretien avec l’auteur] », Perspectives chinoi (…)
- 30 Connu en Occident sous le nom de Fruit Chan.
- 31 Concernant la consommation de fœtus humains, citons également les exhibitions controversées de l’a (…)
14Au niveau de la littérature contemporaine, nous pouvons citer la nouvelle « Ba ba ba » 爸爸爸 de Han Shaogong 韩少功 (1953 – ), dans laquelle la mère du protagoniste, Bingzai, accoucheuse, confectionne des fortifiants à base de placentas28. Plus près de nous, Mo Yan 莫言 (1956 – ) explique que ce qui lui a donné l’idée de son roman Le Pays de l’alcool (Jiuguo 酒国) est la pratique courante de récupérer dans les hôpitaux les fœtus humains de trois mois (issus majoritairement d’avortements) et de les réduire en poudre pour en faire un fortifiant29. Fait qui n’est pas sans rappeler l’intrigue du film La nouvelle cuisine (Jiaozi 饺子), réalisé par le Hongkongais Chen Guo 陳果30 (1959 – ) en 2004, dans lequel une femme nommée Tante Mei vend des raviolis fourrés aux fœtus humains, promesses de la beauté et de la jeunesse éternelles31.
- 32 On trouve parfois le terme 股 (signifiant « la cuisse ») à la place de 骨 (« l’os »). Voir à ce suje (…)
15Les actes de cannibalisme réalisés dans un but de piété filiale sont, dans les ouvrages historiques, extrêmement nombreux. Nous l’avons déjà abordé dans la partie précédente, à propos du Bencao shiyi de Chen Zangqi. Il s’agit d’un don physique de soi (comprendre « don d’une partie de soi ») pour soigner ou nourrir un parent ou un beau-parent. Cette pratique porte le nom de « gegu liaoqin » 割骨疗亲32. Les premières traces remontent à l’époque des Six Dynasties, sous la dynastie des Song (420-479), où il est dit :
- 33 Cf. J. Becker, La grande famine de Mao, op. cit., p. 302.
Les gens découpaient parfois des parties de leur corps pour nourrir un ancien vénéré. Souvent, c’est la belle-fille qui coupait une partie de sa jambe ou de sa cuisse afin de faire une soupe nourrissante pour une belle-mère malade, et cette pratique était devenue si courante que l’Etat fut contraint de publier un édit l’interdisant.33
- 34 Cf. Key Ray Chong, Cannibalism in Chine, p. 159. Cité in Georges Guille-Escuret, Sociologie compar (…)
- 35 Sur le fait de s’approprier l’âme d’un défunt respecté à travers l’endo-cannibalisme (principaleme (…)
16La pratique se perpétua jusque sous les dernières dynasties impériales, et peut-être plus tard… Rey Kay Chong, qui a réalisé une étude très complète sur ce sujet, révèle, chiffres à la clé, que ce sont majoritairement les femmes qui se sacrifient pour prouver leur piété filiale. Il explique par exemple que sur 653 cas répertoriés sous la dynastie des Ming : « les dons masculins représentent moins de 1% […] Deux fois sur trois, une belle-fille nourrit l’un de ses beaux-parents […]. Une fois sur quatre, la fille nourrit un de ses ascendants […]. A dix-neuf reprises, l’épouse a alimenté le mari, jamais en sens inverse. »34 Les morceaux de chair sont généralement prélevés sur la cuisse ou le bras. On peut parler ici « d’homophagie » (consommer la chair d’un parent consanguin) ou « d’endo-cannibalisme » (consommer la chair d’un proche — une belle-fille par exemple —, ou d’une personne du même clan)35, sauf que la personne mangée n’est pas une victime rituelle ici, puisqu’elle offre volontairement une partie d’elle-même.
- 36 Des Rotours, « Quelques notes sur l’anthropophagie en Chine », op. cit., p. 416.
- 37 Nous avons trouvé le résumé de cette pièce sur le site http://www.luquanren.com/Article/ShowArticl (…)
17Les personnes qui se sacrifient pour guérir un parent proche sont louées pour leur comportement exemplaire d’enfant respectueux à l’extrême de la piété filiale, une vertu présentée comme essentielle dans le confucianisme. Cela a même donné naissance à des chefs d’œuvre littéraires. Robert des Rotours raconte notamment : « A Pékin, en 1921, j’ai vu une pièce de théâtre qui, si mes souvenirs sont exacts, était intitulée Ting-xiang ko jeou, « Ting-xiang coupe sa chair » ; l’héroïne de la pièce faisait couper sa chair pour guérir la maladie de sa mère. »36 Ses souvenirs sont bien exacts, à quelques détails près. Il s’agit en réalité d’un opéra de Pékin qui s’intitule en pinyin Dingxiang gerou 丁香割肉. L’histoire se passe dans un village. Une veuve vit avec ses trois belles-filles et son fils cadet, les deux aînés travaillant loin de la maison. Seul son fils cadet se montre pieux envers elle en s’occupant diligemment de leurs terres, et seule l’épouse de ce dernier, nommée Dingxiang, se montre polie et dévouée. Les deux autres belles-filles, perfides et jalouses, font tout pour envenimer les relations entre Dingxiang et la belle-mère, en vain. Jusqu’au jour où elles font croire à la vieille dame que Dingxiang lui a lancé une malédiction pour que son corps entier soit couvert de furoncles et qu’elle finisse par en mourir. Écœurée et terrifiée par ce qu’elle vient d’entendre, la belle-mère tombe malade : du jour au lendemain, elle ne peut plus rien avaler, ni nourriture ni liquide, et semble avoir perdu la raison. Un prêtre taoïste explique à son fils cadet que le seul remède valable est de lui faire boire un bouillon fait avec de la viande humaine. Sans hésiter un instant, Dingxiang se rend dans sa chambre et se coupe un morceau de la cuisse. L’épouse du fils aîné saisit l’occasion pour servir le bouillon à sa belle-mère en lui faisant croire qu’il s’agit de sa propre chair, et que Dingxiang reste enfermée dans sa chambre en feignant d’être malade. La belle-mère, une fois guérie, est outrée par le comportement de Dingxiang : elle sort de ses gongs et part la molester. Mais elle trouve celle-ci mal en point, alitée, couverte de sueur et gémissante. Elle comprend alors ce qui s’est réellement passé et punit les deux perfides comme il se doit. Par la suite, Dingxiang est érigée dans le village en modèle de piété filiale37.
- 38 Cf. Cris, op. cit., p. 205. Malgré tout, rappelons que ce ne sont pas toujours les jeunes qui se s (…)
18Paradoxalement, c’est cette piété filiale tant louée dans l’Histoire de Chine que Lu Xun dénonce dans sa nouvelle « Le journal d’un fou », la présentant comme une forme cachée de cannibalisme. Comme l’explique Sebastian Veg : « La révélation nocturne du protagoniste consiste en la prise de conscience que les livres anciens sont remplis de prescriptions cannibales, recouvertes par le vernis moral des quatre vertus cardinales « humanité, justice, voie, vertu ». C’est en particulier la piété filiale, et plus généralement le pouvoir des anciens et des hommes sur les plus jeunes et les femmes »38.
- 39 Tout le monde a à l’esprit le naufrage de la frégate Méduse, de la Marine française, échouée au la (…)
- 40 Rémi Mathieu, Anthologie des mythes et légendes de la Chine ancienne. Paris : Gallimard, coll. « C (…)
19Universellement, la faim a poussé au cannibalisme39. La Chine ne fait pas figure d’exception. Et les traces de cette pratique sont très anciennes. Les yayu 猰狳, bêtes sauvages légendaires et anthropophages, sont censées avoir régulièrement sévi durant les périodes de pénurie alimentaire à l’époque mythique. Elles sont définies par Rémi Mathieu comme des quadrupèdes à tête de dragon et parfois comme des renards ou des chats sauvages anthropophages des contrées occidentales40. Ces créatures ont-elles réellement existé ? Ou bien sont-elles utilisées pour désigner une population précise qui se serait livrée à des actes de cannibalisme durant une période de pénurie ? On peut en effet se poser la question.
- 41 Cf. Sima Guang 司马光, Zizhi tongjian 资治通鉴 (Miroir compréhensif pour aider le gouvernement), juan 17 (…)
- 42 Cf. Ying Shao 应劭 (140 – 206), Fengsu tongyi 风俗通义 (« Généralités sur les moeurs et les coutumes »), (…)
20Le grand avantage qu’on a lorsqu’on étudie le cannibalisme dans l’Empire du Milieu est qu’il n’y aucun tabou à cet égard en Chine. Concernant les cas de cannibalisme en période de famine, les historiographes chinois ont toujours pris soin de les noter. Comme l’explique Sima Guang 司马光 (1019-1086), historien de la dynastie des Song : « En période de famine, les humains se mangent entre eux »41. Dans la Chine ancienne, les enfants sont généralement consommés en premier : les gens s’échangent leurs enfants, pour ne pas avoir à manger leur progéniture (d’où l’expression « yi zi xi hai » 易子析骸)42. Parfois, les acteurs mis en cause peuvent constituer un groupe entier, dont les membres sont solidaires. La viande humaine est consommée dans un but de survie, que cela implique ou non de tuer les victimes. Il est dit notamment dans le Chaoye qianzai 朝野佥载, cité plus haut :
- 43 Traduction personnelle. Texte original : « 隋末荒乱,狂贼朱粲起于襄、邓间。岁饥,米斛万钱,亦无得处,人民相食。粲乃驱男女小大,仰一大铜钟,可二百石,煮人 (…)
Lors de la période troublée de la fin des Sui [581-618], le fanatique brigand Zhu Can leva ses troupes dans la région de Xiangzhou et Dengzhou. En cette période de famine, une simple once de riz coûtait 10 000 pièces. Mais comme on ne pouvait de toute façon en acheter nulle part, les gens venaient à se manger entre eux. Zhu Can fit alors amener un groupe d’hommes et de femmes, jeunes et vieux, ainsi qu’une énorme cloche en cuivre, qui pouvait à elle seule contenir jusqu’à deux cents dan de céréales. Il y fit cuire les malheureux pour rassasier ses troupes. Et c’est ainsi que périrent de nombreuses gens.43
- 44 Nous ne traiterons pas de tous ces cas en détail. Un grand nombre ont déjà été minutieusement répe (…)
- 45 Cf. Ji Yun 纪昀, Yuewei caotang biji 阅微草堂笔记, « 滦阳消夏录 », juan 2 : « 盖前崇禎末,河南 、山东大旱蝗,草根树皮皆尽,乃以人为粮,官吏弗能 (…)
21Les exemples au cours de l’Histoire sont extrêmement variés : famines dues à de mauvaises récoltes, périodes troublées, villes assiégées44. La pratique semble s’être perpétuée jusque sous les Ming, puisqu’on raconte qu’à la fin du règne de l’empereur Chongzhen 崇祯 (1628 – 1644), lors d’une terrible famine, il existait des marchés de viande humaine dans les provinces du Henan et du Shandong. Les victimes, majoritairement des femmes et des enfants, étaient désignées sous le terme « d’humains d’alimentation » (cairen 菜人)45.
- 46 Theodore White, A la quête de l’Histoire, Henri Rollet (trad.). Montréal : Stanké, 1979, p. 165-16 (…)
22Ce qui attire cependant l’attention des chercheurs depuis quelques décennies, ce sont les faits de cannibalisme qui ont eu lieu non pas sous les dernières dynasties impériales, mais au cours du xxe siècle, par exemple lors de la famine durant la guerre civile, notamment dans la province du Henan. Le journaliste américain du Time Magazine, Theodore White (1915 – 1986), nous en livre un témoignage poignant dans son ouvrage A la quête de l’Histoire. Il prend soin de préciser, néanmoins, que les personnes mangées étaient toutes décédées de mort naturelle avant d’être consommées46.
- 47 Cf. Cris, op. cit., p. 281.
- 48 Ibidem, p. 28.
- 49 Ibid., p. 29.
23Ces faits historiques se retrouvent dans la littérature moderne et contemporaine. Citons par exemple un extrait de la nouvelle « Le journal d’un fou » de Lu Xun. Alors qu’une période de disette sévit dans son village, le protagoniste est pris d’un délire de persécution : il est persuadé que l’ensemble des gens qui l’entourent (voisins, villageois, membres de sa famille) projettent de le tuer pour le manger. Tout le monde est suspect à ses yeux, même son frère, même le docteur qui vient l’examiner, comme si un complot énorme se tramait autour de lui. Les habitants le pousseraient au suicide pour ne pas avoir à le tuer eux-mêmes et ne pas se heurter à la vengeance de son âme. Ils le feraient également passer pour un fou pour se déculpabiliser. La nouvelle serait avant toute chose une métaphore de la « société ancienne cannibale » forgée par Lu Xun et figée dans le discours révolutionnaire communiste à travers la dénonciation rituelle du « féodalisme »47. A travers les propos de son protagoniste, Lu Xun explique dans sa nouvelle : « Au début, les hommes sauvages ont tous dû manger un peu d’homme. Ensuite, développant des idées différentes, certains n’ont plus mangé d’homme ; en décidant de s’améliorer, ils sont devenus des êtres humains, de vrais êtres humains. »48 Et un peu plus loin : « Vous pouvez changer, changez sincèrement ! Vous devez comprendre qu’on ne tolérera plus les mangeurs d’homme dans ce monde à l’avenir. »49 Si Lu Xun avait su ce que le demi-siècle suivant allait réserver de monstruosités en la matière, il aurait sûrement ajouté une fin moins heureuse à sa nouvelle…
24Il en est de même dans le roman de Chen Zhongshi 陈忠实, Au pays du cerf blanc (Bailu yuan 白鹿原), dont le récit se situe peu après la chute de la dynastie des Qing puis pendant la lutte entre nationalistes et communistes. Au chapitre 18, alors que sévit une terrible famine, un couple essaie de convaincre son fils de tuer sa femme pour la manger :
- 50 Cf. Chen Zhongshi, Au pays du cerf blanc, Shao Baoqing / Solange Cruveillé (trad.). Paris : Le Seu (…)
Mourir de faim n’effrayait plus, ne surprenait plus. Les premiers à périr furent les personnes âgées et les enfants, car c’étaient les plus fragiles. Quand les vieux mouraient, non seulement on n’était plus accablé, mais on se réjouissait des économies qu’on allait réaliser et qui allaient permettre aux personnes plus utiles de survivre. Seuls les ragots pouvaient encore éveiller quelque intérêt chez les gens. Ainsi, on racontait qu’une jeune femme, mariée depuis un an, réveillée au milieu de la nuit par la faim et ne parvenant pas à se rendormir, tâta le lit et se rendit compte que son mari n’était pas là. Se doutant qu’il mangeait à la dérobée avec ses beaux-parents, elle se glissa à pas feutrés sous la fenêtre de la belle-mère et surprit son mari et ses parents en pleine discussion :
— Ne t’inquiète pas, dit le beau-père, dès que la famine sera finie, on te trouvera une nouvelle femme. Il faut la tuer, sinon toute la famille va crever de faim ! Alors, non seulement tu perdras ta femme, mais en plus notre nom s’éteindra !
La jeune femme, terrifiée, partit la nuit même chez ses parents. Là, elle s’endormit, calmée par les consolations de sa mère. Mais elle ne mit pas longtemps à se réveiller à nouveau. Elle entendit son père dire :
— Plutôt que de la laisser manger par les autres, mieux vaudrait la manger nous-mêmes !
La jeune femme tomba de son lit et perdit la raison…
Les rumeurs de ce genre, à l’instar des croassements de corbeaux, faisaient froid dans le dos.50
- 51 Cf. Yang Jisheng 楊繼繩,, Mubei : Zhongguo liushi niandai da jihuang jishi 墓碑——中國六十年代大饑荒紀實. Taïwan : (…)
- 52 Cf. J. Becker, La grande famine de Mao, op. cit., pp. 295-305.
- 53 Ibidem, p. 300.
25Mais l’exemple historique le plus récent concerne la période noire du Grand Bond en avant (1958 – 1962), lancé par Mao, qui entraîna la plus grande famine du siècle et fit, selon les estimations, entre 30 et 50 millions de morts en Chine51. Jasper Becker, auteur de l’ouvrage très complet La grande famine de Mao, consacre un court chapitre au cannibalisme52. On constate que de nombreuses provinces furent touchées : le Sichuan, le Liaoning, l’Anhui, le Shaanxi, le Ningxia, le Hebei, mais aussi le Tibet, le Qinghai, le Gansu et le Heilongjiang. Comme dans la Chine ancienne, les premières victimes tuées à dessein pour se nourrir étaient les enfants. Ceux qui consommaient de la chair humaine étaient même décrits comme « ayant une odeur étrange, leurs yeux et leur peau prenant une couleur rouge. »53 L’écrivain Ma Jian 马建 (1953 – ) cite également des événements similaires qui eurent lieu sous la Révolution Culturelle, dans son roman Beijing Coma (Beijing zhiwu ren 北京植物人) :
- 54 Ma Jian, Beijing Coma, Constance de Saint-Mont (trad. de l’anglais). Paris : J’ai lu, « Par ailleu (…)
Je me rappelai un passage du journal de mon père qui décrivait un acte de cannibalisme dont il avait été témoin [dans un camp du] Gansu : « Trois jours après que Jiang est mort de faim, Hu et Gao ont découpé des tranches dans sa fesse et sa cuisse et les ont rôties sur un feu. Ils ne s’attendaient pas à ce que la femme de Jiang vienne chercher le corps le lendemain. Elle avait pleuré pendant des heures en tenant son corps mutilé dans ses bras. » […] Je n’arrive tout simplement pas à imaginer comment on peut se résoudre à manger de la chair humaine. Mon père m’a dit que sur les trois mille droitistes qui avaient été envoyés [dans le camp de rééducation du Gansu], mille sept cents étaient morts de faim. Parfois les survivants étaient si affamés qu’ils étaient obligés de manger les cadavres.54
- 55 Nous aborderons ce point dans la partie 6.
26Nous verrons que malheureusement, à cette époque-là, les cas de cannibalisme ne furent pas tous motivés par la faim…55
- 56 Georges Guille-Escuret, Sociologie comparée du cannibalisme, vol. 2, op. cit., p. 97.
- 57 « Chidiao diren yige shi » 吃掉敌人一个师. Cf. Dictionnaire chinois-français 汉法词典,. Beijing : Shangwu yin (…)
27Le cannibalisme peut également être pratiqué en temps de guerre ou de rivalité, dans un but de punition, de vengeance ou de simple cruauté, faisant de l’acte de dévorer les organes des victimes défaites un symbole de possession, de prise de pouvoir. Comme l’explique Georges Guille-Escuret, docteur en ethnologie et en biologie, consommer la chair de l’ennemi ou d’un prisonnier est, en cas de guerre, un symbole d’allégeance à son souverain ou à son général, et un témoignage de la solidarité et de l’unité du groupe56. Ne dit-on pas, en chinois, lorsqu’on anéantit une division ennemie, qu’on « l’engloutit » ?57 Faut-il voir dans cette expression autre chose qu’une image ? On peut se poser la question…
- 58 Cf. Robert des Rotours, « Quelques notes sur l’anthropophagie en Chine », op. cit., p. 389. Voir a (…)
- 59 Cf. Sima Qian, Shiji, « Qingbu liezhuan » 黥布列传.
- 60 Des Rotours cite à ce sujet le Traité des châtiments et des Lois (Xingfa zhi 刑法志), dont un passage (…)
- 61 Source : Sima Guang, Zizhi tongjian 资治通鉴, juan 111 : « 醢诸县令,以食其妻子;不肯食者,辄支解之». Traduction Robert de (…)
28La référence la plus célèbre concerne l’Archer Yi 羿, que ses serviteurs mirent à mort. Ils le firent ensuite bouillir et forcèrent ses fils à manger sa chair. Refusant d’obtempérer, les fils furent tués à leur tour58. Dans les Mémoires historiques, Sima Qian raconte aussi que Liu Bang 刘邦 (256 – 195 avant notre ère), fondateur de la dynastie des Han et coutumier des actes de vengeance, obligea les princes feudataires à manger la chair de son ancien allié Peng Yue 彭越, soupçonné de préparer une rébellion, qu’il avait fait occire et cuisiner59. Cette manœuvre avait pour but de dissuader les princes de se liguer contre lui60. Un autre exemple connu concerne le cruel pirate Sun En 孙恩, meneur d’une révolte paysanne d’inspiration taoïste dans la région du Zhejiang, en 399 de notre ère : « Il faisait mettre en hachis salé les sous-préfets de la région [de Shaoxing 绍兴] pour les donner à manger à leurs épouses et à leurs enfants ; si ceux-ci se refusaient à les manger, il les faisait dépecer. »61
29La punition, qui a toujours pour but d’effrayer, peut parfois être ordonnée sur un simple coup de sang, comme c’est le cas dans un texte du Tang zhiyan 唐摭言, recueil de biji composé par Wang Dingbao 王定保 (870-940) sous les Cinq dynasties :
- 62 Traduction personnelle. Texte original : « 周岭南首陈元光设客,令一袍裤行酒。光怒,令曳出,遂杀之。须臾烂煮,以食诸客。后呈其二手,客惧,攫喉而吐。 » (…)
Sous la dynastie des Zhou [fondée par l’Impératrice Wu Zetian], Chen Yuanguang, le chef de la région de Lingnan [Guangdong et Guangxi], organisa un banquet pour recevoir des invités. Il demanda à un de ses officiers de servir l’alcool. Soudain, Chen Yuanguang se mit terriblement en colère contre lui : il ordonna qu’on le fasse sortir et qu’on le tue. En peu de temps, le cadavre du pauvre homme fut cuisiné et on le servit aux invités. Lorsque ces derniers aperçurent finalement deux mains dans le plat, ils s’enfoncèrent aussitôt les doigts dans la gorge pour se faire vomir.62
- 63 Cf. Yutang xianhua 玉堂闲话, in TPGJ, j. 269, rubrique « Actes de cruauté », récit « Zhao Siwan » 赵思绾, (…)
30Dans son Yutang xianhua 玉堂闲话 (« Bavardages du Hall de Jade »), recueil de biji composé à la fin des Tang et au début des Cinq Dynasties, Wang Renyu 王仁裕 (880-956) raconte encore que le général séditieux Zhao Siwan 赵思绾, avant d’être vaincu, dévora les foies de soixante-six victimes. Certaines, à ce moment-là, étaient encore agonisantes63.
- 64 Voir à ce sujet le court article de Lin Ling 林翎, « 中国历史上最悲惨的一页:吃人肉 », op. cit., p. 2.
- 65 Tao Zongyi, Chuogeng lu, chap. 9 : « 想肉天下兵甲方殷,而淮右之军嗜食人,以小儿为上,妇女次之,男子又次之. »
- 66 Cf. Lin Ling, op. cit., p. 4 : « 战争真正可怕的地方不是在于屠戮生命,而是在于摧残人性。 »
31Sous les Yuan, on trouve même des détails expliquant la façon de cuisiner la viande humaine. Cela se fait principalement dans un contexte de guerre, pour nourrir les troupes armées lors de périodes de pénurie alimentaire64. Tao Zongyi 陶宗仪 (fin des Yuan, début des Ming), auteur du recueil de biji Chuogeng lu 辍耕录 (Archives de l’arrêt des cultures), explique au chapitre 9 : « En période de guerre […] la chair des enfants est considérée comme la plus exquise des nourritures ; vient ensuite celle des femmes, et en dernier celle des hommes »65. La viande peut être rôtie, bouillie, les victimes cuites vivantes, entières ou en morceaux (jambes, poitrine). Ceux qui en mangent trouvent cela tellement bon qu’ils qualifient la viande humaine de « viande désirée » (xiangrou 想肉). Il faut cependant ici bien insister sur le contexte : il ne s’agit pas de combler un caprice alimentaire, ni simplement de trouver un moyen de nourrir les soldats. La barbarie est mise en avant à tout point de vue, la cruauté est sans limite, et Tao Zongyi présente ces événements comme des actes vils et inhumains. Comme l’explique Lin Fu-shih : « Ce qu’il y a de véritablement effrayant dans la guerre, ce n’est pas le fait de massacrer des vies, mais de porter atteinte à ce qui nous rend humain »66.
6. Le cannibalisme culturel et idéologique
- 67 Cf. Han Shaogong, Pa pa pa, N. Dutrait (trad.), op. cit., p. 7
32La pratique relève, à ce stade, soit de la folie meurtrière, soit de la superstition. Comme l’explique Noël Dutrait dans la préface de la traduction française de Ba ba ba de Han Shaogong, le passé millénaire de la Chine voit s’opposer deux cultures : la culture confucéenne « rationaliste » et la culture « non orthodoxe » des minorités, régie par des règles et des religions primitives67.
- 68 Cf. Jasper Becker, La grande famine de Mao, op. cit., p. 301.
- 69 Cf. J. Becker, op. cit. p. 304. Voir aussi Georges Guille-Escuret, Sociologie comparée du cannibal (…)
- 70 Cf. J. Becker, op. cit., p. 304.
33Kay Ray Chong, dans son étude le cannibalisme en Chine, défend l’idée qu’il y a en Chine un « cannibalisme de survie » (époques de famine…) et un « cannibalisme culturel ». C’est cela qui fait selon lui de la Chine un cas à part68. Cet acte barbare de manger la chair d’un ennemi est-il cantonné à la Chine ancienne et classique ? Assurément pas. En effet, des faits similaires se sont déroulés au xixe siècle à Canton, à propos d’une querelle autour du droit sur l’eau. Cet épisode est relaté par le sinologue James Dyer Ball (1847 – 1919) dans son livre Choses vues en Chine : « Après chaque escarmouche, les hommes faits prisonniers étaient abattus. Ensuite les cœurs et les foies étaient distribués et mangés ; on permettait même aux jeunes enfants de participer au festin. »69 Plus près de nous, au niveau littéraire, au chapitre IV de Ba ba ba, Han Shaogong raconte que lors d’une période de rivalités entre deux villages voisins, une guerre est déclarée. L’un des villages fait alors bouillir dans une marmite un porc et le cadavre d’un ennemi coupé en morceaux, et chaque habitant, malgré l’écœurement, est obligé de manger un morceau pioché au hasard dans le bouillon, pour prouver sa solidarité envers les membres du village. Des cas ont par ailleurs été relevés lors de la guerre civile opposant communistes et nationalistes70.
- 71 Zheng Yi, Stèles rouges, Françoise Lemoine & Anne Auyeung (trad.). Paris : Bleu de Chine, 1999, 28 (…)
- 72 10 000 personnes pour l’ensemble de la région.
- 73 Voir le compte-rendu de l’ouvrage rédigé par Max Lagarrigue, in Communisme, n° 65/66, L’âge d’homm (…)
34Mais la preuve la plus démesurée est l’étude édifiante réalisée par l’écrivain Zheng Yi 郑义 (1947 – ) (de son vrai nom Zheng Guangzhao 郑光召) dans la province du Guangxi, et publiée dans son ouvrage Hongse jinianbei 紅色纪念碑 (Stèles rouges : du totalitarisme au cannibalisme)71. Il y répertorie des centaines de cas de cannibalisme qui eurent lieu durant la Révolution culturelle (1966 – 1976), avec cette fois une visée purement idéologique : « Dans le seul district de Wuxuan [Guangxi], au cours de la Révolution culturelle, 504 personnes ont été tuées et plus d’une centaine dévorée […]72. L’estimation du nombre de cannibales pour ce district est de 10 000. »73
- 74 Sur ces faits, le lecteur intéressé pourra se reporter à l’article « Le cannibalisme au Guangxi » (…)
- 75 Notons néanmoins qu’à la fin de la Révolution Culturelle, certaines victimes ont été réhabilitées, (…)
- 76 Voir le compte-rendu de lecture de Jean-Jacques Gandini in Perspectives chinoises n° 57, janvier-f (…)
- 77 Zheng Yi, Stèles rouges, op. cit., p. 163.
- 78 Une petite nuance à apporter cependant à cette qualification, puisqu’on relève dans l’ouvrage que (…)
35Les faits les plus marquants concernent le meurtre d’une professeure d’école par ses propres élèves, qui, ensuite, se partagèrent son cœur, son foie et la chair de ses cuisses. Ceux qui ne voulaient pas suivre le mouvement risquaient le même traitement, de sorte qu’une hystérie collective submergea toute la ville puis toute la région74. Le principal prétexte à ces orgies ? La lutte des classes. Certains bourreaux clamant haut et fort qu’il ne s’agissait pas simplement de chair humaine, mais de « chair de propriétaire foncier », de « chair de traitre », de « chair d’ennemis de classe ». Les victimes étaient généralement tuées et découpées à la suite de séances de pidou 批斗, ces séances d’humiliation publique courantes sous la Révolution Culturelle. Les personnes ciblées pouvaient être des voisins, des professeurs, des élèves. Elles pouvaient être dépecées vivantes, et leur chair pouvait être consommée lors de banquets collectifs, au vu et au su des autorités75. Pour Zheng Yi : « Le cannibalisme pendant la Révolution Culturelle au Guangxi correspond au despotisme sanguinaire du Parti communiste »76. Il qualifie ainsi ces faits : « une atrocité organisée, armée par la théorie de la dictature du prolétariat, de la lutte des classes du marxisme-léninisme et de la pensée de Mao »77. En ce sens, on peut véritablement parler ici de « cannibalisme culturel »78.
- 79 Cf. Lu Xun, Fleurs du matin cueillies le soir, François Jullien (trad.). Lausanne : A. Eibel, 1976 (…)
- 80 Cf. « Le cannibalisme au Guangxi » (extrait de Stèles rouges de Zheng Yi), op. cit., p. 74.
- 81 Cf. Cris, op. cit., p. 205.
36On pense aussitôt au récit de Lu Xun, Fleurs du matin cueillies le soir (Zhao hua xi shi 朝花夕拾), écrit en 1928. L’auteur se serait inspiré de la tragédie arrivée à l’un de ses amis rencontré au Japon et devenu gouverneur de l’Anhui. Le malheureux fut mis à mort puis son cœur et son foie furent donnés à manger aux soldats du gouvernement79. On pense également à la nouvelle de Lu Xun « Le journal d’un fou » vue plus haut, à propos de laquelle Zheng Yi écrit » « Ce qui n’était que du symbolisme dans son roman était malheureusement devenu réalité dans la grandiose et radieuse société socialiste. »80 Pour Sébastian Veg, le cannibalisme renvoie in fine à « la lutte de tous contre tous »81.
37Ma Jian ajoute sa pierre à l’édifice concernant les faits qui se sont déroulés dans le Guangxi sous la Révolution culturelle, toujours dans son roman Beijing Coma. Alors que le protagoniste effectue un voyage dans le fameux district de Wuxuan (où Zheng Yi mena ses investigations), il rencontre un certain Docteur Song qui lui raconte :
- 82 Ma Jian, Beijing Coma, op. cit., pp. 89-90.
« Ici, [dans le Guangxi], ce n’est pas la faim qui poussait les gens au cannibalisme. C’était la haine. »
Je ne voyais pas ce qu’il voulait dire.
« Il ne leur suffisait pas d’exécuter leurs ennemis ? Pourquoi fallait-il qu’ils les mangent en plus ?
— C’était en 1968, une des années les plus violentes de la Révolution culturelle. [Dans le Guangxi], tuer les ennemis de classe n’était pas suffisant, les comités révolutionnaires locaux forçaient les gens à les manger en plus. Au début, les cadavres des ennemis étaient mis à mijoter dans de grandes cuves avec des pieds de porc. Mais à mesure que la campagne progressait, il y avait trop de cadavres, et seuls le cœur, le foie et la cervelle étaient cuits. […] Tu vois ces volumes que mon équipe de chercheurs vient de retrouver : Chroniques de la Révolution culturelle dans la province du Guangxi. Regarde, il est écrit ici que dans la province du Guangxi, en 1968, plus de 100 000 personnes ont été tuées, et que dans le seul district de Wuxuan, 3523 personnes ont été assassinées, et que 350 d’entre elles furent mangées. Si je n’avais pas été emprisonné en août de cette année-là, j’aurais sans doute été tué moi aussi. »82
38Il nous raconte plus en détail les actes de l’ethnie Zhuang de la province du Guangxi, dans son autre roman Chemins de poussière rouge (Hongchen 红尘), en reprenant les faits présentés plus haut concernant une professeure :
- 83 Ma Jian, Chemins de poussière rouge, Jean-Jacques Bretou (trad. de l’anglais). Paris : « J’ai lu » (…)
J’ai passé une grande partie du mois dernier dans le village de Longzhou près de la frontière vietnamienne. […] J’ai pensé aux étudiants du village voisin qui ont massacré leur professeur pendant la Révolution culturelle. Pour prouver leur dévotion au Parti, ils l’ont découpé en morceaux, fait cuire dans une bassine avant de la manger pour le dîner. Comme ils avaient pris goût aux abats frais, avant de tuer leur victime suivante, ils lui ont ouvert le ventre et lui ont tapé dans le dos pour faire tomber le foie encore chaud dans leurs mains. Les villages locaux ont dû consommer environ trois cents ennemis de classe ces années-là.83
- 84 Georges Guille-Escuret, Sociologie comparée du cannibalisme, vol.2 , op. cit., pp. 116-117.
39Ma Jian s’est-il inspiré de l’enquête de Zheng Yi ou bien a-t-il réellement entendu parler de ces faits connus de tous dans la région ? Quoi qu’il en soit, si barbares soient-ils, ces événements sont à relativiser. Georges Guille-Escuret voit dans l’étude de Zheng Yi un pessimisme extrême et un jugement généralisé et partial sur une nation chinoise présentée comme barbare, alors qu’à ses yeux, les pratiques cannibales de l’ethnie Zhuang du Guangxi étaient surtout influencées par un passé chamanique ancestral et par la tradition d’un cannibalisme guerrier84.
40Au fil de notre article, nous avons présenté les différentes motivations poussant à la consommation de chair humaine en Chine : guerres, vengeances, famines, idéologie, piété filiale, croyances médicales, rituels ancestraux, penchants culinaires. Nous avons vu les multiples influences que les événements historiques ont eues sur les auteurs anciens, notamment de recueils de contes du premier millénaire, mais aussi sur les auteurs modernes (Lu Xun) et contemporains (Han Shaogong, Mo Yan, Chen Zhongshi, Ma Jian). Il y en a assurément une multitude d’autres.
41Les écrivains chinois sont tout à fait au courant de l’existence de ces pratiques, ils en ont tous plus ou moins entendu parler. L’aveu de Mo Yan à ce sujet est significatif :
- 85 Voir plus haut, note 8.
- 86 Nous avons fait le choix de ne pas traiter du cannibalisme dans le Shuihu zhuan 水浒传, car il s’agit (…)
- 87 Cf. Dutrait Noël, « Le pays de l’alcool de Mo Yan », op. cit., p. 60. Sur cette dernière phrase, o (…)
Existe-t-il réellement dans la société chinoise des faits de cannibalisme ? Historiquement, c’est sûr. Prenez l’exemple de Yi Ya à l’époque des Royaumes Combattants, qui a donné son fils à manger au duc Huan de Qi85. D’autres faits sont attestés à l’époque féodale ; la piété filiale contraignait à donner sa propre chair pour soigner ses parents ; Lu Xun et son Journal d’un fou qui se termine par l’appel « Sauvez les enfants » ; les témoignages de Zheng Yi à l’époque de la Révolution culturelle sur des actes de cannibalisme dans le sud du pays. Tout prouve que le cannibalisme a existé. On en trouve aussi des traces dans le Roman des Trois Royaumes ou dans Au bord de l’eau86 ; mais pour ce qui est de notre époque, nous n’avons pas réellement de preuves que des enfants aient été dévorés, comme je l’écris dans mon roman où le cannibalisme a une valeur plutôt symbolique.87
42La consommation de chair humaine, c’est un fait, a été récurrente dans l’Histoire de Chine et a laissé une empreinte indélébile, et ce jusqu’au siècle dernier. La grande diligence des historiographes et des écrivains chinois, mais aussi le travail énorme fourni par les spécialistes ou chercheurs chinois et européens — dont vous avons à de multiples reprises cité les ouvrages — nous ont permis d’en faire une étude succincte mais complète du sujet : nous leur sommes redevables de tant de sincérité sur une pratique, rappelons-le, généralement taboue et condamnée.
43Reste à savoir si le cannibalisme continuera ou non d’influencer les auteurs chinois, et donnera lieu à de nouvelles études qui apporteront, peut-être, un nouvel éclairage sur ces épisodes sombres de l’Histoire de Chine.
Attachment
-
La consommation de chair – textes originaux traduits (application/pdf – 172k)
Notes
1 Recueil de biji 笔记 de Duan Chengshi 段成式 (803-863).
2 Traduction personnelle. Texte original : « 无物不堪吃,唯在火候,善均五味。 » (Cf. Duan Chengshi 段成式, Xiyang zazu 酉阳杂俎, cité dans le Taiping guangji 太平广记 (TPGJ), juan 234, rubrique « Nourriture » 食, récit « Bai zhangni » 败障泥. Cf. Li Fang 李昉, Taiping Guangji. Beijing : Zhonghua shuju, 1986, p. 1794.).
3 A propos de la terminologie utilisée dans notre article, précisons que l’anthropophagie désigne le fait de consommer de la viande humaine (peu importe l’espèce animale qui consomme cette viande), alors que le cannibalisme désigne le fait de manger un individu de la même espèce que la sienne. À ce titre, lorsqu’on parle des êtres humains, un cannibale est forcément anthropophage et vice versa. Les deux termes seront donc utilisés dans notre article, même si nous privilégierons le mot « cannibalisme », qui peut posséder en outre, selon le contexte, une connotation rituelle.
4 Cf. Lin Ling 林翎, « Zhongguo lishishang zui beican de yi ye : chi renrou » 中国历史上最悲惨的一页:吃人肉 (« L’une des pages les plus tragiques de l’Histoire de Chine : le cannibalisme »), in Zhongyang ribao 中央日報, avril 1989, Editions Changhe, p. 1 : « 中国人吃人的经验可能是世界上最丰富的。. »
5 Robert des Rotours, « Quelques notes sur l’anthropophagie en Chine », T’oung Pao, n° 50, 1963, p. 387
6 Cf. Georges Guille-Escuret, Sociologie comparée du cannibalisme, vol. 2 : la consommation d’autrui en Asie et en Océanie. Paris : PUF, 2012, p. 89 et p. 91, d’après sa lecture de l’ouvrage de Key Ray Chong, Cannibalism in China. Wakefield : Longwood Academic, 1990, 200 p. Ledit ouvrage a été traduit en chinois sous la référence suivante : Key Ray Chong 鄭麒來, Zhongguo gudai de shiren, ren chi ren xingwei toushi 中國古代的食人: 人吃人行為透視. Beijing : Zhongguo she hui ke xue, 1994. Voir particulièrement la partie 5 sur la littérature.
7 Voir notamment les références présentées en notes 5 et 6. Voir aussi Huang Wenxiong 黃文雄,, Zhongguo shiren shi 中國食人史 (Histoire du cannibalisme en Chine). Taipei : Qianwei, 2005, 235 p. D’autres ouvrages seront cités au fil de l’article.
8 Sima Qian, Shiji, « Qi taigong shijia » 齐太公世家
9 Cf. Guanzi 管子, « 小称 » : « 易牙以厨艺服侍齐桓公。齐桓公说:“只有蒸婴儿肉还没尝过。”於是易牙将其长子蒸了献给齐桓公吃. » Voir aussi Han Fei zi 韩非子, « 二柄·难一皆 » : « 齐桓公好味,易牙蒸其子首而进之。 ».
10 Connu aussi sous le nom de Lushi zashuo 卢氏杂说, écrit par Lu Yan 卢言 sous la dynastie des Tang.
11 Traduction personnelle. Texte original : « 唐张茂昭为节镇,频吃人肉,及除统军,到京。班中有人问曰:闻尚书在镇好人肉,虚实?”昭笑曰:“人肉腥而且肕,争堪吃。” » (Cf. Lushi zazi 卢氏杂记, in TPGJ, j. 261, rubrique « Raillerie » 嗤鄙, récit « Zhang Maozhao » 张茂昭, édition de référence p. 2035).
12 Cf. Chaoye qianzai 朝野佥载, in TPGJ, j. 267, rubrique « Actes de cruauté » 酷暴, récit « Dugu Zhuang » 独狐庄, p. 2094-2095.
13 Recueil de biji composé par Zhang Zhuo 张鷟 (657-730) sous la dynastie des Tang.
14 Traduction personnelle. Texte original : « 周杭州临安尉薛震好食人肉。有债主及奴诣临安,于客舍,遂饮之醉。杀而脔之,以水银和煎,并骨消尽。后又欲食其妇,妇觉而遁。县令诘得其情,申州,录事奏,奉敕杖杀之。 ». Cf. Chaoye qianzai 朝野佥载, in TPGJ, j. 267, rubrique « Actes de cruauté » 酷暴, récit « Xuezhen » 薛震, p. 2094).
15 Cf. Des Rotours, « Quelques notes sur l’anthropophagie en Chine », op. cit., p. 397. L’auteur cite un passage du Shiliu guo chunqiu 十六国春秋, « Hou zhao lu » 后赵录.
16 Cf. Marco Polo, La Description du monde, Pierre-Yves Badel (trad.), chapitre LXXIV. Paris : Le livre de Poche, coll. « Classiques », 2012, p. 140.
17 Ibidem, chapitre CLIV, p. 267.
18 Voir partie 5 du présent article, sur le cannibalisme guerrier.
19 Chen Zangqi, après avoir étudié minutieusement le Classique de Materia medica du Divin laboureur (Shennong bencao jing 神农本草经) (époque Han), considéré comme le plus grand classique de pharmacopée chinoise, estima qu’il y avait dedans beaucoup de lacunes, et décida d’y remédier en publiant un ouvrage plus complet.
20 Chen Zangqi 陈藏器, Bencao shiyi 本草拾遗 : « 人肉疗羸瘵 ».
21 Cf. Xin Tangshu 新唐书, chap. 195. Cité in Des Rotours, « Quelques notes sur l’anthropophagie en Chine », op. cit., p. 416. On peut se demander néanmoins s’il ne s’agit pas plutôt, en fait de « fils pieux », de « filles » et de « belles-filles » pieuses. Voir la partie suivante du présent article sur le cannibalisme et la piété filiale.
22 Cf. J. Becker, La grande famine de Mao (titre original : Hungry Ghosts, China’s secret Famine), Michel Pencréach (trad.). Paris : Dagorno, 1998, p. 302. Pour une étude poussée des parties du corps humains aux vertus médicinales présentées dans le Bencao gangmu, voir W.C. Cooper et Nathan Sivin, « Man as a Medicine: Pharmacological and Ritual Aspects of Traditional Therapy Using Drugs Derived from the Human Body », in Chinese Science : Exploration of an Ancient Tradition. Cambridge : The MIT Press, 1973, p. 203-272.
23 Cf. J. Becker, La grande famine de Mao, op. cit., p. 302.
24 « Le Journal d’un fou », in Cris, Sebastian Veg (trad.). Paris : Editions rues d’Ulm, 2010, p. 24.
25 Ibidem, note 7 p. 181.
26 Cf. Wells Williams, The Middle Kingdom. New York, (1847) 1899, vol. I, p. 514. Cité in Des Rotours, « Quelques notes sur l’anthropophagie en Chine », op. cit., p. 421. Voir aussi Edgar Snow, Living China. Londres, 1936, p. 29.
27 Cf. Cris, op. cit., p. 214. Voir la traduction intégrale de la nouvelle p. 39-48.
28 Cf. Han Shaogong, Pa pa pa (N. Dutrait, Hu Sishe, trad.). La Tour d’Aigues : Editions de l’Aube, coll. « Proche », 1995.
29 Cf. Noël Dutrait, « Le pays de l’alcool de Mo Yan [Entretien avec l’auteur] », Perspectives chinoises, n° 58, avril 2000, p. 60.
30 Connu en Occident sous le nom de Fruit Chan.
31 Concernant la consommation de fœtus humains, citons également les exhibitions controversées de l’artiste chinois contemporain Zhu Yu 朱昱 (1970 – ), se présentant comme le premier « artiste cannibale » et se délectant de soupes de fœtus humains dans le simple but de choquer. Pour plus d’informations sur cet artiste, mais aussi sur le fait de manger des fœtus en Chine et à Taiwan, voir l’article de Meiling Cheng, « Violent Capital: Zhu Yu on File », The Drama Review, Vol. 49, No. 3 (Autumn, 2005), The MIT Press, p. 58-77.
32 On trouve parfois le terme 股 (signifiant « la cuisse ») à la place de 骨 (« l’os »). Voir à ce sujet l’intervention de Chün Fang Yü de l’Université de Rutgers : « Filial Piety, Iatric Cannibalism and the Cult of Kuan-yin in Late Imperial China », AAS Convention, Washington, avril 1994.
33 Cf. J. Becker, La grande famine de Mao, op. cit., p. 302.
34 Cf. Key Ray Chong, Cannibalism in Chine, p. 159. Cité in Georges Guille-Escuret, Sociologie comparée du cannibalisme, vol. 2, op. cit., p. 91-92.
35 Sur le fait de s’approprier l’âme d’un défunt respecté à travers l’endo-cannibalisme (principalement sous la préhistoire), voir l’article de M. Patou-Mathis, « Aux racines du cannibalisme », La Recherche, janvier 2000.
36 Des Rotours, « Quelques notes sur l’anthropophagie en Chine », op. cit., p. 416.
37 Nous avons trouvé le résumé de cette pièce sur le site http://www.luquanren.com/Article/ShowArticle.asp?ArticleID=302. Dernière date de consultation : 20 mai 2015.
38 Cf. Cris, op. cit., p. 205. Malgré tout, rappelons que ce ne sont pas toujours les jeunes qui se sacrifient pour les vieux. A la fin de la nouvelle Ba ba ba de Han Shaogong, en pleine période de famine, le tailleur Zheng prépare une décoction mortelle pour supprimer les vieillards (dont lui-même), les impotents et les bébés, afin de laisser plus de chances de survie aux jeunes gens, faisant passer la lignée avant tout. Tout le monde boit le breuvage volontairement.
39 Tout le monde a à l’esprit le naufrage de la frégate Méduse, de la Marine française, échouée au large de la Mauritanie en 1816 : une minorité de naufragés ayant pris place sur un radeau survécut, principalement grâce à la consommation de chair humaine. Il en fut de même pour les survivants du crash aérien du vol 571 Fuerza Aérea Uruguaya dans la cordillère des Andes le 13 octobre 1972. Pour plus d’informations à ce sujet, voir l’article en ligne du Point du 20/12/2012, « Sauvetage de seize rugbymen cannibales dans les Andes. ». http://www.lepoint.fr/c-est-arrive-aujourd-hui/20-decembre-1972-bien-avant-chabal-il-existait-deja-des-rugbymen-cannibales-dans-les-andes-20-12-2012-1604056_494.php
40 Rémi Mathieu, Anthologie des mythes et légendes de la Chine ancienne. Paris : Gallimard, coll. « Connaissance de l’Orient », 1989, p. 113
41 Cf. Sima Guang 司马光, Zizhi tongjian 资治通鉴 (Miroir compréhensif pour aider le gouvernement), juan 17 : « Da ji, ren xiang shi » 大饥,人相食.
42 Cf. Ying Shao 应劭 (140 – 206), Fengsu tongyi 风俗通义 (« Généralités sur les moeurs et les coutumes »), « 皇霸·五伯».
43 Traduction personnelle. Texte original : « 隋末荒乱,狂贼朱粲起于襄、邓间。岁饥,米斛万钱,亦无得处,人民相食。粲乃驱男女小大,仰一大铜钟,可二百石,煮人肉以喂贼。生灵歼于此矣。»,Cf. Chaoye qianzai, in TPGJ, j. 267, rubrique « Actes de cruauté », récit 朱粲, p. 2093.
44 Nous ne traiterons pas de tous ces cas en détail. Un grand nombre ont déjà été minutieusement répertoriés dans les articles de Robert des Rotours (« Quelques notes sur l’anthropophagie en Chine », op. cit. et « Encore quelques notes sur l’anthropophagie en Chine », T’oung Pao, n° 54, 1/3, Leiden : Brill, 1968, p. 1-49) ainsi que dans l’ouvrage de Key Ray Chong, Cannibalism in China, op. cit.
45 Cf. Ji Yun 纪昀, Yuewei caotang biji 阅微草堂笔记, « 滦阳消夏录 », juan 2 : « 盖前崇禎末,河南 、山东大旱蝗,草根树皮皆尽,乃以人为粮,官吏弗能禁。妇女幼孩反接鬻于市,谓之菜人 婦女幼孩,反接鬻於市,謂之菜人 ». Voir la traduction de Jacques Dars in Ji Yun, Passe-temps d’un été à Luanyang. Paris : Gallimard, coll. « Connaissance de l’Orient », 1998, p. 135, « Humains à cuisiner » : « C’est qu’à la fin de l’ère Chongzhen de la précédente dynastie, quand par suite de la sécheresse et des ravages de sauterelles au Henan et au Shandong il ne resta plus ni racines ni écorces, on se nourrit de chair humaine, sans que les fonctionnaires officiels pussent l’interdire. Femmes et jeunes enfants, mains liées derrière le dos, étaient vendus sur les marchés comme « humains à cuisiner », que les bouchers achetaient et emmenaient pour les débiter tels des moutons ou des porcs. »
46 Theodore White, A la quête de l’Histoire, Henri Rollet (trad.). Montréal : Stanké, 1979, p. 165-167. Pour la version originale, voir T. White, In search of History. Harpercollins, 1978, 561 p.
47 Cf. Cris, op. cit., p. 281.
48 Ibidem, p. 28.
49 Ibid., p. 29.
50 Cf. Chen Zhongshi, Au pays du cerf blanc, Shao Baoqing / Solange Cruveillé (trad.). Paris : Le Seuil, 2012, p. 378.
51 Cf. Yang Jisheng 楊繼繩,, Mubei : Zhongguo liushi niandai da jihuang jishi 墓碑——中國六十年代大饑荒紀實. Taïwan : Tiandi tushu, 2009, 660 p. Pour une traduction, voir Yang Jisheng, Stèles, la Grande famine en Chine, 1958-1961. Paris : Le Seuil, 2012, 660 p. Voir aussi Zhou Xun, The Great Famine in China, 1958-1962. Yale University Press, 2012.
52 Cf. J. Becker, La grande famine de Mao, op. cit., pp. 295-305.
53 Ibidem, p. 300.
54 Ma Jian, Beijing Coma, Constance de Saint-Mont (trad. de l’anglais). Paris : J’ai lu, « Par ailleurs », 2009, p. 88.
55 Nous aborderons ce point dans la partie 6.
56 Georges Guille-Escuret, Sociologie comparée du cannibalisme, vol. 2, op. cit., p. 97.
57 « Chidiao diren yige shi » 吃掉敌人一个师. Cf. Dictionnaire chinois-français 汉法词典,. Beijing : Shangwu yinshu guan, 2011, p. 87.
58 Cf. Robert des Rotours, « Quelques notes sur l’anthropophagie en Chine », op. cit., p. 389. Voir aussi Séraphin Couvreur, Tso tchouan. Ho kien fou, 1914, tome II, p. 205 ; et Marcel Granet, Danses et légendes de la Chine ancienne. Paris : Presses Universitaires de France, 1926, p. 164.
59 Cf. Sima Qian, Shiji, « Qingbu liezhuan » 黥布列传.
60 Des Rotours cite à ce sujet le Traité des châtiments et des Lois (Xingfa zhi 刑法志), dont un passage décrit les différentes façons de cuire les restes d’un condamné : en hachis, avec ou sans les os, mélangés avec des légumes ou avec de la viande, en gros ou en petits morceaux… Les destinataires de ce genre de préparation sont avertis de la nature de la viande, et se contentent souvent de la considérer comme un avertissement. Mais il arrive également qu’ils soient tenus d’en consommer, pour prouver leur solidarité envers leur souverain et leur haine à l’égard du traître (Cf. « Quelques notes sur l’anthropophagie en Chine », op. cit., pp. 391-392).
61 Source : Sima Guang, Zizhi tongjian 资治通鉴, juan 111 : « 醢诸县令,以食其妻子;不肯食者,辄支解之». Traduction Robert des Rotours, « Quelques notes sur l’anthropophagie en Chine », op. cit. ,p. 398.
62 Traduction personnelle. Texte original : « 周岭南首陈元光设客,令一袍裤行酒。光怒,令曳出,遂杀之。须臾烂煮,以食诸客。后呈其二手,客惧,攫喉而吐。 » (Cf. Zhiyan 摭言, in TPGJ, j. 267, rubrique « Actes de cruauté » 酷暴, récit « 陈元光 », p. 2094).
63 Cf. Yutang xianhua 玉堂闲话, in TPGJ, j. 269, rubrique « Actes de cruauté », récit « Zhao Siwan » 赵思绾, p. 2114.
64 Voir à ce sujet le court article de Lin Ling 林翎, « 中国历史上最悲惨的一页:吃人肉 », op. cit., p. 2.
65 Tao Zongyi, Chuogeng lu, chap. 9 : « 想肉天下兵甲方殷,而淮右之军嗜食人,以小儿为上,妇女次之,男子又次之. »
66 Cf. Lin Ling, op. cit., p. 4 : « 战争真正可怕的地方不是在于屠戮生命,而是在于摧残人性。 »
67 Cf. Han Shaogong, Pa pa pa, N. Dutrait (trad.), op. cit., p. 7
68 Cf. Jasper Becker, La grande famine de Mao, op. cit., p. 301.
69 Cf. J. Becker, op. cit. p. 304. Voir aussi Georges Guille-Escuret, Sociologie comparée du cannibalisme, vol.2, op. cit., p. 107.
70 Cf. J. Becker, op. cit., p. 304.
71 Zheng Yi, Stèles rouges, Françoise Lemoine & Anne Auyeung (trad.). Paris : Bleu de Chine, 1999, 288 p. Au départ, Zheng Yi avait commencé son enquête dans le but d’écrire un roman. Ce qu’il découvrit le fit changer d’avis et donna lieu à la publication même de l’enquête. Mais pour ce faire, Zheng Yi dut quitter la Chine continentale. Le livre est paru d’abord à Taïwan. Il vit aujourd’hui avec sa femme aux Etats-Unis. Pour plus d’informations sur cet auteur et l’histoire de la rédaction de ce livre, voir Michel Bonnin, Perspectives chinoises, n° 11-12, janvier/février 1993, pp. 68-71. Voir aussi Jacques Andrieu, « Les gardes rouges : des rebelles sous influence », Revue Cultures et Conflits, n° 18, 1995, pp.121-164. Pour une étude contextualisée des événements présentés dans le livre de Zheng Yi, voir enfin Donald Sutton, « Consuming Counterrevolution: The Ritual and Culture of Cannibalism in Wuxuan, Guangxi, China, May to July 1968 », Comparative Studies in Society and History, n° 37, 1995, pp. 136-172.
72 10 000 personnes pour l’ensemble de la région.
73 Voir le compte-rendu de l’ouvrage rédigé par Max Lagarrigue, in Communisme, n° 65/66, L’âge d’homme, 2001, p. 272.
74 Sur ces faits, le lecteur intéressé pourra se reporter à l’article « Le cannibalisme au Guangxi » (extrait de Stèles rouges de Zheng Yi), traduit par Annie Au-Yeung et Françoise Lemoine-Minaudier, paru dans la revue Perspectives chinoises, n° 11-12, 1993, pp. 72-83.
75 Notons néanmoins qu’à la fin de la Révolution Culturelle, certaines victimes ont été réhabilitées, et certains bourreaux ont été condamnés. Certains témoins ou acteurs avouent regretter leurs actes, d’autres s’être sentis obligés de le faire. D’autres encore, toutefois, gardent le silence ou continuent à vouer une haine féroce aux descendants de leurs victimes, même vingt ans plus tard (cf. Ibidem, p. 81).
76 Voir le compte-rendu de lecture de Jean-Jacques Gandini in Perspectives chinoises n° 57, janvier-février 2000, p. 100.
77 Zheng Yi, Stèles rouges, op. cit., p. 163.
78 Une petite nuance à apporter cependant à cette qualification, puisqu’on relève dans l’ouvrage que les personnes âgées qui mangeaient la chair des victimes considéraient principalement la vertu médicale de la chair humaine (avant l’aspect idéologique du cannibalisme). Dans son compte-rendu, Jean-Jacques Gandini explique en effet : « Ce qui est consommé en priorité ce sont les viscères qui sont censés guérir divers maux selon les croyances locales : la cervelle, le cœur, les intestins, l’utérus et surtout le foie, réputé donner du courage et être en outre un puissant tonique. […] La consommation de cervelle était aussi prisée par les vieillards qui en escomptaient un regain de jeunesse. » (op. cit., pp. 98-99).
79 Cf. Lu Xun, Fleurs du matin cueillies le soir, François Jullien (trad.). Lausanne : A. Eibel, 1976, p.152 (cité dans Cris, op. cit., note 13 p. 181).
80 Cf. « Le cannibalisme au Guangxi » (extrait de Stèles rouges de Zheng Yi), op. cit., p. 74.
81 Cf. Cris, op. cit., p. 205.
82 Ma Jian, Beijing Coma, op. cit., pp. 89-90.
83 Ma Jian, Chemins de poussière rouge, Jean-Jacques Bretou (trad. de l’anglais). Paris : « J’ai lu », 2014, p. 344.
84 Georges Guille-Escuret, Sociologie comparée du cannibalisme, vol.2 , op. cit., pp. 116-117.
85 Voir plus haut, note 8.
86 Nous avons fait le choix de ne pas traiter du cannibalisme dans le Shuihu zhuan 水浒传, car il s’agit là d’un cannibalisme involontaire : le couple de taverniers tue les voyageurs riches et se débarrasse de leur chair dans la farce de leurs petits pains, mais les consommateurs desdits petits pains ne sont pas au courant du contenu de leur nourriture.
87 Cf. Dutrait Noël, « Le pays de l’alcool de Mo Yan », op. cit., p. 60. Sur cette dernière phrase, on peut toutefois objecter que la pratique de consommer des fœtus humains à des fins médicinales est bien un acte de cannibalisme contemporain sur les enfants (même si ces derniers sont encore au stade de fœtus). Mo Yan lui-même reconnaît d’ailleurs s’être inspiré de cette pratique pour son roman (voir plus haut, note 29).
References
Electronic reference
Solange Cruveillé, “La consommation de chair humaine en Chine”, Impressions d’Extrême-Orient [Online], 5 | 2015, Online since 15 September 2015, connection on 09 January 2023. URL: http://journals.openedition.org/ideo/379
Voir de plus:
Chine : avec un mandat illimité, « un système à vie », le président Xi Jinping suscite la critique
L’Assemblée populaire de Chine, réunie à partir de lundi, devrait voter sans ciller un mandat illimité à l’actuel président, Xi Jinping. Une mesure que des Pékinois ne se privent pourtant pas de critiquer.
L’Assemblée nationale populaire (ANP) de Chine se réunit à partir de lundi 5 mars pendant près de deux semaines. Sans surprise, les délégués chinois devraient voter la modification de la Constitution voulue par le président chinois, en supprimant la limite à deux mandats pourtant prévue Deng Xiaoping dans les années 1980. Une mesure qui ne fait pas l’unanimité parmi les Pékinois.
Xi Jinping dans les pas de Mao Tsé-toung ?
Xi Jinping est chef d’Etat depuis 2013. À 64 ans, il entame un deuxième mandat prévu jusqu’en 2023. Sans limite dans le temps cette fois, il occupe aussi les fonctions de secrétaire général du Parti communiste chinois et de président de la Commission militaire centrale. Une modification constitutionnelle, soumise aux députés, pourrait offrir au président un mandat illimité. Pourtant, en 1982, le numéro un chinois, Deng Xiao Ping, l’architecte de la Chine moderne avait introduit ce plafond à deux mandats pour prévenir la concentration excessive du pouvoir, comme l’avait montré le règne de Mao Tsé de 1949 à 1976. La mesure, qui est un séisme politique, ne plaît pas à certains Pékinois. Ils ne veulent pas revenir en arrière. « Il faut suivre l’envie du peuple avant de décider de la modification de la Constitution, sinon c’est inutile », n’hésite pas à clamer un habitant. « Je ne suis pas d’accord avec un système à vie », ajoute-t-il.
Les temps ont changé. Il faut laisser les nouvelles générations participer au gouvernement de notre pays. Il faut du sang neuf, c’est comme ça qu’on arrivera à avancer.
Un Pékinois sur la modification constitutionnelle
à franceinfo
Une Pékinoise renchérit et s’interroge sur le pouvoir et l’âge. « Je trouve qu’il ne faut pas rester au pouvoir à vie. Chaque individu a la capacité à réaliser beaucoup de projets tant qu’il est en forme. Mais ça n’est plus possible quand on vieillit, qu’on est fatigué », assène-t-elle. Cette femme précise qu’elle se contentait, jusqu’ici, d’« un système plutôt démocratique avec des réunions régulières », comme celle qui commence lundi.
Depuis l’annonce du projet présidentiel, il y a une semaine, les réseaux sociaux sont surveillés par la censure. Et parmi les experts chinois, ceux qui ne soutiennent pas la décision sont priés de se taire.
Voir encore:
La Chine avance à grand pas dans la modification de sa météo
L’Empire du Milieu s’apprête à fortement amplifier un programme expérimental de modification des conditions météorologiques. La zone concernée représentera une fois et demi la superficie de l’Inde.
Pierre Griner
La Chine, une puissance montante au point de faire la pluie et le beau temps ? La réalité devrait bientôt rattraper l’expression. En développant massivement un programme de modification des conditions météorologiques, le pays pourra, d’ici 2025, infléchir la météo grâce aux avancées spectaculaires de la recherche en matière « d’ensemencement » des nuages, rapporte CNN. Si cette technologie n’est pas nouvelle, l’ampleur du programme impressionne : la zone concernée couvrira une surface de 5,5 millions de kilomètres carrés, soit une fois et demi la superficie de l’Inde.
Le concept d’ensemencement des nuages, déjà connu, consiste à injecter de petites quantités d’iodure d’argent dans les nuages qui comportent un taux d’humidité élevé, ce qui provoque la condensation des particules, puis des précipitations. Pékin est familière de cette technologie, utilisée notamment lors des JO de 2008 pour assurer un ciel dégagé pendant les épreuves sportives, ou encore lors des grandes exhibitions politiques dans la capitale.
Un enjeu stratégique
À l’heure où le dérèglement climatique menace, la maîtrise de cette technologie permettrait à la Chine de préserver ses régions agricoles des chutes de grêle, de lutter plus efficacement contre les grands feux de forêt, ou encore de parer aux périodes de sécheresse. L’année dernière, l’agence de presse chinoise Chine nouvelle annonçait en effet que la manipulation météorologique avait permis de réduire de 70% les dommages provoqués par la grêle sur les cultures dans le Xinjiang. Cette technologie a toutefois nécessité un investissement massif de la part du gouvernement chinois qui a, au total, déboursé pas moins de 1,34 milliard de dollars entre 2012 et 2017.
Cet engouement fait cependant tiquer certains pays, comme l’Inde justement. Les deux pays, qui partagent une frontière le long de l’Himalaya, s’y étaient confrontés lors de violents heurts en juin 2020. L’Inde se demande depuis plusieurs années si la modification météorologique et les chutes de neige artificielles ne pourraient pas donner l’ascendant à la Chine en cas de conflit futur dans cette zone montagneuse où les mouvements de troupes sont essentiels.
Voir enfin:
Polémique sur les crèches de Noël : « On devrait supprimer Noël dans ce cas » ironise Pierre Charon
Avant les fêtes de Noël, c’est une polémique que la droite avive volontiers. La semaine dernière, le conseil général de Vendée, présidé par le président du groupe UMP du Sénat, Bruno Retailleau, a dû retirer la crèche de Noël qu’il avait installée.
François Vignal
Public Sénat
08 déc 2014
Avant les fêtes de Noël, c’est une polémique que la droite avive volontiers. La semaine dernière, le conseil général de Vendée, présidé par le président du groupe UMP du Sénat, Bruno Retailleau, a dû retirer la crèche de Noël qu’il avait installée. Saisi par une association de défense de la laïcité, le tribunal administratif a motivé sa décision au nom du principe de séparation de l’Église et de l’État. La décision passe mal en Vendée, terre de tradition catholique forte, et chez une partie de la droite. « Bientôt, il faudra supprimer le mot Dieu de tout notre vocabulaire », ironise Pierre Charon, sénateur UMP de Paris, qui y voit une décision anti-chrétienne « au moment où ils sont martyrisés dans une partie du monde ». Ce sarkozyste renvoie à une réponse du ministère de l’Intérieur, datant de 2007, qui affirmait que « le principe de laïcité n’impose pas aux collectivités territoriales de méconnaître les traditions issues du fait religieux ». Le ministre était à l’époque Nicolas Sarkozy. Entretien.
Vous dénoncez la décision du tribunal administratif de Nantes qui a demandé au conseil général de Vendée de retirer la crèche de Noël qu’il avait installée. Pourquoi ?
J’ai été outré par cette décision et par celui qui l’a demandée. C’est une provocation. Nous avions déjà connu dans les années précédentes des demandes pour retirer les sapins de Noël, car ce serait un signe ostentatoire. Je trouve la décision du tribunal très agressive vis-à-vis du président du conseil général, surtout en Vendée. Bientôt, il faudra supprimer le mot Dieu de tout notre vocabulaire. C’est un peu insensé. Il faut arrêter les provocations.
Mais qu’est-ce qu’une crèche de Noël a à faire dans le hall d’un conseil général ou d’une mairie ?
Toutes les mairies mettent des sapins de Noël partout. Ou alors on décide d’enlever toutes les églises du pays, car c’est aussi un signe ostentatoire religieux. Il faut arrêter de répondre à quelques babas cool écervelés à un moment où tout ça est très crispant dans la société. On prend la décision de retirer une crèche juste avant Noël, alors que cette fête est uniquement féérique. Ça n’a rien à voir avec la religion. On devrait se demander si on supprime Noël dans ce cas. La connerie n’a pas de limites…
La laïcité impose pourtant une neutralité des bâtiments publics…
Il faut du discernement. C’est ça le vivre ensemble. La réponse du ministre de l’Intérieur à une question écrite en mars 2007 l’explique tout a fait. (NDLR : à une question de Jean-Luc Mélenchon, alors sénateur, au sujet d’une crèche installée par une mairie, le ministère de l’Intérieur, dirigé à l’époque par Nicolas Sarkozy, répond que « le principe de laïcité n’impose pas aux collectivités territoriales de méconnaître les traditions issues du fait religieux qui, sans constituer l’exercice d’un culte, s’y rattachent néanmoins de façon plus ou moins directe. Tel est le cas de la pratique populaire d’installation de crèches, apparue au XIIIe siècle. Tel est le cas aussi de la fête musulmane de l’Aïd-el-Adha ».) Sans discernement, on supprime tout. L’Hôtel-Dieu doit changer de nom dans ce cas… Les musulmans ne le demandent même pas. Ceux qui demandent cela sont des ramassis de gens hors-sol et anti-calotin. Il ne faut pas y céder.
Mais il y a aussi le préfet qui a demandé à Robert Menard, maire de Beziers, soutenu par le FN, de retirer la crèche qu’il a installée car elle contrevient « aux dispositions constitutionnelles et législatives garantissant le principe de laïcité »…
C’est une erreur. C’est souffler sur des braises.
Qualifieriez-vous ces décisions d’anti-chrétiennes ?
Oui, au moment où les chrétiens sont martyrisés dans une partie du monde, je crois qu’il faut arrêter. On ne va pas brûler les minarets et faire sauter les synagogues. Arrêtons les bêtises. Noël, c’est féérique et je crois qu’on doit croire au Père-Noël le plus longtemps possible.
Voir enfin:
[Entretien] Douglas Murray : l’Occident en ligne de mire
Une attaque en règle contre notre civilisation est en cours, alimentée par la haine de soi et l’antiracisme, avertit Douglas Murray.
Valeurs actuelles. Avortements forcés parfois tardifs jusqu’à il y a peu, internements forcés : la Chine est plus que critiquable en matière de droits de l’homme et bénéficie pourtant d’une étonnante indulgence. Seul l’Occident, en effet, semble responsable de tous les maux de la planète et focalise les critiques : il serait raciste, esclavagiste, patriarcal, discriminatoire…
Désormais, dénonce Douglas Murray dans son nouvel ouvrage, « l’Occident ne peut jamais bien agir tandis que le reste du monde ne pourrait jamais mal se comporter ». L’écrivain, journaliste et commentateur politique avait déjà commencé à évoquer sans concessions la disparition de la civilisation européenne dans son best-seller l’Étrange Suicide de l’Europe, immigration, identité, islam (L’Artilleur). Une réflexion percutante qu’il avait poursuivie avec la Grande Déraison, race, genre, identité (L’Artilleur) en exposant les dangers posés par la “politique de l’identité”, dont l’antiracisme.
Avec Abattre l’Occident, l’intellectuel britannique poursuit son analyse en montrant comment une véritable guerre est menée contre l’Occident par une partie de ses propres habitants. Un ouvrage coup de poing, qui illustre les aberrations idéologiques du système de pensée perverti qu’il dénonce à l’aide de nombreux exemples.
Vous faites le parallèle entre les attaques que subirait actuellement l’Occident avec les conflits du XXe siècle, notamment la guerre froide ?
Douglas Murray. Comme au XXe siècle, une guerre a été déclarée contre l’Occident. Certes, elle est différente dans le sens où il s’agit d’une guerre culturelle destinée à combattre la tradition occidentale. Mais, un peu comme lors de la guerre froide, c’est le camp de la démocratie, des droits et des principes universels, de la raison qui se trouve menacé.
Bien sûr, les attaques contre l’Occident en ce moment sont différentes de la plupart des conflits précédents. Parce que ce sont des attaques qui sont portées sur nous-mêmes PAR nous-mêmes. Il y a de nombreuses variantes de l’antioccidentalisme. Il y a l’antioccidentalisme chinois, l’antioccidentalisme arabe et bien d’autres encore. Mais celui qui me préoccupe est l’antioccidentalisme occidental, c’est-à-dire l’attaque de nos propres fondements civilisationnels par des personnes issues de nos propres sociétés. Il s’agit d’une remise en question radicale de notre histoire et des éléments qui constituent les bases de notre fierté, de notre identité et de nos valeurs.
Même si des gens comme le Kremlin et le Parti communiste chinois (PCC) font tout pour en profiter, il s’agit d’abord d’une attaque que nous menons contre nous-mêmes. Alors qu’avant, nous étions fiers et que nous défendions notre culture occidentale, nous entendons désormais un discours acerbe selon lequel il faudrait la démanteler. On ne veut plus la transmettre, l’étudier, ou alors sous un angle biaisé et accusateur. En revanche, n’importe quelle culture qui n’est pas occidentale se retrouve célébrée et vénérée.
Pourquoi un tel autodénigrement ?
Si ce mépris de la culture occidentale se propage à grande échelle, c’est par ignorance : on n’apprend aux jeunes générations incultes que les parties sombres de son histoire, on en fait une lecture biaisée et on passe sous silence tous les apports qu’elle a pu donner à notre monde.
Nous avons offert de considérables avancées scientifiques, économiques, musicales, etc. La culture occidentale est celle qui vit s’épanouir le Bernin, Vinci, Michel-Ange, Mozart, Bach, La Fontaine, Pascal et tant d’autres. Elle fit sortir de la misère des millions d’individus et fit briller les lumières de l’esprit. Mais on apprend aux écoliers son rôle dans l’esclavage et ses autres fautes sans contrebalancer par ses richesses.
Les artisans de ce déséquilibre sont des idéologues qui voient le monde sous un rapport de domination et à travers la politique des identités. L’Occident est vu comme raciste et patriarcal et doit alors expier ses fautes.
Vous montrez comment cette haine de soi occidentale est exploitée sur le plan géopolitique…
Oui, le mal vient de l’intérieur, mais il est exploité de l’extérieur. Cette haine de soi est un mal typiquement occidental que certaines puissances sont ravies d’exploiter. Comme je le montre dans mon livre, les communistes chinois trouvent particulièrement commode d’être confrontés à un concurrent occidental qui ne cesse de répéter à quel point il est raciste. Pendant ce temps, le PCC peut s’en tirer notamment en envoyant au bas mot 1 million de personnes dans des camps de concentration. Par exemple, au cours d’une session du Conseil des droits de l’homme de l’ONU, au cours de l’été 2021, Zhao Lijian, porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois, a déclaré devant la presse internationale que le monde occidental devait faire un « examen de conscience profond » pour lutter contre le « racisme systémique » et « la discrimination raciale ». Et ce, alors qu’un certain racisme décomplexé existe en Chine… Le Parti communiste chinois transforme ainsi les faiblesses occidentales en armes.
Obsédés par nos fautes, nous sommes incapables de voir les atteintes aux droits de l’homme qui ont lieu dans certains pays et toute une compréhension du monde nous échappe.
J’ai parlé à des personnes qui ont souffert des régimes de Corée du Nord, de Chine, de Russie et de bien d’autres pays, et elles sont tout simplement stupéfaites que les pays les plus libres – les nôtres, en Occident – soient les plus obsédés par cette autocritique qui mène à l’autodénigrement, au dégoût de soi et finalement à l’automutilation. Obsédés par nos fautes, nous sommes incapables de voir les atteintes aux droits de l’homme qui ont lieu dans certains pays et toute une compréhension du monde nous échappe.
Vous montrez comment Karl Marx et Michel Foucault ont influencé cet antioccidentalisme. Pourtant, ils n’étaient pas de blanches colombes, loin de là. Comment expliquer l’indulgence dont ils bénéficient ?
Quant à Foucault, nous savons maintenant quelle personne épouvantable il était.
Tous deux étaient sans aucun doute des stylistes impressionnants, capables d’exposer avec force des idées qui étaient totalement absurdes. Cela requiert une certaine compétence. Comme je le mentionne dans mon livre, Marx était bien plus raciste que son époque. C’était un convaincu vraiment vicieux et désagréable. Pourtant, étrangement, les personnes qui se sont attaquées à tous les autres personnages historiques qui ne pensaient pas comme nous dans les années 2020 ne se sont pas encore attaquées à Marx. La raison en est évidente, bien sûr. Parce qu’ils l’admirent et veulent encore défendre ses idées. Une vision catastrophique et irréalisable. Quant à Foucault, nous savons maintenant quelle personne épouvantable il était. La révélation de ses abus sexuels sur de jeunes enfants en Afrique du Nord est à la fois choquante et sans surprise. Au cœur de ses idées, il y a une obsession absolue pour le pouvoir.
Le véritable principe d’organisation le plus puissant sur terre est l’amour.
Qui l’exerce et contre qui il est exercé. Bien sûr, Foucault est extrêmement contradictoire, mais il a fourni un cadre qui semble plaire à des personnes issues d’un large éventail de disciplines. Il est toujours l’un des penseurs les plus cités dans diverses écoles de pensée. J’espère que son temps sera bientôt révolu. Sa philosophie, telle qu’il la présente lui-même, est sauvagement anti-humaine et inadaptée à la tâche qui consiste à essayer de nous comprendre. Par exemple, considérer toutes les dynamiques humaines à travers le prisme du “pouvoir” est quelque chose qui ignore ce que je pense – et surtout ce que pensaient de grands penseurs comme Rilke -, à savoir que le véritable principe d’organisation le plus puissant sur terre est l’amour. Mais Foucault n’était pas très intéressé par cela. Ses disciples non plus. Et c’est un fait éloquent.
Nous vivons à l’ère du ressentiment.
La grande indulgence dont ils bénéficient doit sans doute au travail de sape que leurs travaux ont effectué sur les institutions occidentales. Si le racisme de Marx et les viols de Foucault sur des jeunes Orientaux restent passés sous silence, c’est parce qu’ils appartiennent au camp de la gauche politique. Et leurs œuvres continuent à être diffusées. Personne ne semble trouver à redire sur le fait que l’un des penseurs à l’origine du discours antioccidental satisfaisait son appétit sexuel en utilisant des jeunes mineurs autochtones dans des pays étrangers…
Vous mettez en garde contre les hommes de ressentiment, pourquoi ?
Eh bien, nous vivons à l’ère du ressentiment. Il faut toujours traiter Nietzsche avec beaucoup de prudence, et c’est ce que je fais, mais son travail sur la question dans la Généalogie de la morale est vraiment perspicace et d’une grande utilité pour notre époque. Par exemple, sa description des hommes gonflés par le ressentiment qui rouvrent des blessures depuis longtemps guéries et pleurent ensuite sur leur douleur. Cela ne vous rappelle-t-il pas un certain type de personnes aujourd’hui ?
Le problème des personnes qui se complaisent dans le ressentiment, c’est qu’elles peuvent toujours trouver d’autres personnes responsables de leurs maux. Il y a toujours quelqu’un ou quelque chose d’autre à blâmer. Il peut s’agir d’un parent. Il peut s’agir d’un problème “structurel” de la société. Pourtant, le plus souvent, le problème vient d’eux-mêmes. Comme le dit Nietzsche, quelqu’un doit se tenir droit face à ces personnes et dire : “Oui, quelqu’un a ruiné votre vie – cette personne, c’est vous. ” Mais qui accepterait une telle tâche ? Pour ma part, je tenterais de le faire si l’occasion devait se présenter.
Regardez toutes les choses dont nous avons hérité en Occident.
Comment sauvegarder ce que nous sommes ?
Comme je le dis dans ce qui est mon chapitre préféré de ce nouveau livre, la réponse à toutes ces choses est la “gratitude”. C’est la seule chose suffisamment profonde pour faire évoluer les gens loin du “ressentiment”. Je crois qu’il est crucial que nous réalisions que le ressentiment est l’un des moteurs les plus profonds de l’esprit humain, même si celui-ci est parfois déformé. Il doit être contré par quelque chose d’aussi profond, et je suggère que cette chose soit la gratitude. Regardez toutes les choses dont nous avons hérité en Occident.
J’étais à Paris, tout récemment, pour la première fois depuis trois misérables années. Le simple fait de se promener dans les rues de Paris fait naître – ou devrait faire naître – un profond sentiment de gratitude. Regardez ce qui nous a été donné. Regardez ce qu’on nous a donné, ce qu’on nous a laissé, ce qu’on nous a confié, ce dont nous devons nous montrer à la hauteur ! Tout cela pourrait être si différent.
Je peux me plaindre des choses qui ne sont pas exactement à mon goût en ce moment ou je peux avoir une saine gratitude.
J’ai grandi dans la paix, j’ai vécu la majeure partie de ma vie dans la paix et j’ai dû me rendre dans d’autres endroits pour voir la guerre. Je vis dans un pays doté d’un État de droit, d’une démocratie représentative, d’une grande culture et de bien d’autres choses encore. Je peux me plaindre des choses qui ne sont pas exactement à mon goût en ce moment ou je peux avoir une saine gratitude. Où est passé cet esprit ? Je crois qu’il est parti en fumée sous l’impulsion de penseurs comme Foucault et Marx. Mais je crois que nous pouvons le retrouver. Non seulement nous pouvons, mais nous devons.
Abattre l’Occident, de Douglas Murray, L’Artilleur, 432 pages, 22 €.

























 Publié par jcdurbant
Publié par jcdurbant  Il y a autant de racismes qu’il y a de groupes qui ont besoin de se justifier d’exister comme ils existent, ce qui constitue la fonction invariante des racismes. Il me semble très important de porter l’analyse sur les formes du racisme qui sont sans doute les plus subtiles, les plus méconnaissables, donc les plus rarement dénoncées, peut-être parce que les dénonciateurs ordinaires du racisme possèdent certaines des propriétés qui inclinent à cette forme de racisme. Je pense au racisme de l’intelligence. (…) Ce racisme est propre à une classe dominante dont la reproduction dépend, pour une part, de la transmission du capital culturel, capital hérité qui a pour propriété d’être un capital incorporé, donc apparemment naturel, inné. Le racisme de l’intelligence est ce par quoi les dominants visent à produire une « théodicée de leur propre privilège », comme dit Weber, c’est-à-dire une justification de l’ordre social qu’ils dominent. (…) Tout racisme est un essentialisme et le racisme de l’intelligence est la forme de sociodicée caractéristique d’une classe dominante dont le pouvoir repose en partie sur la possession de titres qui, comme les titres scolaires, sont censés être des garanties d’intelligence et qui ont pris la place, dans beaucoup de sociétés, et pour l’accès même aux positions de pouvoir économique, des titres anciens comme les titres de propriété et les titres de noblesse.
Il y a autant de racismes qu’il y a de groupes qui ont besoin de se justifier d’exister comme ils existent, ce qui constitue la fonction invariante des racismes. Il me semble très important de porter l’analyse sur les formes du racisme qui sont sans doute les plus subtiles, les plus méconnaissables, donc les plus rarement dénoncées, peut-être parce que les dénonciateurs ordinaires du racisme possèdent certaines des propriétés qui inclinent à cette forme de racisme. Je pense au racisme de l’intelligence. (…) Ce racisme est propre à une classe dominante dont la reproduction dépend, pour une part, de la transmission du capital culturel, capital hérité qui a pour propriété d’être un capital incorporé, donc apparemment naturel, inné. Le racisme de l’intelligence est ce par quoi les dominants visent à produire une « théodicée de leur propre privilège », comme dit Weber, c’est-à-dire une justification de l’ordre social qu’ils dominent. (…) Tout racisme est un essentialisme et le racisme de l’intelligence est la forme de sociodicée caractéristique d’une classe dominante dont le pouvoir repose en partie sur la possession de titres qui, comme les titres scolaires, sont censés être des garanties d’intelligence et qui ont pris la place, dans beaucoup de sociétés, et pour l’accès même aux positions de pouvoir économique, des titres anciens comme les titres de propriété et les titres de noblesse. 

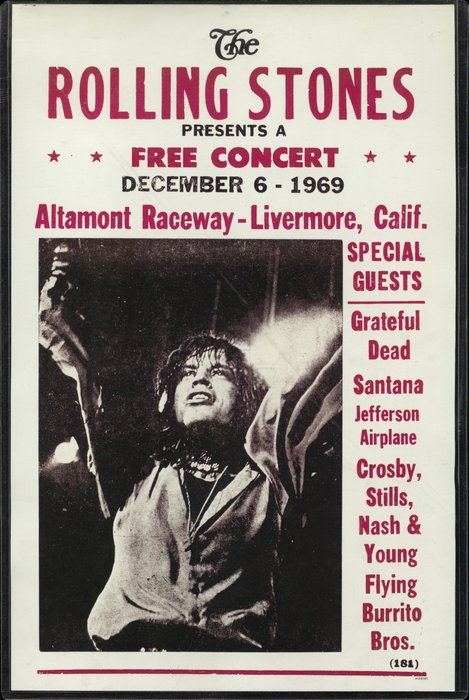





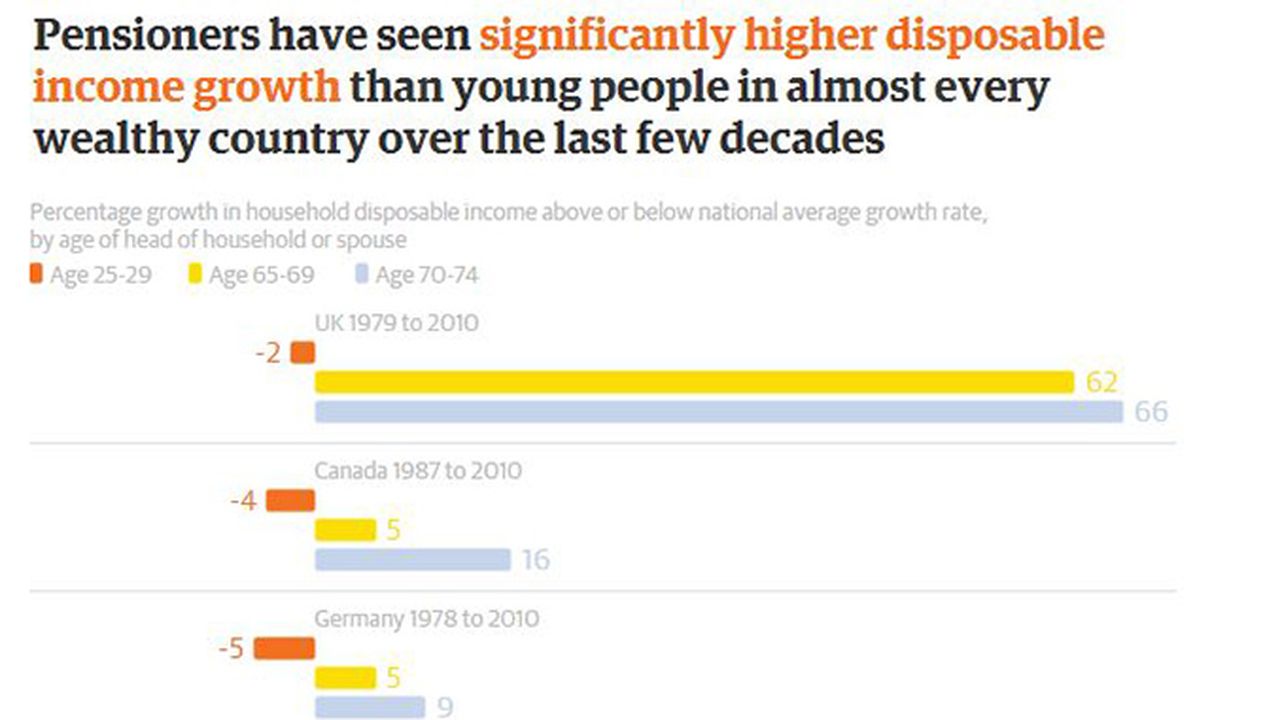



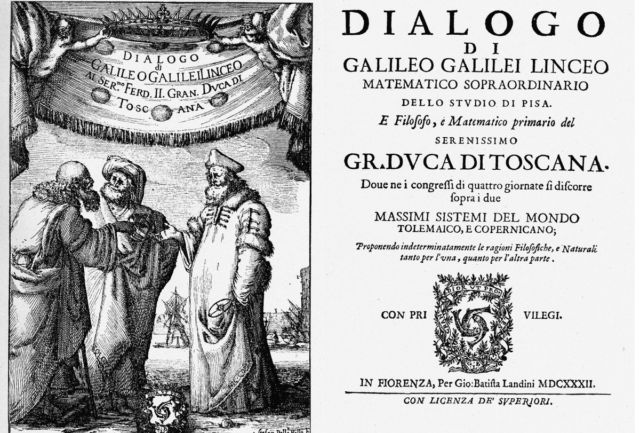


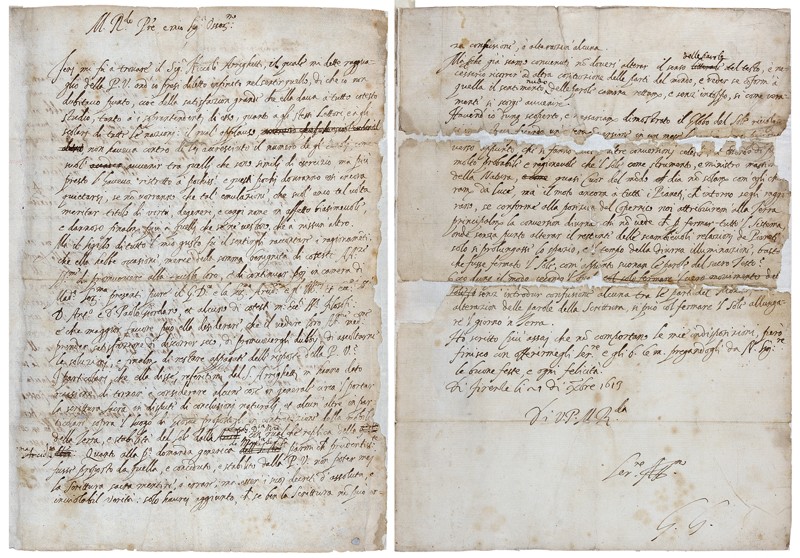
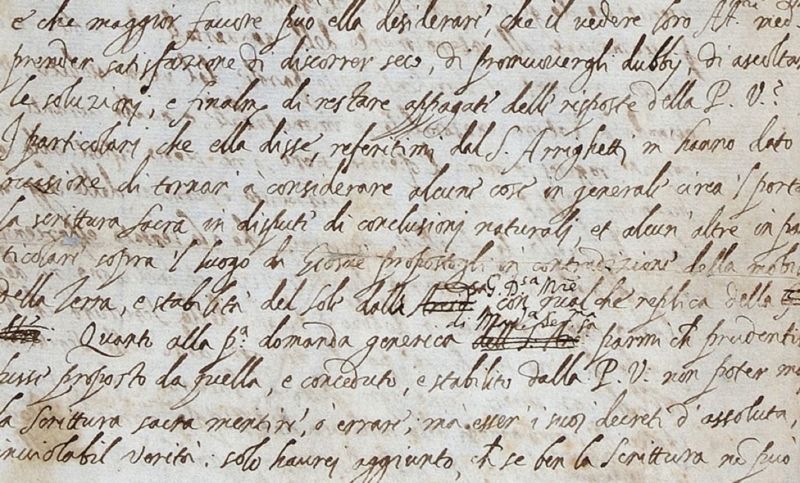
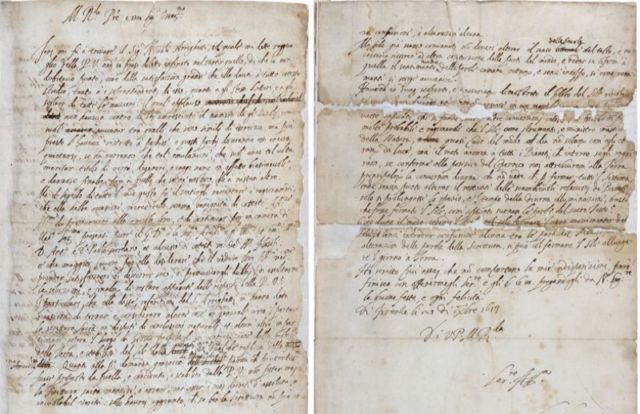




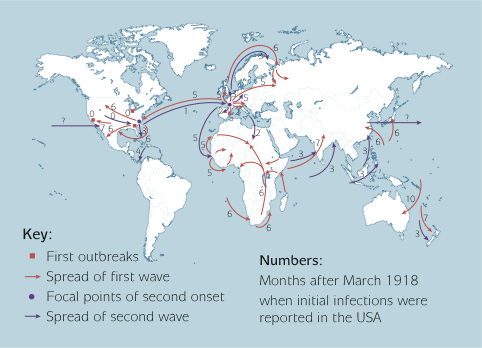



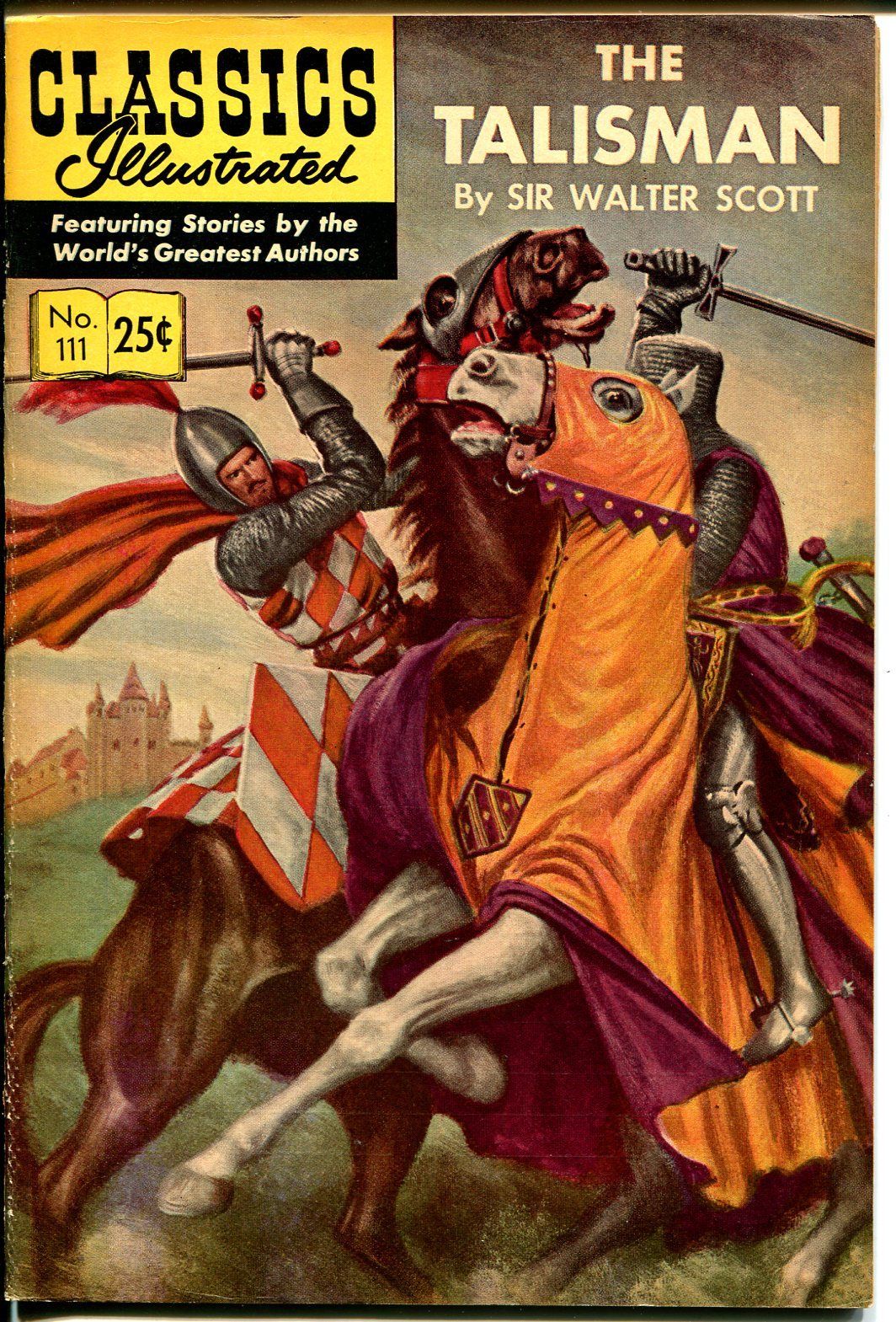

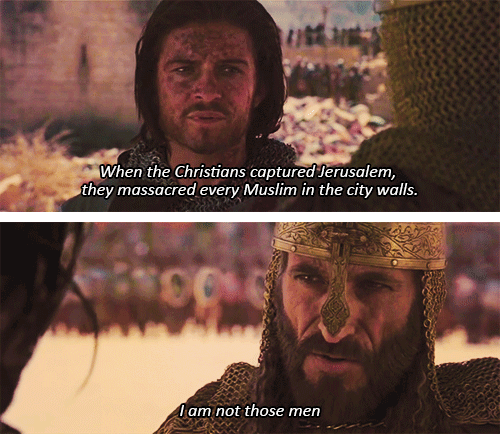 Il nous faut entrer dans une pensée du temps où la bataille de Poitiers et les Croisades sont beaucoup plus proches de nous que la Révolution française et l’industrialisation du Second
Il nous faut entrer dans une pensée du temps où la bataille de Poitiers et les Croisades sont beaucoup plus proches de nous que la Révolution française et l’industrialisation du Second


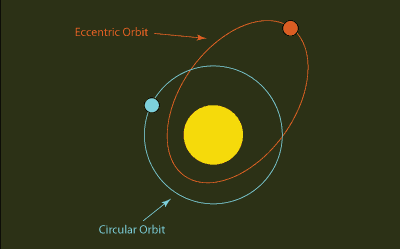
 Toutes les époques sont-elles concernées par la falsification historique ? Toutes les époques sont concernées, mais les raisons de ces maquillages varient selon les dominantes idéologiques. Pour faire court, l’histoire est instrumentalisée, en Occident, depuis les Lumières : encyclopédistes et philosophes tressent une légende noire de l’Église, dont ils combattent le pouvoir. Au XIXe siècle, le roman national, tel que l’enseigne l’école jusqu’aux années 1950, s’inscrit dans une veine républicaine qui glorifie la Révolution et caricature l’“Ancien Régime”. L’après-guerre est dominée, jusqu’à la fin des années 1960, par l’histoire marxiste, ce qui s’explique par l’hégémonie culturelle du Parti communiste.
Toutes les époques sont-elles concernées par la falsification historique ? Toutes les époques sont concernées, mais les raisons de ces maquillages varient selon les dominantes idéologiques. Pour faire court, l’histoire est instrumentalisée, en Occident, depuis les Lumières : encyclopédistes et philosophes tressent une légende noire de l’Église, dont ils combattent le pouvoir. Au XIXe siècle, le roman national, tel que l’enseigne l’école jusqu’aux années 1950, s’inscrit dans une veine républicaine qui glorifie la Révolution et caricature l’“Ancien Régime”. L’après-guerre est dominée, jusqu’à la fin des années 1960, par l’histoire marxiste, ce qui s’explique par l’hégémonie culturelle du Parti communiste.

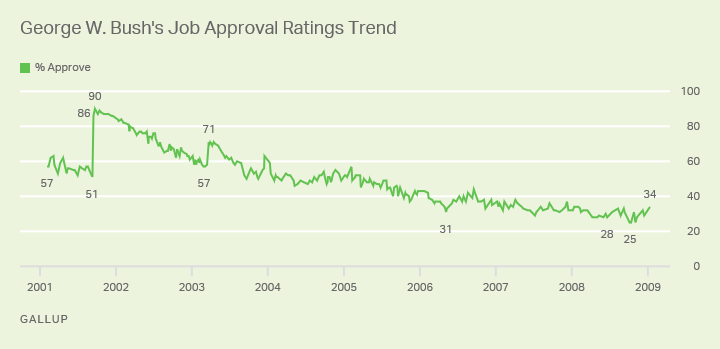














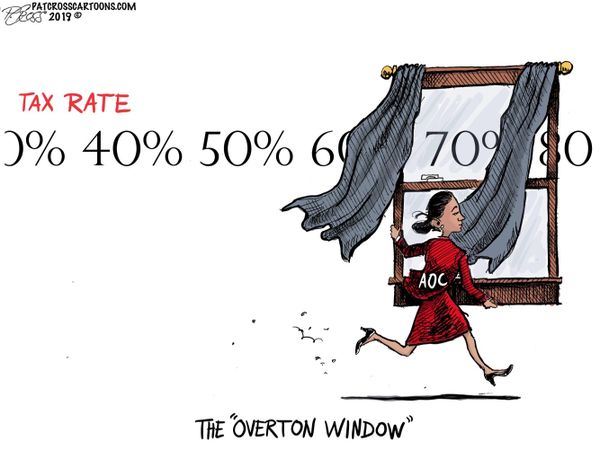








Republicans face backlash over racist labeling of coronavirus
China says US politicians are stigmatizing the country with ‘despicable’ practice of calling the virus ‘Wuhan coronavirus’ and ‘China coronavirus’
Adam Gabbatt in New York
Senior Republican figures are facing backlash over an apparent effort to label Covid-19 as “Chinese coronavirus” – as China accused some US politicians of “disrespecting science” in order to “stigmatize” the country.
Kevin McCarthy, the House minority leader, and Mike Pompeo, the secretary of state, are among those to add a geographical marker to the coronavirus in recent days.
Pompeo called the virus the “Wuhan coronavirus” on Friday, referring to the Chinese city where the outbreak started, and McCarthy used the term “Chinese coronavirus” on Monday, when he tweeted out a link to the Centers for Disease Control and Prevention, the federal agency that has led the US effort to fight the virus.
The CDC website specifically avoids the phrase when talking about Covid-19, the novel strain of coronavirus at the heart of the global outbreak.
Other Republicans, including Senator Tom Cotton and Representative Paul Gosar – who is in self-quarantine – have used similar terms.
China reacted furiously on Monday, with a spokesman for the foreign ministry criticizing US elected officials.
“Despite the fact that the WHO [World Health Organization] has officially named this novel type of coronavirus, certain American politician[s], disrespecting science and the WHO decision, jumped at the first chance to stigmatize China and Wuhan with it. We condemn this despicable practice,” said Geng Shuang.
Republicans’ attempts to associate Covid-19 overtly with China repeats a common theme of associating epidemics with certain countries, such as 1918 influenza pandemic being branded “Spanish flu”.
Academics have warned the practice leads to stigma and racism, and the World Health Organization sent a memo to governments and media organizations at the end of February, urging people not to use the terms “Wuhan Virus”, “Chinese Virus” or “Asian Virus”.
“Governments, citizens, media, key influencers and communities have an important role to play in preventing and stopping stigma surrounding people from China and Asia in general,” the WHO said.
The branding fits neatly with Donald Trump’s anti-China rhetoric and ongoing trade war, however – as Democratic congressman Ted Lieu pointed out in a tweet, referring to Trump as Potus, the president of the United States.
“One reason @POTUS & his enablers failed to contain #COVID2019 is due to the myopic focus on China. The virus was also carried into the US from other countries & US travelers. Calling it Chinese coronavirus is scientifically wrong & as stupid as calling it the Italian coronavirus.”
Voir de plus:
Coronavirus : « En Chine, plus personne ne croit en la parole officielle »
Marie Holzman
Traductrice, auteur de nombreux ouvrages sur la Chine contemporaine, présidente de Solidarité Chine
D’abord ignorée puis longtemps sous-estimée par les autorités de Pékin, l’épidémie de coronavirus montre les blocages d’un régime qui néanmoins ne peut plus totalement contrôler l’information, relève Marie Holzman, spécialiste du monde chinois dans une tribune au « Monde ».
Le Monde
29 janvier 2020
Tribune. Décidément la Chine est placée sous le signe des catastrophes sanitaires à répétition. En 2003, ce fut l’épidémie du SRAS [syndrome respiratoire aigu sévère] qui se répandit à travers le monde et fit plus de huit cents morts. Durant l’année du cochon, qui vient de se terminer ce 24 janvier, ce sont plus de trois cents millions de porcs qui ont dû être abattus dans le pays, et maintenant que l’année du rat débute, on se demande si ce n’est pas la mauvaise habitude des gourmets chinois de rechercher des aliments « exotiques » comme le rat des bambous ou la chauve-souris qui ont provoqué l’irruption d’un nouveau virus mortel à Wuhan.
Déjà en 2003, l’épidémie du SRAS avait été provoquée dans la province du Guangdong par la consommation de civettes qui avaient été infectées par les chauves-souris qui pullulent dans la province voisine du Yunnan.
Vieux réflexe bureaucratique
Quelles que soient les causes de l’épidémie, ce qui frappe le plus les observateurs, c’est la façon dont les autorités chinoises ne parviennent pas à se défaire d’un vieux réflexe bureaucratique issu de la tradition communiste : cacher les problèmes aussi longtemps que possible, afin d’éviter de porter la responsabilité du drame. La catastrophe de Tchernobyl est évoquée sur les réseaux chinois par les internautes qui discutent fiévreusement de l’évolution de ce qui ressemble de plus en plus à une pandémie.
Si le gouvernement avait pris les mesures requises à temps, en serions-nous là aujourd’hui, se demandent-ils. L’épidémie du SRAS avait commencé à la fin de l’année 2002, mais il a fallu attendre que des victimes soient reconnues à Hongkong avant que Pékin ne décide de prendre des mesures à l’échelle nationale en février 2003.
Depuis l’arrivée au pouvoir de Xi Jinping en 2012, la liberté d’expression a été mise à rude épreuve. Aujourd’hui le seul média qui s’autorise encore à communiquer quelques informations est le journal en ligne Caixin. D’après ce média, le premier cas avéré de malade atteint par le coronavirus a été découvert à Wuhan le 8 décembre 2019. Les autorités locales ont choisi de ne pas transmettre l’information à la direction du Parti.
A la fin du mois de décembre 2019, les autorités centrales commencent à s’inquiéter. Une information interne circule à Pékin, et des fuites parviennent à informer quelques Chinois actifs sur les réseaux. Le pot aux roses est dévoilé et c’est le 31 décembre seulement que les autorités de Wuhan envoient le virus pour le faire analyser à Pékin. Le 2 janvier, le virus est identifié et les annonces commencent : il y a bien une épidémie à Wuhan, mais « tout est sous contrôle ». Réaction locale ? Huit internautes sont accusés de « transmettre des rumeurs » et sont arrêtés à Wuhan.
Rage
Aujourd’hui, l’exaspération de la population chinoise est à son comble. La décision de fermer la ville de Wuhan, ainsi qu’une dizaine de villes avoisinantes, c’est-à-dire à isoler près de soixante millions de Chinois passe d’autant plus mal qu’elle a été prise du jour au lendemain, et sans avertir au préalable la population. Et ceci dans les pires conditions, puisque le réveillon du Nouvel an était le 24 janvier et c’est le moment de l’année où plusieurs centaines de millions de migrants retournent dans leur village, et où de nombreux habitants de Wuhan sont en vacances.
Les voyageurs dont la plaque d’immatriculation montrait qu’ils venaient de Wuhan ont été aussitôt interdits de séjour partout où ils passaient : ni les hôtels, ni les restaurants n’acceptaient de les laisser entrer dans leur établissement !
Wang Dan, l’un des leaders du mouvement estudiantin pour la démocratie en 1989, actuellement exilé aux Etats-Unis, bien connu et respecté pour ses déclarations rationnelles et modérées a craché sa rage dans un tweet : « Si nous étions encore dans la période Hu Jintao et Wen Jiabao, nous aurions eu au moins le spectacle de la compassion, même si elle était probablement partiellement feinte. Maintenant que nous sommes sous le règne de Xi Jinping, nous n’avons même pas l’honneur d’un petit spectacle ! Alors que l’épidémie continuait à progresser, que la vie des citoyens ne tient plus qu’à un fil, Xi est resté à Pékin pour festoyer à l’occasion du Nouvel an, au milieu des chants et des danses, se moquant totalement de tout. On a dépassé le niveau du dégoût, on entre dans le chaos. Je suis convaincu que cette crise, quelle que soit son évolution, va sonner le tocsin du Parti communiste chinois et de Xi Jinping ». Un jugement d’une rare sévérité qui sous-estime les capacités de résistance du régime.
Par dizaine de milliers
Le problème fondamental en Chine aujourd’hui, c’est que plus personne ne croit en la parole officielle. Il existe du coup un nouveau type d’information privée créée par des intellectuels émigrés : des émissions sur YouTube commentent l’actualité chinoise avec un professionnalisme qui convainc le public chinois. Décryptant les reportages et l’actualité en Chine, ils parviennent à en donner une lecture objective.
Désormais les seules informations non censurées viennent des réseaux sociaux. Avec des faits mais aussi des rumeurs même si colportées de bonne foi. Le nombre des contaminations n’en parait pas moins déjà beaucoup plus important que celui reconnu par les autorités. Le directeur de la faculté de médecine de Hongkong University assure que les malades se comptent par dizaine de milliers et non par milliers. Sans être démenti.
Il a fallu attendre le 24 janvier pour que le gouvernement chinois se réunisse en urgence. Un groupe de commandement national a été créé pour gérer la crise, et le premier ministre Li Keqiang en a pris la direction. Il ne s’est rendu à Wuhan que le 27 janvier. Quelques jours plus tôt, le 20 janvier, le maire de Wuhan, qui n’a pourtant pas l’habitude de s’exprimer devant les médias, a accepté une interview de la chaîne officielle, CCTV 13, où il explique maladroitement pourquoi il n’a pas pu s’exprimer plus tôt.
Traduction : « Tout ça, ce n’est pas de ma faute, c’est la faute de ceux d’en haut qui ne m’avaient pas donné le feu vert ». Comme l’écrivit en 2003 Liu Xiaobo [Prix Nobel de la paix 2010 mort en prison en juillet 2017] : « Les services de la santé du Parti communiste chinois ont caché des nouvelles déterminantes. Ce que ce genre de censure provoque, ce n’est pas seulement la mort de la presse, mais c’est aussi la vie des citoyens qui est mise en danger. » Cette déclaration n’a rien perdu de son actualité.
Marie Holzman (Traductrice, auteur de nombreux ouvrages sur la Chine contemporaine, présidente de Solidarité Chine)
Voir encore:
Four lessons the Spanish flu can teach us about coronavirus
Up to 100 million people died in 1918-19 in the world’s deadliest pandemic. What can we learn?
Hannah Devlin
3 Mar 2020
Spanish flu is estimated to have killed between 50 million and 100 million people when it swept the globe in 1918-19 – more than double the number killed in the first world war. Two-thirds of its victims died in a three-month period and most were aged 18-49. So what lessons has the world’s deadliest pandemic taught us?
1) How not to name a pandemic
In spring 1918, soldiers in Europe on both sides starting suffering from a new type of influenza. But if the illness seemed worse than seasonal flu, the squalid conditions of the trenches were blamed and, not wanting to admit any potential weakness, Britain, France and Germany kept the outbreak a secret. It was only when the disease hit Spain, a neutral country, that the first accurate reports emerged giving the pandemic its name.
Misidentifying illnesses as being from one country or one ethnic group is a common theme (the 2009 swine flu outbreak was initially labelled “Mexican flu”) and often leads to stigma and racism. In Spain “the name caused offence for a long time after”, said Prof Julia Gog, a mathematician who researches flu dynamics at the University of Cambridge.
“When we give talks we’re careful to call it 1918 influenza – there’s no way its origin was Spain. There’s a joke that when an epidemic is said to emerge first in a place, it almost certainly didn’t. Except Wuhan might actually be right.”
2) Tell the truth and warn the public
The Spanish flu hit during the first world war, so authorities were unusually keen to avoid further social disruption or blows to national morale. Much of the pandemic was characterised by increasingly untenable reassurances that the Spanish flu was not something to be overly concerned about. In June 1918, just before the UK felt the full force of the outbreak, the Daily Mail advised readers that flu was no worse than a cold and that people should not have “any great dread” but “maintain a cheery outlook on life”. The Times initially adopted a casual, jokey tone before growing critical of official complacency.
“Epidemics all follow this similar arc where people deny or dismiss the threat until it becomes impossible to ignore any more,” said Mark Honigsbaum, a medical historian at City, University of London. The way coronavirus is being played down by some leaders is concerning, he said, and even throwaway comments that appear to undermine the seriousness of the threat can set the tone for how people respond to advice.
“You still have politicians like Boris Johnson saying they’re happy to shake hands. Just stop shaking hands,” said Honigsbaum. “We need to take this a little bit more seriously. I’m shocked by the complacency at the political level.”
3) Uncontrolled movement can lead to tragic outcomes
The unusual circumstances of the first world war reversed the normal pattern of human movement in a pandemic. Instead of the sickest people staying put in bed, many were sent home from the frontline, which may have contributed to the rapid spread of the disease. And many countries struggled to balance national war interests with public health.
In New Zealand, which was slow to clamp down on ships entering and leaving its ports, nearly 1% of the population died within two months in late 1918, triggering even worse outbreaks in Pacific territories such as Western Samoa, where 30% of men, 22% of women and 10% of children died.
By contrast, the coronavirus outbreak has prompted draconian clampdowns on civil life. The World Health Organization has credited the response in China, where entire cities were placed in lockdown and schools and work suspended, with averting hundreds of thousands of cases of Covid-19.
4) The potential for a second wave
The first wave of Spanish flu in spring 1918 wasn’t that bad. But by August, when a second wave spread from France across Europe, the US and much of the globe, the virus had mutated to a far deadlier form and appeared to hit hardest in regions that had not already been exposed, meaning people had lower immunity.
Flu viruses are fundamentally different from coronaviruses in that they are constantly shuffling their genomes, which means they rapidly morph from one strain into another – that’s why flu vaccines are needed annually. Coronaviruses tend to be genetically fairly stable and so scientists don’t expect a sudden shift in the mortality rate of Covid-19. But the question of whether coronavirus will disappear, reappear in waves or simmer in the background as an endemic illness still remains to be answered.
Viruses where transmission is strongly affected by temperature and humidity often come in waves and initially it was expected that Covid-19 might die down in the spring and possibly reappear next winter. But the geographic spread is already raising questions about this.
“Iran right now, Italy right now, they’re all warmer than the UK, so the argument that we’ll be safer as we move towards the summer doesn’t make sense,” said Gog. “How transmission depends on temperature and humidity is unknown, but it’s possible it may not be a two-wave thing, at least not due to climate.”
Whether we see a second wave will also depend on whether people who have been infected once have long-term immunity, which would suppress re-emergence in the community. Reports of a Japanese woman getting the virus twice raised the prospect that immunity may wane in the weeks or months after recovery, which some think could make a second wave more likely. This is something experts are tracking closely as case numbers continue to rise.
Voir encore:
Foreign Ministry Spokesperson Zhao Lijian’s Regular Press Conference on March 4, 2020
I’d like to share with you some latest figures. According to the statistics from the National Health Commission this morning, March 3 saw 2,652 patients cured and discharged from hospital in China’s mainland, bringing the tally to 49,856.
Outside Hubei, the number of newly confirmed cases per day has been hovering around 10 for six days running, and that of newly reported suspected cases per day has been capped under 100 for five days running. In Wuhan, the number of patients cured and discharged has exceeded that of confirmed cases.
Q: According to reports, the IAEA issued two reports on the Iranian nuclear issue on March 3. One is a quarterly report on Iran’s implementation of JCPOA obligations. It says Iranian stockpile of enriched uranium has exceeded one tonne and Iran is continuing violation of limits in other key areas set out in the deal. The other is a report on Iran’s implementation of the comprehensive safeguards agreement and the additional protocol. It asks Iran to provide access without delay to two locations. The IAEA will review relevant issues as its board meet next week. I wonder if China has a comment?
A: We have taken note of the IAEA’s latest reports on Iran. It confirms that the agency’s verification activities on Iran’s implementation of the JCPOA have been going on, that Iran has not taken the fifth step of reducing commitments and has not diverted declared nuclear material for other purposes. China encourages Iran to continue cooperation with the agency. At the same time, we hope the agency will uphold the principle of objectivity, impartiality and neutrality, exercise safeguards oversight on Iran in strict accordance with its mandate, and work together with Iran to resolve relevant issues.
I reiterate, the US unilateral withdrawal from the JCPOA and maximum pressure on Iran is the root cause of the current Iranian nuclear crisis. The US should give up its wrong approach and leave room for dialogue and negotiation. Parties to the deal should follow the step-by-step and reciprocal approach and seek full and effective implementation within the Joint Commission framework. The IAEA board should properly handle the issue and support diplomatic efforts to preserve the JCPOA. China will continue to work in close collaboration with relevant parties to uphold the deal and realize a political and diplomatic solution of the issue.
Q: It was once speculated that the virus was leaked from a lab in China and such speculation was already countered by the Chinese side. Still, there are many versions about the origin of the virus and « patient zero ». Some media and netizens still talk about it in ways like « China virus »and « Wuhan virus ». There are also news stories saying that some US seasonal influenza patients actually came down with COVID-19. What is your response?
A: It is highly irresponsible for some media to dub it « China virus ». We firmly oppose that. I want to stress two points.
First, no conclusion has been reached yet on the origin of the virus, as relevant tracing work is still underway. The WHO has said many times that what we are experiencing now is a global phenomenon with its source still undetermined, and we should focus on containing it and avoid stigmatizing language toward certain places. The name COVID-19 was chosen by the WHO for the purpose of making no connections between the virus and certain places or countries. Dr. Zhong Nanshan, respiratory specialist and member of the Chinese Academy of Engineering, said that the epidemic was first reported in China but was not necessarily originated in China.
Second, we should all say no to « information virus » and « political virus ». By calling it « China virus » and thus suggesting its origin without any supporting facts or evidence, some media clearly want China to take the blame and their ulterior motives are laid bare. The epidemic is a global challenge. The right move should be working together to fight it, which means no place for rumors and prejudice. We need science, reason and cooperation to drive out ignorance and bias.
Q: The confirmed cases of COVID-19 have been on the rise worldwide. Some countries are feeling increasingly strained in epidemic prevention and control. But in China, we see a climbing cure rate, and the numbers of newly confirmed and suspected cases have been kept low for several days on end. What has China been sharing with other affected countries, in terms of prevention, control, diagnosis and treatment?
A: China has been closely following the global footprint of COVID-19. We have been strengthening international cooperation in this area with the vision of a community with a shared future for mankind in mind and in an open, transparent and responsible attitude. That’s what we’ve been saying and we’ve been doing.
Yesterday afternoon, together with the National Health Commission, the Foreign Ministry had a video conference with COVID-19 experts from Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova, Armenia, Turkmenistan and the SCO Secretariat. The video conference was attended by officials from the NHC, the Foreign Ministry, the General Administration of Customs and China’s embassies in the relevant countries, experts from the Chinese Center for Disease Control and Prevention and Peking University First Hospital, officials from foreign diplomatic and health departments, foreign diplomatic missions in China, foreign experts in the health field, and representatives from relevant international organizations.
The experts on the Chinese side gave a full account of the epidemic situation in China and our experience in epidemic control and treatment. All participants had an in-depth exchange of views on control measures, diagnosis, screening and laboratory tests, pledging further actions on sharing information and coordinating actions to safeguard regional and global health security.
Prior to yesterday’s video conference, China has already had such communication with the EU via two video conferences. You can look for more details of these meetings from the press release we’ve already issued.
Q: According to reports, due to the COVID-19 epidemic, Japan and China will delay President Xi Jinping‘s planned visit to Japan in April. Can you confirm that?
A: I responded to this question yesterday. We will let you know if there’s any update.
Q: On March 3 local time, Togo’s Constitutional Court announced the final result of the presidential election held on February 22. Incumbent President Faure Essozimna Gnassingbé was reelected with 70.78 percent of the vote. Does China have a comment?
A: China notes the result of the presidential election announced by Togo’s Constitutional Court. We extend warm congratulations to Mr. Faure Essozimna Gnassingbé on his reelection as president. Under his leadership, the government and people of Togo are sure to achieve greater progress in national development.
China and Togo have a profound traditional friendship. Placing high emphasis on advancing this relationship, we stand ready to work with Togo to carry forward our traditional friendship, deepen practical cooperation and realize in-depth, all-round development of bilateral relations.
Q: Findings and analysis of Qihoo 360 revealed recently that the CIA’s APT-C-39 engaged in an 11-year-long cyber infiltration and attack program against key Chinese sectors, with victims ranging from space and aviation to scientific research and development, oil industry, Internet companies and government agencies. What’s China’s comment?
A: It has long been an open secret that the US government and relevant departments, in violation of international law and basic norms governing international relations, have been engaging in large-scale, organized and indiscriminate cyber theft, surveillance and attacks against foreign governments, enterprises and individuals. From WikiLeaks to the Edward Snowden case to the recent Swiss company Crypto AG case, the immoral practices of the US have been exposed time and again. The Qihoo 360 report serves as further evidence. As facts show, the US is the world’s number one cyber attack initiator. It is quite literally an « empire of hackers ». However, like a thief crying « stop thief », it has been dressing up as the victim at every turn, putting its hypocrisy and double standard on cyber security on full display.
China has long been a victim of the US cyber theft and attacks. We have lodged stern representations with it repeatedly. Once again we urge it to offer clear explanations, immediately stop such activities and restore peace, security, openness and cooperation in cyberspace.
Q: Appearing before the House Foreign Affairs Committee on February 28, US Secretary of State Mike Pompeo said in response to the Iranian nuclear issue that the US will appeal to the UN Security Council to extend the arms embargo on Iran that is set to expire in October under the terms of Resolution 2231 so that China and Russia will not be able to sell their weapons to Iran. The Russian Foreign Ministry expressed its regret over this on March 3 and urged the US to end breach of the JCPOA and strictly implement Resolution 2231. What is your comment?
A: We note the relevant reports. China believes that the JCPOA, as an important outcome of multilateralism endorsed by the UNSC Resolution 2231, should be implemented effectively and in full. The US withdrew itself from the JCPOA in 2018 in total disregard of the Resolution and has subsequently been obstructing the implementation of the JCPOA and the Resolution. This is the root cause why a crisis has arisen on the Iranian nuclear issue. The US should stop blaming China and Russia for no cause, strictly observe Resolution 2231, and return to the right track of implementing the JCPOA. China will work with all relevant parties to continuously uphold the authority of the UNSC Resolution and the JCPOA and advance the political and diplomatic process of the Iranian nuclear issue.
Q: Can you give us an update on which countries China has sent experts to fight the coronavirus and medical equipment to? And are any new flights planning to bring Chinese citizens from countries hit by the virus? Also, do you have a total number of cases brought into China by international arrivals?
A: On your first question, please refer to yesterday’s transcript of the press conference for my answer.
Regarding your second question, the foreign ministry and our diplomatic missions overseas are closely following the situation on the ground in relevant countries and actively carrying out consular protection and services. In case of emergencies, we hope Chinese nationals overseas will contact local government departments for help and also contact our embassy or consulate. If the epidemic worsens to a degree that puts Chinese citizens’ health and security under serious threat, we will take necessary measures to assist their return home. We will keep you updated if there’s anything new.
As to your third question, we’ll try to gather more information from relevant authorities before I come back to you.
Voir encore:
La Génération Y sacrifiée dans les pays riches
Dans une vaste étude parue cette semaine, le Guardian se penche sur les revenus dans les pays développés et démontre que les jeunes vingtenaires et trentenaires sont les grands perdants de la croissance sur ces trente dernières années.
Vous vous en doutiez sûrement déjà un peu, mais la récente étude publiée par le Guardian le prouve. La Génération Y (composée de ceux qui sont nés entre 1980 et 1995) est la grande oubliée des trente dernières années de croissance dans les pays développés.
Les journalistes britanniques se sont penchés sur la vaste base de données du Luxembourg Income Study, et en ont tirés plusieurs enseignements très intéressants sur les niveaux de richesse des différentes générations dans huit pays développés (la France, le Royaume-Uni, les Etats-Unis, l’Allemagne, le Canada, l’Australie, l’Italie et l’Espagne).
Des retraités plus riches que les jeunes
Dans tous ces pays, exceptés l’Australie, le revenu disponible (c’est à dire celui qui reste après avoir payé ses impôts) des vingtenaires a progressé beaucoup plus lentement que celui des Baby-boomers et retraités. Pire, dans certains pays comme la France et les Etats-Unis, le revenu disponible de la Génération Y est inférieur de 20% à la moyenne nationale. Alors qu’en 1978, les jeunes de cet âge avaient plutôt tendance à être plus riches que la moyenne !
La situation est complètement inédite et explique le sentiment croissant de déclassement ressentis par certains jeunes comme l’exprime Angel Gurria, secrétaire général de l’OCDE, au Guardian : “Un nombre croissant de gens pensent que dans leur pays les enfants gagneront moins bien leur vie que leurs parents”.
Des causes multiples et des conséquences pour toute la société
Pour expliquer cette progression déséquilibrée du revenu disponible, le quotidien britannique avance plusieurs causes : la crise économique et le chômage bien sûr qui empêchent les jeunes d’accéder à un poste stable et rémunérateur, mais aussi le poids croissant de la dette, surtout pour les diplômés aux Etats-Unis, et la hausse des prix de l’immobilier.
Les conséquences de ces inégalités entre générations pourraient se révéler dramatiques. D’abord parce qu’elles menacent la cohésion sociale mais aussi parce qu’elles aggravent les inégalités entre classes sociales, les jeunes étant de plus en plus dépendants de l’aide de leurs parents à un moment clé de leur vie, celui du passage à l’âge adulte.
Enfin, la faiblesse des revenus des jeunes adultes peut les contraindre à rester plus longtemps chez leurs parents, les empêchant ainsi de fonder leur propre famille. En Espagne par exemple, 8 jeunes sur 10 vivent encore chez leurs parents à trente ans. Cela risque d’avoir un impact négatif plus large sur la natalité dans les pays développés déjà confrontés à une population vieillissante. De quoi donner envie à tout le monde de s’attaquer sérieusement au problème…
Voir enfin:
Commentary: « Political virus » even more dangerous than coronavirus
BEIJING, March 7 (Xinhua) — As China spares no efforts and makes huge sacrifices to fight the novel coronavirus (COVID-19) outbreak, some U.S. individuals and media outlets have alleged the virus « originated in China » and demanded an apology from the country.
This kind of absurd argument smears the Chinese people and runs counter to the urgent need of international collaboration in the face of the epidemic.
Such an argument, like a « political virus, » is even more dangerous than COVID-19. It reveals nothing but prejudice, arrogance and ignorance.
The epidemic was first reported in China but that does not mean it necessarily originated in China, specialists have explained. The World Health Organization (WHO) has said many times that COVID-19 is a global phenomenon with its source still undetermined.
The name COVID-19 was chosen by the WHO for the purpose of making no connections between the virus and certain places or countries.
Moreover, no matter where the origin is, China and other countries hit by the epidemic are all victims of the virus and are faced with a serious battle against the outbreak. What is the point of blaming the victim and arguing that someone should apologize for it?
However, there are people who ignore the facts, put political interests above public interests and science, spread rumors and incite ideological prejudices, even racial discrimination and xenophobia. What are they up to?
Viruses know no borders. To protect the health and safety of the people across the world, the Chinese people have made huge sacrifices and major contributions.
Since the outbreak, China has been fighting at the forefront against the epidemic. The country has taken the utmost effort to contain the epidemic and shared information and experience with the rest of the world.
As WHO Director-General Tedros Adhanom Ghebreyesus said, China’s containment of the outbreak has bought time for the rest of the world.
Bruce Aylward, an epidemiologist who recently headed the WHO-China Joint Mission on COVID-19, spelled out the impact of aggressive containment measures adopted by the Chinese government.
He told reporters following his visit to Wuhan, the epicenter of the outbreak and an 11-million-metropolis that has been under lockdown for more than a month, that it is important to recognize the people of Wuhan. « The world is in your debt. »
COVID-19 is a virus of humanity, not of any certain country. WHO has published data that over 17,000 cases have been confirmed in 88 countries and regions outside China by Friday, calling for early and aggressive measures to break the chain of transmission worldwide.
As the saying goes, a small leak will sink a great ship. What we need in the face of the epidemic is not stigmatizing a country or attacking a country, but science, rationality and solidarity.
These are the most powerful weapons against our common enemy.
If there is anyone who owes the world an apology, it must be those who spread « political virus » that smears China.
Voir par ailleurs:
Didier Sicard : « Il est urgent d’enquêter sur l’origine animale de l’épidémie de Covid-19 »
Tara Schlegel
France Culture
27/03/2020
Entretien | La recherche se focalise sur les traitements et les vaccins, analyse le professeur Didier Sicard, mais elle néglige l’origine animale de l’épidémie. Spécialiste des maladies infectieuses, il affirme qu’il faut retourner sur le terrain, étudier de plus près la chaîne de transmission des coronavirus.
Didier Sicard est un spécialiste des maladies infectieuses, il a notamment travaillé longtemps sur le VIH. Docteur en médecine interne, il est aujourd’hui professeur émérite à Sorbonne Université. Ce qui le frappe dans cette crise est « l’indifférence au point de départ« , à l’origine de la pandémie.
Très impliqué dans la création de l’Institut Pasteur au Laos, Didier Sicard a pu constater à quel point la transformation de la forêt primaire rapproche l’homme des chauves-souris et donc d’un réservoir de virus qu’on a trop peu étudié.
Comme vous le lirez plus bas, le professeur Sicard dénonce le sous-investissement de la France dans cet Institut Pasteur. Or depuis la parution de cet entretien, la direction de cette structure de recherche a reçu la confirmation du renouvellement du poste de virologue qu’elle attendait depuis des mois ! Le Ministère des Affaires étrangères et l’Institut Pasteur à Paris s’y sont engagés.
Par ailleurs, si la Chine a interdit le 24 février dernier « totalement et immédiatement » le trafic et la consommation d’animaux sauvages, une législation analogue existe déjà depuis 2003 sans être appliquée réellement par Pékin. Le professeur Sicard plaide donc pour la création d’un tribunal sanitaire international.
L’ancien président du Comité consultatif d’éthique de 1999 à 2008 souligne enfin combien, dans cette épidémie où la question du contact est primordiale, il faut que chacun se comporte comme un modèle.
Vous souhaitez revenir aux origines du mal ?
Le point de départ de cette pandémie, c’est un marché ouvert de Wuhan dans lequel s’accumulent des animaux sauvages, serpents, chauves-souris, pangolins, conservés dans des caisses en osier. En Chine, ces animaux sont achetés pour la fête du Rat. Ils coûtent assez cher et ce sont des aliments de choix. Sur ce marché, ils sont touchés par les vendeurs, dépecés, alors qu’ils sont maculés d’urine et que les tiques et les moustiques font une sorte de nuage autour de ces pauvres animaux, par milliers. Ces conditions ont fait que quelques animaux infectés ont forcément infecté d’autres animaux en quelques jours. On peut faire l’hypothèse qu’un vendeur s’est blessé ou a touché des urines contaminantes avant de porter la main à son visage. Et c’est parti !
Ce qui me frappe toujours, c’est l’indifférence au point de départ. Comme si la société ne s’intéressait qu’au point d’arrivée : le vaccin, les traitements, la réanimation. Mais pour que cela ne recommence pas, il faudrait considérer que le point de départ est vital. Or c’est impressionnant de voir à quel point on le néglige. L’indifférence aux marchés d’animaux sauvages dans le monde est dramatique. On dit que ces marchés rapportent autant d’argent que le marché de la drogue. Au Mexique, il y a un tel trafic que les douaniers retrouvent même des pangolins dans des valises…
Ce n’est pourtant pas la première fois que des animaux sont à l’origine de crises sanitaires ?
Les animaux sont effectivement à l’origine de la plupart des crises épidémiques depuis toujours : le VIH, les grippes aviaires type H5N1, Ebola. Ces maladies virales viennent toujours d’un réservoir de virus animal. Et on ne s’y intéresse pratiquement pas. C’est la même chose pour la dengue. J’ai des relations très étroites avec le Laos et sur place, au moment où la maladie apparaît, les populations disent : ‘Il faut démoustiquer ‘. Mais en réalité c’est pendant la saison sèche, au moment où il n’y a que des larves, qu’il faudrait mener une politique d’extermination des larves de moustique. Or personne ne le fait parce que les gens se disent ‘oh, il n’y a pas de moustiques, pourquoi voulez-vous qu’on utilise des insecticides ?’. Et l’Institut Pasteur du Laos s’époumone en vain, en demandant aux populations locales de porter l’effort avant que la maladie n’éclate.
C’est exactement comme le travail qui reste à faire sur les chauves-souris. Elles sont elles-mêmes porteuses d’une trentaine de coronavirus ! Il faut que l’on mène des travaux sur ces animaux. Evidemment, ce n’est pas très facile : aller dans des grottes, bien protégé, prendre des vipères, des pangolins, des fourmis, regarder les virus qu’ils hébergent, ce sont des travaux ingrats et souvent méprisés par les laboratoires. Les chercheurs disent : ‘Nous préférons travailler dans le laboratoire de biologie moléculaire avec nos cagoules de cosmonautes. Aller dans la jungle, ramener des moustiques, c’est dangereux.’ Pourtant, ce sont de très loin les pistes essentielles.
Par ailleurs, on sait que ces épidémies vont recommencer dans les années à venir de façon répétée si on n’interdit pas définitivement le trafic d’animaux sauvages. Cela devrait être criminalisé comme une vente de cocaïne à l’air libre. Il faudrait punir ce crime de prison. Je pense aussi à ces élevages de poulet ou de porc en batterie que l’on trouve en Chine. Ils donnent chaque année de nouvelles crises grippales à partir de virus d’origine aviaire. Rassembler comme cela des animaux, ce n’est pas sérieux.
C’est comme si l’art vétérinaire et l’art médical humain n’avaient aucun rapport. L’origine de l’épidémie devrait être l’objet d’une mobilisation internationale majeure.
Quel type de recherches faudrait-il mettre en œuvre ?
Il faut essayer de reconstituer le parcours épidémiologique qui fait que la chauve-souris tolère des coronavirus depuis des millions d’années, mais aussi qu’elle les disperse.
Elle contamine ainsi d’autres animaux. Lorsque les chauves-souris sont accrochées dans les grottes et meurent, elles tombent par terre. Alors les serpents, les vipères en particulier, qui raffolent de leurs cadavres, les mangent. Tout comme les petits chauves-souriceaux enfants qui tombent et sont dévorés immédiatement par ces serpents qui sont donc probablement des hôtes intermédiaires des virus. En plus, il y a dans ces grottes des nuages de moustiques et de tiques et il faudrait essayer de voir quels sont les insectes qui sont aussi éventuellement transmetteurs du virus.
Une autre hypothèse porte sur la transmission qui se produit quand les chauves-souris sortent la nuit manger des fruits, en particulier dans les bégoniacées. Elles ont un réflexe quasiment automatique, dès qu’elles déglutissent, elles urinent. Elles vont donc contaminer les fruits de ces arbres et les civettes, qui adorent les mêmes fruits, se contaminent en les mangeant. Les fourmis participent aux agapes et les pangolins – pour lesquels la nourriture la plus merveilleuse est constituée de fourmis – dévorent les fourmis et s’infectent à leur tour.
C’est toute cette chaîne de contamination qu’il faut explorer. Les réservoirs de virus les plus dangereux sont probablement les serpents, car ce sont eux qui se nourrissent perpétuellement des chauves-souris, elles-mêmes porteuses des coronavirus. Il se pourrait donc que les serpents hébergent ces virus en permanence. Mais c’est justement cela qu’il faut savoir et vérifier. Il faudrait donc que des chercheurs capturent des chauves-souris, mais aussi qu’ils fassent le même travail sur les fourmis, les civettes, les pangolins et essayent de comprendre leur tolérance au virus. C’est un peu ingrat, mais essentiel.
Quel est le rapport qu’entretient la population locale avec ces chauves-souris ?
Ce qui m’a frappé au Laos, où je vais souvent, c’est que la forêt primaire est en train de régresser parce que les Chinois y construisent des gares et des trains. Ces trains, qui traversent la jungle sans aucune précaution sanitaire, peuvent devenir le vecteur de maladies parasitaires ou virales et les transporter à travers la Chine, le Laos, la Thaïlande, la Malaisie et même Singapour. La route de la soie, que les chinois sont en train d’achever, deviendra peut-être aussi la route de propagation de graves maladies.
Sur place, les grottes sont de plus en plus accessibles. Les humains ont donc tendance à s’approcher des lieux d’habitation des chauves-souris, qui sont de surcroît des aliments très recherchés. Les hommes construisent aussi désormais des parcs d’arbres à fruit tout près de ces grottes parce qu’il n’y a plus d’arbres en raison de la déforestation. Les habitants ont l’impression qu’ils peuvent gagner des territoires, comme en Amazonie. Et ils construisent donc des zones agricoles toutes proches de zones de réservoir de virus extrêmement dangereuses.
Moi, je n’ai pas la réponse à toutes ces questions, mais je sais simplement que le point de départ est mal connu. Et qu’il est totalement méprisé. On en fait des discours de conférence sur un mode folklorique. On parle à propos des chauves-souris de la malédiction des pharaons.
Mais il n’existe pas d’après vous d’études suffisamment sérieuses sur la capacité des chauves-souris à héberger des coronavirus ?
Si, il y a sûrement des études sérieuses, je ne peux pas dire qu’il n’y a rien du tout. Mais je le vois bien, quand je me rends à l’Institut Pasteur du Laos qui est dirigé par un homme exceptionnel, Paul Brey. Ce directeur a la fibre d’un Louis Pasteur, il est passionné depuis vingt ans par les questions de transmission. Mais il est extrêmement seul. Même l’étude des moustiques, qui est fondamentale pour comprendre la transmission des maladies au Laos, est presque abandonnée. Et Paul Brey me répète qu’il y a une trentaine d’espèces de coronavirus chez les chauve-souris. L’effort scientifique n’est donc pas à la hauteur.
Quand le ministère des Affaires étrangères français retire le poste de virologue de cet Institut Pasteur qui est à quelques centaines de kilomètres de la frontière chinoise, on est atterré. Cela s’est passé en novembre 2019. Nous allons essayer de récupérer ce poste, mais c’est quand même effrayant de se dire qu’aux portes même de là où les maladies infectieuses virales viennent, on a de la peine à mettre tous les efforts. L’Institut Pasteur du Laos est soutenu très modérément par la France, il est soutenu par les Japonais, les Américains, les Luxembourgeois. La France y contribue, mais elle n’en fait pas un outil majeur de recherche.
Quel est le rôle exact de cet Institut Pasteur ?
Sa mission est de former des chercheurs locaux. De faire des études épidémiologiques sur les virus existants le chikungunya, la dengue et maintenant le coronavirus. D’être un lieu d’études scientifiques biologiques de haut niveau dans un territoire lointain, tropical, mais avec un laboratoire de haute sécurité. D’être au plus près de là où se passent les épidémies et d’avoir des laboratoires à la hauteur. C’est très difficile pour les pays relativement pauvres d’avoir un équipement scientifique de haut niveau. Le réseau des Instituts Pasteurs – qui existent dans plusieurs pays – est une structure que le monde nous envie. Mais des instituts comme celui du Laos ont besoin d’être aidé beaucoup plus qu’il ne l’est actuellement. Ces laboratoires ont du mal à boucler leur budget et ils ont aussi de la peine à recruter des chercheurs. La plupart d’entre eux préfèrent être dans leur laboratoire à l’Institut Pasteur à Paris ou dans un laboratoire Sanofi ou chez Merieux, mais se transformer en explorateur dans la jungle, il n’y a pas beaucoup de gens qui font cela. Or c’est ce que faisait Louis Pasteur, il allait voir les paysans dans les vignes, il allait voir les bergers et leurs moutons. Il sortait de son laboratoire. Tout comme Alexandre Yersin qui était sur le terrain, au Vietnam, quand il a découvert le bacille de la peste.
La recherche entomologique et la recherche sur les animaux transmetteurs n’est donc pas à la hauteur des enjeux. Bien sûr qu’elle existe, mais elle doit compter peut-être pour 1% de la recherche. Parce que ce qui fascine les candidats au Prix Nobel, c’est de trouver un traitement ou un nouveau virus en biologie moléculaire et pas de reconstituer les chaînes épidémiologiques. Or les grandes découvertes infectieuses sont nées ainsi : l’agent du paludisme, le Plasmodium, a été découvert par un Français, Alphonse Laveran sur le terrain, en Tunisie. Et ce sont des recherches qui sont fondamentales et qui sont faites à une échelle qu’on a un peu oubliée. Comme si la vision micro avait fini par faire disparaître l’importance du macro.
Auriez-vous d’autres exemples qui montrent que l’étude du comportement animal est cruciale ?
La peste reste un exemple passionnant. Le réservoir de la peste, ce sont les rats.
Il y a des populations de rats qui sont très résistantes et qui transmettent le bacille de la peste, mais s’en fichent complètement. Et puis, il y a des populations de rats très sensibles. Il suffit qu’un jour, quelques individus de la population de rats sensible rencontrent la population de rats qui est résistante pour qu’ils se contaminent. Les rats sensibles meurent. A ce moment là, les puces qui se nourrissent du sang des rats, désespérées de ne plus avoir de rats vivants, vont se mettre à piquer les hommes. Reconstituer ce tout début de la chaîne de transmission permet d’agir. Dans les endroits où la peste sévit encore, en Californie, à Madagascar, en Iran ou en Chine, lorsque l’on constate que quelques rats se mettent à mourir, c’est exactement le moment où il faut intervenir : c’est extrêmement dangereux car c’est le moment où les puces vont se mettre à vouloir piquer les humains. Dans les régions pesteuses, lorsque l’on voit des centaines de rats morts, c’est une véritable bombe.
Heureusement, la peste est une maladie du passé. Il doit y avoir encore 4 000 ou 5 000 cas de peste dans le monde. Ce n’est pas considérable et puis les antibiotiques sont efficaces. Mais c’est un exemple, pour montrer que l’origine animale est fondamentale et toujours difficile à appréhender. Elle est néanmoins essentielle pour la compréhension et permet de mettre en place des politiques de prévention. Aujourd’hui, si l’on continue à vendre des animaux sauvages sur un marché, on est dans une situation délirante. Il faut appliquer le principe de précaution.
Le trafic d’animaux sauvage est pourtant prohibé. Il existe une convention internationale qui encadre toutes les ventes.
Oui, mais en Chine, notamment, cette convention internationale n’est pas respectée. Il faudrait créer une sorte de tribunal sanitaire international. On voit bien que si on demande à chaque pays de s’organiser nationalement, rien ne changera. La Chine a fait pression au début sur l’OMS pour qu’on ne dise pas qu’il s’agissait d’une pandémie. Elle a tenté de bloquer les choses, car elle contribue fortement au financement de l’OMS. Il serait donc important que ce soit un tribunal sanitaire totalement indépendant, comme un tribunal international pour les crimes de guerre, avec des inspecteurs indépendants qui vérifient ce qu’il se passe sur le terrain.
Au Laos, dans la campagne, il y a beaucoup de marchés où les animaux sauvages sont vendus comme des poulets ou des lapins. Dans l’indifférence générale, car c’est la culture locale. Or la culture est la chose la plus difficile à faire évoluer dans un pays.
Dans cette épidémie, en tant que spécialiste des maladies infectieuses, y a-t-il quelque chose qui vous frappe dans l’attitude de la population ?
Oui, c’est l’écart entre une sorte de désinvolture indifférente, un regard un peu critique sur l’Italie, sur la Chine et la découverte brutale de la catastrophe sanitaire.
On est passé d’une insouciance à une extrême inquiétude et les deux sont aussi toxiques l’une que l’autre : l’insouciance crée la contamination et l’angoisse extrême aboutit à des comportements irrationnels. J’en veux pour preuve la fuite des Parisiens, des Lyonnais, des habitants des grandes villes vers leurs résidences secondaires. Cela m’a paru témoigner d’abord une vision à très courte vue, comme si l’on pouvait échapper, en guerre, à l’arrivée des armées allemandes. Et ensuite d’un comportement extraordinairement individualiste, dans le mauvais sens du terme : ‘Sauve qui peut, moi je me renferme dans ma campagne et puis tant pis pour les autres, je me protège’. Bien sûr, j’imagine que si l’on peut protéger des personnes âgées et les mettre à l’abri, c’est très bien. Mais quand on voit des jeunes couples ou des bandes d’amis qui se disent maintenant on va partir en vacances ! Il y a là une image d’autant plus choquante que dans cette épidémie, il s’agit justement de tout autre chose que d’un sauve-qui-peut. Il s’agit, à l’inverse, de se demander comment chacun peut être vu par l’autre comme un modèle.
Il faudrait donc afficher une sorte d’attitude universalisable ?
Oui, il ne faut pas se mettre ‘en dehors’. Il ne faut pas considérer qu’on a 30 ans et qu’on est en bonne santé et qu’on ne va pas se laisser avoir par tous ces discours. Je pense aussi aux couples qui pourraient dire, on va continuer quand même à s’embrasser dans la rue, on se connaît, on n’est pas contagieux. Alors que l’on sait qu’environ 1/3 des personnes contaminantes ne présentent aucun symptôme. Par conséquent, il faut que chacun intègre le fait qu’il est possiblement contaminant à son insu. Et si cette personne part dans un territoire à priori vierge de tout virus, son comportement va être une vraie bombe pour les autres.
L’épidémie est passée par des gens qui sont revenus de Chine ou d’Italie. Je connais l’exemple d’une femme italienne qui s’est rendue en Argentine. Elle a participé à un mariage et embrassé tout le monde. Cette femme a contaminé 56 personnes ! L’irresponsabilité en période d’épidémie fait d’immenses dégâts. Il faut au contraire respecter à la lettre les mesures barrières. Comme attendre, par exemple, devant le supermarché avant d’entrer si on voit qu’il y a du monde.
Quant aux masques, ce sont des protecteurs psychologiques pour les promeneurs et non des protecteurs virologiques. Il faut que chaque Français se dise : je fais tout pour que les autres ne puissent rien me reprocher. Nous avons besoin d’une attitude où l’on cherche le regard de l’autre avant son propre regard. Cela seul sera porteur d’efficacité.
Pourquoi dites-vous que les masques ne sont pas protecteurs ?
Ils sont protecteurs bien évidemment pour les médecins et les soignants, dans un milieu où circule le virus. Mais quand vous avez des gens qui se promènent dans la rue en portant des masques, c’est paradoxal. Ils pensent se protéger des autres mais il y a un écart considérable entre l’inutilité des masques dans la rue et l’utilité vitale des masques dans les hôpitaux. Moi-même, j’étais à la pharmacie samedi matin et j’ai montré ma carte de médecin pour vérifier si je pouvais acheter des masques. Le pharmacien m’a répondu qu’il n’y en avait plus. Donc, si j’en avais eu besoin pour soigner un malade je n’aurais pas pu aller le voir, ou je l’aurais peut-être contaminé. On a trop vu de gens se promener dans la rue en arborant des masques comme une sorte de panoplie. Il y a un drame politique majeur dans cette absence de masques.
Faut-il les réserver aux soignants ?
Oui, c’est évident. A tous ceux qui travaillent à proximité du virus. Quand vous voyez au supermarché des caissières qui n’ont pas de masques alors que les clients ont des masques, il y a quelque chose de complètement contre productif. Ceux qui n’en ont pas besoin en ont eu, et ceux qui en ont vraiment besoin en manquent. Cela est directement lié aux comportements individuels. Jamais je n’aurais osé me promener dans la rue avec un masque tant que les soignants n’en avaient pas. C’est quelque chose qui m’aurait effaré. Cela montre au fond la cécité des gens et leur ignorance. Si on se promène sans croiser personne, il n’y a aucun intérêt à porter un masque.
Que pensez-vous, d’un point de vue éthique, de l’attitude des soignants, qui sont en première ligne alors qu’ils étaient en grève il y a encore quelques semaines ?
C’est leur fonction. Un médecin est mobilisé dans son for intérieur pour accomplir son métier. Les lâches ne viennent pas dès le début. Donc cela me paraît à la fois admirable et normal.
La souffrance du corps hospitalier, je la vois depuis dix ou quinze ans. Le nombre de mes collègues qui m’ont dit, tu as tellement de chance d’être à la retraite ! Nous souffrons, c’est épouvantable, l’hôpital est devenu une entreprise. Et je suis tout à fait d’accord avec leur discours : l’hôpital a été martyrisé. Avec des décisions purement économiques qui ont fait fi de l’intérêt des malades et des médecins.
Il faut mesurer le nombre de médecins qui sont partis en retraite anticipée en expliquant que leur métier n’avait plus d’intérêt et qu’ils avaient l’impression de passer leur temps à remplir des fiches et des cases. Il y a eu un vrai saccage de l’hôpital public depuis une décennie. Le dernier ministre de la Santé qui avait encore vraiment conscience de son rôle et qui respectait le personnel de santé, c’était Xavier Bertrand. Après, cela a été la catastrophe.
Mais cette casse du système hospitalier a-t-elle des répercussions aujourd’hui au moment de la crise sanitaire ?
Non, il y a un découplage. Toutes les mesures qui rendaient l’hôpital non fonctionnel ont temporairement disparu. Les administrateurs sont terrifiés dans leurs bureaux et ne font plus rien. Ce sont les médecins qui font tout. Ils ont retrouvé la totalité de leur pouvoir. Il y a pour eux un certain bonheur à retrouver le métier qu’ils ont toujours voulu faire. L’administration a plié bagage, ou plus exactement elle est aux ordres. Le rapport de force s’est renversé : il y a un an, les médecins étaient aux ordres de l’administration ; à présent, c’est l’administration qui est aux ordres des médecins. C’est un phénomène très intéressant. Les médecins eux-mêmes ne sont plus entravés par la contrainte de remplir leurs lits avec des malades qui rapportent de l’argent, ce qui était le principe jusqu’alors. Maintenant, ils répondent à leur cœur de métier. A ce qui est la lutte contre la mort. Au fond, ils retrouvent l’ADN profond de leur métier.
C’est presque un paradoxe : il y a moins de détresse dans le corps médical actuellement en situation d’activité maximale, qu’il n’y avait de détresse il y a six mois quand ils étaient désespérés et déprimés car ils estimaient que leur métier avait perdu son sens.
Pensez-vous que le politique saura s’en souvenir ?
Oui, je le pense. Je crois qu’on va changer d’époque. Je peux vous donner un exemple pour lequel je me bats depuis deux ans. Je ne donnerai pas le nom de l’hôpital mais je connais une femme chirurgien spécialiste des grands brûlés. A l’hôpital, son service a fermé et elle n’avait plus de poste. Elle souhaitait néanmoins continuer à travailler avec des enfants victimes de brûlures. Or son service d’enfants brûlés a été transformé en un service de chirurgie plastique de la fesse et du sein. Parce que cela rapporte beaucoup d’argent. Mais elle me dit toujours que s’il y avait un incendie dans une école avec quarante ou cinquante enfants brûlés, on n’aurait plus la capacité de les accueillir parce qu’on considère que la brûlure n’est pas assez rentable et qu’il vaut mieux s’intéresser à la chirurgie des stars. Cette vision économique de la médecine, qui s’est introduite depuis dix ans, est une catastrophe absolue.
Il s’agit d’un hôpital public ?
Oui bien entendu. Dans le privé, les établissements font ce qu’ils veulent. Mais que dans le public, on détruise une activité qui n’est pas rentable – car les brûlures cela coûte effectivement très cher et rapporte très peu et il n’y a pas d’activité privé capable de les prendre en charge – qu’on écarte cela au profit d’activités rentables ce n’est pas normal. Au fond, le public était angoissé à l’idée qu’il lui fallait investir énormément dans des équipements haut de gamme pour être à la hauteur du privé. Or le public n’aura jamais autant d’argent que le privé et n’arrivera jamais à suivre. Et à force de dépenser de l’argent pour des secteurs ultra pointus, on finit par négliger l’accueil des personnes les plus vulnérables, que ce soient les personnes âgées, les personnes en situation d’alcoolisme, de précarité. L’hôpital public a fini par oublier sa fonction hospitalière, je l’ai dit à plusieurs reprises.
90% des médecins en ont été conscients et cela a été pour eux une souffrance terrible. Tout comme pour les infirmières et les autres personnels soignants, de faire un métier qui était relié à l’argent.
En quoi pensez vous que les hommes politiques vont modifier leur regard sur l’hôpital ?
On n’a aucune certitude, mais je pense que les Français s’en souviendront et demanderont des comptes. Le Président Macron avait promis d’arrêter la tarification à l’activité, le système actuel de financement des hôpitaux. Les économistes ont poussé des hauts-cris en disant qu’on n’arriverait plus à mesurer ce que coûte telle ou telle opération. Et le chef de l’Etat a renoncé. Moi, je pense qu’après cette crise, le président de la République va modifier cette tarification à l’activité. L’hôpital demandera à être remboursé sur ce qu’il réalise et ce qu’il considère comme sa priorité. Il faut faire confiance à l’hôpital pour ne pas traiter les patients inutilement et remplir des lits comme si on était au club méditerranée. L’hôpital va retrouver sa vraie fonction de soins publics.
Voir de plus:
Chine. Vous reprendrez bien un peu d’animal exotique ?
L’appétit toujours plus grand des Cantonais pour les plats à base d’espèces rares pourrait bien entraîner l’éradication des pangolins, des serpents sauvages et autres salamandres géante
Il ne fait pas encore jour et déjà M. Qiu, de Foshan à Canton, est occupé à faire sortir des couleuvres d’une cage pour les transférer dans un grand sac. Il va ensuite les jeter dans une marmite d’eau bouillante. L’homme tient sa boutique de soupe au serpent depuis plus de dix ans. En hiver, les habitants de la province de Canton surveillent tout particulièrement leur alimentation, si bien que sa boutique est très fréquentée.
De nombreux Cantonais n’aiment rien tant que de prendre un bol de soupe au serpent bien chaude au petit déjeuner pour lutter contre le froid. “Nous, les Cantonais, nous sommes convaincus depuis toujours que la viande de serpent guérit les maladies, souligne M. Qiu. En plus de cela, elle est nutritive et protège du rhume”.
Le marché de la viande d’animaux sauvages est en plein essor. Ainsi, les restaurants font de bonnes affaires, même s’ils flirtent avec l’illégalité. Des espèces protégées comme les varans ou les pangolins sont chassées et vendues illégalement, puis finissent dans les assiettes des clients.
1 800 yuans le hibou
La réputation qu’ont les Cantonais de manger des animaux sauvages n’est pas usurpée : cette tradition ancrée fait partie de la culture du Lingnan (la zone comprenant Canton et les provinces avoisinantes). Un salarié du bureau chinois de la Wildlife Conservation Society (WCS) affirme que les Cantonais “mangent absolument de tout” – les mets les plus recherchés étant des espèces en voie de disparition.
Parmi les espèces les plus consommées à Canton, on trouve le varan, la salamandre géante de Chine, des serpents sauvages, des hiboux et le bruant auréole. Une fois préparé, un hibou entier peut valoir environ 1 800 yuans [221 euros]. Les pangolins se vendent à 500 yuans [61 euros] le jin [env. 500 grammes], les varans à environ 100 yuans [12 euros].
Selon Yang Nan [pseudonyme], membre de la Société des amoureux de la nature, qui a mené une enquête à Canton, les bruants auréole sont peut-être l’animal le plus vendu sur les marchés de la ville. Cet oiseau a presque acquis un statut mythique depuis trente ans en raison de sa valeur nutritive. En saison, il peut s’en livrer 100 000 quotidiennement dans les restaurants, chacun étant vendu 100 yuans sous forme de soupe. D’énormes troupes de ces oiseaux survolaient autrefois Pékin au printemps et en été, mais depuis dix ans on n’en voit presque plus. Bientôt, ils auront tous été mangés. “Aujourd’hui, les oiseaux migrateurs évitent de survoler Canton”, soutient Yang.
Préparer ces mets délicats est une activité des plus sanguinaires. Un cuisinier d’un restaurant de Shenzhen (province de Canton), nous explique comment on tue et on prépare le pangolin : d’abord, on l’assomme d’un coup de marteau sur la tête, puis on le suspend au bout d’une corde, et on l’égorge à l’aide d’un couteau pour le saigner. Ensuite, on le plonge dans l’eau bouillante pour enlever les écailles – comme on plume un poulet. Puis, il faut le passer à feu doux pour enlever les poils fins. Enfin, on le vide, on le lave et on le cuit. La viande peut ensuite être braisée, cuite à la vapeur dans une soupe claire ou cuite en ragoût.
“La plupart des habitués ne paient pas eux-mêmes la note, explique un patron de restaurant. Les hommes d’affaires qui doivent leur demander une faveur invitent lesdits habitués à dîner, soit pour étaler leur cash, soit pour régaler un fonctionnaire”. Et ce sont ces mêmes fonctionnaires qui protègent les restaurants où l’on vend de la viande illégale.
Propriétés nutritionnelles extraordinaires
La passion des Chinois pour la consommation d’animaux sauvages est liée aux propriétés médicinales qu’ils prêtent à ces aliments. D’anciens écrits médicaux attribuent de telles vertus à presque toutes les plantes et animaux – et même aux organes d’animaux, à leurs excréments, leurs humeurs, leur peau ou leurs plumes. La médecine chinoise considère que l’art médical et la nourriture puisent aux mêmes sources.
Ces conceptions sont encore extrêmement répandues, et même les illettrés peuvent citer un certain nombre de “prescriptions” pour diverses affections : des alcools faits à partir de pénis de tigre ou de testicules de bélier pour la virilité, ou encore des os de tigre pour un squelette solide et des muscles vigoureux. Et il est généralement admis qu’on préserve mieux sa santé par son régime que par la médecine. Mais ces idées sont poussées de plus en plus loin. Presque toutes les plantes et les animaux rares ou inhabituels se voient maintenant conférer des propriétés médicinales ou nutritionnelles extraordinaires.
Alors, ces animaux sauvages sont-ils vraiment plus nutritifs ? Zheng Jianxian, spécialiste de l’alimentation à l’université de technologie de Chine du Sud, ne le croit pas. “Ces aliments n’ont pas les propriétés mystiques qu’on leur prête, affirme-t-il. En comparant les valeurs nutritionnelles du bétail et de la volaille produites nationalement avec celles d’animaux sauvages, nous avons trouvé des quantités identiques de protéines, de glucides, de lipides et autres éléments nutritifs. Les espèces sauvages n’ont aucune valeur nutritionnelle particulière et ne présentent aucun avantage. Et même lorsqu’il y a effectivement de petites différences, elles sont loin d’être aussi importantes que les gens ne l’imaginent”.
La plupart des bienfaits de ces aliments sont psychologiques
En fait, dans bien des cas, de tels aliments sont bien moins nourrissants. L’aileron de requin est constitué de fines bandes de cartilage et n’a ni goût spécifique, ni valeur nutritionnelle particulière. Il se compose principalement de collagène, une protéine incomplète, dépourvue de ces acides aminés essentiels que sont le tryptophane et la cystéine. Il est bien moins nourrissant que la chair de requin proprement dite, laquelle fournit des protéines complètes.
Même topo pour ce qui est de la soupe dite aux nids d’hirondelle, considérée par les Chinois comme un trésor national. Cette soupe est faite à partir des nids de salangane, lesquels contiennent la salive de l’oiseau mêlée à des algues, des plumes et des fibres végétales. La salive elle-même contient des enzymes, des protéines de mucus, des glucides et un peu de sel. On retrouve ces mêmes ingrédients dans la salive d’autres animaux – il n’y a là rien de magique. Pourtant, ces nids sont devenu des produits de grande valeur, alimentant toute une chaîne d’approvisionnement, depuis la collecte jusqu’à la consommation des nids en passant par leur préparation. Les populations de salanganes sur les côtes d’Asie du sud-est sont menacées à cause de la surexploitation.
Feng Yongfeng, journaliste spécialisé dans l’environnement au Quotidien de Guangming, fait valoir que la plupart des bienfaits de ces aliments sont psychologiques. Il n’en reste pas moins que ces idées d’un autre âge entraînent encore l’abattage d’animaux sauvages.
M. Luo, un habitant de Guangzhou avec qui nous nous sommes entretenus, reconnaît qu’il mange de la viande de ces animaux, mais qu’il aurait dû mal à changer ses habitudes du jour au lendemain. Par ailleurs, il estime que les autorités devraient davantage communiquer sur l’interdiction de consommer des espèces protégées. “Les pouvoirs publics et les médias ont incité les gens à ne pas manger d’aileron de requin, de pénis de tigre et de patte d’ours, alors je n’en mange pas”, concède-t-il. Mais il ajoute qu’il a mangé du pangolin pendant dix ans avant d’apprendre qu’il s’agissait d’une espèce protégée. A l’en croire, il faudrait dire clairement aux citoyens ce qu’ils peuvent et ce qu’ils ne peuvent pas manger.
Voir enfin:
China’s inaction for 3 days in January at root of pandemic
A second wave of the coronavirus is boomeranging back to the mainland
TOKYO — Chinese students are returning home in droves from European countries, convinced that it is now safer to be in China to avoid the new coronavirus.
For municipalities such as Beijing, the arrivals pose a serious risk of a second wave of infections, as the students come back from virus-hit nations.
Right as the battle against the invisible enemy looked as if it had turned a corner and given China a glimmer of hope, the second wave threatens to cancel hard-earned gains.
The response toward the students has been harsh on Chinese social media. « They left the country in the first place because they like foreign countries better. Don’t return with the virus now, » one poster wrote.
« They are spoiled rich kids, and they run away when times get tough, » wrote another.
Fearing a second wave, the Beijing government made a bombshell announcement that all travelers arriving in the Chinese capital from abroad would be forcibly quarantined for 14 days at « centralized observation centers » designated by authorities.
The compulsory quarantine, which went into force on Monday, applies to foreign nationals as well. Arrivals are isolated regardless of whether they have symptoms, and they have to pay for their stay.
The purpose of the compulsory quarantine is to tightly control SARS-CoV-2 — the new coronavirus that has spread to various parts of the world from Wuhan, in China’s Hubei Province.
The number of cases brought back into China from abroad has been surging in recent days. According to figures released by the Chinese government on Tuesday, the total number of imported cases in China reached 143, with Beijing alone accounting for 40 of them.
The infections have ignited worries of a small leak sinking a great ship.
If the virus were to catch fire again, this time through carriers coming back from overseas, all the stringent movement-restrictions enforced within China will have been meaningless. The progress made so far in the « people’s war on the virus, » which Chinese President Xi Jinping repeatedly talks about, could be reduced to ashes.
Zhong Nanshan — the 83-year-old medical doctor specializing in respiratory diseases who became a national hero in the fight against SARS in 2003 — is spearheading the fight against this coronavirus.
Zhong’s team made an interesting observation of the threat China was facing in the initial stages of the crisis. Noting that the actual situation in Hubei in January was far worse than the media was suggesting, his team said that « a five-day delay in controlling the virus would have led to three times as many infections. »
The team added that a « failure to control the situation in Wuhan would have caused a second peak of the outbreak in Hubei Province around mid-March and would have continued until late April. »
It was a race against time.
The Chinese government locked down Wuhan on Jan. 23, halting all public transportation going in and out of the city. The following day an order was issued suspending group travel within China. But in a blunder that would have far reaching consequences, China did not issue an order suspending group travel to foreign countries until three days later, on Jan. 27.
In retrospect, it was a painful mistake. This is what happened in those critical three days:
The weeklong Lunar New Year string of holidays began on Jan. 24, with the outbound traffic peak lasting through Jan. 27.
The Chinese government let the massive exodus of group travelers continue despite the public health crisis. No explanation has been given.
Furthermore, while suspending group travel, China did nothing to limit individuals traveling overseas.
Groups account for less than half of all Chinese tourists heading abroad.
Chinese travelers journeyed to Japan, South Korea, Italy, Spain, France, the U.K., Australia, North America and South America, one planeload after another.
This was happening while many restaurants in China were unable to open for business due to the outbreak. It is said that once abroad, many Chinese prolonged their vacations as much as possible to avoid having to return home.
The number of infections gradually increased at popular winter destinations, such as Japan’s Hokkaido. In other destinations like Thailand, cases have surged in recent days.
A considerable number of Chinese individual travelers were staying put in the Hokkaido capital of Sapporo in mid-February, even after the annual Snow Festival ended.
The five-day delay that Zhong’s team warned about did not happen. But in reality, a three-day delay did. And as the doctor predicted, infections spread to many people, and across the world. Now we are seeing the « second wave » that the team talked about.
After the first wave hit China, the outbreak went on a second wave across the world, especially in Europe. The number of deaths from the coronavirus in Italy, home to many Chinese residents, has topped 2,100.
The delay in the Chinese government’s ban on group travel to foreign countries may have helped to double or possibly triple the number of people infected.
In the days before Wuhan was locked down on Jan. 23, as many as 5 million of its 11 million citizens had already left the city, as the mayor and others have testified.
Chinese authorities are now busy coping with a growing number of coronavirus cases flying back into the country. A Chinese Foreign Ministry spokesperson described the inflow as « the main risk » the country is facing.
To accommodate the inbound travelers, the Beijing government has reopened Xiaotangshan Hospital. If travelers arriving in Beijing on flights from abroad test positive for the virus during their compulsory 14-day intensive observation period, they will be sent to the hospital, which has a little more than 1,000 beds.
The hospital is far away from the central part of Beijing. It was thrown up during the 2003 outbreak of severe acute respiratory syndrome to quarantine patients. This time, renovation work was launched at the end of January to prepare for a possible dramatic rise in the number of patients in Beijing.
The reopening is a symbol of Beijing facing another crisis.
The compulsory 14-day quarantine cannot be good for business. Foreign businesspeople will likely be scared away. It will become difficult for China to attract foreign investment, and supply chain disruptions could become even more serious.
Already, China’s economy has been dealt a serious blow. The main economic figures for the January-February period, including industrial production, all posted negative growth for the first time since records began. Growth in gross domestic product for the January-March quarter is also likely to be negative.
The virus’s spread in Europe and the U.S. will lead to a slump in demand for goods exported by China.
The current crisis will also affect China’s politics. When can a postponed annual session of the National People’s Congress, China’s parliament, be held? It depends on whether the second wave of infections can be contained.
The Chinese leadership has envisioned a V-shaped economic recovery beginning in April. But the global spread of the virus has cast a dark cloud over that scenario.
Xi’s team faces a bumpy road ahead as it seeks to simultaneously move the stalled domestic economy ahead and bring the virus under control.
Voir par ailleurs:
China Bars U.S. Trip for Doctor Who Exposed SARS Cover-Up
Joseph Kahn
The New York Times
BEIJING, July 12 A Chinese doctor who exposed the cover-up of China’s SARS outbreak in 2003 has been barred from traveling to the United States to collect a human rights award, a friend of the doctor and a human rights group said this week.
The doctor, Jiang Yanyong, a retired surgeon in the People’s Liberation Army, was awarded the Heinz R. Pagels Human Rights of Scientists Award by the New York Academy of Sciences. His army-affiliated work unit, Beijing’s Hospital 301, denied him permission to travel to the award ceremony in September, Hu Jia, a Chinese rights promoter who is a friend of Dr. Jiang’s, said Thursday.
The Information Center for Human Rights and Democracy, which is based in Hong Kong, also issued a statement reporting the rejection of the travel request. The doctor could not be reached at his home for comment, and a person who answered the phone in the director’s office of Hospital 301 said the situation was unclear, declining to provide further details.
Dr. Jiang rose to international prominence in 2003, when he disclosed in a letter circulated to international news organizations that at least 100 people were being treated in Beijing hospitals for severe acute respiratory syndrome, or SARS. At the time, the Chinese medical authorities were asserting that the entire nation had only a handful of cases of the disease.
The revelation prompted China’s top leaders to acknowledge that they had provided false information about the epidemic. The health minister and the mayor of Beijing were removed from their posts.
SARS eventually killed more than 800 people worldwide, and the government came under international scrutiny for failing to provide timely information that medical experts said might have saved lives.
Dr. Jiang was initially hailed as a hero in Chinese and foreign news media. He used his new prestige in 2004 to press China’s ruling Politburo Standing Committee to admit that the leadership had made a mistake in ordering the military to shoot unarmed civilians on June 3 and 4, 1989, when troops were deployed to suppress democracy protests that began in Tiananmen Square in Beijing.
Dr. Jiang, who treated Beijing residents wounded in the 1989 assault, contended that the official line that the crackdown was necessary to put down a rebellion was false. His statement antagonized party leaders, who consider the crackdown a matter of enormous political sensitivity.
Jiang Zemin, then the leader of the military, ordered the detention of Dr. Jiang, who spent several months in custody, people involved in his defense say. Dr. Jiang was eventually allowed to return to his home but remained under constant watch. He has not been allowed to accept press requests for interviews or to visit family members who live in the United States, friends and human rights groups say.
Mr. Hu said that Dr. Jiang’s superiors at Hospital 301 had told him that he could not travel to New York to collect his award because the ruling Communist Party was seeking to maintain an atmosphere of social and political stability in the period leading up to the 17th Party Congress in the fall, when party leaders decide on a new leadership lineup.
“There is always some big political event they can use as an excuse to put pressure on human rights defenders,” Mr. Hu said. “The real reason is that they want to keep him under house arrest so he has no opportunity to speak the truth to the outside world.”
How China’s “Bat Woman” Hunted Down Viruses from SARS to the New Coronavirus
Wuhan-based virologist Shi Zhengli has identified dozens of deadly SARS-like viruses in bat caves, and she warns there are more out there
BEIJING—The mysterious patient samples arrived at Wuhan Institute of Virology at 7 P.M. on December 30, 2019. Moments later, Shi Zhengli’s cell phone rang. It was her boss, the institute’s director. The Wuhan Center for Disease Control and Prevention had detected a novel coronavirus in two hospital patients with atypical pneumonia, and it wanted Shi’s renowned laboratory to investigate. If the finding was confirmed, the new pathogen could pose a serious public health threat—because it belonged to the same family of bat-borne viruses as the one that caused severe acute respiratory syndrome (SARS), a disease that plagued 8,100 people and killed nearly 800 of them between 2002 and 2003. “Drop whatever you are doing and deal with it now,” she recalls the director saying.
Shi—a virologist who is often called China’s “bat woman” by her colleagues because of her virus-hunting expeditions in bat caves over the past 16 years—walked out of the conference she was attending in Shanghai and hopped on the next train back to Wuhan. “I wondered if [the municipal health authority] got it wrong,” she says. “I had never expected this kind of thing to happen in Wuhan, in central China.” Her studies had shown that the southern, subtropical areas of Guangdong, Guangxi and Yunnan have the greatest risk of coronaviruses jumping to humans from animals—particularly bats, a known reservoir for many viruses. If coronaviruses were the culprit, she remembers thinking, “could they have come from our lab?”
While Shi’s team at the Chinese Academy of Sciences institute raced to uncover the identity and origin of the contagion, the mysterious disease spread like wildfire. As of this writing, about 81,000 people in China have been infected. Of that number, 84 percent live in the province of Hubei, of which Wuhan is the capital, and more than 3,100 have died. Outside of China, about 41,000 people across more than 100 countries and territories in all of the continents except Antarctica have caught the new virus, and more than 1,200 have perished.
The epidemic is one of the worst to afflict the world in recent decades. Scientists have long warned that the rate of emergence of new infectious diseases is accelerating—especially in developing countries where high densities of people and animals increasingly mingle and move about.
The New Coronavirus Outbreak: What We Know So Far
“It’s incredibly important to pinpoint the source of infection and the chain of cross-species transmission,” says disease ecologist Peter Daszak, president of EcoHealth Alliance, a New York City–based nonprofit research organization that collaborates with scientists, such as Shi, around the world to discover new viruses in wildlife. An equally important task, he adds, is hunting down other related pathogens—the “known unknowns”—in order to “prevent similar incidents from happening again.”
Tracing the Virus at Its Source
To Shi, her first virus-discovery expedition felt like a vacation. On a breezy, sunny spring day in 2004, she joined an international team of researchers to collect samples from bat colonies in caves near Nanning, the capital of Guangxi. Her inaugural cave was typical of the region: large, rich in limestone columns and—being a popular tourist destination—easily accessible. “It was spellbinding,” Shi recalls, with milky-white stalactites hanging from the ceiling like icicles, glistening with moisture.
But the holidaylike atmosphere soon dissipated. Many bats—including several insect-eating species of horseshoe bats that are abundant in southern Asia—roost in deep, narrow caves on steep terrain. Often guided by tips from local villagers, Shi and her colleagues had to hike for hours to potential sites and inch through tight rock crevasses on their stomach. And the flying mammals can be elusive. In one frustrating week, the team explored more than 30 caves and saw only a dozen bats.
These expeditions were part of the effort to catch the culprit in the SARS outbreak, the first major epidemic of the 21st century. A Hong Kong team had reported that wildlife traders in Guangdong first caught the SARS coronavirus from civets, mongooselike mammals that are native to tropical and subtropical Asia and Africa.
Before SARS, the world had little inkling of coronaviruses—named because, seen under a microscope, their spiky surface resembles a crown—says Linfa Wang, who directs the emerging infectious diseases program at Singapore’s Duke-NUS Medical School. Coronavirues were mostly known for causing common colds. “The SARS outbreak was a game changer,” says Wang, whose work on bat-borne coronaviruses got a swift mention in the 2011 Hollywood blockbuster Contagion. It was the first time a deadly coronavirus with pandemic potential emerged. This discovery helped to jump-start a global search for animal viruses that could find their way into humans.
Shi was an early recruit of that worldwide effort, and both Daszak and Wang have since been her long-term collaborators. But how the civets got the virus remained a mystery. Two previous incidents were telling: Australia’s 1994 Hendra virus infections, in which the contagion jumped from horses to humans, and Malaysia’s 1998 Nipah virus outbreak, in which it moved from pigs to people. Both diseases were found to be caused by pathogens that originated in fruit-eating bats. Horses and pigs were merely the intermediate hosts.
In those first virus-hunting months in 2004, whenever Shi’s team located a bat cave, it would put a net at the opening before dusk—and then wait for the nocturnal creatures to venture out to feed for the night. Once the bats were trapped, the researchers took blood and saliva samples, as well as fecal swabs, often working into the small hours. After catching up on some sleep, they would return to the cave in the morning to collect urine and fecal pellets.
But sample after sample turned up no trace of genetic material from coronaviruses. It was a heavy blow. “Eight months of hard work seemed to have gone down the drain,” Shi says. “We thought coronaviruses probably did not like Chinese bats.” The team was about to give up when a research group in a neighboring lab handed it a diagnostic kit for testing antibodies produced by people with SARS.
There was no guarantee the test would work for bat antibodies, but Shi gave it a go anyway. “What did we have to lose?” she says. The results exceeded her expectations. Samples from three horseshoe bat species contained antibodies against the SARS virus. “It was a turning point for the project,” Shi says. The researchers learned that the presence of the coronavirus in bats was ephemeral and seasonal—but an antibody reaction could last from weeks to years. So the diagnostic kit offered a valuable pointer as to how to hunt down viral genomic sequences.
Shi’s team used the antibody test to narrow down locations and bat species to pursue in the quest for these genomic clues. After roaming mountainous terrain in the majority of China’s dozens of provinces, the researchers turned their attention to one spot: Shitou Cave on the outskirts of Kunming, the capital of Yunnan—where they conducted intense sampling during different seasons throughout five consecutive years.
The efforts paid off. The pathogen hunters discovered hundreds of bat-borne coronaviruses with incredible genetic diversity. “The majority of them are harmless,” Shi says. But dozens belong to the same group as SARS. They can infect human lung cells in a petri dish, cause SARS-like diseases in mice, and evade vaccines and drugs that work against SARS.
In Shitou Cave—where painstaking scrutiny has yielded a natural genetic library of bat viruses—the team discovered a coronavirus strain in 2013 that came from horseshoe bats and had a genomic sequence that was 97 percent identical to the one found in civets in Guangdong. The finding concluded a decade-long search for the natural reservoir of the SARS coronavirus.
Viral Melting Pots
In many bat dwellings Shi has sampled, including Shitou Cave, “constant mixing of different viruses creates a great opportunity for dangerous new pathogens to emerge,” says Ralph Baric, a virologist at the University of North Carolina at Chapel Hill. And in the vicinity of such viral melting pots, Shi says, “you don’t need to be a wildlife trader to be infected.”
Near Shitou Cave, for example, many villages sprawl among the lush hillsides in a region known for its roses, oranges, walnuts and hawthorn berries. In October 2015 Shi’s team collected blood samples from more than 200 residents in four of those villages. It found that six people, or nearly 3 percent, carried antibodies against SARS-like coronaviruses from bats—even though none of them had handled wildlife or reported SARS-like or other pneumonia-like symptoms. Only one had travelled outside of Yunnan prior to sampling, and all said they had seen bats flying in their village.
Three years earlier, Shi’s team had been called in to investigate the virus profile of a mineshaft in Yunnan’s mountainous Mojiang County—famous for its fermented Pu’er tea—where six miners suffered from pneumonialike diseases (two of them died). After sampling the cave for a year the researchers discovered a diverse group of coronaviruses in six bat species. In many cases, multiple viral strains had infected a single animal, turning it into a flying factory of new viruses.
“The mineshaft stunk like hell,” says Shi, who went in with her colleagues wearing a protective mask and clothing. “Bat guano, covered in fungus, littered the cave.” Although the fungus turned out to be the pathogen that had sickened the miners, she says it would only have been a matter of time before they caught the coronaviruses if the mine had not been promptly shut.
With growing human populations increasingly encroaching on wildlife habitats, with unprecedented changes in land use, with wildlife and livestock transported across countries and their products around the world, and with a sharp increase in both domestic and international travel, new disease outbreaks of pandemic scale are a near mathematical certainty. This had been keeping Shi and many other researchers awake at night—long before the mysterious samples landed at the Wuhan Institute of Virology on that ominous evening last December.
About a year ago, Shi’s team published two comprehensive reviews about coronaviruses in Viruses and Nature Reviews Microbiology. Drawing evidence from her own studies—many of which were published in top academic journals—and from others, Shi and her co-authors warned of the risk of future outbreaks of bat-borne coronaviruses.
Racing against a Deadly Pathogen
On the train back to Wuhan on December 30 last year, Shi and her colleagues discussed ways to immediately start testing the patient samples. In the following weeks—the most intense and the most stressful time of her life—China’s bat woman felt she was fighting a battle in her worst nightmare, even though it was one she had been preparing for over the past 16 years. Using a technique called polymerase chain reaction, which can detect a virus by amplifying its genetic material, the first round of tests showed that samples from five of seven patients contained genetic sequences known to be present in all coronaviruses.
Shi instructed her team to repeat the tests and, at the same time, sent the samples to another laboratory to sequence the full viral genomes. Meanwhile she frantically went through her own laboratory’s records from the past few years to check for any mishandling of experimental materials, especially during disposal. Shi breathed a sigh of relief when the results came back: none of the sequences matched those of the viruses her team had sampled from bat caves. “That really took a load off my mind,” she says. “I had not slept a wink for days.”
By January 7 the Wuhan team determined that the new virus had indeed caused the disease those patients suffered—a conclusion based on results from polymerase chain reaction analysis, full genome sequencing, antibody tests of blood samples and the virus’s ability to infect human lung cells in a petri dish. The genomic sequence of the virus—now officially called SARS-CoV-2 because it is related to the SARS pathogen—was 96 percent identical to that of a coronavirus the researchers had identified in horseshoe bats in Yunnan, they reported in a paper published last month in Nature. “It’s crystal clear that bats, once again, are the natural reservoir,” says Daszak, who was not involved in the study.
The genomic sequences of the viral strains from patients are, in fact, very similar to one another, with no significant changes since late last December, based on analyses of 326 published viral sequences. “This suggests the viruses share a common ancestor,” Baric says. The data also point to a single introduction into humans followed by sustained human-to-human transmission, researchers say.
Given that the virus seems fairly stable and that many infected individuals appear to have mild symptoms, scientists suspect the pathogen might have been around for weeks or even months before the first severe cases raised alarm. “There might have been mini outbreaks, but the virus burned out” before causing havoc, Baric says. “The Wuhan outbreak is by no means incidental.” In other words, there was an element of inevitability to it.
To many, the region’s burgeoning wildlife markets—which sell a wide range of animals such as bats, civets, pangolins, badgers and crocodiles—are perfect viral melting pots. Although humans could have caught the deadly virus from bats directly (according to several studies, including those by Shi and her colleagues), independent teams have suggested in preprint studies that pangolins may have been an intermediate host. These teams have reportedly uncovered SARS-CoV-2–like coronaviruses in these animals, which were seized in antismuggling operations in southern China.
On February 24 the nation announced a permanent ban on wildlife consumption and trade except for research or medicinal or display purposes—which will stamp out an industry worth $76 billion and put approximately 14 million people out of jobs, according to a 2017 report commissioned by the Chinese Academy of Engineering. Some welcome the initiative, whereas others, such as Daszak, worry that without efforts to change people’s traditional beliefs or provide alternative livelihoods, a blanket ban may push the business underground. This could make disease detection even more challenging. “Eating wildlife has been part of the cultural tradition in southern China” for thousands of years, Daszak says. “It won’t change overnight.”
In any case, Shi says, “wildlife trade and consumption are only part of problem.” In late 2016 pigs across four farms in Qingyuan county in Guangdong—60 miles from the site where the SARS outbreak originated—suffered from acute vomiting and diarrhea, and nearly 25,000 of the animals died. Local veterinarians could not detect any known pathogen and called Shi for help. The cause of the illness, called swine acute diarrhea syndrome (SADS), turned out to be a virus whose genomic sequence was 98 percent identical to a coronavirus found in horseshoe bats in a nearby cave.
“This is a serious cause for concern,” says Gregory Gray, an infectious disease epidemiologist at Duke University. Pigs and humans have very similar immune systems, making it easy for viruses to cross between the two species. Moreover a team at Zhejiang University in the Chinese city of Hangzhou found the SADS virus could infect cells from many organisms in a petri dish, including rodents, chickens, nonhuman primates and humans. Given the scale of swine farming in many countries, such as China and the U.S., Gray says, looking for novel coronaviruses in pigs should be a top priority.
Although the Wuhan outbreak is the sixth one caused by bat-borne viruses in the past 26 years —the other five being Hendra in 1994, Nipah in 1998, SARS in 2002, MERS (Middle East respiratory syndrome) in 2012, and Ebola in 2014—“the animals [themselves] are not the problem,” Wang says. In fact, bats help promote biodiversity and the health of their ecosystems by eating insects and pollinating plants. “The problem arises when we get in contact with them,” he says.
Fending Off Future Outbreaks
More than two months into the epidemic—and seven weeks after the Chinese government imposed citywide transportation restrictions in Wuhan, a megacity of 11 million—life feels almost normal, Shi says, laughing. “Maybe we are getting used to it. The worst days are certainly over.” The institute staffers have a special pass to travel from home to their laboratory, but they cannot go anywhere else. For more than a month, they had to subsist on instant noodles during their long hours in the lab because the institute’s canteen was closed.
The researchers found that the new coronavirus enters human lung cells using a receptor called angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2). The scientists have since been screening for drugs that can block it. They, as well as other research groups, are also racing to develop vaccines and test promising candidates. In the long run, the team plans to develop broad-spectrum vaccines and drugs against coronaviruses deemed risky to humans. “The Wuhan outbreak is a wake-up call,” Shi says.
Many scientists say the world should move beyond merely responding to deadly pathogens when they arise. “The best way forward is prevention,” Daszak says. Because 70 percent of animal-borne emerging infectious diseases come from wild creatures, “where we should start is to find all those viruses in wildlife globally and develop better diagnostic tests,” he adds. Doing so would essentially mean rolling out what researchers such as Daszak and Shi have been doing on a much bigger scale.
Such efforts should focus on high-risk viral groups in certain mammals prone to coronavirus infections, such as bats, rodents, badgers, civets, pangolins, and nonhuman primates, Daszak says. He adds that developing countries in the tropics, where wildlife diversity is greatest, should be the front line of this battle against viruses.
In recent decades, Daszak and his colleagues analyzed approximately 500 human infectious diseases from the past century. They found that the emergence of new pathogens tended to happen in places where a dense population had been changing the landscape—by building roads and mines, cutting down forests and intensifying agriculture. “China is not the only hotspot,” he says, noting that other major emerging economies, such as India, Nigeria and Brazil, are also at great risk.
Once potential pathogens are mapped out, scientists and public health officials can regularly check for possible infections by analyzing blood and swab samples from livestock, wild animals that are farmed and traded, and high-risk human populations, such as farmers, miners, villagers who live near bats, and people who hunt or handle wildlife, Gray says. This approach, known as “One Health,”, aims to integrate the management of wildlife health, livestock health, and human health. “Only then can we catch an outbreak before it turns into an epidemic,” he says, adding that the approach could potentially save the hundreds of billions of dollars such an epidemic can cost.
Back in Wuhan, China’s bat woman has decided to retire from the front line of virus-hunting expeditions. “But the mission must go on,” says Shi, who will continue to lead research programs. “What we have uncovered is just the tip of an iceberg.” Daszak’s team has estimated that there are as many as 5,000 coronavirus strains waiting to be discovered in bats globally. Shi is planning a national project to systematically sample viruses in bat caves—with much greater scope and intensity than her team’s previous attempts.
“Bat-borne coronaviruses will cause more outbreaks,” she says with a tone of brooding certainty. “We must find them before they find us.”
Voir enfin:
1La récente plainte déposée par Huawei France contre Valérie Niquet, chercheuse à la FRS et experte reconnue du monde asiatique, vient opportunément souligner la sensibilité du sujet et le caractère devenu épidermique de la question abordée par Antoine Izambard, journaliste au magazine économique Challenges.
2 La Chine mène une politique expansionniste directement sous le contrôle de Xi Jinping et du Parti communiste chinois visant à établir un leadership mondial incontesté, et la France constitue une cible de choix de par sa puissance économique, industrielle et scientifique, même si celle-ci est en relatif déclin.
3 Et ce n’est pas la reconnaissance historique de la RPC par le général de Gaulle en 1964 qui préserve encore notre pays des ambitions de Pékin et de l’emploi de méthodes plutôt discutables pour piller nos pépites technologiques.
4 D’où l’intérêt de ce livre plutôt corrosif et remettant en cause certaines pratiques où l’aveuglement français laisse sans voix. S’appuyant sur des exemples et des faits très concrets, le constat est sévère en dévoilant de véritables failles sécuritaires. Les enjeux sont importants, car Pékin dispose d’une arme quasi absolue : sa puissance financière sans limites, lui permettant de financer toutes ses acquisitions et pouvant acheter une clientèle aveugle sur leurs compromissions potentielles.
5 Antoine Izambard propose ainsi plusieurs approches illustrant ce rouleau compresseur chinois utilisant toutes les ressources du soft power, dont l’espionnage à outrance, notamment via l’envoi d’étudiants « bien sous tout rapport », mais qui permettent à Pékin de siphonner notre technologie. Le cas de Toulouse et de ses universités scientifiques en est une illustration. Pékin s’appuie aussi sur un réseau d’influenceurs, mêlant politiques, diplomates et hommes d’affaires souhaitant favoriser les échanges entre les deux pays, mais souvent à la naïveté confondante face à la prédation quasi systémique pilotée par la Chine.
6 Le mirage du grand marché chinois a tant fasciné que les principes de précaution face à une future concurrence n’ont pas été respectés. Ainsi, nos laboratoires de recherche et nos universités accueillent pléthore d’étudiants et étudiantes dont certains sont très avides d’informations et pillent sans vergogne les travaux effectués. Curieusement, les universités à dominante SHS (sciences humaines et sociales) sont peu concernées, le risque étant pour le Parti communiste chinois d’avoir alors de futurs contestataires potentiels.
7 Et si le rachat de grands crus bordelais peut contribuer à rééquilibrer notre balance commerciale, d’autres pratiques sont plus douteuses comme l’a démontré le fiasco autour de l’aéroport de Toulouse dont les propriétaires chinois ont pratiqué une gouvernance pour le moins baroque.
8 Parmi les autres points soulevés par l’auteur, il y a l’intérêt suspect pour la Bretagne avec une présence importante dans les universités dont particulièrement l’UBO (université de Bretagne occidentale), mais aussi la présence d’un institut Confucius à Brest sur les 14 présents en France, deuxième port militaire de France avec notamment la Force océanique stratégique (Fost) basée dans la rade à l’île Longue. Cette coïncidence n’est pas due au hasard et soulève bien des interrogations.
9 Il y a également le rachat du groupe Demos faisant de la formation professionnelle continue et qui possède entre autres la Revue d’études préparant les militaires à différents concours, avec environ 2 000 élèves par an, et dont le fichier pourrait être intéressant à exploiter.
10 Faut-il pour autant cesser toute activité avec Pékin ? Ce serait impossible et inutile tant l’interdépendance est désormais irréversible. Par contre, il est urgent de faire preuve de plus de réalisme et d’exercer un contrôle accru sur les investissements chinois. Cela signifie également une réponse européenne plus solide et consciente des enjeux de souveraineté actuellement remis en cause par Pékin. En effet, les efforts chinois sont tous azimuts et visent également les instances internationales avec un succès certain favorisé par la candeur de nombreux États devenus « clients ». Ainsi, les Chinois sont à la tête de l’Organisation de l’aviation civile internationale (2015), de l’Union internationale des télécommunications (2018) et de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (2019), pouvant d’ores et déjà influer sur les normes de régulation internationales de demain dans des domaines clés. Cette mainmise sur ces organisations doit désormais inquiéter.
11 L’enquête présentée ici est donc tout à fait pertinente et démontre ces jeux troubles auxquels nous devons faire face. La lucidité est indispensable alors que la naïveté de certains dirigeants politiques et économiques est une faute, et fragilise notre indépendance et notre souveraineté.