


Celui qui vous dit « Gorée est une île », celui-là a menti, cette île n’est pas une île, elle est continent de l’esprit. Jean-Louis Roy
Ce sanctuaire africain qui est la Maison des Esclaves fut capitale de souffrances et de larmes car des innocents sont morts ici, victimes du temps de la honte. Si ces murs pouvaient parler, ils en diraient long. Heureusement qu’ils se sont tus à jamais ; et moi, je fais parler ces murs. Joseph N’diyae
Le monde moderne n’est pas mauvais : à certains égards, il est bien trop bon. Il est rempli de vertus féroces et gâchées. Lorsqu’un dispositif religieux est brisé (comme le fut le christianisme pendant la Réforme), ce ne sont pas seulement les vices qui sont libérés. Les vices sont en effet libérés, et ils errent de par le monde en faisant des ravages ; mais les vertus le sont aussi, et elles errent plus férocement encore en faisant des ravages plus terribles. Le monde moderne est saturé des vieilles vertus chrétiennes virant à la folie. G.K. Chesterton
Nous sommes une société qui, tous les cinquante ans ou presque, est prise d’une sorte de paroxysme de vertu – une orgie d’auto-purification à travers laquelle le mal d’une forme ou d’une autre doit être chassé. De la chasse aux sorcières de Salem aux chasses aux communistes de l’ère McCarthy à la violente fixation actuelle sur la maltraitance des enfants, on retrouve le même fil conducteur d’hystérie morale. Après la période du maccarthisme, les gens demandaient : mais comment cela a-t-il pu arriver ? Comment la présomption d’innocence a-t-elle pu être abandonnée aussi systématiquement ? Comment de grandes et puissantes institutions ont-elles pu accepté que des enquêteurs du Congrès aient fait si peu de cas des libertés civiles – tout cela au nom d’une guerre contre les communistes ? Comment était-il possible de croire que des subversifs se cachaient derrière chaque porte de bibliothèque, dans chaque station de radio, que chaque acteur de troisième zone qui avait appartenu à la mauvaise organisation politique constituait une menace pour la sécurité de la nation ? Dans quelques décennies peut-être les gens ne manqueront pas de se poser les mêmes questions sur notre époque actuelle; une époque où les accusations de sévices les plus improbables trouvent des oreilles bienveillantes; une époque où il suffit d’être accusé par des sources anonymes pour être jeté en pâture à la justice; une époque où la chasse à ceux qui maltraitent les enfants est devenu une pathologie nationale. Dorothy Rabinowitz
Nous sommes entrés dans un mouvement qui est de l’ordre du religieux. Entrés dans la mécanique du sacrilège : la victime, dans nos sociétés, est entourée de l’aura du sacré. Du coup, l’écriture de l’histoire, la recherche universitaire, se retrouvent soumises à l’appréciation du législateur et du juge comme, autrefois, à celle de la Sorbonne ecclésiastique. Françoise Chandernagor
Le capital de la France s’est égaré dans les iles productrices de sucre. De quelle démence absolue, de quel aveuglement témoigne une pareille conduite ! Ne pouvons-nous conclure avec raison que la plus grande faveur qu’un ennemi – ou plutôt un ami – pourrait faire à la France, ce serait de s’emparer de ses colonies et, de cette façon, d’arrêter cette misérable de capital ? Si les esclaves noirs chassaient les Européens des Antilles, ils seraient nos meilleurs amis, car les capitaux de la nation trouveraient l’emploi qu’ils auraient dû trouver depuis longtemps. A en croire le sens commun, la possession d’une telle province doit être estimée comme une cause de pauvreté et de faiblesse, non de richesse et de force. Ce n’est pas seulement le capital français employé dans les iles sucrières qui est détourné directement de l’agriculture; on peut en dire autant de tout le capital qui est employé dans le commerce extérieur. La possession d’iles sucrières, aussi riches et aussi prospères que celles de la France et de l’Angleterre, éblouit l’esprit humain, qui n’est apte à voir qu’un côté des choses; il ne considère ici que la navigation, la réexportation, le profit commercial, une grande circulation; il ne voit pas le revers de la médaille, de capitaux détournés du pays, d’une façon nuisible. (…) On ne voit pas que la culture de la Martinique a pour rançon les landes de Bordeaux, la culture de Saint-Domingue les déserts de la Bretagne, la richesse de la Guadeloupe la misère de la Sologne. Si vous acquérez les richesses provenant de l’Amérique au prix de la pauvreté et de la misère de provinces entières, êtes-vous assez aveugles pour penser que le bilan se chiffre par un bénéfice ? Tous les arguments que j’ai employés contre les iles sucrières françaises sont applicables à celles de l’Angleterre; les unes et les autres, je les considère comme des obstacles à la prospérité des deux royaumes, et, autant que puisse valoir l’expérience de la perte de l’Amérique du nord, je suis autorisé par ce fait si grand, si important, à penser qu’un pays peut perdre le monopole d’un empire éloigné, et, par l’effet même de cette perte imaginaire, devenir plus riche, plus puissant et plus prospère. Arthur Young (1788)
Puisqu’on l’opprime dans sa race et à cause d’elle, c’est d’abord de sa race qu’il lui faut prendre conscience. Ceux qui, durant des siècles, ont vainement tenté, parce qu’il était nègre, de le rérduire à l’état de bête, il faut qu’il les oblige à le reconnaître pour un homme. Or il n’est pas ici d’échappatoire, ni de tricherie, ni de « passage de ligne » qu’il puisse envisager : un Juif, blanc parmi les blancs, peut nier qu’il soit juif, se déclarer un homme parmi les hommes. Le nègre ne peut nier qu’il soit nègre ni réclamer pour lui cette abstraite humanité incolore : il est noir. Ainsi est-il acculé à l’authenticité : insulté, asservi, il se redresse, il ramasse le mot de « nègre » qu’on lui a jeté comme une pierre, il se revendique comme noir, en face du blanc, dans la fierté. L’unité finale qui rapprochera tous les opprimés dans le même combat doit être précédée aux colonies par ce que je nommerai le moment de la séparation ou de la négativité : ce racisme antiraciste est le seul chemin qui puisse mener à l’abolition des différences de race. Jean-Paul Sartre (Orphée noir, 1948)
[La négrologie, c’est] deux choses. D’une part, la négritude, en clair la réaction d’une avant-garde d’étudiants africains établis dans les années 1930 en Occident aux préjugés dont ils étaient la cible. Une réaction aujourd’hui convertie en riposte de masse renvoyant à l’expéditeur un racisme qui colle à la peau pour s’attribuer des valeurs immuables, irréductibles à l’universel. C’est la crispation identitaire d’Africains qui se sentent relégués à la marge de la modernité. La négrologie, c’est d’autre part une série de mythes dérivés de faits historiques avérés – la traite esclavagiste et le colonialisme – selon lesquels tous les malheurs du continent plongent leurs racines dans ces tragédies: ainsi, les Africains seraient victimes, et jamais acteurs, de leur destin. (…) La couverture de l’Afrique au jour le jour s’en tient à un lexique recevable par le grand public, qui dépolitise et, de fait, travestit les réalités. C’est une écriture à double fond. J’ai voulu rompre avec cette duplicité de la bonne conscience. (…) Partie avec d’énormes handicaps, laissée pour compte après des décennies de paternalisme et de tutelle, l’Afrique a subi au lendemain de la chute du mur de Berlin les effets de guerres dévastatrices, de l’effondrement de l’Etat et du naufrage des rêves qui la propulsaient vers l’avant par l’éducation ou l’essor matériel. Malgré les efforts consentis par leurs parents, seuls 27% des écoliers vont au bout du cycle élémentaire. Ce traumatisme fait de la jeune génération – plus de la moitié des Africains ont moins de 15 ans – une génération de desperados. Le présent, pour eux, n’a pas d’avenir. (…) Quand j’écris l’Afrique meurt, je pense: des Africains meurent. Voyez, sur le front du sida, le Sud-Africain Thabo Mbeki: voilà un jeune président très bien formé, respectable, mais enkysté dans l’idée d’une renaissance africaine nécessairement précédée d’une épreuve analogue à la grande peste du XIVe siècle en Europe. Il croit à l’existence d’un «sida africain» qui frapperait en particulier l’homme noir. Cette vision a coûté la vie à des dizaines, sinon des centaines, de milliers de malades, privés de traitements appropriés. (…) Un de mes souvenirs les plus troublants d’étudiant étranger débarquant à Paris, c’est qu’à l’université mes condisciples noirs étaient notés de façon très indulgente. Le corps professoral estimait que ces enfants de notables formaient un précieux réseau d’influence. Ce type d’attitude, mélange de bienveillance et de calcul, constitue à mes yeux la pire forme du racisme. Si nous ne sortons pas de cette prison cutanée, comment ceux qui furent victimes de conduites racistes en sortiraient-ils? L’opinion réagit de façon anormale. Au cours des cinq années écoulées, la crise du Congo-Kinshasa a coûté la vie à plus de 3 millions de personnes. Où sont les intellectuels européens? Où sont les reportages? Pourquoi ce silence? Parce qu’on digère mieux les morts africains que les autres. Un seul émissaire étranger de haut niveau a assisté en 1995 aux cérémonies du premier anniversaire du génocide rwandais: la vice-Premier ministre ougandaise. L’ambassadeur de France avait pris congé. Peut-on imaginer cela en d’autres temps et sous d’autres cieux? Il paraît normal de mourir en masse en Afrique, puisque tout y est « primitif et sauvage ». Ce continent n’a pourtant pas le monopole de la cruauté. (…) L’Occident n’a jamais abandonné sa quête de l’homme fort. Qui est au roi nègre ce que la « bonne gouvernance » est à la corruption: une litote. Les Américains ont cherché des leaders providentiels endurcis par le maquis. Meles Zenawi en Ethiopie, Yoweri Museveni en Ouganda. Modèles voués à l’échec, puisque rien n’a été entrepris au niveau des institutions. A la clef, des individus isolés, en lévitation au-dessus de leur société. Tout autant que les dinosaures Omar Bongo (Gabon) ou Gnassingbé Eyadéma (Togo), mais plus féroces dans la répression. (…) La politique africaine de la France a été infiniment paternaliste. Pourquoi ses élites récusent-elles le constat de l’effondrement de l’Etat en Afrique? A gauche: parce qu’il conduirait à l’apologie d’une tutelle. A droite: parce qu’il discrédite quarante ans de coopération. Comment justifier quatre décennies d’assistance militaire au spectacle du naufrage de l’armée ivoirienne? (…) [L’Afrique] est riche de son sous-sol et, en ce sens, bénie des dieux. L’Afrique est riche, mais les Africains sont pauvres. Sortons de ce discours qui veut que les fléaux naturels orchestrent la fatalité. Les carences en termes d’organisation, les blocages sociaux, les échecs de l’instruction, la faiblesse des rendements: tout cela fait l’essentiel du malheur du continent. Si l’on remplaçait les 15 millions d’Ivoiriens par autant de Belges ou d’Irlandais, nul doute que la Côte d’Ivoire « tournerait ». (…) Tout passe d’abord par la vérité. Il faut un amour sans pitié pour l’Afrique. En France ou aux Etats-Unis, les Africains insérés dans un tissu social différent incarnent des figures de réussite. Alors que leur société d’origine opprime l’individu au nom d’un carcan collectif dévoyé, présenté comme authentiquement africain. L’exigence d’honnêteté ne peut souffrir d’exception culturelle. (…) Face à l’ethnie, l’Occident est partagé entre le fétichisme et la diabolisation. Tous les maux du continent seraient dus à son caractère tribal. A mes yeux, l’ethnie est le mensonge de l’Afrique, au même titre que la nation est celui de l’Europe. Comme les récits qui fondent notre idée nationale sont apocryphes, ceux qui définissent l’ethnie relèvent de l’imaginaire. Que dire de ces fadaises sur « le réveil des vieux démons »? A rebours, le tribalisme est l’expression la plus moderne qui soit de l’Afrique. Reste que, même fausse, une idée massivement admise devient une réalité. On meurt encore sur des barrages pour appartenir à la mauvaise tribu. (…) En Afrique noire, ce prosélytisme ([des sectes évangéliques] est bien plus puissant que son alter ego islamique. Voilà la preuve que l’homme africain déconcerté cherche une autre identité. Quand on entre en religion, on révolutionne sa vie. La nouvelle foi permet de s’affranchir de la règle communautaire initiale, au profit d’une promesse d’avenir meilleur. Et au risque du charlatanisme. (…) Les Ivoiriens s’entretuent, mais accusent la terre entière: la France bien sûr, et parfois leurs voisins. Jamais ils ne portent de regard critique sur eux-mêmes, le concept d’ivoirité, l’exploitation des immigrés sahéliens dans les plantations, le paternalisme autoritaire du défunt Félix Houphouët-Boigny. C’est ce mythe de l’éternelle victime qui a tué Jean Hélène. Un policier croit être dans le sens de l’Histoire en l’abattant. Pour transférer ainsi toute la haine de soi sur l’autre, pour abdiquer toute maîtrise de son destin, il faut être parvenu à un haut degré d’aliénation. Stephen Smith
La préfecture a jusqu’au « lundi 7 septembre à 12h » pour édicter un nouvel arrêté excluant les communes et « les périodes horaires » qui ne sont pas caractérisées « par une forte densité de population » ou « des circonstances locales susceptibles de favoriser la diffusion » du coronavirus. Faute de nouvel arrêté, l’actuel « sera automatiquement suspendu. (…) L’arrêté en cause, qui était valable jusqu’au 30 septembre, « porte une atteinte immédiate à la liberté d’aller et venir et à la liberté personnelle des personnes appelées à se déplacer » dans les communes concernées. (…) Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait en permanence et sur la totalité des (communes concernées) une forte concentration de population ou des circonstances particulières susceptibles de contribuer à l’expansion de la covid-19. Tribunal administratif de Strasbourg
Ces gens jargonnent beaucoup et se prennent pour des intellectuels. Pour eux, la France est toujours coloniale. Ils considèrent que les Arabes et les Noirs sont encore aujourd’hui des indigènes et ne répondent pas aux mêmes droits que les autres citoyens. Ce groupuscule a étendu son réseau d’influence dans les banlieues grâce au relais des mairies, surtout communistes et d’extrême gauche, en infiltrant les sphères du pouvoir grâce aux facultés et à la sympathie des universitaires, puis dans les médias qui reprennent aujourd’hui ses éléments de langage comme les mots “racisé” ou “privilège blanc”. Ils sont très actifs et visibles sur le terrain médiatique à travers, notamment, le comité La Vérité pour Adama. C’est terrible car ils ont pour objectif de détruire ce pays, colonial à leurs yeux, que représente la République. Anne-Sophie Nogaret
Adama Traoré n’est pas la victime du racisme et d’un contrôle d’identité au faciès. Il a été arrêté par des gendarmes, dont deux étaient noirs, dans le cadre d’une affaire de délinquance et non pas en raison de sa couleur de peau. Je ne veux pas nier l’existence du racisme, mais il n’est pas l’apanage de la police, ni celui des Blancs. Ce genre de théorie crée du séparatisme et nuit à l’unité du pays. Si j’étais blanche, je serais hors de moi en entendant que je suis forcément une privilégiée, raciste et nantie. Par ailleurs, je refuse de marcher dans les rues de Paris pour défendre un délinquant accusé de viol sur un jeune codétenu. Prendre la famille Traoré comme modèle est une insulte faite aux Noirs. Il avait deux épouses. La polygamie est illégale dans notre pays et je considère cette pratique comme de la maltraitance pour les gamins qui la subissent. La très nombreuse fratrie Traoré a un casier judiciaire très chargé et ne donne rien d’autre qu’une image déplorable des jeunes de quartier. Quels sont leurs projets? Je ne peux pas répondre, mais je suis sûre d’une chose: ces gens ne sont pas dans une démarche constructive mais à l’inverse guerrière et vengeresse pour mettre le chaos dans le pays. Ce n’est pas ce que je veux pour notre jeunesse. Rachida Hamdan
C’est un indigénisme avec l’islamisme en embuscade. Youcef Brakni pilote la tête d’Assa Traoré. Les indigénistes ont compris que le comité La Vérité pour Adama est le report politiquement correct de leurs idées identitaires et racistes. Ces idées progressent et ils tissent leur toile grâce au réseau d’influence de l’intelligentsia et à la passerelle construite avec une bourgeoisie gauchiste qui aime à s’encanailler avec le lumpenprolétariat des cités sans n’y avoir jamais mis les pieds. Ces gens rêvent de révolution en mangeant des petits-fours et se fichent bien en réalité de la condition des Noirs et des Arabes dans les banlieues. Nous sortons juste de trois mois de confinement pour raisons sanitaires et, grâce à eux, on ne parle que de racisme alors que la crise économique est devant nous et que tout ceci ne fait que l’aggraver. Universitaire chercheuse
Le projet de ces activistes vise à remplacer l’égalité républicaine par la reconnaissance juridique des minorités. Ils veulent une photo figée de l’Histoire au nom de la diversité qui serait leur seule réalité. Ils sont en conflit avec une pensée rationnelle. L’homme se développe par l’expérience qui a permis son émancipation. C’est ainsi que la République a dépassé la contradiction du colonialisme grâce à ses valeurs et en apportant à chacun les mêmes droits sans distinction. Ces gens refusent cette pensée du progrès, c’est la raison pour laquelle ils cassent tout. Guylain Chevrier
Danièle Obono, député de la France Insoumise, proche du «Parti des indigènes de la République» (PIR) vient d’être nommée au sein du Conseil d’administration de l’UFR de Science politique de l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Cette instance fixe au quotidien les orientations des enseignements et des recherches proposés aux étudiants. Depuis plusieurs années, les activistes en tous «genres» tentent d’infiltrer l’Université afin de poser un vernis «scientifique» sur leurs engagements les plus radicaux. Les militants du genre furent les pionniers. Et désormais, les études de genre prospèrent et se répandent d’amphithéâtres en amphithéâtres. L’université a ainsi servi de caisse de résonance aux adeptes de l’écriture inclusive, aux avocats de la fluidité des genres et des toilettes neutres … Avec Danièle Obono, c’est une autre idéologie qui fait de l’entrisme. Une idéologie aux antipodes de notre tradition humaniste. La députée de Paris s’est, en effet, faite l’avocate des thèses «décolonialistes» prônées par le Parti des indigènes de la République. Ce groupuscule extrémiste avait publié en 2016 des messages de soutien aux organisateurs d’un attentat contre des civils à Tel Aviv! «L’Antisionisme», revendiqué par sa porte-parole Houria Bouteldja dissimule mal un réel antisémitisme. Selon elle, «les juifs sont les boucliers, les tirailleurs de la politique impérialiste française et de sa politique islamophobe». Sic! A l’occasion des 10 ans des Indigènes de la République, Danièle Obono avait encensé le parti indigéniste, qualifiant même le discours de sa porte-parole Houria Bouteldja de «très beau et très juste». En réalité, l’idéologie que Danièle Obono défend, repose sur des fondements racialistes. Elle va jusqu’à prôner la non-mixité raciale et sexuelle (!) dans les réunions politiques ou syndicales, en somme un apartheid inversé. Ce genre d’inepties tend malheureusement à se développer, comme ce fut le cas durant le blocus de Tolbiac, les étudiants avaient déjà pris l’initiative d’organiser des Assemblées Générales interdites aux hommes blancs. Re-Sic! Elle s’est également «distinguée» dans son soutien à un texte de Rap dont les paroles font froid dans le dos: «Nique la France, et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes, (…) ton pays est puant, raciste et assassin». Doit-on s’attendre à ce que ce genre de colique verbale soit désormais au programme de l’UFR? (…) L’argent public qui finance la recherche publique doit-il servir à diffuser une propagande «bolcho-trotsko-marxiste» comme se définit Danièle Obono, ou pire à soutenir l’offensive des «décolonialistes». En réalité, cette nomination n’entache pas seulement l’image de l’UFR de Science politique. Demain, ce seront l’ensemble des diplômes et des recherches de l’Université Paris 1 qui seront suspects. Nous demandons donc au Président de Paris 1 et au conseil d’administration de l’université de dénoncer cette nomination. Sinon, le risque c’est de voir l’université Française devenir le cheval de Troie de tous les courants nés au sein de la gauche radicale américaine la plus folle. Guilhem Carayon et Olivier Vial
Je n’ai pas pleuré Charlie. J’ai pleuré, un peu, beaucoup, dans la nuit de samedi à dimanche. (…) En pensant aux ami-e-s et aux camarades qui sont devenu-e-s Charlie. En ressentant l’insupportable violence politique, idéologique, symbolique de l’omniprésente et omnipotente injonction. En lisant la liste interminable des terroristes venu-e-s des quatre coins de la planète et derrière lesquel-le-s allaient défiler ces Charlie. (…) J’ai pleuré en pensant à la signature de l’organisation à laquelle j’appartiens, dont je suis encore formellement une des dirigeantes, apposée à côté de celle de l’UMP pour appeler à cette manif en proclamant « Nous sommes Charlie : Défendons les valeurs de la République ! » (…) En lisant le tract du PCF/Front de gauche appelant noir sur blanc à l’unité nationale. (…) J’ai pleuré en pensant à tous les reculs, toutes les défaites, tous les choix et les décisions politiques des 10-15 dernières années qui nous ont amenés à ce point. (…) A toutes les fois où ma gauche s’est refusée de parler d’islamophobie, de ne serait-ce que prononcer le mot. Toutes les fois où elle s’est refusée à se mobiliser contre les lois islamophobes. Toutes les fois où des camarades ont défendu, mordicus, les caricatures racistes de Charlie Hebdo ou les propos de Caroline Fourest au nom de la « liberté d’expression » (des Blanc-he-s/dominant-e-s) ou de la laïcité « à la Française ». Mais se sont opportunément tu-e-s quand l’Etat s’est attaqué à Dieudonné, voire ont appelé et soutenu sa censure… Toutes les fois où des « camarades » nous ont sommé-e-s, nous les « islamo-gauchistes », de montrer patte blanche et d’affirmer avant toute autre chose que nous luttions bien contre l’antisémitisme. Toutes les fois que d’autres nous ont carrément, à mots plus ou moins couverts, traité-e-s d’antisémites. J’ai pleuré en me rappelant le jour où je me suis devenue Noire. Et celui où je suis devenue « intersectionnelle ». La première fois que j’ai été face à face avec le racisme et les privilèges de Blanc-he-s de celles et ceux que je considérais dans leur majorité comme mes « camarades ». L’instant où je me suis rendue compte qu’il y avait bien un « eux » et un « nous » et que j’étais aussi « eux », ces « Autres », et pas tout le temps « nous ». Le moment où je me suis fait dire que j’étais, à la rigueur, « légitime » pour m’occuper de tels sites, assemblées, thématiques et autres commissions mais certainement pas pour représenter ma sensibilité dans certaines instances de direction ou à la tribune de meetings ou de manifs. (…) Aujourd’hui, j’organise. La (re)mobilisation antiraciste. En commençant par soutenir l’appel à manifester le 18 janvier prochain, jour du sommet à Washington entre ministres européens et états-unien « contre le terrorisme » et de la manif islamophobe d’extrême-droite à Paris. Manifester contre l’islamophobie, l’antisémitisme, tous les racismes. Manifester contre l’union sacrée nationale d’Hollande-Valls-Sarkozy, et contre l’union sacrée internationale de la « guerre de civilisation contre le terrorisme ». Danièle Obono (11.01.2015)
Il paraît ‘Qu’on-Peut-Pu-Rien-Dire’ #BienPensance.Heureusement on peut encore écrire de la merde raciste dans un torchon illustrée par les images d’une députée française noire africaine repeinte en esclave… L’extrême-droite, odieuse, bête et cruelle. Bref, égale à elle-même. Ça fait trois ans qu’on alerte sur le fait qu’il y a un processus de racialisation, de racisme dans ce pays. Cette image est une insulte à mes ancêtres, ma famille et mon mouvement politique. Une souillure indélébile. J’ai mal à ma République. Et je suis plus déterminée que jamais à lutter contre le #racisme, pour la liberté, l’égalité et la fraternité.Danièle Obono
A travers moi, c’est la République qui est souillée. Danièle Obono
Cette fiction avait pour but de montrer l’atrocité de l’esclavage commis par des Africains au XVIIIème siècle. Personne ne l’a compris, c’était donc une erreur. Mais nous accuser de racisme, cela est et sera toujours pour nous insupportable. Geoffroy Lejeune
Devant l’émoi suscité par le dernier épisode de notre fiction estivale, nous tenons à apporter quelques précisions. Nous avons bien conscience de la mauvaise foi de certains, mais nous devons, pour les autres, éclaircir nos intentions. Tout l’été, Valeurs actuelles a publié chaque semaine un « Roman-fiction » dont le concept était simple ; plonger une personnalité contemporaine dans une période passée, afin de faire resurgir par ce contraste certaines inepties de notre époque. Il y eut ainsi François Fillon au temps de la Révolution, Éric Zemmour à Waterloo ou encore Didier Raoult dans les tranchées de 1914. Le dernier épisode était consacré à la députée de la France Insoumise Danièle Obono, que nous avons fait « voyager » dans l’univers atroce de l’esclavage africain du XVIIIe siècle. Notre intention, transparente, était la suivante : là où les indigénistes et les déconstructeurs de l’Histoire veulent faire payer le poids de cette insoutenable traite aux seuls Européens, nous voulions rappeler qu’il n’existât pas d’unité africaine, et que la complexité de la réalité, sa dureté, était à raconter. Nous avons choisi cette élue car elle participe selon nous, par ses prises de position répétées, à cette entreprise idéologique de falsification de l’Histoire. Notre texte n’a rien de raciste. Sans quoi nous n’en aurions pas publié une ligne. Évidemment. Il est commode pour nos adversaires de nous imputer cette accusation, que rien n’étaie dans le contenu. Chacun pourra juger par lui-même de l’opportunité d’une telle fiction, mais personne n’y trouvera une banalisation de l’esclavage ou une quelconque stigmatisation. Évidemment. Les images néanmoins, et d’autant plus quand elles sont isolées sur les réseaux sociaux, renforcent la cruauté inhérente au sujet même. Il s’agit de dessins accompagnant cette fiction, et tout comme l’esclavage lui-même, les images de l’esclavage sont d’une ignominie sans nom. Si nous contestons fermement les accusations dont nos contempteurs nous accablent, nous avons suffisamment de clairvoyance pour comprendre que la principale intéressée, madame Danièle Obono, ait pu se sentir personnellement blessée par cette fiction. Nous le regrettons et lui présentons nos excuses. À l’avenir nous maintiendrons la vigilance absolue dont doit faire preuve un journal comme Valeurs actuelles, attaqué quotidiennement. De même que nous continuerons de marcher à rebours de l’air du temps quand il nous semble faire fausse route. Valeurs actuelles
Valeurs actuelles a publié jeudi dernier l’ultime épisode de son « roman de l’été ». Le personnage central de cette fiction, par le texte et par l’image, était Danièle Obono, députée de La France Insoumise. Celle-ci était ramenée à l’Afrique du temps de l’esclavage. Il s’agissait évidemment de dénoncer les horreurs des pratiques des esclavagistes, mais ce texte comme ses illustrations ont donné lieu à une incompréhension et à une interprétation que nous regrettons profondément. Il s’est donc agi d’une grave erreur. Nous la reconnaissons humblement, et nous renouvelons surtout à Danièle Obono les excuses de notre journal et de sa rédaction. Elle a exprimé la révolte et la blessure que lui ont inspiré ce texte et ses illustrations. Nous nous inclinons devant ses sentiments et exprimons avec force les regrets que nous lui devons. Le racisme, l’antisémitisme, la haine, et les extrémismes en général sont étrangers à notre culture et à celle de la France. Nous les rejetons comme antinomiques aux valeurs de notre publication depuis toujours. Porteuse d’un média d’opinion engagé, notre rédaction travaille à tout moment avec rigueur et passion pour défendre ses valeurs et ses convictions. Nous continuerons à le faire, sans nous en écarter. C’est pourquoi nous rejetons formellement les accusations portées à notre encontre qui ne reflètent en rien les idées que nous incarnons. Valeurs actuelles
En tant que citoyen, j’estime que ce qu’a fait Valeurs actuelles est indigne de notre époque. Jusque-là, la présence sur LCI de Geoffroy Lejeune pouvait se justifier dans les débats d’idées, où tous les courants s’expriment. Mais cet excès de Valeurs actuelles contrevient à notre ligne et à nos valeurs. Il ne sera plus chroniqueur sur LCI. C’est la décision qui a été prise ce week-end par Fabien Namias [directeur général adjoint de LCI] et Thierry Thuillier [directeur général]. Nous faisons une télévision construite sur le débat d’idées, dans le respect, et pas une télévision d’opinion à la Fox, sur la polémique. Ce parti pris ralentit peut-être la progression d’audience de la chaîne, mais LCI ne déviera pas de cela. Gilles Pélisson (TF1)
C’est avant tout un outil pédagogique, pour répondre à la non-visibilité de la traite négrière dans les manuels scolaires. Nous vivons dans un monde d’images, et cette Marche permet de symboliser l’esclavage. André-Joseph Gélie
Demain, la Journée nationale de commémoration de l’abolition de l’esclavage ne sera toujours pas célébrée de façon unitaire à Nantes. Une trentaine de comédiens enchaînés et en haillons ont en effet pris part, dès hier, à une « Marche des esclaves » dans les rues de la ville, qui a fait sa fortune au XVIIIe siècle sur le « commerce triangulaire ». Ils étaient encadrés par deux négriers européens, qui criaient « Avancez, bande de nègres ! » entre deux coups de fouet et de bâton. « C’est avant tout un outil pédagogique, pour répondre à la non-visibilité de la traite négrière dans les manuels scolaires », explique André-Joseph Gélie, qui a initié l’événement en 2006. « Nous vivons dans un monde d’images, et cette Marche permet de symboliser l’esclavage. » Hier, les « esclaves » ont ainsi marqué l’arrêt devant l’Hôtel de ville… où l’initiative est jugée « indécente ». « C’est comme si on demandait aux Juifs de théâtraliser leur marche vers les fours crématoires », s’emporte Octave Cestor, conseiller municipal en charge des « relations entre Nantes, l’Afrique et les Caraïbes ». « Nous sommes, en plus, dans une ville qui assume son passé… Ces personnes devraient avoir le courage d’aller à Bordeaux, La Rochelle ou Saint-Malo. Ces villes ne font rien alors qu’elles ont, elles aussi, un passé négrier. » 20 minutes
Est-il pire d’être représentée en esclave qu’en comploteur, en assassin ou en usurier ? Apparemment oui. Comme si les esclaves n’étaient pas des victimes. Victimes de qui, à propos ? Le personnage mis en scène par Valeurs Actuelles est aux prises avec les marchands d’esclaves africains. Et c’est peut-être là que le bât blesse vraiment. Chacun sait que les fournisseurs de la traite transatlantique étaient des Africains, mais certains n’aiment pas qu’on le rappelle. La représentation de l’esclavage n’a pas toujours suscité l’indignation à Nantes. Du temps où Jean-Marc Ayrault en était le maire, la ville avait sa propre fiction historique. Une « Marche des esclaves » a été organisée chaque année à partir de 2006 avec l’accord de la municipalité. Jouer le rôle d’un esclave était alors considéré comme honorifique. Cependant, la manifestation de 2011, encadrée par une « Brigade anti-négrophobie », est allée trop loin. « Une trentaine de comédiens enchaînés et en haillons ont pris part à une ‘Marche des esclaves’ dans les rues de la ville, qui a fait sa fortune au XVIIIe siècle sur le ‘commerce triangulaire’, racontait alors 20 Minutes. Ils étaient encadrés par deux négriers européens, qui criaient ‘’Avancez, bande de nègres !’’ entre deux coups de fouet et de bâton. » C’était trop. « C’est comme si on demandait aux Juifs de théâtraliser leur marche vers les fours crématoires », avait protesté Octave Cestor, conseiller municipal d’origine antillaise, très engagé dans la commémoration de l’esclavage à Nantes. L’année suivante, l’inauguration du Mémorial de l’abolition de l’esclavage avait permis aux socialistes nantais d’imposer des cérémonies d’inspiration plus sobre. Breizh
Guezo fut également un administrateur extrêmement avisé. Grâce aux revenus de la traite, il put abaisser les impôts, stimulant ainsi l’économie agricole et marchande (…) Il fut très aimé et sa mort subite dans une bataille contre les Yorubas fut une véritable tragédie. Wikipedia
We don’t discuss slavery. Barima Kwame Nkye XII (chef ghanéen)
C’est une coutume établie parmi les Nègres de rendre esclaves tous les captifs qu’ils font à la guerre. On sait de manière à n’en pouvoir douter qu’un grand nombre de captifs pris à la guerre seraient exposés à être massacrés cruellement si les vainqueurs ne trouvaient pas s’en défaire en les vendant aux Européens. William Snelgrave
The whole story is phony. Although it functioned as a commercial center, Goree Island was never a key departure point for slaves. Most Africans sold into slavery in the Senegal region would have departed from thriving slave depots at the mouths of the Senegal River to the north and the Gambia River to the south. During about 400 years of the Atlantic slave trade, when an estimated 10 million Africans were taken from Africa, maybe 50,000 slaves — not 20 million as claimed by the Slave House curator — might have spent time on the island. Even then, they would not have been locked in chains in the Slave House. Built in 1775-1778 by a wealthy merchant, it was one of the most beautiful homes on the island; it would not have been used as a warehouse for slaves other than those who might have been owned by the merchant. Likewise, the widely accepted story that the door of no return was the final departure point for millions of slaves is not true. There are too many rocks to allow boats to dock safely. Philip Curtin (Johns Hopkins University)
The Slave House offers a distorted account of the island’s history, created with tourists in mind. (…) Joseph Ndiaye offers a strong, powerful, sentimental history. I am a historian. I am not allowed to be sentimental. (…) The slaves did not pour through that door. The door is a symbol. The history and memory needs to have a strong symbol. You either accept it or you don’t accept it. It’s difficult to interpret a symbol. Abdoulaye Camara (Goree Island Historical Museum)
Goree’s fabricated history boils down to an emotional manipulation by government officials and tour companies of people who come here as part of a genuine search for cultural roots. Lonely Planet
Walking around the dimly lit dungeons [sic], you can begin to imagine the suffering of the people held here. It is this emotive illustration that really describes La Maison des Esclaves as a whole – its historical significance in the slave trade may not have been huge, but the island’s symbolic role is immense. The island’s precise status as a slave-trading station is hotly debated. Of the 20 million slaves that were taken from Africa, the general belief is that only around 300 per year may have gone through Gorée (historians and academics dispute the exact number and some argue that no slaves passed through this specific house); and, even then, the famous doorway would not have been used – ships could not get near the dangerous rocks and the town had a jetty a short distance away. But the number of slaves transported from here isn’t what matters in the debate around Gorée. The island and museum stands as a melancholy reminder of the suffering the Atlantic slave trade inflicted on African people. Lonely Planet
This portal — called the door of no return — is one of the most powerful symbols of the Atlantic slave trade, serving as a backdrop for high-profile visits to Africa by Pope John Paul II, President Clinton and his successor, President Bush, and a destination for thousands of African Americans in search of their roots. More than 200,000 people travel to this rocky island off the coast of Dakar each year to step inside the dark, dungeonlike holding rooms in the pink stucco Slave House and hear details of how 20 million slaves were chained and fattened for export here. Many visitors are moved to tears. But whatever its emotional or spiritual power, Goree Island was never a major shipping point for slaves, say historians, who insist no slaves were ever sold at Slave House, no Africans ever stepped through the famous door of no return to waiting ships. « The whole story is phony, » says Philip Curtin, a retired professor of history at Johns Hopkins University who has written more than two dozen books on Atlantic slave trade and African history. (…) Curtin’s assessment is widely shared by historians, including Abdoulaye Camara, curator of the Goree Island Historical Museum, which is a 10-minute walk from the Slave House. (…) But when the respected French newspaper Le Monde published an article in 1996 refuting the island’s role in the slave trade, Senegalese authorities were furious. Several years ago at an academic conference in Senegal, some Senegalese accused Curtin of « stealing their history, » he says. No one is quite sure where the Slave House got its name, but both Camara and Curtin credit Boubacar Joseph Ndiaye, the Slave House’s curator since the early 1960s, with promoting it as a tourist attraction. Ndiaye is famous in Senegal for offering thousands of visitors chilling details of the squalid conditions of the slaves’ holding cells, the chains used to shackle them and their final walk through the door of no return. (…) That said, Camara believes Ndiaye has played an important role in offering the descendants of slaves an emotional shrine to commemorate the sacrifices of their ancestors. (…) Some tour books have begun warning visitors about the questions surrounding the island, including Lonely Planet’s West Africa guidebook, which concludes (…) None of the controversy appears to have diminished the island’s attraction as a tourist destination. The ferry that carries visitors from Dakar to the island is regularly packed with tourists and school groups. The Seattle Times
Les espaces voûtés de Gorée établis sous les rez-de-chaussée surélevés des habitations, dans des maisons construites dans le dernier quart du XVIIIe siècle ou le premier quart du XIXe siècle sont très tôt considérés comme des « captiveries », des « cabanons à esclaves » ou aussi de simples entrepôts. En 1918, le Père Briault nous donne une aquarelle d’un « ancien cabanon à esclaves » établi dans l’actuel presbytère. Selon le Guide du tourisme de 1926, une excursion à l’île de Gorée à partir de Dakar s’impose pour « visiter les anciennes « captiveries » où étaient parqués les esclaves en attendant le retour des négriers, venus à Gorée charger le « bois d’ébène ». Dans un article sur « Gorée la moribonde » paru en 1928, la revue L’Illustration nous présente une reproduction photographique d’une des maisons à cour portant la légende : « au rez-de-chaussée logement des esclaves ; au premier étage, salle à manger du traitant ». En 1929, le docteur P. Brau décrit les « cachots antiques, longs et étroits, [des maisons de Gorée qui] puent encore la chair esclave torturée… [Ils ont pu ensuite servir d’entrepôts] à d’autres lots de marchandises moins fragiles, mais non moins âprement discutées : les boucauts de lard salé et les tonnelets d’eaux-de-vie…15 ». Dès 1932, dans son guide de visite Gorée, capitale déchue, Robert Gaffiot nous dessine la cour de l’une de ces anciennes « maisons négrières ». Il précise dans la légende du dessin l’usage de cette maison où « les esclaves étaient parqués dans le bas-enclos, à l’obscurité, sous les pièces réservées à l’habitation des trafiquants. Le couloir central dessert, à droite et à gauche, une douzaine de longues et étroites cellules, dans lesquelles les malheureux étaient entassés et, bien souvent, enchaînés. L’autre extrémité du couloir donne sur la mer : le « négrier » avait ainsi toute facilité pour faire disparaître les cadavres de ceux qui ne pouvaient subir jusqu’au bout le supplice de cette vie atroce ». Un autre militaire de la marine française, le docteur Pierre-André Cariou, dans son guide non publié Promenade à Gorée, rédigé à partir des années 1940-1943, reprend l’historique et la description de la Maison des Esclaves. Le docteur assombrit encore le tableau dressé dix ans plus tôt par Robert Gaffiot pour l’ancienne maison négrière. En 1951, l’historien et archéologue de l’Institut Français d’Afrique noire (IFAN) Raymond Mauny dénonce, sans en apporter les preuves, les excès de l’interprétation de Gaffiot et de Cariou, notamment les considérations sur la fonction de la porte donnant sur la mer, reprenant en partie le témoignage d’un témoin oculaire contemporain, le chevalier de Boufflers, mais qui semblerait plutôt s’appliquer au site de Saint-Louis. En face de cette Maison dite des esclaves « aux sinistres cellules », l’IFAN complète et redouble le discours pédagogique à l’intention du touriste par l’installation d’un Musée historique de l’Afrique occidentale française, dans une « belle maison de la fin du XVIIIe siècle » édifiée selon Pierre-André Cariou par un [autre] « négrier » dont les cellules du rez-de-chaussée auraient servi, selon le dit docteur de « cachots » aux esclaves. Cette maison, dite de Victoria Albis, est achetée grâce à des crédits votés lors de la célébration du centenaire de l’abolition de l’esclavage (1848) puis réhabilitée et inaugurée le 4 juin 1954. (…) Dès 1948, à l’occasion du centenaire de l’abolition de l’esclavage, Raymond Mauny propose de consacrer un musée spécifique sur l’esclavage à Gorée et de valoriser, selon lui, « l’un des principaux points où s’effectuait la traite sur la côte occidentale d’Afrique. (…) Après les indépendances, dans la continuité de l’œuvre initiée par le colonisateur, l’État du Sénégal reprend à son compte le discours mémoriel. En 1962, le président Léopold Sédar Senghor nomme Boubacar Joseph Ndiaye, ancien sous-officier de l’armée coloniale française, comme « gardien » de la Maison des Esclaves, régularisant ainsi une situation de fait. La vigueur du discours de ce guide, sans doute inspiré à l’origine par celui du Docteur Cariou, son charisme et la voix imposante de ce « gardien de la mémoire de la traite négrière », l’ont désigné peu à peu comme une sorte de « musée vivant », connu à l’échelle internationale. Gorée doit en grande partie son statut d’île-mémoire de la Traite atlantique à l’éloquence de Joseph Ndiaye, « conservateur » de la Maison des Esclaves. (…) Son récit constitue une re-mémoration de la traite négrière à travers une mise en scène alliant parole, geste et démonstration à l’aide des chaînes en fer reconstituées, avec lesquelles les esclaves étaient attachés. (…) La fonction de ce discours est significative dans la fabrication d’une mémoire liée à la traite atlantique des esclaves, avec une mise en scène et une représentation imagée de la condition de l’esclave appuyées par des citations, des maximes et des proverbes. La réception du discours du « conservateur » se perçoit à travers les diverses réactions observées après la visite du musée et consignées dans le livre d’or. Nombreux sont les guides goréens qui puisent encore une bonne partie de leurs connaissances dans le discours de Joseph Ndiaye. Les réactions observées traduisent des chocs émotionnels qui peuvent déboucher parfois sur des actes spontanés. Le recueillement devant la « porte du voyage sans retour » constitue un acte symbolique qui s’accompagne parfois de rituels, de prières, d’offrandes, de sacrifices, de libations. La signification et la place de l’île dans l’imaginaire de la diaspora noire permettent de mesurer l’impact de cette communauté, en quête d’une identité perdue, dans la cristallisation d’une mémoire de la traite atlantique autour de Gorée. (…) Des contestations naissent sur l’exactitude historique du récit propagé aux visiteurs de la Maison des Esclaves. Dès 1972, le philosophe et chercheur africain Ki-Zerbo, dans son ouvrage « Histoire d’Afrique Noire », s’inquiète de la tournure que peut prendre la défense d’un tel récit qui peut constituer un point de rupture dans la diaspora noire entre l’Afrique et le monde afro des Caraïbes et des Amériques. Deux décennies plus tard, la principale critique émane de deux chercheurs et conservateurs de l’IFAN, Abdoulaye Camara et le père jésuite Joseph Roger de Benoist. Leurs argumentaires sont repris par le journaliste Emmanuel de Roux dans un article paru à Paris dans le journal Le Monde du 27 décembre 1996 sous le titre « Le mythe de la Maison des esclaves qui résiste à la réalité ». L’article remet en cause la fonction de la Maison des Esclaves ainsi que le rôle de l’île de Gorée dans le commerce des esclaves. Le journaliste relate la visite du lieu par son « conservateur » Joseph Ndiaye. « Ce dernier raconte avec émotion l’histoire de cette esclaverie construite par les Hollandais au XVIIIe siècle, pivot de la traite à Gorée qui vit défiler des centaines de millions d’Africains, enchaînés, vers le Nouveau Monde40 ». Contrairement aux affirmations de Joseph Ndiaye, Emmanuel de Roux donne la paternité de la maison aux Français, nie l’existence des cellules qui étaient réservées aux esclaves en attente d’embarcation et minimise le nombre d’esclaves ayant transité sur l’île. En conclusion, l’histoire de cette maison présentée par le conservateur ne serait qu’une légende reprise par Joseph Ndiaye, « qui a mis une douzaine d’années à forger un mythe qui, aujourd’hui, a force de loi». La réaction de l’État est vive et rapide. Les 7 et 8 avril 1997, un séminaire réunissant l’ensemble des spécialistes sénégalais et africanistes sur le thème : « Gorée dans la traite atlantique : mythes et réalités » est convoqué dans l’urgence pour riposter à l’imposture. Dix ans après cette attaque « révisionniste », en 2006, le récit du « conservateur » de la Maison des Esclaves est encore contesté par les descendants de certaines signares qui tiennent un autre discours mémoriel et prônent une autre histoire. Dans son ouvrage, Céleste ou le temps des signares, Jean-Luc Angrand nie l’existence d’esclaveries dans les maisons de Gorée : « Il est évident que cette maison comme les autres maisons de Gorée n’ont jamais contenu d’esclaves de traite, les signares étant en général réfractaires à la déportation des esclaves aux Amériques. Les seuls captifs qui existaient dans les maisons de Gorée étaient les captifs de case (domestiques). […] L’idée pathétique de porte par laquelle seraient passés des esclaves embarquant pour l’Amérique n’était rien qu’une histoire destinée à impressionner les touristes de la fin du XXe siècle». Cette vision de la fonction des supports mémoriels ne prend pas en compte la vraie nature du discours commémoratif car comme l’ont bien montré en 1997 Ibrahima Thioub et Hamady Bocoum « Le discours qui commémore cette fonction de l’île n’a jamais prétendu obéir aux règles universitaires de production du savoir et, en conséquence, ne peut être mesuré à cette aune». En 2009, dans sa récente étude sur la déconstruction du syndrome de Gorée, Ibrahima Seck montre comment l’existence de supports matériels contribue à la cristallisation des mémoires dans certains lieux, témoins de cette période. L’idée d’une « porte du voyage sans retour » n’existe pas seulement à Gorée mais aussi dans les différents points d’embarquement des navires négriers sur la côte occidentale de l’Afrique. « Au Ghana, Elmina a aussi sa porte du non retour alors qu’il s’agit en réalité d’une meurtrière. À Ouidah, où la traite ne s’est pas accompagnée de l’impressionnante monumentalité visible sur l’ancienne Côte de l’or, le programme de la Route de l’esclave de l’UNESCO a érigé un monument sous la forme d’un énorme portail face à la mer pour donner un support matériel au symbolisme du voyage sans retour». Il est clair que Gorée a influencé les autres sites qui ont entrepris un travail de remémoration tel qu’il est recommandé par l’UNESCO depuis 1995. Cette vision romantique de Joseph Ndiaye est transmise par des méta-récits nationalistes ou pan-africanistes dont la réalité est caricaturée d’une manière manichéenne. Ce discours laisse peu de place à une « histoire » plus complexe, « archéologique », des Africains libres, aux esclaves de case ou aux esclaves domestiques ou aux captifs face aux Africains enchaînés, aux esclaves de traite ou de transit, aux signares et aux métis et à celles des Européens expatriés, des commerçants aux militaires. L’indépendance une fois acquise, le premier président Léopold Sédar Senghor développe avec le mouvement de la Négritude une orientation culturaliste pour la société sénégalaise, sans rompre avec la francophonie qu’il inscrit dans l’héritage historique du Sénégal et apporte une nouvelle lecture sur la place de Gorée par rapport à la diaspora noire. À partir des années 1980, et pendant deux décennies, le président Abdou Diouf suit la politique de sauvegarde et de mise en valeur de Gorée mise en place par l’UNESCO et veut étendre le message de l’île-mémoire au monde entier par l’érection d’un grand mémorial de l’esclavage. Durant la dernière décennie de la présidence d’Abdoulaye Wade, l’État est moins présent sur le site de Gorée ; il est occupé à élever à Dakar d’autres infrastructures dont un monument de la Renaissance africaine et un parc culturel dans lequel sera édifié un musée des Civilisations noires, idée émise en 1971 par le président Senghor. Le passé de l’île de Gorée et le souvenir des souffrances et des traumatismes subis par l’Afrique et ses diasporas à travers l’esclavage et la traite atlantique, revisité, joue un rôle de premier plan dans l’affirmation de la politique dite « d’enracinement et d’ouverture » chère au président Léopold Sédar Senghor. Le concept de Négritude s’impose comme idéologie du nouvel État indépendant sénégalais qui s’ouvre sur le monde afro-américain. Le président du nouvel État du Sénégal, Léopold Sédar Senghor choisit l’île de Gorée comme un des supports physiques de démonstration de son concept sur la Négritude, sans lien direct avec l’esclavage. (…) Gorée est un laboratoire idéal pour le projet post-colonial de la Négritude. Lieu d’échanges culturels, artistiques, littéraires et scientifiques regroupant l’Afrique et sa Diaspora, le Festival est le lieu de rencontres, colloques, expositions, chants, danses, spectacles qui rythment la vie quotidienne des populations de Dakar et de Gorée. Le lancement du Festival a lieu en présence d’André Malraux. Le choix de Gorée pour abriter une des manifestations de ce Festival répond à une volonté du pouvoir politique qui entend faire de l’île un lieu privilégié pour une communion des peuples du monde à travers le dialogue des cultures. Un spectacle « son et lumière », les « Féeries de Gorée » est monté pour l’occasion : il retrace les grands moments de l’histoire du Sénégal et particulièrement de l’île de Gorée et de son rôle dans l’histoire de l’esclavage. La Maison des Esclaves est restaurée à l’occasion de ce festival. À l’heure où le tourisme de mémoire émerge autour des lieux chargés d’histoire et notamment à ceux liés à des faits tragiques, le Sénégal concentre ce type de démarche presque exclusivement sur la commémoration de l’esclavage et l’île de Gorée. Des agences américaines proposent aux touristes noirs américains des « Black-History Tours », leur permettant d’aller se recueillir sur la terre de leurs ancêtres, plus particulièrement à Gorée, et de méditer sur leur tragique destin. « Ainsi, après avoir été, entre l’Afrique et les Amériques noires, le trait d’union symbolique de la désolation, Gorée devient-elle peu à peu un symbole d’espoir, vers où, de plus en plus nombreux, convergent aujourd’hui, en une sorte de pèlerinage, les descendants des déportés de jadis, en quête de leurs racines et tous ceux qui entendent puiser dans son histoire les raisons d’une nouvelle solidarité des peuples ». Depuis 2005, la mairie de Gorée organise un festival dans le cadre de la promotion des activités culturelles : le Gorée Diaspora Festival. Cette manifestation internationale constitue un moment de retrouvailles entre la population goréenne et la diaspora. À travers cette manifestation, l’institution municipale vise trois objectifs majeurs : permettre aux membres de la diaspora de retrouver l’identité perdue sur cette île-souvenir, les faire participer à la sauvegarde de la mémoire et orienter le devenir de Gorée d’un statut de terre d’esclaves vers celle d’un carrefour de dialogue interculturel. En ouvrant ainsi la porte du retour, la commune entend faire rayonner Gorée sur la scène internationale. Cette manifestation constitue un moment de festivités, de recueillement et de souvenir : festivals, rencontres cinématographiques, concerts, expositions, musiques, visite de la Maison des Esclaves, randonnée maritime, etc. Le festival inclut aussi un volet éducatif avec l’organisation de séminaires et d’ateliers de formation, de conférences et de colloques dont les thèmes portent sur l’esclavage, la traite négrière et sa mémoire, le dialogue des peuples et des cultures. Hamady Bocoum and Bernard Toulier
La Maison des esclaves est devenu un élément du patrimoine de l’humanité, surtout depuis que l’Unesco a classé l’ensemble de l’île dans cette rubrique. Le problème, c’est que tout est faux, ou presque, comme l’expliquent Abdoulaye Camara et le Père de Benoist, un jésuite, historien, chercheur à l’IFAN. La maison, parfaitement identifiée, n’a rien de hollandais. Elle a été construite par les Français, en 1783, pour Anna Colas, une signare riche dame métisse quand la traite tirait à sa fin. Les pièces du bas ont peut-être servi de logements à des esclaves domestiques mais sûrement pas à la traite. C’étaient essentiellement des entrepôts à marchandises. L’esclaverie, car elle a existé, se situait non loin du fort qui abrite aujourd’hui le Musée historique. Elle a disparu. Enfin, Gorée n’a jamais été un centre très actif pour la traite (deux cents à cinq cents esclaves par an, si l’on en croit les chiffres du savant jésuite), par rapport aux comptoirs de la Côte des esclaves (l’actuel Bénin), du golfe de Guinée ou de l’Angola. La légende de la Maison aux esclaves doit tout à l’indéniable talent de Joseph N’Diaye, qui a mis une douzaine d’années à forger un mythe qui, aujourd’hui, a force de loi. Emmanuel de Roux
Cette histoire de maison des esclaves de Gorée a été inventée par Pierre André Cariou, médecin chef breton de la marine française dans les années 1950. Il n’a pas cherché à la falsifier, mais a émis des suppositions, qu’il a intégrées dans un roman historique non édité « Promenade à Gorée » (manuscrit disponible à la BNF Mitterrand) et dans le circuit touristique qu’il proposait aux rares touristes de l’île de Gorée; souvent des amis et familles qui venaient visiter les marins militaires français hospitalisés à l’hôpital de la Marine. À l’origine de ce qui allait devenir la plus importante escroquerie mémorielle de l’histoire, un petit garçon qui servait de « boy » à Cariou, l’adolescent Joseph N’Diaye. Joseph N’Diaye devenu adulte prit la suite de Cariou dans les années 1970. Dans les années 1980 sorti le film « Racines » avec la figure inoubliable de « Kounta Kinté » l’Africain; les Américains noirs, qui vivaient souvent une sorte d’amnésie volontaire quant à leurs souffrances passées, furent pris d’une envie légitime de retourner voir mama africa. Le seul pays qui disposait d’un véritable ministère de la Culture à l’époque, fabuleux héritage de l’ère Senghor, était le Sénégal. Les fonctionnaires orientèrent naturellement les Tours Operator black vers Gorée, où une personne qui n’était pas fonctionnaire faisait visiter une maison aux rares touristes… Joseph N’Diaye. Rapidement, ce business devint une affaire juteuse pour les réceptifs sénégalais, les TO américains (souvent créés par des Sénégalais des USA) et le gouvernement qui prit peu à peu conscience de l’importance économique de cette affaire. D’autres aussi, les enseignants sénégalais de l’université de Dakar, furent de grands bénéficiaires du « Gorée Business » comme je l’ai nommé. En effet, ils obtinrent de nombreux stages, invitations à des conférences aux Amériques rémunérés grâce aux inventions racontées par tonton Joseph. Certains obtinrent des emplois dans les universités américaines (Colombia University), d’autres à la direction du patrimoine dépendant du ministère de la Culture en profitèrent notamment en détournant les nombreux dons financiers offert pour la sauvegarde de Gorée… Au point que l’Unesco, agacée par ces détournement, ne cautionna plus aucune campagne de sauvegarde du patrimoine bâti. Cela ne pouvait pas durer. Dans les années 1980, un historien américain, Philipp Curtin, intrigué par les soi-disants 20 millions de victimes parties de Gorée, publia une étude statistique rappelant que ce chiffre était celui de l’ensemble de la traite partie de toute la côte d’Afrique, de la Mauritanie à l’Angola. Curtin indiqua aussi que de Gorée partirent entre 900 à 1500 personnes et que le Sénégal représentait 5% de la traite. Panique à Dakar et chez leurs complices sénégalais des USA; heureusement pour eux, la presse, non informée, ne diffusa pas l’information… Dans les années 2000, se fut le tour d’Abdoulaye Camara, enseignant en histoire à l’Université de Dakar, de dénoncer l’affaire à un journaliste du Monde, qui la publia alors. Mais l’article fut étouffé car la bande du Gorée Business comptait alors de puissantes relations amicales en France, Laurence Attali (sœur de Jacques), Catherine Clément (romancière) et la Fondation Danièle Mitterrand. Malgré tout Ki Zerbo philosophe béninois protesta contre l’arnaque dans un article de presse. En 2006 finalement sortit la seule étude scientifique démontrant à partir d’archives qu’il s’agissait bel et bien d’une arnaque: la mienne. Cette études indiquait qu’il y avait non pas une mais deux captiveries; toutes deux démolies mais parfaitement repérables grâce aux plans de cadastres du XVIIIe siècle conservés aux archives BNF Richelieux à Paris. Cette étude démontre aussi que les principaux points de départs des victimes furent Saint Louis au Sénégal et la Gambie. Cette étude obligea Wikipedia à rectifier le tir, malgré le sabotage permanent de mes contributions pendant plus de trois ans organisé par les membres de ce qu’il est convenu d’appeler « le Gorée Business ». Ironie du sort, la population « créole » du XVIIIe siècle, comme démontré par cette étude, constitua le principal frein à la traite des esclaves avec celle de Dakar; cela explique le faible nombre de victimes parties de Gorée. Encore plus « amusant » la femme métisse/créole qui a construit cette maison, Anna Colas Pépin, fut une résistante à la traite comme ses « consœurs » qui dirigeaient l’île de Gorée du XVIIIe au XIXe siècle, car ils s’agissait d’une micro-civilisation matriarcale métisse/créole… Jean Luc Angrand
L’histoire de la maison des esclaves de Gorée serait, à l’en croire, une invention dans les années 1950, du docteur Pierre André Cariou, de son état médecin chef de la marine française. Les hypothèses émises par ce dernier seraient contenues dans un manuscrit conservé à la BNF. On aurait souhaité disposer de plus d’informations à propos dudit manuscrit (par exemple son numéro de référence ou son code pour le retrouver plus aisément). Et pourquoi ne pas citer nommément des passages du texte en question pour étayer davantage son propos. En l’absence de telles précautions, son opinion reste pour le moins superficielle et nous laisse un rien circonspect. (…) Revenant ainsi sur le contexte ayant favorisé le développement de ce « business », c’est-à-dire la sortie du film Racines, Jean-Luc Angrand évoque le rôle majeur des Tour-operator tenus par des Sénégalais installés aux USA sans jamais fournir concrètement ni un nom d’organisme touristique ni celui d’un ressortissant sénégalais. Toutes choses entretenant le flou le plus absolu. « Les Tours Operators n’ont jamais été l’objectif de Gorée, éclaire en revanche François Vergès, ancienne présidente du Comité pour la mémoire de l’esclavage. Il ne faut pas tout confondre. C’est comme si on disait, il y a des voyages organisés à Auschwitz, et donc cela enlève le caractère véridique de ce qui s’y est passé ». Il est évident que Gorée tire son statut de haut lieu mémoriel des dividendes de notoriétés qui attirent touristes et pèlerins. « Il faut lutter pour que Gorée ne devienne pas un endroit mercantile, prévient François Vergès. C’est comme à Roben Island, il y avait un projet de le transformer en endroit mercantile, tout le monde a protesté. Et cela s’est arrêté. Est-ce que ce monsieur (Angrand) empêche qu’il y ait des voyages organisés à Lourdes ou à Saint-Michel ? C’est sélectif comme réflexion ». Sélectif puis accusateur sans véritable référence. En effet, Jean-Luc Angrand accuse les enseignants de l’Université de Dakar d’avoir couvert et amplifié ce qu’il appelle « un mensonge » afin d’en tirer des prébendes financières et ou promotionnelles. Mais de quels professeurs s’agit-il ? Ne peut-il être plus concis dans sa dénonciation ? Il évoque l’obtention de postes dans la prestigieuse University of Columbia. On n’ose croire qu’il parle de Souleymane Bachir Diagne ou de Mamadou Diouf. Le premier, normalien, agrégé et docteur en philosophie cité par le Nouvel Observateur parmi l’un des plus grands penseurs de notre époque. Le second, historien de formation, docteur en histoire de la Sorbonne et auteur de plusieurs ouvrages. Pareil parcours ne saurait-il suffire pour être recruté par un institut américain fut-il Columbia University. Dans la deuxième partie de sa diatribe (…) quand il convoque les travaux de Philippe Curtin dans les années 1980, il se garde bien de mentionner le titre de ou des ouvrages dont il a recours. Chose plutôt surprenante pour qui connaît l’immensité de la production de ce chercheur. Dans le même ordre d’idées, on s’attendait à ce qu’il nous livre au moins des noms d’historiens sénégalais ou africains dignes de ce nom ayant soutenu que de Gorée sont partis vingt millions d’esclaves. Idée absolument saugrenue même pour le néophyte en histoire qui n’ignore point qu’une partie de la longue côte atlantique africaine (Togo-Bénin-Nigeria) était justement appelée côte des esclaves en raison de l’intensité du trafic. Ainsi pour Françoise Vergès, « il est évident que l’Ile de Gorée ne pouvait pas prendre autant d’esclaves que Ouidah (Bénin) ou d’autres forteresses sur la côte africaine. Des historiens africains avaient reconnu depuis longtemps que Gorée a participé à la traite mais n’était pas un grand centre, ni un lieu de baraquements ». Alors que la « civilisationniste » Maboula Soumahoro préfère évoquer le départ d’esclaves de la région de Sénégambie. Des « Slaves Castel », on en trouve dans cette région comme au Ghana ou au Bénin. Si des esclaves ne sont pas partis de Gorée, ils sont partis de toute la région ouest africaine donc cela ne change rien à la situation. Je ne comprends pas tellement cette position de nier ce caractère à Gorée ». Autre incompréhension, M. Angrand cite Abdoulaye Camara, enseignant à l’UCAD. Lequel aurait voulu et dénoncé l’imposture dans le journal Le Monde mais l’affaire fut étouffée par le lobby dit « goréen ». On ne peut qu’être interloqué par cette information n’apportant au demeurant rien de concret à son argumentaire. L’incompréhension se porte sur deux facteurs principaux : D’abord pourquoi Jean-Luc Angrand ne fait-il pas siennes les conclusions d’Abdoulaye Camara et les reproduire ici (du moins une partie) pour donner davantage de densité et de crédibilité à son article ? Ensuite, comment se fait-il que cet enseignant-chercheur de l’UCAD se tourne vers le quotidien Le Monde pour publier ses résultats (encore qu’il ne nous fournit ni le numéro ni la date) ? Alors qu’il existe en Afrique même et partout au monde une myriade de revues d’histoire susceptibles de vulgariser ses travaux. Ou faut-il croire ceux-ci n’étaient pas à la hauteur ? Par ailleurs, on est en droit de demeurer interrogatif quant à la soumission de la gazette française pour étouffer cette affaire. Pour qui connaît l’histoire de ce journal né au lendemain de la deuxième guerre mondiale et ses multiples prises à partie avec l’Etat française, la chose parait peu probante. Restant dans sa volonté constante de fournir des preuves du bienfondé de sa théorie, Angrand fait appel à la rescousse une production de Joseph Ki-Zerbo. Mais là également, il commet une erreur factuelle rédhibitoire en présentant ce dernier comme un philosophe béninois alors qu’il est de notoriété publique que l’homme est historien de spécialité et Burkinabé de nationalité. D’autre part, il ne nous dit point où, quand et sur quel support ce penseur a publié son article. (…) Pour conclure sa réflexion, il propose son argument béton à savoir son étude sur la question. Il la présente, « sans prétention », comme le seul vrai travail scientifique en l’espèce (lui qui n’est pas véritablement connu dans la communauté des historiens). Toutefois, il ne dit mot sur le titre de ladite étude ni la publication où elle est apparue avant d’être intégrée dans son livre. Celui-ci, soutient-il, mérite d’être enseigné à l’université en raison de la distinction reçue de la part de l’académie des sciences d’Outre-mer. Rappelons que de tels trophées ne sont pas toujours gages d’excellence. Aussi l’ouvrage très polémique d’Olivier Pétré-Grenouilleau : les traites négrières (Gallimard, 2004) reçut-il le prix du livre d’histoire du Sénat et celui de l’essai de l’académie française avec à chaque fois des jurys composés de non spécialistes. Le seul membre du premier jury ayant quelques clignotants en ce domaine fut Marc Ferro, grand connaisseur de l’Urss de son état. En matière d’histoire de l’Outre-mer, son seul fait d’armes est d’avoir dirigé un ouvrage collectif : le livre noir du colonialisme (Robert Lafont, 2003). En fait le succès du travail de Pétré-Grenouilleau provient de deux facteurs précis. Il a permis de découvrir un point majeur en l’occurrence la diversité des traites négrières. Et d’autre part il est apparu comme une forme d’absolution des Européens qui n’étaient opportunément plus les seuls méchants négriers. Responsabilité qu’ils partageaient dorénavant avec les Arabes et les Africains eux-mêmes. Ce sont donc ces deux points qui justifient les nombreux satisfécits dont Olivier Pétré-Grenouilleau a bénéficié en dépit des sérieuses lacunes que contient son essai. Ce dernier fait pratiquement un blackout total (vingt pages sur plus de trois cent soixante) sur le trafic de l’Atlantique sud mené par les Hispano-portugais, c’est-à-dire la droiture. Laquelle a été encore plus importante que le très connu commerce triangulaire se faisant plus au nord. De plus cet historien reprend par devers lui des chiffres fantaisistes quant au nombre de déportés dans le cadre du trafic transaharien et de l’océan indien. Fantaisiste car n’offrant pas contrairement aux échanges de l’ouest des sources bien chiffrées et quantifiables. Moussa Diop
Cet article de presse [de Momar Mbaye, Docteur en histoire de l’Université de Rouen et Moussa Diop, journaliste] est une bien amusante rhétorique faite par des enseignants sénégalais qui tentent de sauver leurs « têtes » après une bonne vingtaine d’années de baratin. Toute les affirmations contenues dans mon article de presse du Hufffingtonpost sont sourcées; mon principal adversaire monsieur Hamady Bocoum Directeur National du Patrimoine Sénégalais vient de reconnaître à demi mots dans un article de la revue du patrimoine français In Situ du mois d’Avril 2103v(sur internet) le bien fondé de mes travaux de recherches (en partie dûs à Hubert Dupuy); essayant au passage de mettre sur le dos de l’état français l’origine de cette arnaque mémorielle. Hamady Bocoum ment très mal car dans le même article il indique par inadvertance que le représentant de l’état français de l’époque, le Professeur Mauny (1951) niait toute véracité à cette invention du Médecin Chef de la Marine Pierre André Cariou; lui même peut être inspiré par Robert Gaffiot auteur de Gorée Capital déchue (1933). Gaffiot inventeur ou co-inventeur avec Cariou du Mythe (à creuser). La faute n’est pas, comme je l’ai dit, d’avoir débuté le mythe puisque ce sont deux Français qui l’ont inventé à l’usage des familles de militaires français hospitalisés à l’hôpital de la Marine française bien avant l’indépendance (avant guerre) mais bien d’en avoir fait, un fait historique reconnu par l’état sénégalais après l’indépendance tout en permettant au « griot mémoriel » Joseph Ndiaye d’en rajouter des couches. Une historiette jamais reconnue par le professeur Théodore Monod fondateur de l’IFAN et son assistant le professeur Mauny représentant l’état français avant l’indépendance. Il n’y a donc pas de complot « blanc » contre Gorée…n’est-ce pas ? Les escrocs de l’Université de Dakar n’ont pas hésité à tourner en ridicule le vrai travail de mémoire allant même jusqu’à cacher depuis plus de vingt ans la vraie captiverie de Gorée encore existante, aux pèlerins antillais, noirs-américains et autres. Captiverie dont j’ai révélé l’existence depuis l’année 2006 malgré des menaces physiques à mon encontre de la part du pseudo conservateur Eloi Coly. Vos collègues universitaires corrompus du Gorée Business (malhonnête) refusent de la faire ouvrir car cela leur ferait perdre le contrôle probablement de la pompe à fric et ils seraient obligés de s’expliquer auprès de leurs nombreux amis noirs aux Antilles et USA à qui ils ont fait prendre une vessie pour une lanterne. Enfin, peut-être ont-ils peur de subir les foudres des fondations et états qui ont donné de l’argent pour « sauver Gorée » porte sans retour de l’esclavage d’où furent partis selon le griot mémoriel Joseph Ndiaye 10, 15, 20 millions de victimes (les chiffres qu’il donnait variaient probablement en fonction de la température de l’air ou de la direction du vent)… Autre faute gravissime fut de laisser Joseph Ndiaye mettre en place un discours fonctionnel dans la maison d’Anna Colas Pépin (maison des esclaves) dont le seul but fut de tirer des larmes aux Antillais et noirs américains pour en obtenir toujours plus de pognon…c’est dégueulasse. Enfin, autre faute, laisser Joseph Ndiaye raconter tout et surtout n’importe quoi sur l’histoire patrimoniale de cette maison; dates de constructions fausses, usage du rez-de-chaussée qui n’a jamais été une captiverie transformée en cellules avec la cerise sur le gâteau « une cellule des récalcitrants » (un gag mémoriel). Quelle honte pour l’Université de Dakar que d’avoir laissé un ignorant ridiculiser l’Afrique et le travail des historiens noirs qui font leur boulot correctement; comme Abdoulaye Camara (inspiré tout comme Roger de Benoist par des informations fournies par monsieur Hubert Dupuy) que vous dénigrez dans votre article; tout cela pour enrichir les amis, la famille qui contrôle le Gorée business (malhonnête). Je ne suis pas contre un Gorée Business, tout comme il y a un Mecque Business et un Lourdes Business, mais encore faut il que ce qui est proposé au bout soit honnête alors au nom des mes amis antillais, noirs américains je vous SOMME par la présente d’ouvrir immédiatement la vraie captiverie de Gorée et d’indiquer aux touristes les vrais chiffres de déportés !!!!!. Voici le plan de cadastres de Gorée datant du XVIII siècle avec l’indication de la vraie captiverie (il en avait une seconde dans le fort St François qui est rasé de nos jours); essayez svp de rattraper vos erreurs graves en faisant le boulot correctement pour éviter aux négationnistes de se moquer de nous, les Africains. Il faut maintenant déconstruire/reconstruire; faisons le ensemble avec la participation désormais indispensable de nos frères et sœurs historiens antillais et américains. Jean-Luc Angrand
Après l’ennichement du confinement aveugle et l’actuel emmusellement du masque obligatoire à l’extérieur …
Mais aussi, avec le déchainement de génuflexions que l’on sait, le psychodrame du racisme systémique …
Retour …
Au premier jour du procès des complices des assassins des caricaturistes de Charlie hebdo …
La Maison des esclaves de l’île de Gorée figure dans tous les guides. Pas un touriste ne manquera la visite de ce monument au sinistre passé. Il sera accueilli dans la cour de ce bâtiment ocre rouge par un cicerone inspiré, Joseph N’Diaye, un ancien sous-officier. Ce dernier raconte avec émotion l’histoire de cette « esclaverie » construite par les Hollandais au XVIIe siècle, pivot de la traite à Gorée qui vit défiler des centaines de milliers d’Africains, enchaînés, vers le Nouveau Monde.
Les différentes cellules sont détaillées : celles des hommes, celles des femmes et celles des enfants, le cachot pour les rebelles et la porte pour le « voyage sans retour » qui s’ouvre sur l’océan. Un escalier à double révolution conduit aux appartements des négriers. La fondation France-Liberté, de Danièle Mitterrand, comme en atteste une plaque, a financé une partie de la rénovation de l’édifice. La Maison des esclaves est devenu un élément du patrimoine de l’humanité, surtout depuis que l’Unesco a classé l’ensemble de l’île dans cette rubrique. Le problème, c’est que tout est faux, ou presque, comme l’expliquent Abdoulaye Camara et le Père de Benoist, un jésuite, historien, chercheur à l’IFAN. La maison, parfaitement identifiée, n’a rien de hollandais. Elle a été construite par les Français, en 1783, pour Anna Colas, une signare riche dame métisse quand la traite tirait à sa fin. Les pièces du bas ont peut-être servi de logements à des esclaves domestiques mais sûrement pas à la traite. C’étaient essentiellement des entrepôts à marchandises.
L’esclaverie, car elle a existé, se situait non loin du fort qui abrite aujourd’hui le Musée historique. Elle a disparu. Enfin, Gorée n’a jamais été un centre très actif pour la traite (deux cents à cinq cents esclaves par an, si l’on en croit les chiffres du savant jésuite), par rapport aux comptoirs de la Côte des esclaves (l’actuel Bénin), du golfe de Guinée ou de l’Angola. La légende de la Maison aux esclaves doit tout à l’indéniable talent de Joseph N’Diaye, qui a mis une douzaine d’années à forger un mythe qui, aujourd’hui, a force de loi.
Voir également:
LA CERTIFICATION DES LIEUX DE MEMOIRES DE LA SHOAH NOIRE
Petite note sur la fausse « Maison des esclaves de Gorée »
Jean Luc Angrand
Historien franco-sénégalais
16 novembre 2012
Cette histoire de maison des esclaves de Gorée a été inventé par Pierre André Cariou, médecin chef breton de la marine française dans les années 1950. Il n’a pas cherché à la falsifier, mais a émis des suppositions, qu’il a intégrées dans un roman historique non édité « Promenade à Gorée » (manuscrit disponible à la BNF Mitterand) et dans le circuit touristique qu’il proposait aux rares touristes de l’île de Gorée; souvent des amis et familles qui venaient visiter les marins militaires français hospitalisés à l’hôpital de la Marine.
À l’origine de ce qui allait devenir la plus importante escroquerie mémorielle de l’histoire, un petit garçon qui servait de « boy » à Cariou, l’adolescent Joseph N’Diaye.
Joseph N’Diaye devenu adulte prit la suite de Cariou dans les années 1970. Dans les années 1980 sorti le film « Racines » avec la figure inoubliable de « Kounta Kinté » l’africain; les Américains noirs, qui vivaient souvent une sorte d’amnésie volontaire quant à leurs souffrances passées, furent pris d’une envie légitime de retourner voir mama africa.
Le seul pays qui disposait d’un véritable ministère de la Culture à l’époque, fabuleux héritage de l’ère Senghor, était le Sénégal. Les fonctionnaires orientèrent naturellement les Tours Operator black vers Gorée, où une personne qui n’était pas fonctionnaire faisait visiter une maison aux rares touristes… Joseph N’Diaye.
Rapidement, ce business devint une affaire juteuse pour les réceptifs sénégalais, les TO américains (souvent créés par des Sénégalais des USA) et le gouvernement qui prit peu à peu conscience de l’importance économique de cette affaire.
D’autres aussi, les enseignants sénégalais de l’université de Dakar, furent de grands bénéficiaires du « Gorée Business » comme je l’ai nommé.
En effet, ils obtinrent de nombreux stages, invitations à des conférences aux Amériques rémunérés grâce aux inventions racontées par tonton Joseph. Certains obtinrent des emplois dans les universités américaines (Colombia University), d’autres à la direction du patrimoine dépendant du ministère de la Culture en profitèrent notamment en détournant les nombreux dons financiers offert pour la sauvegarde de Gorée… Au point que l’Unesco, agacée par ces détournement, ne cautionna plus aucune campagne de sauvegarde du patrimoine bâti.
Cela ne pouvait pas durer.
Dans les années 1980, un historien américain, Philipp Curtin, intrigué par les soi-disants 20 millions de victimes parties de Gorée, publia une étude statistique rappelant que ce chiffre était celui de l’ensemble de la traite partie de toute la côte d’Afrique, de la Mauritanie à l’Angola. Curtin indiqua aussi que de Gorée partirent entre 900 à 1500 personnes et que le Sénégal représentait 5% de la traite.
Panique à Dakar et chez leurs complices sénégalais des USA; heureusement pour eux, la presse, non informée, ne diffusa pas l’information…
Dans les années 2000, se fut le tour d’Abdoulaye Camara, enseignant en histoire à l’Université de Dakar, de dénoncer l’affaire à un journaliste du Monde, qui la publia alors. Mais l’article fut étouffé car la bande du Gorée Business comptait alors de puissantes relations amicales en France, Laurence Attali (sœur de Jacques), Catherine Clément (romancière) et la Fondation Danièle Mitterrand. Malgré tout Ki Zerbo philosophe béninois protesta contre l’arnaque dans un article de presse.
En 2006 finalement sortit la seule étude scientifique démontrant à partir d’archives qu’il s’agissait bel et bien d’une arnaque: la mienne. Cette études indiquait qu’il y avait non pas une mais deux captiveries; toutes deux démolies mais parfaitement repérables grâce aux plans de cadastres du XVIIIe siècle conservés aux archives BNF Richelieux à Paris. Cette étude démontre aussi que les principaux points de départs des victimes furent Saint Louis au Sénégal et la Gambie. Cette étude obligea Wikipedia à rectifier le tir, malgré le sabotage permanent de mes contributions pendant plus de trois ans organisé par les membres de ce qu’il est convenu d’appeler « le Gorée Business ».
Ironie du sort, la population « créole » du XVIIIe siècle, comme démontré par cette étude, constitua le principal frein à la traite des esclaves avec celle de Dakar; cela explique le faible nombre de victimes parties de Gorée.
Encore plus « amusant » la femme métisse/créole qui a construit cette maison, Anna Colas Pépin, fut une résistante à la traite comme ses « consœurs » qui dirigeaient l’île de Gorée du XVIIIe au XIXe siècle, car ils s’agissait d’une micro-civilisation matriarcale métisse/créole…
L’étude dont je suis l’auteur fut intégrée dans mon livre « Céleste ou le temps des signares« , seul livre certifié qui puisse servir en université car primé par une académie dépendant de l’éducation nationale française: l’Académie des Science d’Outre-mer.
Voilà donc pourquoi je propose désormais « la certification des lieux de mémoires », c’est-à-dire que tous les lieux de mémoires en Afrique soient désormais certifiés par plusieurs universités, des Amériques (Caraïbes, Etats-Unis), d’Europe et d’Afrique. Avec cette méthode, on éviterait que ne se reproduise des arnaques comme la fausse « maison des esclaves de Gorée ».
Voir de même:
Maison des esclaves de Gorée: les manquements de Jean-Luc Angrand
AFRIQUE – Toute vérité est une suite d’erreurs rectifiées. Si l’affaire de la maison des esclaves est réellement une grosse escroquerie il est bon de le savoir et de le diffuser mais encore faut-il que cette « vérité » soit révélée en s’appuyant sur une argumentation et des preuves ne souffrant d’aucune once de doute.
L’Île de Gorée et sa symbolique maison des esclaves sont des lieux mémoriels qui permettent de se souvenir de l’une des pages les plus douloureuses de l’histoire de l’humanité à savoir la traite des noirs qui eut lieu du XVI au XIXè siècle (au bas mot). C’est un fait. Gorée résiste autant aux déferlantes attaques des eaux de l’océan sur ses parois insulaires mais solides qu’à celles trop souvent légères, pour ne pas dire révisionnistes, de Jean-Luc Angrand. Nous, Momar Mbaye, Docteur en histoire de l’Université de Rouen et Moussa Diop, journaliste, correspondant du quotidien sénégalais Le Soleil à Paris et diplômé en histoire, nous sommes d’abord questionnés sur le sérieux de l’article de Jean-Luc Angrand intitulé « Petite note sur la fausse ‘maison des esclaves de Gorée’« . Au delà de la notification des manquements dans sa démarche, nous apportons des réponses sur le sujet. Nous avons jugé utile de recueillir également le témoignage de Françoise Vergès, alors présidente du comité pour la mémoire de l’esclavage et Maboula Soumahoro, Docteur en langues, culture et civilisation du monde anglophone.
Reconnaissons avant tout que l’objectif que se fixe Monsieur Angrand n’est en soi nullement répréhensible ou condamnable. Bien au contraire la controverse et le débat nourrissent la science. On dira, pour reprendre le mot de Nietzsche, que c’est de la contradiction que l’esprit devient fécond.
Jean-Luc Angrand se définit comme un historien franco-sénégalais, il ne respecte pas toujours un certain nombre de règles exigées par la discipline historique. Parmi celles-ci figurent en première place le sérieux et la rigueur exemplaires dans l’analyse et l’exploitation des sources sous-tendant toute affirmation. Et sous ce rapport, nous constatons que l’écrit de Mr Angrand n’est pas toujours exempt de tels manquements. Aussi, point par point, nous tenterons de mettre en évidence de telles insuffisances.
L’histoire de la maison des esclaves de Gorée serait, à l’en croire, une invention dans les années 1950, du docteur Pierre André Cariou, de son état médecin chef de la marine française. Les hypothèses émises par ce dernier seraient contenues dans un manuscrit conservé à la BNF. On aurait souhaité disposer de plus d’informations à propos dudit manuscrit (par exemple son numéro de référence ou son code pour le retrouver plus aisément). Et pourquoi ne pas citer nommément des passages du texte en question pour étayer davantage son propos. En l’absence de telles précautions, son opinion reste pour le moins superficielle et nous laisse un rien circonspect.
Ce déficit de précision constitue à bien des égards la marque de fabrique de l’article de l' »historien » Angrand.
Revenant ainsi sur le contexte ayant favorisé le développement de ce « business », c’est-à-dire la sortie du film Racines, Jean-Luc Angrand évoque le rôle majeur des Tour-operator tenus par des Sénégalais installés aux USA sans jamais fournir concrètement ni un nom d’organisme touristique ni celui d’un ressortissant sénégalais. Toutes choses entretenant le flou le plus absolu. « Les Tours Operators n’ont jamais été l’objectif de Gorée, éclaire en revanche François Vergès, ancienne présidente du Comité pour la mémoire de l’esclavage. Il ne faut pas tout confondre. C’est comme si on disait, il y a des voyages organisés à Auschwitz, et donc cela enlève le caractère véridique de ce qui s’y est passé ».
Il est évident que Gorée tire son statut de haut lieu mémoriel des dividendes de notoriétés qui attirent touristes et pèlerins. « Il faut lutter pour que Gorée ne devienne pas un endroit mercantile, prévient François Vergès. C’est comme à Roben Island, il y’avait un projet de le transformer en endroit mercantile, tout le monde a protesté. Et cela s’est arrêté. Est-ce que ce monsieur (Angrand) empêche qu’il y ait des voyages organisés à Lourdes ou à Saint-Michel ? C’est sélectif comme réflexion ». Sélectif puis accusateur sans véritable référence. En effet, Jean-Luc Angrand accuse les enseignants de l’Université de Dakar d’avoir couvert et amplifié ce qu’il appelle « un mensonge » afin d’en tirer des prébendes financières et ou promotionnelles. Mais de quels professeurs s’agit-il ? Ne peut-il être plus concis dans sa dénonciation ? Il évoque l’obtention de postes dans la prestigieuse University of Columbia. On n’ose croire qu’il parle de Souleymane Bachir Diagne ou de Mamadou Diouf.
Le premier, normalien, agrégé et docteur en philosophie cité par le Nouvel Observateur parmi l’un des plus grands penseurs de notre époque. Le second, historien de formation, docteur en histoire de la Sorbonne et auteur de plusieurs ouvrages. Pareil parcours ne saurait-il suffire pour être recruté par un institut américain fut-il Columbia University.
Dans la deuxième partie de sa diatribe Jean-Luc Angrand met en exergue des penseurs qui sont sensés apporter de la ressource à sa thèse. Pourquoi pas ? Mais là aussi il pèche par sa légèreté et le manque de rigueur de son raisonnement. Ainsi, quand il convoque les travaux de Philippe Curtin dans les années 1980, il se garde bien de mentionner le titre de ou des ouvrages dont il a recours. Chose plutôt surprenante pour qui connaît l’immensité de la production de ce chercheur. Dans le même ordre d’idées, on s’attendait à ce qu’il nous livre au moins des noms d’historiens sénégalais ou africains dignes de ce nom ayant soutenu que de Gorée sont partis vingt millions d’esclaves. Idée absolument saugrenue même pour le néophyte en histoire qui n’ignore point qu’une partie de la longue côte atlantique africaine (Togo-Bénin-Nigeria) était justement appelée côte des esclaves en raison de l’intensité du trafic.
Ainsi pour Françoise Vergès, « il est évident que l’Ile de Gorée ne pouvait pas prendre autant d’esclaves que Ouidah (Bénin) ou d’autres forteresses sur la cote africaine. Des historiens africains avaient reconnu depuis longtemps que Gorée a participé à la traite mais n’était pas un grand centre, ni un lieu de baraquements ». Alors que la « civilisationniste » Maboula Soumahoro préfère évoquer le départ d’esclaves de la région de Sénégambie. Des « Slaves Castel », on en trouve dans cette région comme au Ghana ou au Bénin. Si des esclaves ne sont pas partis de Gorée, ils sont partis de toute la région ouest africaine donc cela ne change rien à la situation. Je ne comprends pas tellement cette position de nier ce caractère à Gorée ».
Autre incompréhension, M. Angrand cite Abdoulaye Camara, enseignant à l’UCAD. Lequel aurait voulu et dénoncé l’imposture dans le journal Le Monde mais l’affaire fut étouffée par le lobby dit « goréen ». On ne peut qu’être interloqué par cette information n’apportant au demeurant rien de concret à son argumentaire. L’incompréhension se porte sur deux facteurs principaux : D’abord pourquoi Jean-Luc Angrand ne fait-il pas siennes les conclusions d’Abdoulaye Camara et les reproduire ici (du moins une partie) pour donner davantage de densité et de crédibilité à son article ? Ensuite comment se fait-il que cet enseignant-chercheur de l’UCAD se tourne vers le quotidien Le Monde pour publier ses résultats (encore qu’il ne nous fournit ni le numéro ni la date) ? Alors qu’il existe en Afrique même et partout au monde une myriade de revues d’histoire susceptibles de vulgariser ses travaux. Ou faut-il croire ceux-ci n’étaient pas à la hauteur ?
Par ailleurs, on est en droit de demeurer interrogatif quant à la soumission de la gazette française pour étouffer cette affaire. Pour qui connaît l’histoire de ce journal né au lendemain de la deuxième guerre mondiale et ses multiples prises à partie avec l’Etat française, la chose parait peu probante. Restant dans sa volonté constante de fournir des preuves du bienfondé de sa théorie, Angrand fait appel à la rescousse une production de Joseph Ki-Zerbo. Mais là également, il commet une erreur factuelle rédhibitoire en présentant ce dernier comme un philosophe béninois alors qu’il est de notoriété publique que l’homme est historien de spécialité et Burkinabé de nationalité. D’autre part, il ne nous dit point où, quand et sur quel support ce penseur a publié son article.
Pareille omission constitue, si besoin en est, une preuve supplémentaire de son manque de rigueur.
Pour conclure sa réflexion, il propose son argument béton à savoir son étude sur la question. Il la présente, « sans prétention », comme le seul vrai travail scientifique en l’espèce (lui qui n’est pas véritablement connu dans la communauté des historiens). Toutefois, il ne dit mot sur le titre de ladite étude ni la publication où elle est apparue avant d’être intégrée dans son livre.
Celui-ci, soutient-il, mérite d’être enseigné à l’université en raison de la distinction reçue de la part de l’académie des sciences d’Outre-mer. Rappelons que de tels trophées ne sont pas toujours gages d’excellence. Aussi l’ouvrage très polémique d’Olivier Pétré-Grenouilleau : les traites négrières (Gallimard, 2004) reçut-il le prix du livre d’histoire du Sénat et celui de l’essai de l’académie française avec à chaque fois des jurys composés de non spécialistes. Le seul membre du premier jury ayant quelques clignotants en ce domaine fut Marc Ferro, grand connaisseur de l’Urss de son état. En matière d’histoire de l’Outre-mer, son seul fait d’armes est d’avoir dirigé un ouvrage collectif : le livre noir du colonialisme (Robert Lafont, 2003). En fait le succès du travail de Pétré-Grenouilleau provient de deux facteurs précis. Il a permis de découvrir un point majeur en l’occurrence la diversité des traites négrières. Et d’autre part il est apparu comme une forme d’absolution des Européens qui n’étaient opportunément plus les seuls méchants négriers. Responsabilité qu’ils partageaient dorénavant avec les Arabes et les Africains eux-mêmes.
Ce sont donc ces deux points qui justifient les nombreux satisfécits dont Olivier Pétré-Grenouilleau a bénéficié en dépit des sérieuses lacunes que contient son essai. Ce dernier fait pratiquement un blackout total (vingt pages sur plus de trois cent soixante) sur le trafic de l’Atlantique sud mené par les Hispano-portugais, c’est-à-dire la droiture. Laquelle a été encore plus importante que le très connu commerce triangulaire se faisant plus au nord. De plus cet historien reprend par devers lui des chiffres fantaisistes quant au nombre de déportés dans le cadre du trafic transaharien et de l’océan indien. Fantaisiste car n’offrant pas contrairement aux échanges de l’ouest des sources bien chiffrées et quantifiables.
En définitive si cet ouvrage aussi déficitaire sur le plan scientifique a pu recevoir autant de lauriers c’est en raison de son côté rassurant pour l’Occident.
Du coup sommes-nous en droit de nous questionner sur les motivations ayant présidé aux distinctions du livre de Monsieur Angrand, si d’aventure ce texte recelait des imperfections aussi notoires que celles que avons relevées dans son article.
Nous concluons notre critique en rappelant ces mots de Gaston Bachelard ; toute vérité est une suite d’erreurs rectifiées. Donc si l’affaire de la maison des esclaves est réellement une grosse escroquerie il est bon de le savoir et de le diffuser mais encore faut-il que cette « vérité » soit révélée en s’appuyant sur une argumentation et des preuves ne souffrant d’aucune once de doute. Ce qui est loin d’être le cas avec ce cher Monsieur Angrand.
Voir de plus:
Réponse de : Jean Luc ANGRAND Historien (franco-sénégalais) aux humoristes Momar Mbaye, Docteur en histoire de l’Université de Rouen et Moussa Diop, journaliste, membres actif du Gorée Business suite à leurs article dilatoire dans le Huffingtonpost.
Cet article de presse est une bien amusante rhétorique faite par des enseignants sénégalais qui tentent de sauver leurs « têtes » après une bonne vingtaine d’années de baratin. Toute les affirmations contenues dans mon article de presse du Hufffingtonpost sont sourcé; mon principal adversaire monsieur Hamady Bocoum Directeur National du Patrimoine Sénégalais vient de reconnaître à demi mots dans un article de la revue du patrimoine français In Situ du mois d’Avril 2103(sur internet) le bien fondé de mes travaux de recherches (en partie dû à Hubert Dupuy); essayant au passage de mettre sur le dos de l’état français l’origine de cette arnaque mémorielle.
Hamady Bocoum ment très mal car dans le même article il indique par inadvertance que le représentant de l’état français de l’époque, le Professeur Mauny (1951) niait toute véracité à cette invention du Médecin Chef de la Marine Pierre André Cariou; lui même peut être inspiré par Robert Gaffiot auteur de Gorée Capital déchue(1933). Gaffiot inventeur ou co-inventeur avec Cariou du Mythe (à creuser). La faute n’est pas comme je l’ai dit d’avoir débuté le mythe puisque ce sont deux français qui l’on inventés à l’usage des familles de militaires français hospitalisés à l’hôpital de la Marine française bien avant l’indépendance (avant guerre) mais bien d’en avoir fait, un fait historique reconnu par l’état sénégalais après l’indépendance tout en permettant au « griot mémoriel » Joseph Ndiaye dans rajouter des couches.
Une historiette jamais reconnue par le professeur Théodore Monod fondateur de l’IFAN et son assistant le professeur Mauny représentant l’état français avant l’indépendance. Il n’y a donc pas de complot « blanc » contre Gorée…n’est-ce pas ?
Les escrocs de l’Université de Dakar n’ont pas hésité à tourner en ridicule le vrai travail de mémoire allant même jusqu’à cacher depuis plus de vingt ans la vraie captiverie de Gorée encore existante, aux pèlerins antillais, noirs américains et autres. Captiverie dont j’ai révélé l’existence depuis l’année 2006 malgré des menaces physique à mon encontre de la part du pseudo conservateur Eloi Coly.
Vos collègues universitaires corrompus du Gorée Business (malhonnête) refusent de la faire ouvrir car cela leurs ferait perdre le contrôle probablement de la pompe à fric et ils seraient obligé de s’expliquer auprès de leurs nombreux amis noirs aux Antilles et USA à qui ils ont fait prendre une vessie pour une lanterne. Enfin peut être ont ils peur de subir les foudres des fondations et états qui ont donné de l’argent pour « sauver Gorée » porte sans retour de l’esclavage d’où fut parti selon le griot mémoriel Joseph Ndiaye 10, 15, 20 millions de victimes (les chiffres qu’il donnait variés probablement en fonction de la température de l’air ou de la direction du vent)…
Autre faute gravissime fut de laisser Joseph Ndiaye mettre en place un discourt fonctionnel dans la maison d’Anna Colas Pépin (maison des esclaves) dont le seul but fut de tirer des larmes aux antillais et noirs américains pour en obtenir toujours plus de pognons…c’est dégueulasse. Enfin autre faute, laisser Joseph Ndiaye raconter tout et surtout n’importe quoi sur l’histoire patrimoniale de cette maison; dates de constructions fausses, usage du rez-de-chaussé qui n’a jamais été une captiverie transformé en cellules avec la Cerise sur le gâteau « une cellule des récalcitrants » (un gag mémoriel).
Quelle honte pour l’Université de Dakar que d’avoir laissé un ignorant ridiculiser l’Afrique et le travail des historiens noirs qui font leurs boulots correctement; comme Abdoulaye Camara (inspiré tout comme Roger de Benoist par des informations fournis par monsieur Hubert Dupuy) que vous dénigrez dans votre article; tout cela pour enrichir les amis, la famille qui contrôle le Gorée business (malhonnête).
Je ne suis pas contre un Gorée Business, tout comme il y a un Mecque Bussines et un Lourde Business mais encore faut il que ce qui est proposée au bout soit honnête alors au nom des mes amis antillais, noirs américains je vous SOMMES par la présente d’ouvrir immédiatement la vraie captiverie de Gorée et d’indiquer aux touristes les vrais chiffres de déportés !!!!!. Voici le plan de cadastres de Gorée datant du XVIII siècle avec l’indication de la vraie captiverie (il en avait une seconde dans le fort St François qui est rasé de nos jours); essayez svp de rattraper vos erreurs graves en faisant le boulot correctement pour éviter aux négationnistes de ce moquer de nous, les africains. Il faut maintenant déconstruire/reconstruire faisons le ensemble avec la participation désormais indispensable de nos frères et sœurs historiens antillais et américains :
Bien à vous,
Senegal Slave House’s past questioned
GOREE ISLAND, Senegal — Standing in a narrow doorway opening onto the Atlantic Ocean, tour guide Aladji Ndiaye asked a visitor to this Senegalese island’s Slave House to imagine the millions of shackled Africans who stepped through it, forced onto overcrowded ships that would carry them to lives of slavery in the Americas. »After walking through the door, it was bye-bye, Africa, » says Ndiaye, pausing before solemnly pointing to the choppy waters below. « Many would try to escape. Those who did died. It was better we give ourselves to the sharks than be slaves. »
This portal — called the door of no return — is one of the most powerful symbols of the Atlantic slave trade, serving as a backdrop for high-profile visits to Africa by Pope John Paul II, President Clinton and his successor, President Bush, and a destination for thousands of African Americans in search of their roots.
More than 200,000 people travel to this rocky island off the coast of Dakar each year to step inside the dark, dungeonlike holding rooms in the pink stucco Slave House and hear details of how 20 million slaves were chained and fattened for export here. Many visitors are moved to tears.
But whatever its emotional or spiritual power, Goree Island was never a major shipping point for slaves, say historians, who insist no slaves were ever sold at Slave House, no Africans ever stepped through the famous door of no return to waiting ships.
« The whole story is phony, » says Philip Curtin, a retired professor of history at Johns Hopkins University who has written more than two dozen books on Atlantic slave trade and African history.
Although it functioned as a commercial center, Goree Island was never a key departure point for slaves, Curtin says. Most Africans sold into slavery in the Senegal region would have departed from thriving slave depots at the mouths of the Senegal River to the north and the Gambia River to the south, he says.
During about 400 years of the Atlantic slave trade, when an estimated 10 million Africans were taken from Africa, maybe 50,000 slaves — not 20 million as claimed by the Slave House curator — might have spent time on the island, Curtin says.
Even then, they would not have been locked in chains in the Slave House, Curtin says. Built in 1775-1778 by a wealthy merchant, it was one of the most beautiful homes on the island; it would not have been used as a warehouse for slaves other than those who might have been owned by the merchant.
Likewise, Curtin adds, the widely accepted story that the door of no return was the final departure point for millions of slaves is not true. There are too many rocks to allow boats to dock safely, he says.
Curtin’s assessment is widely shared by historians, including Abdoulaye Camara, curator of the Goree Island Historical Museum, which is a 10-minute walk from the Slave House.
The Slave House, says Camara, offers a distorted account of the island’s history, created with tourists in mind.
But when the respected French newspaper Le Monde published an article in 1996 refuting the island’s role in the slave trade, Senegalese authorities were furious. Several years ago at an academic conference in Senegal, some Senegalese accused Curtin of « stealing their history, » he says.
No one is quite sure where the Slave House got its name, but both Camara and Curtin credit Boubacar Joseph Ndiaye, the Slave House’s curator since the early 1960s, with promoting it as a tourist attraction.
Ndiaye is famous in Senegal for offering thousands of visitors chilling details of the squalid conditions of the slaves’ holding cells, the chains used to shackle them and their final walk through the door of no return.
« Joseph Ndiaye offers a strong, powerful, sentimental history. I am a historian. I am not allowed to be sentimental, » Camara says.
That said, Camara believes Ndiaye has played an important role in offering the descendants of slaves an emotional shrine to commemorate the sacrifices of their ancestors.
« The slaves did not pour through that door. The door is a symbol. The history and memory needs to have a strong symbol, » Camara says. « You either accept it or you don’t accept it. It’s difficult to interpret a symbol. »
Some tour books have begun warning visitors about the questions surrounding the island, including Lonely Planet’s West Africa guidebook, which concludes: « Goree’s fabricated history boils down to an emotional manipulation by government officials and tour companies of people who come here as part of a genuine search for cultural roots. »
None of the controversy appears to have diminished the island’s attraction as a tourist destination. The ferry that carries visitors from Dakar to the island is regularly packed with tourists and school groups.
At the Slave House, the visitors’ book is crowded with entries by tourists expressing a powerful mix of anger, sadness and hope at what they’ve experienced — no matter if it is fact or fiction.
« The black Africans will never forget this shameful act until kingdom come, » penned a visitor from Ghana.
Voir aussi:
Obama, speaking to reporters after the rare moment of solemnity, said it had been « very powerful » for him to see the world-famous site, which helped him “fully appreciate the magnitude of the slave trade” and “get a sense in an intimate way” of the hardships slaves faced. He called the trip a reminder that « we have to remain vigilant when it comes to the defense of human rights. »
« This is a testament to when we’re not vigilant in defense of human rights, what can happen, » he said. « Obviously, for an African American, an African American president, to be able to visit this site, gives me even greater motivation in terms of human rights around the world. »
The door was the point out of which many, perhaps millions, of African slaves took the final step from their home continent and onto the slave ships that would bring them to the new world, if they even survived the journey. Or that’s the story according to Goree Island official history, anyway. The truth may actually be far more complicated.
No one doubts the vast scale or horrific consequences of the trans-Atlantic slave trade, which destroyed countless communities in Africa, tore families apart, forced millions into bondage and killed perhaps one in 10 just during their voyage across the ocean. But it turns out that Senegal’s famous Door of No Return might not actually have played a very significant role in that story. And the wide gulf between the myth of the door and its reality may actually be, in itself, a revealing symbol of our relationship to this dark chapter in world history. What Obama really saw at Goree Island’s famous, pink-walled building may not have been a monument to slavery’s history so much as its haunting legacy and ineffable memory.
If you ask the stewards of this museum on Goree Island what happened there, they’ll likely refer you to the plaques on the wall, which say that millions of slaves passed through the building that Obama visited Thursday, now called the House of Slaves. That’s been the story for years. In 1978, the United Nations cultural body formally named it as a world heritage site, explaining that « From the 15th to the 19th century, it was the largest slave-trading centre on the African coast. » When Nelson Mandela visited in 1991, a tour guide told him that a hole beneath some stairs had been used as a cruel holding cell for disobedient slaves; Mandela insisted on crawling inside. It was also visited by Pope John Paul II, Presidents Bill Clinton and George W. Bush and many African heads of state.
But if you ask Africa scholars, they’ll tell you a very different story. « There are literally no historians who believe the Slave House is what they’re claiming it to be, or that believe Goree was statistically significant in terms of the slave trade, » Ralph Austen, who as a professor emeritus at the University of Chicago has written several academic articles on the subject, told the Associated Press.
Historical studies, according to Austen and other academics who spoke to the AP, suggest that 33,000 slaves were transferred from Goree Island – a huge number to be sure, but a tiny fraction of what the island’s official history claims. And, of those, perhaps zero were moved from the House of Slaves or out of its Door of No Return. « Historians say the door faced the ocean so that the inhabitants of the house could chuck their garbage into the water, » the AP says. « No slaves ever boarded a ship through it. » The historian Ana Lucia Araujo told the news agency, « It’s not a real place from where real people left in the numbers they say.”
Historians first uncovered the apparent truth about Goree in the 1990s. But almost 20 years later, the site’s emotional power is still strong – as is its prominent place in a history that it actually had very little to do with. But that might be about something much bigger than just the persistence of myth or the challenge in overturning a too-good-to-be-true story.
As academics downplayed the historical role of Goree in past centuries, a very different kind of scholar began to study its significance today, for Africans and members of the African diaspora. Katharina Schramm, in a book on the role of history in African ideologies today, called the Door of No Return a symbol of « the cultural amnesia and sense of disconnection that slavery and the Middle Passage stand for. » The door, she wrote, has become increasingly associated not just with its largely fictional past but with its very real present as a place of historical « healing and closure, » sometimes now described as a « Door of Return » out of slavery’s shadow.
Dionne Brand, a Canadian poet and novelist who often writes about race, explored the symbolic power of Goree’s sites at length in a 2002 book on identity and history, « A Map to the Door of No Return: Notes to Belonging. » She wrote that the door, whatever its role in past centuries, is today « a place to return to, a way of being » for people, like her, struggling to confront the role of slavery in her family’s past. Dionne writes, in a passage that might have resonated with Obama as he looked through the door and over the Atlantic:
The door signifies the historical moment which colours all moments in the Diaspora. It accounts for the ways we observe and are observed as people, whether it’s through the lens of social injustice or the lens of human accomplishments. The door exists as an absence. A thing in fact which we do not know about, a place we do not know. Yet it exists as the ground we walk. Every gesture our bodies make somehow gestures toward this door. What interest me primarily is probing the Door of No Return as consciousness. The door casts a haunting spell on personal and collective consciousness in the Diaspora. Black experience in any modern city or town in the Americas is a haunting. One enters a room and history follows; one enters a room and history precedes. History is already seated in the chair in the empty room when one arrives. Where one stands in a society seems always related to this historical experience. Where one can be observed is relative to that history. All human efforts seem to emanate from this door.
Historians, since realizing the banal truth of Goree Island in the 1990s, have been struggling with how, or whether, to reconcile their accounting with the island’s power today, how to square what actually happened at this house in Senegal with the Door of No Return as it is today felt and perceived by visitors from Nelson Mandela to Obama. If no slaves ever actually stepped through the door, can it still be a symbol of the slave trade, which did in fact reshape entire continents? Of slavery’s still-unfolding legacy? At what point does the symbolism overshadow the reality?
In 1995, as an early iteration of this still-going debate raged on an e-mail listserv for Africa scholars, the scholar John Saillant, then of Brown University, argued that Goree could still matter, even if it turned out that millions of slaves hadn’t really moved through it. « We can understand Goree as important & interesting without extravagant claims about numbers, » he wrote.
La Traite négrière, un lourd héritage
—
Demain, la Journée nationale de commémoration de l’abolition de l’esclavage ne sera toujours pas célébrée de façon unitaire à Nantes. Une trentaine de comédiens enchaînés et en haillons ont en effet pris part, dès hier, à une « Marche des esclaves » dans les rues de la ville, qui a fait sa fortune au XVIIIe siècle sur le « commerce triangulaire ». Ils étaient encadrés par deux négriers européens, qui criaient « Avancez, bande de nègres ! » entre deux coups de fouet et de bâton.
« Indécent » pour Octave Cestor
« C’est avant tout un outil pédagogique, pour répondre à la non-visibilité de la traite négrière dans les manuels scolaires », explique André-Joseph Gélie, qui a initié l’événement en 2006. « Nous vivons dans un monde d’images, et cette Marche permet de symboliser l’esclavage. » Hier, les « esclaves » ont ainsi marqué l’arrêt devant l’Hôtel de ville… où l’initiative est jugée « indécente ». « C’est comme si on demandait aux Juifs de théâtraliser leur marche vers les fours crématoires », s’emporte Octave Cestor, conseiller municipal en charge des « relations entre Nantes, l’Afrique et les Caraïbes ». « Nous sommes, en plus, dans une ville qui assume son passé… Ces personnes devraient avoir le courage d’aller à Bordeaux, La Rochelle ou Saint-Malo. Ces villesne font rien alors qu’elles ont, elles aussi, un passé négrier. »
Voir de même:
Danièle Obono, une « décolonialiste » au sein de l’université française ?
FIGAROVOX/TRIBUNE – Guilhem Carayon s’inquiète de la nomination de Danièle Obono à la Sorbonne. Il y voit une offensive du parti indigéniste à l’Université et craint que les thèses racialistes ne se développent au sein de l’enseignement supérieur.
Cette tribune est écrite par Guilhem Carayon, responsable de l’UNI Paris 1 Panthéon Sorbonne.
Elle est cosignée par Olivier Vial, président de l’UNI.
Danièle Obono, député de la France Insoumise, proche du «Parti des indigènes de la République» (PIR) vient d’être nommée au sein du Conseil d’administration de l’UFR de Science politique de l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Cette instance fixe au quotidien les orientations des enseignements et des recherches proposés aux étudiants.
Depuis plusieurs années, les activistes en tous «genres» tentent d’infiltrer l’Université afin de poser un vernis «scientifique» sur leurs engagements les plus radicaux. Les militants du genre furent les pionniers. Et désormais, les études de genre prospèrent et se répandent d’amphithéâtres en amphithéâtres. L’université a ainsi servi de caisse de résonance aux adeptes de l’écriture inclusive, aux avocats de la fluidité des genres et des toilettes neutres …
Avec Danièle Obono, c’est une autre idéologie qui fait de l’entrisme. Une idéologie aux antipodes de notre tradition humaniste. La député de Paris s’est, en effet, faite l’avocate des thèses «décolonialistes» prônées par le Parti des indigènes de la République.
Ce groupuscule extrémiste avait publié en 2016 des messages de soutien aux organisateurs d’un attentat contre des civils à Tel Aviv! «L’Antisionisme», revendiqué par sa porte-parole Houria Bouteldja dissimule mal un réel antisémitisme. Selon elle, «les juifs sont les boucliers, les tirailleurs de la politique impérialiste française et de sa politique islamophobe». Sic!
A l’occasion des 10 ans des Indigènes de la République, Danièle Obono avait encensé le parti indigéniste, qualifiant même le discours de sa porte-parole Houria Bouteldja de «très beau et très juste». En réalité, l’idéologie que Danièle Obono défend, repose sur des fondements racialistes. Elle va jusqu’à prôner la non-mixité raciale et sexuelle (!) dans les réunions politiques ou syndicales, en somme un apartheid inversé. Ce genre d’inepties tend malheureusement à se développer, comme ce fut le cas durant le blocus de Tolbiac, les étudiants avaient déjà pris l’initiative d’organiser des Assemblées Générales interdites aux hommes blancs. Re-Sic!
Elle s’est également «distinguée» dans son soutien à un texte de Rap dont les paroles font froid dans le dos: «Nique la France, et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes, (…) ton pays est puant, raciste et assassin». (*) Doit-on s’attendre à ce que ce genre de colique verbale soit désormais au programme de l’UFR?
Alors, comment a-t-on pu intégrer Danièle Obono dans un conseil qui détermine les orientations de l’enseignement des Science politique dans l’université symbole des libertés intellectuelles depuis le Moyen-Âge? Comment peut-on avoir choisi une personnalité aussi radicale, discréditant par ses engagements anti-humanistes l’image et le prestige de La Sorbonne?
L’argent public qui finance la recherche publique doit-il servir à diffuser une propagande «bolcho-trotsko-marxiste» comme se définit Danièle Obono, ou pire à soutenir l’offensive des «décolonialistes».
En réalité, cette nomination n’entache pas seulement l’image de l’UFR de Science politique. Demain, ce seront l’ensemble des diplômes et des recherches de l’Université Paris 1 qui seront suspects. Nous demandons donc au Président de Paris 1 et au conseil d’administration de l’université de dénoncer cette nomination ;
Sinon, le risque c’est de voir l’université Française devenir le cheval de Troie de tous les courants nés au sein de la gauche radicale américaine la plus folle.
(*) Nique la France, Zone d’expression populaire, 2009
Voir encore:
Comment le réseau indigéniste tisse sa toile
ENQUÊTE – L’affaire Floyd est une opportunité pour les militants indigénistes et communautaristes qui se sont emparés ces dernières semaines de cette émotion légitime pour porter leurs revendications et imbiber un peu plus la société de leur doctrine.
Le calvaire de George Floyd, cet Afro-Américain agonisant durant huit minutes et quarante-six secondes sous le genou d’un policier blanc, a ébranlé le monde entier et suscité une vague d’indignation sans précédent. Son martyre a traversé l’Océan pour importer dans l’Hexagone une problématique que certains voudraient similaire en comparant cette dramatique affaire de Minneapolis avec celle d’Adama Traoré, ce jeune homme de 24 ans, originaire du quartier de Boyenval, à Beaumont-sur-Oise, et mort en juillet 2016 après son interpellation par les gendarmes.
Depuis quatre ans, le comité La Vérité pour Adama, par la voix d’Assa Traoré, sa sœur, n’a de cesse de désigner les gendarmes comme racistes et responsables de la mort du jeune homme. Devenu porte-drapeau de la mobilisation contre les violences policières, le comité a organisé des manifestations à Paris les 2 et 13 juin derniers et veut se faire l’écho en France du mouvement américain Black Lives Matter.
Des revendications disparates
Pour Sami Biasoni, coauteur avec Anne-Sophie Nogaret de l’ouvrage Français malgré eux, publié aux Éditions de l’Artilleur, la comparaison du cas d’Adama Traoré avec celui de George Floyd s’apparenterait plutôt à une stratégie opportuniste pour porter en réalité d’autres revendications: «L’affaire Floyd est tombée au bon moment pour les membres du comité La Vérité pour Adama. Elle leur a permis d’accomplir un véritable coup de force médiatique, en réunissant à Paris près de 15.000 personnes portant des revendications très disparates passant de l’antiracisme au militantisme contre les violences policières. Cela démontre aussi une véritable faiblesse de notre société et la remise en cause de l’unité nationale après les nombreuses manifestations des néoféministes, des environnementalistes, des “gilets jaunes”, etc. Il faut, insiste l’auteur, noter également l’influence des thèses défendues par les activistes indigénistes derrière le comité La Vérité pour Adama.»
Ce mouvement indigéniste auquel fait référence Sami Biasoni est actif sur le terrain des manifestations (aux côtés notamment d’organisations comme la très sulfureuse Ligue de défense noire africaine). Né en 2005, il s’appuie sur une littérature universitaire issue de Michel Foucault, Pierre Bourdieu ou l’ethnopsychiatrie. Les Indigènes de la République n’ont de cesse, depuis leur création, de dénoncer la France comme un État dont le racisme serait institutionnalisé. Cette pensée est théorisée par des personnalités comme le sociologue Saïd Bouamama ou Houria Bouteldja. Cette dernière s’est distinguée lors d’une allocution publique en affirmant au micro «Mohammed Merah, c’est moi», exprimant ainsi sa compassion pour le terroriste dont la folie haineuse avait fait sept morts, dont trois enfants, et six blessés lors des tueries de Toulouse et Montauban en 2012.
Actifs dans les banlieues
«Ces gens jargonnent beaucoup et se prennent pour des intellectuels, déplore Anne-Sophie Nogaret, l’autre auteur de Français malgré eux. Pour eux, la France est toujours coloniale. Ils considèrent que les Arabes et les Noirs sont encore aujourd’hui des indigènes et ne répondent pas aux mêmes droits que les autres citoyens. Ce groupuscule a étendu son réseau d’influence dans les banlieues grâce au relais des mairies, surtout communistes et d’extrême gauche, en infiltrant les sphères du pouvoir grâce aux facultés et à la sympathie des universitaires, puis dans les médias qui reprennent aujourd’hui ses éléments de langage comme les mots “racisé” ou “privilège blanc”. Ils sont très actifs et visibles sur le terrain médiatique à travers, notamment, le comité La Vérité pour Adama. C’est terrible car ils ont pour objectif de détruire ce pays, colonial à leurs yeux, que représente la République.»
Rachida Hamdan est connue pour sa bonne humeur contagieuse et son sourire indéboulonnable. Depuis le local de son association, elle veut dire aujourd’hui sa colère contre la famille Traoré et son comité. Une indignation exprimée sans filtre sur les réseaux sociaux, mais aussi auprès des jeunes dans ces quartiers qu’elle connaît bien à Saint-Denis. La présidente de l’association dyonisienne Les Résilientes, qui se veut universaliste et laïque, crie au mensonge. «Adama Traoré n’est pas la victime du racisme et d’un contrôle d’identité au faciès, martèle Rachida Hamdan. Il a été arrêté par des gendarmes, dont deux étaient noirs, dans le cadre d’une affaire de délinquance et non pas en raison de sa couleur de peau. Je ne veux pas nier l’existence du racisme, mais il n’est pas l’apanage de la police, ni celui des Blancs. Ce genre de théorie crée du séparatisme et nuit à l’unité du pays. Si j’étais blanche, je serais hors de moi en entendant que je suis forcément une privilégiée, raciste et nantie. Par ailleurs, je refuse de marcher dans les rues de Paris pour défendre un délinquant accusé de viol sur un jeune codétenu. Prendre la famille Traoré comme modèle est une insulte faite aux Noirs.»
Une théorie identitaire
Cette militante féministe insiste pour souligner la polygamie du père, d’origine malienne, de cette famille de 10 enfants.«Il avait deux épouses, s’étrangle-t-elle. La polygamie est illégale dans notre pays et je considère cette pratique comme de la maltraitance pour les gamins qui la subissent. La très nombreuse fratrie Traoré a un casier judiciaire très chargé et ne donne rien d’autre qu’une image déplorable des jeunes de quartier.»
Rachida Hamdan, activiste infatigable de la cause des femmes et de la défense des valeurs républicaines, est très souvent attaquée par les islamistes ou les indigénistes qu’elle connaît trop bien dans la ville de Saint-Denis. Elle en est convaincue, le comité La Vérité pour Adama est aujourd’hui piloté par cette nébuleuse d’activistes «racialistes».Selon elle, la lutte contre les violences policières n’est pour ces militants qu’un écran de fumée. Elle relève notamment l’omniprésence de Youcef Brakni, porte-parole du comité. L’homme est aussi l’organisateur du Printemps des quartiers en 2012. Cet événement majeur de la cause réunissait à Bagnolet, en Seine-Saint-Denis, les personnalités les plus influentes de la sphère indigéniste.
«Quels sont leurs projets? s’interroge la militante. Je ne peux pas répondre, mais je suis sûre d’une chose: ces gens ne sont pas dans une démarche constructive mais à l’inverse guerrière et vengeresse pour mettre le chaos dans le pays. Ce n’est pas ce que je veux pour notre jeunesse.» Le nom de Youcef Brakni, ancien membre du Mouvement islamique de libération et farouche opposant à l’IVG, revient aussi dans la bouche de cette universitaire chercheuse qui veut rester anonyme et connaît bien le mouvement indigéniste ; elle décrit à travers ce personnage «un indigénisme avec l’islamisme en embuscade». «Youcef Brakni pilote la tête d’Assa Traoré, affirme-t-elle. Les indigénistes ont compris que le comité La Vérité pour Adama est le report politiquement correct de leurs idées identitaires et racistes. Ces idées progressent et ils tissent leur toile grâce au réseau d’influence de l’intelligentsia et à la passerelle construite avec une bourgeoisie gauchiste qui aime à s’encanailler avec le lumpenprolétariat des cités sans n’y avoir jamais mis les pieds. Ces gens rêvent de révolution en mangeant des petits-fours et se fichent bien en réalité de la condition des Noirs et des Arabes dans les banlieues. Nous sortons juste de trois mois de confinement pour raisons sanitaires et, grâce à eux, on ne parle que de racisme alors que la crise économique est devant nous et que tout ceci ne fait que l’aggraver.»
Reconnaissance des minorités
«Dénationaliser l’histoire de France», cette autre idée défendue par les indigénistes signifie-t-elle que ces militants ambitionnent de repenser le récit national ou de remettre en cause l’héritage de grandes figures historiques? La multiplication des actes de vandalisme sur les statues de Victor Schœlcher et de Charles de Gaulle qualifiés de racistes interroge.
Guylain Chevrier, docteur en histoire et enseignant, s’insurge contre ces phénomènes. «Le projet de ces activistes vise à remplacer l’égalité républicaine par la reconnaissance juridique des minorités. Ils veulent une photo figée de l’Histoire au nom de la diversité qui serait leur seule réalité. Ils sont en conflit avec une pensée rationnelle. L’homme se développe par l’expérience qui a permis son émancipation. C’est ainsi que la République a dépassé la contradiction du colonialisme grâce à ses valeurs et en apportant à chacun les mêmes droits sans distinction. Ces gens refusent cette pensée du progrès, c’est la raison pour laquelle ils cassent tout.»
On aurait donc mal compris le texte de Valeurs actuelles sur Danièle Obono. «Ce n’est pas un texte raciste», a tenté de plaider, en réponse à la condamnation unanime de son dernier fait de gloire journalistique, le directeur du magazine d’extrême droite, Geoffroy Lejeune. On aurait manqué, nous autres ignares, de perspicacité, de hauteur de vue, de connaissance de l’histoire.
Texte anonyme
Car il se serait seulement agi de rappeler que l’esclavage avait bénéficié de complicités de trafiquants africains – une vieille coutume de l’extrême droite est de minorer la responsabilité des Occidentaux dans l’affaire en mettant en avant celle de certains Noirs. Si cet infâme article imaginant la députée de La France insoumise dans un village tchadien du XVIIIe siècle donne la nausée, ce ne serait pas parce qu’il est bêtement à vomir, mais parce que l’esclavage est une horreur, dont Valeurs aurait tenu à nous rappeler l’affreuse réalité. Rien à voir, donc, avec les préjugés ou les obsessions du magazine, a affirmé Geoffroy Lejeune, qu’on a pourtant senti plus péteux que jamais à la télévision ce week-end.
Publier un texte anonyme sur une femme noire contenant des phrases comme «Danièle fut échangée avec des Toubous prévenus par un tam-tam» ou «elle était pour sa part heureuse d’être trop âgée pour subir ce douloureux écartèlement des lèvres permettant d’y glisser ces plateaux de bois qui leur donnaient ce profil qui l’effrayait malgré elle» n’aurait rien de raciste pour le directeur de l’hebdomadaire. C’est raciste, absolument. On imagine le sourire de l’auteur au moment d’écrire ces lignes, ravi d’adresser un clin d’œil complice, bien entendu, à son lecteur… Interrogé par Libé sur l’identité de ce mystérieux rédacteur, nommé «Harpalus», Geoffroy Lejeune répond : «Je ne veux pas le dire car c’est inutile. J’assume la responsabilité dans cette histoire.»
Qui lit Valeurs actuelles de temps à autre sait parfaitement à quoi s’en tenir avec cet ex-magazine conservateur roupillant, qui a dérivé vers la radicalité à partir de 2012, sous la direction d’Yves de Kerdrel (qui a condamné publiquement le texte sur Danièle Obono). Son successeur nommé en 2016, Geoffroy Lejeune, qui rêve d’union des droites par l’extrême et a promu Zemmour «homme de l’année» en «une» début août, a poussé les feux plus loin encore, dans une direction militante, plus convaincue par la cause. Le fait est que le jeune patron de Valeurs, bientôt 32 ans, se sent assez fort pour imprimer des articles aussi répugnants que ce «voyage» de Danièle Obono dans l’Afrique esclavagiste – notons au passage que l’odyssée s’achève par une rédemption trouvée dans un monastère de bénédictines.
Interview d’Emmanuel Macron
Comment l’injustifiable a-t-il été rendu possible? Geoffroy Lejeune ne peut pourtant pas s’appuyer sur un bilan commercial étincelant : la «diffusion payée individuelle» de son journal, propriété de l’industriel Iskandar Safa, est tombée de 114 000 exemplaires en moyenne en 2016 à 76 000 en 2019. Ni sur les succès électoraux des candidats qu’il a soutenus, tel François-Xavier Bellamy, en déroute aux européennes. D’où vient alors l’incroyable assurance de Valeurs ? Nul doute que l’interview «exclusive» accordée par Emmanuel Macron en octobre dernier au magazine a beaucoup contribué à ce processus d’autolégitimation et d’autopersuasion.
Mais c’est aussi l’accueil réservé à cet hebdomadaire pas du tout comme les autres dans les médias audiovisuels qui a joué. Chose impensable il y a dix ans, les journalistes de Valeurs ont envahi les plateaux et studios. La nouvelle garde, composée de Charlotte d’Ornellas, Tugdual Denis, Louis de Raguenel ou Raphaël Stainville, squatte les émissions de débats construites sur la culture du clash, à l’invitation de chaînes très conciliantes. Ex-éditorialiste politique numéro 1 de LCI, Geoffroy Lejeune vient d’être appelé par Cyril Hanouna à la table des chroniqueurs de Balance ton post !. On arrête quand le délire ?
Voir encore:
L’esclavage dans le monde
Selon le Global Slavery Index (Indice mondial de l’esclavage) créé par la Walk Free Foundation en 2013, le nombre de personnes concernées par l’esclavage moderne est estimé à 30 millions. 3 critères sont pris en compte pour ce calcul : l’esclavage, le travail forcé ou le trafic d’être humain. Méconnu, ce « crime caché » concentre 22 des 29,8 millions d’esclaves dans seulement 10 pays (dont 14 millions en Inde).
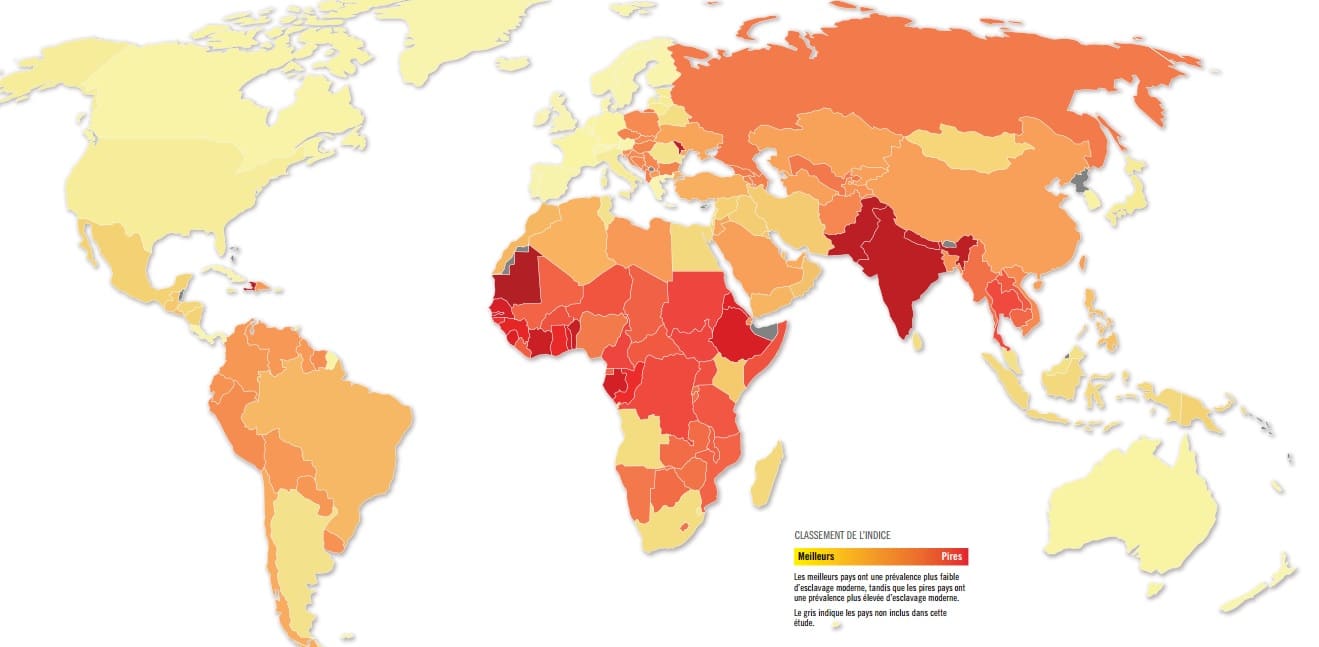 Carte de l’esclavage dans le monde, cliquez dessus pour l’agrandir. Source : Walk Free
Carte de l’esclavage dans le monde, cliquez dessus pour l’agrandir. Source : Walk Free
Jetez un œil aux dix pays où l’esclavage est le plus répandu par nombre d’habitant.
10. Gabon
Le Gabon est à la fois un pays de destination et de transit pour les victimes de l’esclavage moderne. Hommes et femmes de tous âges sont contraints à diverses formes d’esclavage moderne dans ce pays d’Afrique. Les filles sont le plus souvent victimes de la traite à la servitude domestique (ou dans les restaurants et les marchés) ou le travail sexuel alors que les garçons sont victimes de la traite pour le travail manuel. Les mariages d’enfants et mariages forcés sont monnaie courante.
Selon l’UNICEF, l’absence de réglementation sur les travailleurs immigrés clandestins combinée à l’accroissement de la pauvreté, ont provoqué une augmentation massive de la traite des enfants dans tout le pays au cours des 10 dernières années. L’agence estime que 200 000 enfants non accompagnés sont introduits clandestinement au sein de la région pour y travailler chaque année.
9. Gambie
En Gambie, il y a de nombreux cas de mendicité forcée, de servitude domestique et de prostitution, y compris le tourisme pédophile. Les femmes, les filles et les garçons sont victimes de la traite en direction de la Gambie pour l’exploitation sexuelle commerciale. Selon l’UNICEF, près de 60 000 enfants en Gambie sont exposés à cette forme d’esclavage, notamment les orphelins et enfants de la rue.
8. Côte d’Ivoire
Les femmes et enfants asservis en Côte-d’Ivoire sont souvent soumis au travail forcé et à la prostitution. Un grand nombre d’enfants sont forcés à travailler dans les mines, la pêche, l’agriculture, la construction, le travail domestique et à la vente de rue ainsi que le cirage de chaussures.
7. Bénin
Dans ce pays d’Afrique de l’Ouest, les femmes et les enfants impliqués contre leur gré dans le commerce sexuel, le travail domestique et le travail forcé sont les principales victimes de l’esclavage moderne. Le Bénin compte environ 80 000 esclaves… L’Organisation Internationale pour les Migrations (IOM) affirme que plus de la moitié sont des enfants. La plupart travaillent dans les plantations de coton ou de noix de cajou ou comme domestiques dans les maisons.
6. Moldavie
Avec environ 33 000 esclaves, la Moldavie est principalement un pays d’origine pour l’esclavage moderne. Les émigrants moldaves sont asservis dans d’autres pays voisins comme l’Ukraine, la Russie, l’Allemagne, la Biélorussie et ailleurs. Les moldaves ont été victimes de la traite à des fins de prélèvement d’organes.
5. Népal
Au Népal, les pratiques esclavagistes modernes comprennent le travail forcé et la prostitution. On estime que 259 000 Népalais sont asservis, tant à l’intérieur du pays qu’à l’étranger. Une économie paralysée, la corruption endémique et la discrimination ethnique et sexuelle institutionnalisée ont créé des conditions permettant à l’esclavage de prospérer depuis la fin de 10 ans de guerre civile au Népal en 2006.
4. Inde
Bien que l’Inde occupe la quatrième place en terme d’esclaves par habitants, c’est surtout le pays avec le plus grand nombre de personnes réduites à l’esclavage dans le monde. Presque toutes les formes d’esclavage sont répandues, allant de la servitude pour dettes inter-générationnelle au commerce du sexe, du travail des enfants au mariage forcé… Avec environ 13,9 millions d’esclaves, l’Inde abrite près de la moitié de la population asservie sur terre.
3. Pakistan
L’esclavage moderne au Pakistan est principalement caractérisé par la servitude pour dettes. La Banque asiatique de développement estime que 1,8 million de pakistanais sont liés à cette forme d’esclavage, bien que certaines ONG en dénombrent beaucoup plus (jusqu’à 4,5 millions). Beaucoup de Pakistanais migrent vers les pays du Golfe, l’Iran, la Turquie, l’Afrique du Sud et ailleurs à la recherche de travail, où ils sont en proie à des agents de travail sans scrupules qui retiennent leur passeports et ne paient pas leur salaires.
2. Haïti
L’esclavage des enfants est un problème très répandu dans la nation caribéenne d’Haïti. Le pays figure à la deuxième place de ce classement avec près de 209 000 esclaves, dont le problème est alimenté par une forte pauvreté, un manque d’accès aux services sociaux et un système pour le travail des enfants connu sous le nom de restavek, dans lequel les enfants pauvres des zones rurales sont envoyés pour travailler avec les familles des villes.
1. Mauritanie
La Mauritanie se classe à la pire place de ce classement concernant la « prévalence de l’esclavage ». Jusqu’à 20% de la population est considérée comme esclave. La chose la plus horrible est certainement que le statut d’esclave se transmet à travers les générations. En 1981, la Mauritanie avait pourtant abolie l’esclavage…
Voici le classement de l’ONG Free Walk :

En France il y aurait encore 8500 esclaves.
La fabrication du Patrimoine : l’exemple de Gorée (Sénégal)
Hamady Bocoum and Bernard Toulier
Les patrimoines de la traite négrière et de l’esclavage
In situ
20 | 2013
« Celui qui vous dit « Gorée est une île » / Celui-là a menti / Cette île n’est pas une île / Elle est continent de l’esprit » (Jean-Louis Roy, 1999)2(fig. n°1). Cet écrivain et diplomate francophone canadien, imprégné du discours des lieux, oppose la matérialité tangible de ce petit bout de terre établi au large de la presqu’île du Cap-Vert, à la portée symbolique de cette île-mémoire, « expression focale de la traite négrière ».
Nous ne reviendrons pas ici sur l’état des connaissances concernant l’histoire de l’esclavage et de la traite en Sénégambie et à Gorée. Dès les années 1970-80, les premiers travaux de synthèse sont menés par le professeur MBaye Gueye3. En 1997, un article du journal Le Monde mettant en cause la place de Gorée dans la traite atlantique et la fonction de la Maison des Esclaves dans « l’économie symbolique de la mémoire collective » suscite un séminaire sur Gorée et l’esclavage, dirigé par l’Institut Fondamental d’Afrique Noire Cheikh Anta Diop de Dakar4. Cette vive riposte « nationale », relayée par une démarche des historiens africains dans le cadre de la mondialisation en 2001, est supportée depuis 2007 par un programme d’études et de recherches domicilié à l’université de Dakar5.
Nous nous attacherons ici à l’observation de la « fabrique » de ce patrimoine mémoriel, depuis la période coloniale jusqu’à nos jours à travers les discours des différents acteurs, chercheurs et historiens, gestionnaires et conservateurs, hommes d’État et responsables de collectivités ou de communautés, responsables d’organisations non gouvernementales ou journalistes, aux différentes échelles locales, nationales ou internationales, à travers les sources archivistiques ou architecturales et les archives vivantes des mémoires-militantes. Ces observations pluridisciplinaires nécessitent un croisement des moyens d’investigation et d’interprétation des sources à travers divers continents.
Comment le site a-t-il été « inventé » et le « centre historique » protégé, comme témoin de l’esclavage et de son abolition dans le cadre d’une mise en tourisme de l’Afrique Occidentale Française (A.O.F.) ? Comment l’État du Sénégal s’est-il approprié cette « greffe coloniale » sur la construction mémorielle et la gestion du cadre bâti qui est devenu depuis 1978 un site de portée patrimoniale international, avec son inscription sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO6 ?
Depuis quelques décennies, Gorée est au centre d’un véritable pèlerinage célébrant la diaspora des afro-descendants qui impose une surenchère compétitive et aux intérêts divergents de construction de musées, d’édification de mémoriaux et de routes touristiques de l’esclavage pour capter les retombées de ce nouveau tourisme dit « culturel »7. Quelles en sont les conséquences perceptibles sur le patrimoine et la transmission de la mémoire ?
La construction d’un tourisme colonial lié à la mémoire de l’esclavage : 1926-1959
En 1926, le discours colonial exposé dans le Guide du tourisme en Afrique Occidentale Française présente les Français comme des libérateurs et des civilisateurs « [qui] abolirent l’esclavage et rassemblèrent la terre africaine8 ». Le touriste est appelé à découvrir, « sous les préjugés négriers et sous les rêveries humanitaires, le caractère paysan des hommes de la savane9 ».
Au cours des années 1930, l’agence économique de l’Afrique-Occidentale-Française (A-O-F) procède à la mise en valeur touristique des territoires coloniaux et un syndicat d’initiative et de tourisme de l’AOF est installé à Dakar. En 1936, la revue à grand tirage L’Illustration consacre un numéro spécial à « L’œuvre de la France en Afrique occidentale », avec un supplément sur le tourisme. Elle décrit « l’inexprimable et inépuisable attrait » de cette « nature ardente », inquiétante hier, mais accueillante aujourd’hui : « l’AOF est la banlieue tropicale de l’Europe »10. La même année Air-France inaugure une ligne aérienne vers Dakar11.
L’invention de la Maison des Esclaves
Les espaces voûtés de Gorée établis sous les rez-de-chaussée surélevés des habitations, dans des maisons construites dans le dernier quart du XVIIIe siècle ou le premier quart du XIXe siècle sont très tôt considérés comme des « captiveries », des « cabanons à esclaves » ou aussi de simples entrepôts. En 1918, le Père Briault nous donne une aquarelle d’un « ancien cabanon à esclaves » établi dans l’actuel presbytère12. Selon le Guide du tourisme de 1926, une excursion à l’île de Gorée à partir de Dakar s’impose pour « visiter les anciennes « captiveries » où étaient parqués les esclaves en attendant le retour des négriers, venus à Gorée charger le « bois d’ébène »13. Dans un article sur « Gorée la moribonde » paru en 1928, la revue L’Illustration nous présente une reproduction photographique d’une des maisons à cour portant la légende : « au rez-de-chaussée logement des esclaves ; au premier étage, salle à manger du traitant »14. En 1929, le docteur P. Brau décrit les « cachots antiques, longs et étroits, [des maisons de Gorée qui] puent encore la chair esclave torturée… [Ils ont pu ensuite servir d’entrepôts] à d’autres lots de marchandises moins fragiles, mais non moins âprement discutées : les boucauts de lard salé et les tonnelets d’eaux-de-vie…15 ». Dès 1932, dans son guide de visite Gorée, capitale déchue, Robert Gaffiot nous dessine la cour de l’une de ces anciennes « maisons négrières ». Il précise dans la légende du dessin l’usage de cette maison où « les esclaves étaient parqués dans le bas-enclos, à l’obscurité, sous les pièces réservées à l’habitation des trafiquants. Le couloir central dessert, à droite et à gauche, une douzaine de longues et étroites cellules, dans lesquelles les malheureux étaient entassés et, bien souvent, enchaînés. L’autre extrémité du couloir donne sur la mer : le « négrier » avait ainsi toute facilité pour faire disparaître les cadavres de ceux qui ne pouvaient subir jusqu’au bout le supplice de cette vie atroce16 ». Un autre militaire de la marine française, le docteur Pierre-André Cariou, dans son guide non publié Promenade à Gorée, rédigé à partir des années 1940-1943, reprend l’historique et la description de la Maison des Esclaves. Le docteur assombrit encore le tableau dressé dix ans plus tôt par Robert Gaffiot pour l’ancienne maison négrière17. En 1951, l’historien et archéologue de l’Institut Français d’Afrique noire (IFAN) Raymond Mauny18 dénonce, sans en apporter les preuves, les excès de l’interprétation de Gaffiot19 et de Cariou, notamment les considérations sur la fonction de la porte donnant sur la mer, reprenant en partie le témoignage d’un témoin oculaire contemporain, le chevalier de Boufflers, mais qui semblerait plutôt s’appliquer au site de Saint-Louis20.
Le discours pédagogique colonial : musées et monuments historiques
En face de cette Maison dite des esclaves « aux sinistres cellules », l’IFAN complète et redouble le discours pédagogique à l’intention du touriste par l’installation d’un Musée historique de l’Afrique occidentale française, dans une « belle maison de la fin du XVIIIe siècle » édifiée selon Pierre-André Cariou par un [autre] « négrier » dont les cellules du rez-de-chaussée auraient servi, selon le dit docteur de « cachots » aux esclaves. Cette maison, dite de Victoria Albis, est achetée grâce à des crédits votés lors de la célébration du centenaire de l’abolition de l’esclavage (1848) puis réhabilitée et inaugurée le 4 juin 195421. La présentation, œuvre d’Abdoulaye Ly et de Raymond Mauny, repose sur des bases géographiques et historiques, incluant des cartes ethniques et géographiques de l’AOF. L’une des six salles d’exposition est consacrée à l’esclavage et à son abolition, reprenant ainsi l’orthodoxie de la pensée coloniale22.
À l’exemple des sites de la métropole, la promotion touristique est diversifiée, exploitant les ressources de cette « île-mémoire » et de cette « île-musée ». Le circuit de visites mis au point dans les années 1940-1950 est jalonné de deux institutions gérées par l’IFAN : le musée historique et le musée de la Mer (inauguré en 1959, ouvert au public en 1960)23. Gorée est aussi le laboratoire d’essai pour la protection et la restauration des sites et monuments de l’AOF où seront également impliqués les hommes de science, chercheurs et archéologues de l’IFAN, contribuant ainsi à la promotion d’une politique culturelle coloniale.
Le classement de l’île au titre des monuments historiques et des sites
Les dispositions juridiques en vigueur en métropole vont quasi systématiquement être appliquées dans les colonies avec la loi du 31 décembre 1913 relative au classement et à la protection des monuments historiques. Cette initiative sera poursuivie avec notamment le décret du 25 août 1937 portant sur la protection des monuments naturels et des sites de caractère historique, légendaire ou pittoresque des colonies, pays de protectorats et territoires sous mandat relevant du ministère des Colonies24. Le pilotage de l’application de cette loi, régulièrement réajustée, est confié à la Commission supérieure des Monuments historiques et des Arts indigènes qui est représentée à Dakar par un délégué permanent assermenté désigné par le Gouverneur général. Le dispositif colonial connaîtra une ultime retouche avec la loi n° 56.1106 du 3 novembre 1956 dont le Sénégal indépendant s’inspirera, très largement, pour préparer la loi 71-12 du 25 janvier 1971 fixant le régime des monuments historiques et des sites archéologiques.
En 1937, quelques jours seulement après la promulgation de l’arrêté de protection par le gouverneur général de l’AOF, André Villard, archiviste-bibliothécaire du Gouvernement général de l’AOF, saisit l’occasion pour proposer le classement de l’île de Gorée, à l’exception de ses terrains militaires, avec restauration des édifices et espaces spécifiques : « Le jardin, la maison dite des Esclaves, l’église, la maison Boufflers, la maison des Donjons, le quartier de la pointe Nord et la rue Bambara et autres points à désigner […]25 ». Mais avant même l’adoption de la proposition de classement, les maisons de Gorée sont mises à mal lors de la bataille navale de Dakar entre le 23 et le 25 septembre 1940. Entre 1940 et 1952, une première campagne de restauration et de réhabilitation est mise en place par les autorités militaires de la marine, sans doute soucieuses d’effacer rapidement les traces de l’affrontement avec les alliés, et en déficit de logements. Elle touche près de 90 bâtiments. Les réseaux d’approvisionnement en eau et en électricité sont également modernisés26. La proposition d’André Villard est adoptée le 15 novembre 1944, et le classement est étendu à l’île tout entière27.
En 1942, Monod plaide en faveur de la sauvegarde de Gorée qui avait particulièrement souffert des bombardements de 1940 et dont de nombreuses maisons étaient déjà en ruine auparavant28. « On ne saurait en effet envisager de gaieté de cœur la destruction, ou même une mutilation trop poussée d’un ensemble légué par le passé et dont il est notre devoir de conserver au moins les parties les plus typiques ou les plus curieuses, pour l’instruction ou le déduit de nos successeurs qui nous en voudront, à juste titre, si nous ne leur abandonnons qu’une île de Gorée dépouillée de ce qui fait son cachet et définitivement « banalisée »29 ». Pour le pouvoir colonial, l’île de Gorée et ses monuments sont d’abord les témoins d’une présence européenne ancienne et forte qui présentent les mêmes critères « scientifiques » de préservation historiques et archéologiques que les monuments métropolitains. L’argumentaire de sauvegarde de l’île reprend les critères habituels en vigueur en Occident pour la protection « monumentale » ; on notera l’absence d’argumentation en faveur de la fonction « commerciale » de ce comptoir colonial destiné à la traite.
Dès 1948, à l’occasion du centenaire de l’abolition de l’esclavage, Raymond Mauny propose de consacrer un musée spécifique sur l’esclavage à Gorée et de valoriser, selon lui, « l’un des principaux points où s’effectuait la traite sur la côte occidentale d’Afrique. […] Nos descendants regretteront le vandalisme de notre époque de fer qui ne sait pas respecter le passé. Mais au fait qu’attend-t-on pour restaurer, protéger, aménager en musée de Gorée, l’une au moins de ces esclaveries ? Ça parle les vieilles pierres… Il serait bon, parfois de les écouter raconter un passé dont on se réjouit qu’il soit révolu. […] L’AOF est pauvre en sites historiques, ne l’oublions pas : il est d’autant plus nécessaire et urgent de sauvegarder le peu que le passé nous a légué [… et de sauvegarder ces] quelques maisons et pans de murs de basalte qui constituent ses plus anciens titres de noblesse qui disparaissent chaque jour30 ».
Ainsi, le pouvoir colonial a jeté les prémices d’une politique de patrimonialisation basée sur le développement touristique d’un circuit de visites, l’ouverture de musées et la mise en valeur de monuments historiques, sans négliger le caractère marin du site.
Le « conservateur » de la Maison des Esclaves31 : un discours sur la mémoire des lieux (1960-2009)
Après les indépendances, dans la continuité de l’œuvre initiée par le colonisateur, l’État du Sénégal reprend à son compte le discours mémoriel En 1962, le président Léopold Sédar Senghor nomme Boubacar Joseph Ndiaye32, ancien sous-officier de l’armée coloniale française, comme « gardien » de la Maison des Esclaves, régularisant ainsi une situation de fait33. La vigueur du discours de ce guide, sans doute inspiré à l’origine par celui du Docteur Cariou, son charisme et la voix imposante de ce « gardien de la mémoire de la traite négrière », l’ont désigné peu à peu comme une sorte de « musée vivant », connu à l’échelle internationale. Gorée doit en grande partie son statut d’île-mémoire de la Traite atlantique à l’éloquence de Joseph Ndiaye, « conservateur » de la Maison des Esclaves.
En 1978, Joseph Ndiaye exprime l’origine de son engagement. « Je suis revenu des guerres européennes et indochinoises profondément marqué par les choses que j’avais vues là-bas. Je suis devenu un nationaliste… Un nationaliste engagé…34 ». Son récit constitue une re-mémoration de la traite négrière à travers une mise en scène alliant parole, geste et démonstration à l’aide des chaînes en fer reconstituées, avec lesquelles les esclaves étaient attachés. « Ce sanctuaire africain qui est la Maison des Esclaves fut capitale de souffrances et de larmes car des innocents sont morts ici, victimes du temps de la honte. Si ces murs pouvaient parler, ils en diraient long. Heureusement qu’ils se sont tus à jamais ; et moi, je fais parler ces murs35 ». Il poursuit son discours sur une description fonctionnelle des pièces de la maison. Sous le rez-de-chaussée surélevé, les « cellules » abritent les esclaves. « Il y avait parfois dans cette maison 100 à 150 esclaves répartis dans les différentes cellules de 2 m 60 de carré et qui pouvaient contenir chacune 15 à 20 esclaves qui étaient assis dos contre le mur avec des chaînes les maintenant au cou et au bras. Les enfants étaient séparés de leurs parents, les jeunes filles des femmes…36 ».
La fonction de ce discours est significative dans la fabrication d’une mémoire liée à la traite atlantique des esclaves, avec une mise en scène et une représentation imagée de la condition de l’esclave appuyées par des citations, des maximes et des proverbes37. La réception du discours du « conservateur » se perçoit à travers les diverses réactions observées après la visite du musée et consignées dans le livre d’or38. Nombreux sont les guides goréens qui puisent encore une bonne partie de leurs connaissances dans le discours de Joseph Ndiaye. Les réactions observées traduisent des chocs émotionnels qui peuvent déboucher parfois sur des actes spontanés. Le recueillement devant la « porte du voyage sans retour » constitue un acte symbolique qui s’accompagne parfois de rituels, de prières, d’offrandes, de sacrifices, de libations. La signification et la place de l’île dans l’imaginaire de la diaspora noire permettent de mesurer l’impact de cette communauté, en quête d’une identité perdue, dans la cristallisation d’une mémoire de la traite atlantique autour de Gorée.
Les critiques du discours « mémoriel » T1
Des contestations naissent sur l’exactitude historique du récit propagé aux visiteurs de la Maison des Esclaves. Dès 1972, le philosophe et chercheur africain Ki-Zerbo, dans son ouvrage « Histoire d’Afrique Noire », s’inquiète de la tournure que peut prendre la défense d’un tel récit qui peut constituer un point de rupture dans la diaspora noire entre l’Afrique et le monde afro des Caraïbes et des Amériques39. Deux décennies plus tard, la principale critique émane de deux chercheurs et conservateurs de l’IFAN, Abdoulaye Camara et le père jésuite Joseph Roger de Benoist. Leurs argumentaires sont repris par le journaliste Emmanuel de Roux dans un article paru à Paris dans le journal Le Monde du 27 décembre 1996 sous le titre « Le mythe de la Maison des esclaves qui résiste à la réalité ». L’article remet en cause la fonction de la Maison des Esclaves ainsi que le rôle de l’île de Gorée dans le commerce des esclaves. Le journaliste relate la visite du lieu par son « conservateur » Joseph Ndiaye. « Ce dernier raconte avec émotion l’histoire de cette esclaverie construite par les Hollandais au XVIIIe siècle, pivot de la traite à Gorée qui vit défiler des centaines de millions d’Africains, enchaînés, vers le Nouveau Monde40 ». Contrairement aux affirmations de Joseph Ndiaye, Emmanuel de Roux donne la paternité de la maison aux Français, nie l’existence des cellules qui étaient réservées aux esclaves en attente d’embarcation et minimise le nombre d’esclaves ayant transité sur l’île. En conclusion, l’histoire de cette maison présentée par le conservateur ne serait qu’une légende reprise par Joseph Ndiaye, « qui a mis une douzaine d’années à forger un mythe qui, aujourd’hui, a force de loi41 ». La réaction de l’État est vive et rapide. Les 7 et 8 avril 1997, un séminaire réunissant l’ensemble des spécialistes sénégalais et africanistes sur le thème : « Gorée dans la traite atlantique : mythes et réalités » est convoqué dans l’urgence pour riposter à l’imposture42.
Dix ans après cette attaque « révisionniste », en 2006, le récit du « conservateur » de la Maison des Esclaves est encore contesté par les descendants de certaines signares qui tiennent un autre discours mémoriel et prônent une autre histoire. Dans son ouvrage, Céleste ou le temps des signares, Jean-Luc Angrand nie l’existence d’esclaveries dans les maisons de Gorée : « Il est évident que cette maison comme les autres maisons de Gorée n’ont jamais contenu d’esclaves de traite, les signares étant en général réfractaires à la déportation des esclaves aux Amériques. Les seuls captifs qui existaient dans les maisons de Gorée étaient les captifs de case (domestiques). […] L’idée pathétique de porte par laquelle seraient passés des esclaves embarquant pour l’Amérique n’était rien qu’une histoire destinée à impressionner les touristes de la fin du XXe siècle43 ». Cette vision de la fonction des supports mémoriels ne prend pas en compte la vraie nature du discours commémoratif car comme l’ont bien montré en 1997 Ibrahima Thioub et Hamady Bocoum « Le discours qui commémore cette fonction de l’île n’a jamais prétendu obéir aux règles universitaires de production du savoir et, en conséquence, ne peut être mesuré à cette aune44 ».
En 2009, dans sa récente étude sur la déconstruction du syndrome de Gorée, Ibrahima Seck montre comment l’existence de supports matériels contribue à la cristallisation des mémoires dans certains lieux, témoins de cette période. L’idée d’une « porte du voyage sans retour » n’existe pas seulement à Gorée mais aussi dans les différents points d’embarquement des navires négriers sur la côte occidentale de l’Afrique. « Au Ghana, Elmina a aussi sa porte du non retour alors qu’il s’agit en réalité d’une meurtrière. À Ouidah, où la traite ne s’est pas accompagnée de l’impressionnante monumentalité visible sur l’ancienne Côte de l’or, le programme de la Route de l’esclave de l’UNESCO a érigé un monument sous la forme d’un énorme portail face à la mer pour donner un support matériel au symbolisme du voyage sans retour45 ». Il est clair que Gorée a influencé les autres sites qui ont entrepris un travail de remémoration tel qu’il est recommandé par l’UNESCO depuis 1995.
Cette vision romantique de Joseph Ndiaye est transmise par des méta-récits nationalistes ou pan-africanistes dont la réalité est caricaturée d’une manière manichéenne46. Ce discours laisse peu de place à une « histoire » plus complexe, « archéologique », des Africains libres, aux esclaves de case ou aux esclaves domestiques ou aux captifs face aux Africains enchaînés, aux esclaves de traite ou de transit, aux signares et aux métis et à celles des Européens expatriés, des commerçants aux militaires47.
Gorée, entre le discours sur la négritude et le tourisme de mémoire
L’indépendance une fois acquise, le premier président Léopold Sédar Senghor développe avec le mouvement de la Négritude une orientation culturaliste pour la société sénégalaise, sans rompre avec la francophonie qu’il inscrit dans l’héritage historique du Sénégal et apporte une nouvelle lecture sur la place de Gorée par rapport à la diaspora noire. À partir des années 1980, et pendant deux décennies, le président Abdou Diouf suit la politique de sauvegarde et de mise en valeur de Gorée mise en place par l’UNESCO et veut étendre le message de l’île-mémoire au monde entier par l’érection d’un grand mémorial de l’esclavage. Durant la dernière décennie de la présidence d’Abdoulaye Wade, l’État est moins présent sur le site de Gorée ; il est occupé à élever à Dakar d’autres infrastructures dont un monument de la Renaissance africaine et un parc culturel dans lequel sera édifié un musée des Civilisations noires, idée émise en 1971 par le président Senghor48.
Le passé de l’île de Gorée et le souvenir des souffrances et des traumatismes subis par l’Afrique et ses diasporas à travers l’esclavage et la traite atlantique, revisité, joue un rôle de premier plan dans l’affirmation de la politique dite « d’enracinement et d’ouverture » chère au président Léopold Sédar Senghor49. Le concept de Négritude s’impose comme idéologie du nouvel État indépendant sénégalais qui s’ouvre sur le monde afro-américain. Le président du nouvel État du Sénégal, Léopold Sédar Senghor choisit l’île de Gorée comme un des supports physiques de démonstration de son concept sur la Négritude, sans lien direct avec l’esclavage.
En 1966, le président Léopold Sédar Senghor50 exprime sa vision culturelle et politique dans l’organisation, à Dakar, du premier Festival mondial des arts nègres projeté lors des congrès des artistes et écrivains noirs de Paris (1956) et de Rome (1959)51. « Le premier festival mondial des arts nègres a très précisément pour objet de manifester, avec les richesses de l’art nègre traditionnel, la participation de la Négritude à la Civilisation de l’Universel52 » (fig. n°6). Gorée est un laboratoire idéal pour le projet post-colonial de la Négritude. Lieu d’échanges culturels, artistiques, littéraires et scientifiques regroupant l’Afrique et sa Diaspora, le Festival est le lieu de rencontres, colloques, expositions, chants, danses, spectacles qui rythment la vie quotidienne des populations de Dakar et de Gorée53. Le lancement du Festival a lieu en présence d’André Malraux54.
Le choix de Gorée pour abriter une des manifestations de ce Festival répond à une volonté du pouvoir politique qui entend faire de l’île un lieu privilégié pour une communion des peuples du monde à travers le dialogue des cultures. Un spectacle « son et lumière », les « Féeries de Gorée » est monté pour l’occasion : il retrace les grands moments de l’histoire du Sénégal et particulièrement de l’île de Gorée et de son rôle dans l’histoire de l’esclavage55. La Maison des Esclaves est restaurée à l’occasion de ce festival.
Les années suivant cette première rencontre mondiale des arts nègres sont marquées par un afflux de touristes afro-américains au Sénégal. À l’heure où le tourisme de mémoire émerge autour des lieux chargés d’histoire et notamment à ceux liés à des faits tragiques, le Sénégal concentre ce type de démarche presque exclusivement sur la commémoration de l’esclavage et l’île de Gorée56. Des agences américaines proposent aux touristes noirs américains des « Black-History Tours », leur permettant d’aller se recueillir sur la terre de leurs ancêtres, plus particulièrement à Gorée, et de méditer sur leur tragique destin. « Ainsi, après avoir été, entre l’Afrique et les Amériques noires, le trait d’union symbolique de la désolation, Gorée devient-elle peu à peu un symbole d’espoir, vers où, de plus en plus nombreux, convergent aujourd’hui, en une sorte de pèlerinage, les descendants des déportés de jadis, en quête de leurs racines et tous ceux qui entendent puiser dans son histoire les raisons d’une nouvelle solidarité des peuples57 ».
Depuis 2005, la mairie de Gorée organise un festival dans le cadre de la promotion des activités culturelles : le Gorée Diaspora Festival. Cette manifestation internationale constitue un moment de retrouvailles entre la population goréenne et la diaspora58. À travers cette manifestation, l’institution municipale vise trois objectifs majeurs : permettre aux membres de la diaspora de retrouver l’identité perdue sur cette île-souvenir, les faire participer à la sauvegarde de la mémoire et orienter le devenir de Gorée d’un statut de terre d’esclaves vers celle d’un carrefour de dialogue interculturel. En ouvrant ainsi la porte du retour, la commune entend faire rayonner Gorée sur la scène internationale. Cette manifestation constitue un moment de festivités, de recueillement et de souvenir : festivals, rencontres cinématographiques, concerts, expositions, musiques, visite de la Maison des Esclaves, randonnée maritime, etc. Le festival inclut aussi un volet éducatif avec l’organisation de séminaires et d’ateliers de formation, de conférences et de colloques dont les thèmes portent sur l’esclavage, la traite négrière et sa mémoire, le dialogue des peuples et des cultures.
De nouveaux projets d’aménagements touristiques (1968-1970)
En 1968, l’État sénégalais signe avec le groupe « Euretudes » une convention de mission globale d’aménagement touristique de l’île de Gorée. Dans les termes de cette convention, apparaît une volonté manifeste de sauvegarder le caractère authentique de l’île. « S’agissant d’un lieu dont l’histoire comporte une signification profonde pour les populations du Sénégal, la nature des activités et les aménagements susceptibles d’être implantés dans l’île de Gorée devront tenir compte de ce fait et s’inscrire parfaitement dans son cadre particulier59 ». Sous réserve de vérifications, cette étude aurait été confiée à l’architecte Jacques Couelle, qui veut faire de Gorée « l’Acropole du monde noir »60. « Je veux faire de Gorée un véritable bijou […] Ce n’est pas pour rien qu’on m’a nommé l’architecte des îles… Il faut un poète pour une île de rêve. Il faut recréer un univers poétique, suspendu […] recréer une élite de cœur et pas une élite de gens riches, recréer un style et un esprit XVIIIe siècle. Celui qui n’aime pas le passé n’a pas droit au futur. J’accomplis une œuvre de piété. J’agis comme un apôtre, un artiste […] Le projet ne sera exécuté qu’avec l’accord des 800 Goréens ; eux-aussi font partie du décor ». Pour cela, il prévoyait le doublement de la superficie du port, la création d’un plan d’eau sur le Castel, l’importation de milliers d’oiseaux non migrateurs et la reconstitution sur la partie haute de l’île d’un immense village troglodytique. Ce projet n’a heureusement pas été réalisé61.
Cette première mission, à vocation essentiellement touristique, fut rapidement suivie par une autre mission de recensement des principaux sites archéologiques du Sénégal. En partenariat avec l’Unesco et sur la demande des autorités sénégalaises, une mission technique de préservation et de mise en valeur fut organisée sur tout le territoire national. Dans son inventaire sur le patrimoine historique national, Cyr Descamps souligne l’urgence de la protection et de la restauration des sites de Gorée et de Saint-Louis qui regorgent de souvenirs légendaires et historiques devenus aujourd’hui des lieux de pèlerinage. D’après ce chercheur, Gorée « est certainement le lieu le plus chargé d’histoire de toute la côte Ouest-africaine. […]. Toutes les maisons sont de style ancien, une des plus remarquables est la célèbre Maison des esclaves (…)62 ». L’expert recommande de valoriser ce patrimoine tout en respectant son caractère authentique.
Ces différentes initiatives de mise en valeur culturelle et touristique de l’île, associant ou non son passé de lieu de mémoire de l’esclavage, se concentrent essentiellement sur une politique de rénovation et de sauvegarde du patrimoine immobilier, élaborées par l’État du Sénégal en relation avec de nombreux partenaires et par le maintien de multiples musées aux conceptions encore largement héritées de l’époque coloniale et qui posent problème à la Direction du patrimoine culturel et à l’IFAN Ch. A. Diop.
Le rôle de l’UNESCO et le classement au Patrimoine mondial de l’humanité (1978)
L’UNESCO insiste sur la protection et la sauvegarde des patrimoines culturels et naturels qui peuvent être une alternative pour appuyer le décollage économique des jeunes États indépendants. Dès 1976, le Sénégal ratifie la Convention de 1972 sur la protection du patrimoine culturel et naturel de l’UNESCO63. Parallèlement, le gouvernement sénégalais procède au classement parmi les Monuments historiques de l’île de Gorée, s’inspirant des lois de sauvegarde de l’héritage colonial. Ainsi, en novembre 1975, le site est inscrit sur l’Inventaire des monuments historiques du Sénégal (arrêté N° 012771 du 17 novembre 1975), conformément à la loi qui « fixe le régime des monuments historiques et celui des fouilles et découvertes » (loi n°71.12 du 25 janvier 1971, décret d’application n°73.746 du 8 août 1973).
Réunie à Washington du 5 au 8 septembre 1978, la seconde session du Comité du patrimoine mondial chargé de la mise en œuvre de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel et naturel inscrit sur la Liste du patrimoine mondial l’île de Gorée parmi les douze premiers sites. Gorée a été inscrite sur la seule base du critère VI de la convention de 197264. L’inscription de l’île sur la liste du patrimoine mondial de l’humanité est naturellement une reconnaissance du rôle et de la place de Gorée dans l’économie de la Traite atlantique. Cette inscription a été précédée de multiples missions d’experts, français ou belges, envoyés par l’UNESCO à la demande du gouvernement du Sénégal, afin d’élaborer des études préliminaires pour la sauvegarde du patrimoine architectural.
La mission effectuée en 1974 par A. Grégoire porte sur les monuments historiques de l’île de Gorée et de Saint-Louis du Sénégal. Elle s’inscrit dans la suite de l’expertise de Descamps des années 1969-1970. Grégoire dresse l’inventaire des bâtiments historiques, propose des mesures pour la présentation et la réhabilitation du site, ainsi qu’une évaluation globale des coûts65. L’année suivante, une seconde mission réalisée dans le cadre de l’aide aux États-membres pour la préservation et la mise en valeur du patrimoine culturel et naturel est conduite par Jean-Pierre Frapolli et Maurice Clerc et précise l’expertise précédente. Elle dresse un plan directeur de rénovation, avec ses aspects juridiques et financiers, en vue des projets de développement touristique que la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD) envisage de financer au Sénégal66. En 1977, une troisième mission menée par Michel Parent nuance notamment les conclusions de l’expertise précédente avec des mises en garde sur le développement excessif des équipements touristiques suscitées par l’arrivée de la BIRD67. L’année suivante, une quatrième mission menée par Pierre-André Lablaude inclut la réhabilitation du site historique de Gorée dans un large projet touristique de l’ensemble de la Petite Côte68.
En novembre 1978, lors de la 20e session de la Conférence générale de l’UNESCO, le directeur général est autorisé à entreprendre, en collaboration avec le gouvernement sénégalais, les études techniques nécessaires pour mettre au point un plan d’action détaillé concernant la protection, la préservation, la restauration et la mise en valeur du patrimoine architectural de l’île et pour définir les modalités de sa promotion sous la forme d’une campagne internationale. Il prévoit la sauvegarde de tous les aspects du patrimoine architectural présentant un intérêt historique ou artistique, ainsi qu’une animation culturelle ayant pour objet de les mettre en valeur. À partir de 1979, un comité de sauvegarde veille officiellement au respect de la convention (conformité des ouvrages de réhabilitation, sécurité du bien, etc.).
Toutes ces études et démarches préalables conduisent à l’élaboration d’un Plan d’Action pour la Sauvegarde du patrimoine architectural de Gorée, présenté par l’UNESCO et approuvé en Conseil des Ministres du gouvernement sénégalais le 4 décembre 198069. Ce plan prévoit notamment la création [non réalisée] d’un « musée sur la Traite et un centre d’archivage et d’étude sur les Noirs dans le monde » à la maison Cinquèz (à l’angle de la rue de la Pointe et de la rue Dakar, vers le fort d’Estrée), ainsi que le développement de l’Université des Mutants. La restauration de neuf bâtiments historiques est prévue, affectés à des activités socio-culturelles, tel que l’école du Soudan projetée en auberge de jeunesse. Estimé à un coût total de 4 millions de dollars, ce plan de sauvegarde entrevoit, en plus de la restauration des bâtiments, le recrutement temporaire de deux experts associés (architecte-restaurateur) et un consultant dans la muséographie70. Le montant de la contribution internationale s’élevait à 315 000 dollars. Le Sénégal aurait quant à lui financé pour l’équivalent de plus de 2,3 millions de dollars dont un certain nombre de travaux d’infrastructures et de rénovation non prévus au plan de rénovation de l’UNESCO.
En marge des restaurations et des aménagements, le Sénégal s’engage à concevoir une campagne de sensibilisation de l’opinion publique pour la préservation de l’île. En contrepartie, l’UNESCO publie une brochure71, une affiche72 (fig. n°7), un dossier de presse, l’émission de timbres… et réalise une exposition photographique à Gorée et au siège de l’UNESCO.
Le lancement du Plan de sauvegarde de Gorée, l’île-mémoire (1980)
Le 22 décembre 1980, à la veille de la démission du président Léopold Sédar Senghor, le directeur général de l’UNESCO et sénégalais Amadou Mahtar M’Bow lance un appel en faveur de la sauvegarde de Gorée pour accompagner l’exécution du Plan de sauvegarde de l’île de Gorée approuvé à Dakar quelques jours plus tôt. « Le patrimoine architectural de Gorée doit être sauvé autant pour préserver la haute valeur culturelle de l’île que pour assurer à tous ses habitants des conditions de vie et des activités à la mesure de leurs espoirs ». En effet, « à travers les diverses périodes qu’elle a traversées, Gorée a préservé une cohérence architecturale qui réunit les apports culturels les plus dissemblables – nordiques et méditerranéens, islamiques et chrétiens – pour les fondre dans une unité dictée à la fois par l’exiguïté de l’espace, l’exposition aux vents du grand large, l’homogénéité du matériau de construction et, enfin, peut-être surtout, les courants d’une histoire tourmentée qui avait fait de chaque demeure un entrepôt d’esclaves en même temps qu’une position de défense. Gorée offre une heureuse symbiose du passé et du présent, de l’histoire et du quotidien, de l’harmonie des formules visibles et de l’empreinte dramatique du souvenir. C’est pourquoi elle constitue désormais un de ces lieux uniques où peut se retremper la mémoire des jeunes générations d’Afrique et des Amériques, en même temps que se renouvellent les sources de leur inspiration. Un tel endroit, poursuit-il, s’il appartient à l’imaginaire vivant de l’Afrique et des Amériques, appartient, dans une égale mesure, à la conscience du monde. Il peut devenir une terre de méditation, un haut lieu de réflexion et de recueillement, où les hommes, plus conscients des tragédies de leur histoire, apprendront mieux le sens de la justice et celui de la fraternité73 ». Le discours, repris des rapports antérieurs des experts de l’UNESCO où « chaque demeure est un entrepôt d’esclaves » est donc accrédité officiellement par ledit organisme international et rejoint le récit de Joseph Ndiaye.
Sur le rôle et la place de Gorée dans la traite atlantique, Amadou Mahtar M’Bow ajoute : « Dans des caves humides et sombres, ou dans des cachots de torture pour ceux qui se révoltaient, les déportés séjournaient durant des semaines, dans l’attente du voyage sans retour. Là, au moment d’embarquer, chaque esclave était marqué au fer rouge, à l’emblème de son propriétaire. Puis les esclaves étaient entassés dans les cales, où beaucoup d’entre eux devaient périr avant l’arrivée à destination. Mais l’Amérique, dont la colonisation a été à l’origine de cette tragique déportation, allait être également le cadre de grandes luttes libératrices qui, peu à peu, y mettront fin. Préparée par le triomphe de la Révolution haïtienne à Vertières en 1803, et proclamée au Congrès de Vienne en 1815, l’abolition officielle de la traite négrière produisit ses effets sur Gorée ».
L’application du Plan de sauvegarde et de restauration (1980-2000)
En 1981, sous la nouvelle présidence d’Abdou Diouf et toujours avec le soutien de l’UNESCO, l’effort de restauration et de préservation se poursuit. Plusieurs édifices sont ainsi restaurés et rénovés pour être affectés à de nouvelles fonctions. Outre la France, d’autres pays de la communauté internationale se mobilisent pour la restauration de quelques bâtiments74. Des travaux d’aménagement portent également sur la restauration du kiosque à musique, des fontaines et de la Batterie de l’Embarcadère, le pavage des rues principales, l’aménagement du marché des produits de l’artisanat et de la place des restaurants. En 1982, Pierre André Lablaude enregistre l’état d’avancement et la réception des premières restaurations et fixe le programme des travaux à venir, dont celui sur les études concernant la rénovation de l’ancien Palais du Gouverneur (Relais de l’Espadon) en équipement hôtelier75.
Localement, la mise en œuvre de la campagne de sauvegarde est confiée au Bureau d’architecture des Monuments historiques (BAMH) qui a parfois recours à l’expertise de l’Institut Fondamental de l’Afrique Noire (IFAN) pour la conduite des opérations de rénovation et de restauration du patrimoine architectural76 selon une direction bicéphale des travaux. Intervenant parallèlement à l’aménagement d’un nouveau Musée historique au Fort d’Estrée (1977-1989), l’anthropologue d’origine belge Guy Thilmans aurait opéré ainsi à la Maison des Esclaves, en 1981-1982, pour des travaux de restauration des façades de la Maison des Esclaves77.
Les manquements aux règles de restauration de l’UNESCO qui prônent un retour à l’authenticité, sont-ils dus aux campagnes de restauration du XIXe et de la première moitié du XXe siècle, à celles de 1966, de 1981-1982, de 1990-199178 ou de 2010-2011 et aux difficultés d’adaptation d’une habitation privée en musée ouvert au public ? Malgré le manque de documentation et de relevés précis des états avant restauration, la comparaison entre les aquarelles d’Adolphe Hastrel de 183979 (fig. n°8, 9, 10, 11), les premières photographies et l’état actuel (fig. n°12, 13) est édifiante. Pour l’expert Lablaude, la restauration en 1982 des chapiteaux de la galerie est effectuée selon « des proportions erronées et particulièrement maladroites…80 ». La disparition de la base des piliers de cette galerie et du garde-corps central au profit d’un mur plein est sans doute antérieure aux interventions des spécialistes. Mais la suppression des pièces des avant-corps latéraux avec leurs fenêtres aux volets persiennés de couleur verte et leurs baies d’aération ainsi que la mauvaise proportion des cintres des baies du rez-de-chaussée, l’augmentation du nombre des ouvertures sur les façades des bâtiments latéraux, et l’application d’un badigeon à l’ocre rouge soutenu qui a remplacé celui à la chaux, de couleur blanc cassé ou très légèrement ocré, semblent bien relever de campagnes plus récentes. Les façades actuelles portent les traces de nombreux changements. Côté rue, un édicule surmonte la porte d’entrée et toutes les baies ont subi de notables modifications. Côté mer, la constatation est identique : agrandissement de la terrasse supérieure, baies bouchées, percements d’ouvertures… jusqu’à la construction d’une terrasse sur les rochers, accessible à partir de la Porte du voyage sans retour qui aurait pour effet de prévenir l’érosion marine81. Enfin, il est vraisemblable que le toit en tuile à deux versants (fig. n°14) a succédé à une terrasse recouverte par une chape en béton coquillier dénommée argamasse qui se laisse deviner par la présence des gargouilles d’évacuation des eaux, visibles en 183982.
En 1992, dix ans après le lancement de la campagne internationale de sauvegarde, l’UNESCO publie un article sur « Gorée, l’île aux esclaves », dans lequel on peut lire que trois bâtiments seulement ont été restaurés et qu’un quatrième est en cours de consolidation83. Les différents examens de l’état de conservation de l’île menés par le Comité du patrimoine mondial depuis les années 1990 évoquent les travaux réalisés et ceux en cours, et félicitent régulièrement les autorités sénégalaises de leur implication ; mais ils soulignent aussi certains problèmes comme l’occupation illégale et anarchique du site du Castel, toujours préoccupante aujourd’hui et à l’origine d’innombrables désordres architecturaux qui menacent l’authenticité et l’intégrité du site. La 27e session du Comité signale qu’entre 2000 et 2001 le site a subi une pression d’aménagement urbain causée par un projet de construction hôtelière dont les travaux furent interrompus avant la modification irréversible du site84. À cette occasion, un souci récurrent est évoqué. Les lacunes de gestion seraient imputables à l’absence d’un gestionnaire basé sur l’île. La nomination d’un gestionnaire du site, recommandée par l’UNESCO pour tous les sites du patrimoine mondial, conformément aux articles 4 et 5 de la Convention de 1972, est effective depuis deux ans.
Au programme initial sur le Plan de sauvegarde de Gorée, lancé en 1980, l’île de Gorée va bénéficier indirectement d’un autre programme de l’UNESCO sur « La Route de l’esclavage ».
« La Route de l’esclave », un nouveau programme de l’UNESCO (1995)
Depuis 1994, un programme conjoint avec l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT) est lancé à Ouidah (Bénin) : « La Route de l’esclave », une des multiples routes interculturelles de l’UNESCO lancées par le sénégalais Doudou Diene, alors directeur de la Division du dialogue interculturel et interreligieux85. L’objectif de ce programme est l’identification, la restauration et la promotion des sites, bâtiments et lieux de mémoire de la traite négrière qui jalonnent le parcours de la traite. Tout en privilégiant le tourisme culturel, ce programme représente un véritable enjeu de mémoire, car il intègre la dimension économique, historique et éthique du tourisme.
En 2004, dans le cadre du lancement de l’année internationale de la commémoration et de la lutte contre l’esclavage et de son abolition, le Directeur général de l’UNESCO situe ce devoir de mémoire : « Institutionnaliser la mémoire, empêcher l’oubli, rappeler le souvenir d’une tragédie longtemps occultée ou méconnue et lui restituer la place qui doit être la sienne dans la conscience des hommes, c’est en effet répondre à un devoir de mémoire86 ». L’UNESCO s’engage à institutionnaliser la mémoire pour empêcher l’oubli et vulgariser l’histoire de l’esclavage à travers différentes manifestations commémoratives : journées du souvenir, activités de remémoration et de vulgarisation, colloques, festivals, séminaires, ateliers, mémoriaux, expositions. En 2005, l’UNESCO publie une étude sur la mise en tourisme des sites liés à la traite négrière et à l’esclavage en Sénégambie87.
Dans le cadre de ce programme, la promotion de Gorée est largement soutenue par les autorités sénégalaises. Ainsi, en 2001, le musée maritime de Liverpool88 organise une exposition au musée de la Maison des Esclaves, considérée comme une « esclaverie-témoin ». Cette exposition sur la Traite, réalisée en collaboration avec la Direction du Patrimoine historique du ministère de la Culture du Sénégal, par l’ambassade de Grande-Bretagne au Sénégal, est financée par le British Council et Shell Sénégal89. En 2006, on retrouve encore la Direction du Patrimoine historique qui parraine au Village des Arts de Dakar une exposition de l’artiste plasticien Lamine Barro sur « Gorée sur la route de l’esclavage, de la mémoire au pardon »90.
Le mémorial de Gorée-Almadies (1996-2011)
Ce programme sur La Route de l’esclave va sans doute faciliter l’éclosion finale du vieux projet sénégalais de construction d’un mémorial (toujours en attente de réalisation en 2011). Les autorités sénégalaises nourrissaient depuis longtemps l’idée d’ériger un monument en souvenir de la traite des esclaves. Dès 1975, lors d’une visite en Martinique, le président Senghor avait invité les artistes de la communauté afro-américaine à l’édification d’un monument en hommage à l’Afrique91. Le projet de monument à ériger sur l’île de Gorée devait être un trait d’union entre l’Afrique et sa diaspora. Ce monument symboliserait le départ des Africains vers les Amériques en jetant un pont entre les deux continents. Il devait se présenter sous la forme d’« un groupe de personnes qui semblent se lever au-dessus du socle de la sculpture comme pour lancer un appel à ceux qui sont partis à bord des bateaux négriers ; à l’autre extrémité se dresse un homme qui, lui, semble crier : Afrique, lève toi ! Toi, Nègre de là-bas, rejoins-nous !92 ».
En 1986, le président Abdou Diouf reprend le projet d’érection d’un mémorial dédié à l’Afrique et à sa diaspora. Il soumet officiellement l’idée de réaliser un projet de dimension internationale lors du sommet historique de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) à Addis Abéba. Cinq ans plus tard, une Fondation est créée auprès du ministère de la Culture du Sénégal, présidée par l’ancien directeur général de l’UNESCO, le sénégalais Amadou-Mahtar Mbow pour coordonner les actions internationales de promotion et rechercher les financements. Le 29 juin 1992, la première pierre du Mémorial Gorée-Almadies est posée par le président de la république du Sénégal, à l’occasion du 28e sommet de l’OUA et en présence notamment de Federico Mayor, directeur général de l’UNESCO. Ce geste permet de dynamiser à nouveau la campagne pour la sauvegarde de Gorée lancée par l’UNESCO dix ans plus tôt, de répondre aux sollicitations de nombreux intellectuels, artistes et intellectuels noirs, notamment ceux du continent américain. Le choix du site des Almadies se justifie par sa position avancée sur l’Atlantique, orientée en direction des communautés noires américaines vivant de l’autre côté de l’Océan et le désir de ne pas entacher l’environnement de l’île (où il est quand même prévu dès l’origine d’ériger une réplique…). L’UNESCO inscrit ce projet dans le programme sur la Route de l’Esclave, ce qui devait faciliter la recherche de financements internationaux.
En 1996, un concours international pour la construction de ce mémorial est lancé. Le cahier des charges est préparé par l’International Union of Architects (UIA) qui organise un concours international d’architecture. Deux cents quatre-vingt dix concurrents de 66 pays (au total 900 dossiers) participent au concours. Le programme, d’une surface d’environ 12 000 m2, portait sur la conception du mémorial, d’un musée dédié à la navigation, d’un centre d’études et de recherche doté des équipements les plus performants et d’une structure administrative. Les espaces verts devaient faire l’objet d’un traitement spécifique, notamment celui d’un circuit de visite « la procession des civilisations », partie intégrante du lieu93.
Le lauréat désigné en novembre 1997 est l’architecte italien Ottavio Di Blasi94. Il a été choisi par un jury réuni à Dakar sous la présidence de Harry G. Robinson III, vice-président de l’Université Howard de Washington (États-Unis) et représentant du Directeur général de l’UNESCO. « Le projet du lauréat reflète l’esprit, la voix et le symbolisme de l’Afrique. Par sa forme africaine authentique et puissante, il exprime une identité clairement lisible, tant pour le Musée que pour le mémorial. La relation avec la mer s’établit par l’ancrage de l’élément dominant du programme (l’aiguille) sur la falaise et la position de l’autre élément (la coque) sur pilotis au-dessus de la mer. La fracture créée par ce contraste est l’élément majeur de l’approche qui a présidé à la conception du projet. La structure de modules en nid d’abeilles est l’élément typologique dominant. Un système mécanique est intégré à la construction et conçu pour réduire les effets du soleil. La mer est utilisée pour abaisser la température de l’air ambiant95 ». Après avoir été exposée à Dakar, la maquette restera longtemps au siège de l’UNESCO à Paris. Ce mémorial – nouvelle « arche d’alliance » pour le président Abdou Diouf – honore la mémoire des victimes de la traite négrière et symbolise la tolérance et le dialogue entre les civilisations96.
Malgré des appels répétés à la mobilisation internationale, la Fondation ne trouve pas les finances nécessaires à sa réalisation, estimées à 60 milliards de francs CFA97. Le président Diouf inaugure rapidement le 31 décembre 1999 une réplique réduite, perchée sur le sommet de l’île de Gorée (fig. n°15). Le coordinateur du projet est le poète Amadou Lamine Sall, aidé par l’architecte du BAMH Mamadou Berthet et l’ingénieur Mamadou Lamine Adama Diallo, avec l’entrepreneur Fougerolles. La présence de cette réplique, sur le site du Castel de Gorée, projetée dès l’origine du projet, est remise en cause au lendemain des élections présidentielles par le nouveau ministère de la Culture. En 2010, l’UNESCO déclare que « la réplique du mémorial de Gorée sur le Castel est un exemple éloquent de ce qu’il ne faut pas faire pour la préservation de l’intégrité du site et d’un commun accord avec l’UNESCO, il a été convenu de procéder à la requalification de cet ouvrage98 ».
Parmi les nombreux projets en cours, il faut signaler un projet de construction pour un nouveau mémorial de Gorée « en hommage à des millions d’Africains enlevés » qui réapparaît en avril 2011, un an avant les nouvelles élections présidentielles99. Le projet, promu par le groupe financier Swist Invest, est signé d’un architecte-designer tchèque Martin Guadev100, aidé par le studio Sipek. Il reprend une partie du programme du concours UIA/UNESCO de 1996, avec des références post-modernes plus explicites. Le bâtiment d’accueil est une réplique de la Maison des esclaves de Gorée et le visiteur est conduit par la « porte du voyage sans retour » sur une jetée formée par un navire prêt à appareiller, aux cales chargées d’esclaves enchaînés. On retrouve comme commissaire à sa réalisation Amadou Lamine Sall, avec l’architecte Mamadou Berthet et de nouvelles personnalités comme le sculpteur Ousmane Sow. À ce jour, ce projet diffusé sur internet et régulièrement agité n’a pas connu un début de réalisation malgré un tapage médiatique constant101.
Pour une cohérence des discours muséaux sur la traite atlantique
L’indépendance du Sénégal marque l’accroissement des institutions muséales sur l’île. Le musée historique de l’IFAN est déplacé au fort d’Estrée à partir de 1977. Son précédent emplacement était trop exigu pour permettre sa transformation en une institution muséale à la mesure du grand dessein qui prend forme à cette période. Le président Léopold Sédar Senghor lui affecte la batterie de la pointe Nord (fort d’Estrée), à la demande du professeur Amar Samb, directeur de l’IFAN. Les travaux de restauration du fort d’Estrée sont supervisés par le Bureau d,Architecture des Monuments Historiques (BAMH)102. La restauration et l’aménagement muséographique sont réalisés par Guy Thilmans, chercheur à l’IFAN103. Cet établissement ne présente plus l’histoire de l’Afrique occidentale comme précédemment, mais se concentre sur la seule histoire du Sénégal, de la Préhistoire aux royaumes qui ont précédé la présence française, en passant par la traite des noirs et les résistances anti-coloniales (fig. n°16). Il ouvre en 1989.
En face de la Maison des Esclaves, dans l’ancienne villa de la riche signare Victoria Albis, est installé le premier musée dédié aux femmes sur le continent africain104. Ce musée privé, le premier sur l’île de Gorée, est issu d’un projet conçu dès 1987 par le cinéaste Ousmane William Mbaye à la suite de plusieurs expositions de diverses productions artisanales, économiques et culturelles d’associations sénégalaises. Ouvert en 1994 sous la direction d’Annette Mbaye d’Emeville, on y trouve des objets usuels, des outils agricoles, des instruments de musique, des poteries, des vanneries, ainsi que des photographies permettant de mieux comprendre la vie quotidienne de la femme dans le pays. Le musée est sous le parrainage posthume d’Henriette-Bathily105. C’est aussi un centre d’apprentissage, où les femmes viennent s’éduquer, recevoir une formation à l’artisanat et travailler106.
Le musée de la mer107, aménagé dans une ancienne maison de la compagnie des Indes du XVIIIe siècle, est rénové en 1995. À cette occasion, le laboratoire de biologie marine est déménagé, en partie, à l’IFAN Cheickh Anta Diop. Aujourd’hui, le bâtiment central abrite les expositions, tandis que le bâtiment secondaire conserve les cuves et les spécimens laissés sur place lors du déménagement du laboratoire. Ce dernier fait office de laboratoire de conservation. Le musée offre une plus grande place à l’homme dans ses relations avec la mer : la mer source de vie, mais aussi source d’événements dramatiques. Il a pour mission de promouvoir la connaissance de la mer, de ses facteurs et de ses fonctionnements, et de sensibiliser à la préservation de l’environnement marin108. Aujourd’hui le musée est à nouveau fermé en raison d’une forte dégradation. Les efforts sont en cours avec de nombreux partenaires pour le financement de sa réhabilitation109.
À partir de ce bilan sur les musées de Gorée, l’actuelle direction du patrimoine recherche aujourd’hui une meilleure cohérence et un discours plus adapté à l’île-mémoire de la traite atlantique. Cet esprit de témoin vivant de la mémoire de l’esclavage qui se retrouve à la Maison des Esclaves pourrait être relayé dans les autres structures muséales présentes sur l’île afin de clarifier les relations entre mémoire de l’esclavage et mémoire de la traite atlantique, entre les esclaves qui restaient à Gorée et les captifs qui partaient en Amérique. Sans pour autant modifier leurs thématiques actuelles, les autres structures pourraient évoluer vers une plus grande imprégnation dans l’ambiance des mémoires de la traite atlantique. La désaffection relative des autres musées, par rapport à la Maison des Esclaves, semblerait plutôt être un problème de perception des attentes de la part des visiteurs qu’un problème d’incohérence du discours intrinsèque. Ce problème pourrait être résolu par un effort d’adaptation qui, dans chacune des structures existantes, a déjà une base bien réelle. Le musée de la femme Henriette-Bathily développe un discours sur la femme africaine (son rôle social, économique, culturel et politique). La fonction d’animation et la portée sociologique sont indéniables. Cependant, bien que situé sur le lieu de mémoire de la traite atlantique, celui-ci traite trop marginalement de la condition de la femme dans la traite. Il serait peut-être souhaitable, toujours d’après la direction du Patrimoine au vu de l’importante documentation existante sur la femme, de sa captivité au voyage sans retour, et jusqu’à ses conditions de vie dans les plantations, de développer un peu plus ce discours pour se renouveler et être plus en conformité avec les attentes des visiteurs.
Réputé pour sa collection de 750 espèces de poissons et 700 espèces de mollusques, le musée de la mer présente également les écosystèmes et l’habitat de la région. Bien que son discours muséographique parle aussi de la traversée, la vocation première de laboratoire de recherche avec ses remarquables collections de biologie marine n’a pas pu s’accommoder avec la vocation muséale de la traite développée à Gorée, et l’écart est devenu de plus en plus important depuis que Gorée est inscrite au patrimoine mondial. Pour cela, la direction propose de dissocier les deux axes muséographiques en concevant un centre pour le laboratoire de recherche de l’IFAN Cheikh Anta Diop, et un musée centré sur la traversée, les navigations en général y compris en Afrique, les conditions de la traversée et la vie dans les cales des bateaux négriers. Devant la porte du voyage sans retour de la Maison des Esclaves, un projet d’installation d’une cale grandeur nature d’un bateau négrier, serait à l’étude.
Enfin, le musée historique présente l’histoire du Sénégal. De ce fait, il documente assez bien certains épisodes de la traite. Pour autant, le discours muséographique sur le passé de la nation semblerait trop ambitieux pour demeurer à Gorée. Des réflexions sont aujourd’hui en cours pour doter le Sénégal d’un véritable musée national à Dakar. Quant au musée de Gorée, la direction du patrimoine pense qu’il devrait se concentrer sur la présentation exhaustive et illustrée de la production historique, documentaire et archivistique sur la traite atlantique. Ce musée pourrait aussi aider à rendre l’image de Gorée plus conforme à la diversité qui régna en ces lieux, en réalisant des fresques et des reconstitutions sur la vie de la population goréenne.
Le discours symbolique, forgé dès l’époque coloniale à partir d’une « Maison des Esclaves » et d’une « porte du voyage sans retour », repris et amplifié par Joseph Ndiaye, doit être progressivement renouvelé. Comme à Ouidah et dans les autres lieux de célébration du pèlerinage de ce tourisme mémoriel, la « route de l’esclave » est jalonnée de représentations abstraites ou le plus souvent imagées110. La voile en béton d’un bateau négrier, dominant la réplique d’un grand mémorial avorté est érigée depuis 1999 au sommet de l’île-mémoire, malgré les protestations tardives de l’UNESCO. Une statue des esclaves libérés, offerte en 2003 par les Guadeloupéens pour célébrer l’abolition de l’esclavage, est aujourd’hui installée dans le jardin précédant l’accès à la Maison des esclaves (fig. n°17). Les nouveaux projets en cours des mémoriaux et des musées renouvellent et amplifient le discours. Deux projets associent à cette « porte du voyage sans retour » de la Maison des esclaves ou de sa reconstitution, la représentation des cales d’un navire négrier avec leurs esclaves enchaînés. Les critères patrimoniaux d’authenticité et de respect de l’environnement, prônés par l’UNESCO risquent à nouveau de voler en éclat111.
Depuis plusieurs décennies, avant ou après l’Indépendance du Sénégal, l’île de Gorée est un forum permanent où le patrimoine, les mémoires et l’histoire112, les commémorations et les mémoriaux, les discours muséaux, les souvenirs et les représentations, imaginées, entretenues ou construites sur la Traite atlantique sont soumis à une remise en cause perpétuelle, s’adaptant aux découvertes et aux connaissances historiques et aux messages culturels, idéologiques et politiques délivrés par les communautés patrimoniales, l’État du Sénégal et l’UNESCO.
L’histoire de l’esclavage et de celle de la traite atlantique à Gorée, qui ne se limite pas à l’histoire d’un simple « échange commercial » entre producteurs et acheteurs dans un temps donné, inclut et dépasse l’histoire d’un passé raconté et la place de ce passé dans l’imaginaire présent des Sénégalais, c’est-à-dire ce « présent du passé » qu’est la mémoire, collective, sur lequel prend appui une grande partie du patrimoine113.
Notes
1 – Nous remercions Ibrahima Thioub, Xavier Ricou, Cyr Descamps et Dominique Moiselet pour leur aide précieuse dans l’élaboration de cet article. L’article, terminé en décembre 2011, ne tient pas compte des derniers développements de l’actualité et du résultat des recherches en cours. Voir notamment KANE, Moustapha. Histoire de la construction d’un lieu de mémoire de la traite atlantique des esclaves : Gorée de 1944 à nos jours. Dakar, UCAD.
2 – Inscription relevée sur une plaque érigée le 8 novembre 1999 à Gorée à l’entrée du jardin de plantes grasses « canarien » par la Maison africaine de la poésie internationale en présence du Président de la République du Sénégal et du Premier Ministre du Canada.
3 – GUEYE, Mbaye. L’esclavage au Sénégal du XVIIe au XIXe siècle. Nantes, thèse de doctorat de 3e cycle, 1969 ; L’Afrique et l’esclavage. Une étude sur la traite négrière. Martinsart, 1983.
4 – DE ROUX, Emmanuel. « Le mythe de la Maison des esclaves qui résiste à la réalité ». Le Monde, 27 décembre 1996. SAMB, Djibril (dir.). Gorée et l’esclavage, Actes du Séminaire sur Gorée dans la traite atlantique : mythes et réalités, Gorée, 7-8 avril 1997. Dakar : IFAN-CAD, Initiations et Études Africaines, 38, juillet 1997.
5 – Les esclavages et les traites : communautés, frontières et identités. Pôle d’Excellence Régional (PER) domicilié au Département d’Histoire de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l’Université Cheikh Anta Diop. http://peresclave.over-blog.com/categorie-10204481.html [consulté le 25/04/2011]. En 2011, le PER est devenu le Centre Africain de Recherches sur les Traites et les Esclavages (CARTE). http://www.carte-ucad.org/fr [consulté le 26/02/2013]. Sur la traite négrière et l’esclavage, voir notamment les orientations bibliographiques données par : le département d’histoire de l’Université Cheick Anta Diop de Dakar (UCAD), http://www.histoire-ucad.org/archives/index.php/remository.html?func=select&id=34 [consulté le 25/04/2011] ; l’UNESCO, http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001887/188769m.pdf [consulté le 25/04/2011]. Pour un état des lieux et des savoirs sur Gorée, voir : CAMARA, Abdoulaye, BENOIST, Joseph-Roger (de). Histoire de Gorée. Maisonneuve et Larose, 2003, p. 153-155 (bibliographie). Un inventaire du patrimoine immobilier de Gorée, conduit par la Direction du Patrimoine historique classé du ministère de la culture du Sénégal, est en cours depuis 2007.
6 – Voir le site : http://whc.unesco.org/fr/list/26 [consulté le 25/04/2011].
7 – Voir en Afrique les nombreux projets mémoriels et concurrentiels en oeuvre ou en gestation en Gambie, Ghana, Bénin, Congo, … mis en oeuvre avec l’aide de l’UNESCO depuis 1994 : http://www.unesco.org/africa/portal/culture_4.html [consulté le 26/02/2012].
8 – Guide du tourisme en Afrique Occidentale Française et au territoire du Togo sous mandat français. Paris : Agence économique de l’Afrique occidentale Française, 5e éd., 1939 (1ère éd. 1926), p. 10.
9 – « Au XVIIIe siècle […], l’Afrique […] fournit la main d’œuvre esclave nécessaire à l’exploitation des Îles de l’Océan Indien, des Antilles et de l’Amérique. Il y a là un transport de force odieux mais tout à fait méconnu. Les philosophes blâment l’esclavage et la traite mais tout en accréditant la légende du sauvage africain heureux dans sa vertueuse sauvagerie et tout en profitant d’une civilisation matérielle qui comprend les produits coloniaux, ils ne mettent pas l’Afrique à l’honneur du travail. Et il faudra encore de longues années pour que l’on découvre, sous les préjugés négriers et sous les rêveries humanitaires, le caractère paysan des hommes de la savane. ». Guide du tourisme en Afrique Occidentale Française et au territoire du Togo sous mandat français. Paris : Agence économique de l’Afrique occidentale Française, 5e éd., 1939 (1ère éd. 1926), p. 9.
10 – « L’œuvre de la France en Afrique Occidentale ». L’Illustration, 29 février 1936, 94ème année, n°4852, p. 253-256 et supplément p. XIII-XXV. Description de « l’île des esclaves », p. 257-258.
11 – Le 31 mai 1936, la compagnie Air-France inaugure son premier service hebdomadaire entre la France et le Sénégal en trimoteur Dewoitine 338. Ces avions transportaient 15 passagers à la vitesse de 275 km/h. Cette remarquable aventure humaine et technologique participe également du patrimoine en partage entre la France, l’Afrique et l’Amérique. Pour cette raison, le Sénégal a introduit l’Aéropostale sur sa Liste indicative en vue d’une inscription sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO dans la catégorie des biens en série.
12 – Renseignement aimablement communiqué par Xavier Ricou (avril 2011).
13 – Guide du tourisme en Afrique Occidentale Française et au territoire du Togo sous mandat français. Paris : Agence économique de l’Afrique occidentale Française, 5e éd. (1ère éd. 1926), 1939, p. 66.
14 – L’Illustration, n°4435, 3 mars 1928. Renseignement aimablement communiqué par Xavier Ricou.
15 – BRAU, P. (Dr). « L’île du sortilège ». Bull. Comité d’Études historiques et scientifiques de l’Afrique Occidentale Française, t. XI, n°4, oct.-déc. 1928, tiré à part, p. 63.
16 – GAFFIOT, Robert. Gorée, capitale déchue. Paris : L. Fournier, 1933, p. 93. GAFFIOT, Robert. Gorée, toute petite île. Arc-et-Senans : Éditions de l’Aile, 1933, p. 11. Dessin portant la légende : « Cour d’une ancienne maison négrière ». Ce dessin, signé de la main de l’auteur Robert Gaffiot (R.G.), représente la cour de l’actuelle Maison des Esclaves. Il ne porte pas [encore] son appellation postérieure qui serait donc apparue entre 1933 et 1936. Dans ses deux ouvrages Gaffiot n’emploie pas l’expression de « porte de non retour », l’auteur ne précise pas s’il s’agit de la reprise d’une « tradition », orale ou écrite antérieure.
17 – CARIOU, Pierre-André. Promenade à Gorée (Sénégal), manuscrit dactylographié, 1951-1952. L’auteur dépose trois exemplaires du manuscrit à Paris : aux Archives d’Outre-Mer, à la Bibliothèque nationale de France et aux Archives de la Marine. Aujourd’hui, l’exemplaire des Archives de la Marine est conservé à la bibliothèque des Archives d’Outre-Mer à Aix-en-Provence (CAOM) : – copie du manuscrit provisoire, [s.l.n.d.] [dactylographié], (288-6 p.). Aix-en-Provence : Centre des Archives d’Outre-Mer, 24Miom/57 ; – [s.l., s.n.] 1978, 1 vol. (274, 64, [19], 12) : nombr. pl. h. t., plans et cartes h. t. et dépl., 1 plan dépl. en coul. in fine. Aix-en-Provence : Centre des Archives d’Outre-Mer, BIB SOM d4506 ; – s.l., 1978, 1. vol. (12, 274, 64, 19). Paris : Bibliothèque nationale de France, cote FOL- O3M- 1456. Dans l’exemplaire déposé aujourd’hui à la BnF, cette somme dactylographiée comprend un avertissement, une reproduction de l’article « Notice sur Gorée » écrit par le Dr Cariou (publiée dans La presqu’île du Cap-Vert. Dakar : IFAN, 1949, p. 273-282), le manuscrit Promenade à Gorée (274 p.), une bibliographie (64 p.) et des annexes (quatre partitions de chants goréens, 19 p.). La note d’avertissement nous indique que l’auteur a rédigé l’ouvrage sous la forme d’une conférence en 1951-1952, avec révision en 1977. Il n’aurait pas édité ce manuscrit sous le prétexte que sa « Notice sur Gorée » avait déjà été publiée au préalable dans La presqu’île du Cap-Vert (Dakar : IFAN, 1949), le Guide sur musée historique de l’AOF à Gorée (MAUNY, Raymond. Dakar : IFAN, 1955), et enfin Dakar et le Sénégal (Paris : Hachette, les Guides Bleus illustrés, 1972). Cariou est présent à Gorée au moment du bombardement de 1940 et aurait quitté l’île vers 1943. Durant son séjour, il amasse une documentation considérable sur l’île qu’il complète par la lecture des sources d’archives de la métropole. Le plan de Gorée qui accompagne le manuscrit porte la date de 1944. Il semblerait que ce soit cette « histoire » de la Maison des Esclaves écrite par Cariou qui ait servi de trame originelle au discours de l’ancien conservateur Joseph Ndiaye. En 1993, les auteurs du nouveau guide de l’île de Gorée sont plus nuancés et retiennent pour l’usage des petites pièces du rez-de-chaussée de la Maison des Esclaves une fonction mixte de « chambres » pour les « esclaves domestiques » et de « cellules » pour les esclaves de traite. (CAMARA, Abdoulaye, BENOIST, Joseph-Roger (de). Gorée. Guide de l’île et du Musée historique. Dakar : IFAN-Cheik Anta Diop, 1993, p. 12-13).
18 – Raymond Mauny débarque à Dakar le 13 décembre 1937 et y rencontre le professeur Théodore Monod, directeur de l’Institut Français d’Afrique Noire (IFAN), créé le 19 août 1936. Mauny est d’abord affecté dans les services du Gouvernement général. Durant la guerre, il prospecte notamment des sites préhistoriques autour de Dakar. En 1947, il est détaché de l’administration, puis intégré comme assistant à l’IFAN en 1949. Il s’occupe notamment de la protection des sites et des monuments historiques, et de ses prolongements en matière touristique, ainsi que de la mise en place des musées de Gorée, Dakar et Bamako. Pendant quinze ans (1947-1962), il dirige la section archéologie-préhistoire de l’IFAN. (BRASSEUR, Gérard. « Raymond Mauny ». 2000 ans d’histoire africaine. Le sol, la parole, l’écrit. Mélanges en hommage à Raymond Mauny. Paris : L’Harmattan, 1981, t. 1, p. 1-3).
19 Malgré son apport considérable au développement des recherches en AOF, notament dans le domaine de l’archéologie, Mauny est resté profondément conservateur, voire nihiliste. Il a systématiquement nié les apports de l’Afrique aux progrès techniques de l’humanité (invention du fer par exemple), contesté les contacts anciens avec la toute proche Méditerrannée. Ses positions ambigues lui valurent, au lendemain de la seconde guerre mondiale, d’être accusé de collaboration avec l’ennemi, ce qui lui valut une comparution devant la Chambre Civique du Parquet Général de l’AOF en son Audience du 4 décembre 1945. Il sera heureusement acquitté.
20 – MAUNY, Raymond. Guide de Gorée. Dakar : IFAN, Initiations Africaines : VII, 1951, p. 28 : « Quoi qu’en aient dit certains auteurs, il est bien peu probable que les négriers aient utilisé cette porte donnant sur la mer pour faire disparaître les cadavres. Le commerce des esclaves au XVIIIe siècle se faisait au grand jour ; les négriers n’avaient nul besoin de « faire disparaître » des cadavres comme de vulgaires criminels, alors qu’ils jouissaient de la considération due à d’honnêtes commerçants. Et par ailleurs, drôle de façon de procéder, si l’on voulait passer inaperçu, que de jeter un cadavre à la mer à quelques mètres de sa maison… et à portée de ses narines, au surcroît ! Les esclaves étaient embarqués par chaloupes dans l’Anse, au grand jour, et s’il en mourait, ils étaient enterrés dans les lieux de sépulture que l’on retrouve partout dans l’île ». Cette affirmation toute cartésienne doit être relativisée par le récit d’un témoin contemporain qui connaît bien les sites de traite de Gorée et de Saint-Louis, le chevalier de Boufflers. « Dans ce temps çi l’air du Sénégal est le pire de tous. Imagine que nous sentons de nos chambres, et surtout de la mienne, les exhalaisons des cadavres des captifs qui meurent par douzaines dans les cachots, et que les marchands, par économie, font jeter à l’eau pendant la nuit avec des boulets aux pieds. Les boulets se détachent à la longue, et les corps flottent entre deux eaux et vont s’arrêter sur le rivage, dans des endroits où l’on ne peut souvent pas arriver à pied ni en bateau. Ils restent entre les mangliers [= palétuviers et non « mangiers », selon Cyr Descamps] et ils y pourrissent à leur aise. Nous faisons des règlements pour parer à cela ; mais l’infection qui règne actuellement nous montre qu’ils ne sont pas suivis. » (Lettre datée du 9 juin 1786). PRAT, Paul. Lettres du chevalier de Boufflers à la comtesse de Sabran. Paris : Plon, 1891, p. 148-149.
21 – CAMARA, Abdoulaye, BENOIST, Joseph-Roger (de). Histoire de Gorée. Paris : Maisonneuve et Larose, 2003, p. 100-102. A.N. Sénégal, 4P 1442, Institut Français d’Afrique Noire (IFAN) à Dakar, aménagement, construction du musée de Gorée. Pièces écrites et plans, 1949-1953.
22 – MAUNY, Raymond. Guide du Musée historique de l’A.O.F. à Gorée. Dakar : IFAN, catalogue, n°XIII, 1955, p. 11-21. Dans la salle consacrée à l’esclavage et son abolition, sont exposées une maquette du brick négrier nantais La Joséphine (1824), établie d’après les plans du Musée de la Marine à Paris, et des reproductions de documents relatifs à la traite et au transport des esclaves.
23 – Le Musée de la Mer correspond au savoir développé autour du laboratoire de biologie marine par l’IFAN. Il vient compléter ce dispositif touristique muséal et apporter une note exotique de villégiature balnéaire, en contrepoint du tourisme mémoriel. On y organise des expositions reflétant les interactions multiples entre les cultures ouest-africaines et les écosystèmes marins tout en faisant découvrir les instruments modernes d’océanographie.
24 – Décret du 25 janvier 1937 portant protection des monuments naturels et des sites de caractère historique, légendaire ou pittoresque, des colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat relevant du ministère des Colonies. Arrêté n°2805 du 16 octobre 1937 pour l’AOF (Journal officiel de l’AOF, p. 1063).
25 – Lettre d’André Villard au gouverneur général de l’AOF datée du 21 octobre 1937. Archives IFAN, C2/1.
26 – DELCOURT, Jean. Gorée, six siècles d’histoire. Dakar : Clairafrique, 1984, p. 96. À proximité de Dakar, Gorée est considérée comme une villégiature balnéaire et la Marine y installe une maison de repos.
27 – Arrêté du 15 novembre 1944 portant l’inscription sur la liste des monuments naturels et des sites de l’île de Gorée tout entière. Journal officiel de l’AOF, 9 décembre 1944, p. 834. Arrêté complémentaire du 15 février 1951 déclarant Gorée « site historique » et prévoyant une commission spéciale pour examiner les demandes d’autorisation de travaux. Journal officiel de l’AOF, 15 février 1951, p. 234, art. 36/1 à 36/3.
28 – Plan publié par Robert Gaffiot. La légende indique que l’état des habitations fut levé par le sergent Castel en 1932. Il représente les espaces où les maisons sont encore en état, les maisons en ruines et enfin l’emplacement des maisons ayant disparu. (GAFFIOT, Robert. Gorée, toute petite île. Doubs : Arcs-et-Senans, 1933, plan hors-texte).
29 – Lettre de Théodore Monod adressée au Gouverneur général de Dakar et dépendances datée du 8 juillet 1942. Archives IFAN, n°812. (CAMARA, Abdoulaye, BENOIST, Joseph-Roger de. Histoire de Gorée, 2003, p. 135).
30 – MAUNY, Raymond. « En marge du centenaire de l’abolition de l’esclavage, l’île de Gorée ». Paris-Dakar, n° 3732, 22 avril 1948, p. 29.
31 – Ancienne esclaverie construite au XVIIIe siècle, (CAMARA, Abdoulaye, BENOIST, Joseph-Roger de. Histoire de Gorée, 2003, p. 110).
32 – Voir le site : http://fr.wikipedia.org/wiki/Boubacar_Joseph_Ndiaye [consulté le 25/04/2011].
33 – Voir le site : http://www.afrik.com/article9804.html [consulté le 17/06/2011].
34 – Le Soleil, 7 et 8 octobre 1978.
35 – Reportage documentaire sur l’île de Gorée, TF1, émission réalisée en mai 2005.
36 – Reportage documentaire sur l’île de Gorée, TF1, émission réalisée en mai 2005.
37 – Ndiaye, Boubacar Joseph. La maison des esclaves de Gorée. L’esclavage, ses origines et ses répercussions en Afrique ; Gorée historique et traite des noirs à Gorée. Dakar : Maison des Esclaves de Gorée, 1986.
38 – « J’ai été tellement ému par ce que j’ai vu et entendu que j’en ai pleuré, car je viens de comprendre combien la traite négrière était inhumaine, combien mes ancêtres ont souffert depuis leur mise en captivité, leur séjour dans les esclaveries du littoral africain et dans les bateaux qui les ont transportés en Amérique. J’ai eu l’impression d’avoir remonté le temps et vécu moi-même leur calvaire ». Extrait du livre d’or du musée, d’après DIOP, Boubacar Boris, TOBNER, Odile, VERSCHAVE, François-Xavier. Négrophobie. Paris : Les Arènes, 2005).
39 – KI-ZERBO, Joseph. Histoire d’Afrique Noire, d’hier à demain. Paris : Hatier, 1972. ANGRAND, Jean-Luc. L’ouverture de la vraie captiverie de Gorée en 2010 – dixit « Indignez vous ». 13 avril 2010, en ligne http://jeanlucangrand.blogspot.com/2010/04/louverture-de-la-vraie-captiverie-de.html [consulté le 15/04/2011].
40 – De Roux, Emmanuel. « Le mythe de la Maison des esclaves qui résiste à la réalité ». Le Monde, 27 décembre 1996.
41 – De Roux, Emmanuel. « Le mythe de la Maison des esclaves qui résiste à la réalité ». Le Monde, 27 décembre 1996.
42 – Samb, Djibril (dir). Gorée et l’esclavage, Actes du Séminaire sur « Gorée dans la traite atlantique : mythes et réalités », Gorée, 7-8 avril 1997. Dakar : IFAN-CAD, Initiations et Études Africaines, 38, juillet 1997. Voir aussi : SMITH, Stephen. Nécrologie, Pourquoi l’Afrique meurt. Paris : Hachette-Plurielles, 2004. DUARTE, Florence. Esclavage : la thèse qui choque Dakar : http://www.senegalaisement.com/senegal/esclavage_senegal.php [consulté le 01/06/2011].
43 – ANGRAND, Jean-Luc. Céleste ou le temps des signares. Paris : Éditions Anne Pépin, 2006, p. 48. Voir la critique de l’ouvrage par Xavier Ricou qui souligne à juste titre l’absence de sources, des informations lacunaires, des erreurs. http://www.senegalmetis.com/Senegalmetis/Celeste.html [consulté le 20/06/2011].
44 – THIOUB, Ibrahima, BOCOUM, Hamady. « Gorée et les mémoires de la Traite atlantique ». Dans SAMB, Djibril (dir.). Gorée et l’esclavage, Actes du Séminaire sur Gorée dans la traite atlantique : mythes et réalités, Gorée, 7-8 avril 1997. Dakar : IFAN-CAD, Initiations et Études Africaines, 38, juillet 1997, p. 200.
45 – SECK, Ibrahima. « Esclavage et traite des esclaves dans les manuels de l’enseignement secondaire du Sénégal : des programmes de domestication coloniale aux programmes dits d’enracinement et d’ouverture ». Revue Historiens-Géographes du Sénégal, n°8. Dakar : Faculté des Sciences et Technologies de l’Éducation et de la Formation, UCAD, 2009, p. 75. Bénin, Ouidah, Porte du non retour, http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Ouidah_Porte_du_Non_retour.jpg [consulté le 17/06/2011].
46 – NDIAYE, Boubacar Joseph. Il fut un jour à Gorée… l’esclavage raconté à nos enfants. Paris : Lafon, 2006.
47 – THIAW, Ibrahima. « L’archéologie de l’île de Gorée au Sénégal. Chaque maison a une histoire ». Dans SANSONE, Livio, SOUMONNI, Élisée, BARRY, Boubacar (dir.). La construction transatlantique d’identités noires. Entre Afrique et Amériques. Paris : Karthala, 2010, p. 41-56 [trad. française de l’ouvrage paru en anglais en 2008, issu du colloque tenu à Gorée en 2002] ; THIAW, Ibrahima. « L’espace entre les mots et les choses : mémoire historique et culture matérielle à Gorée (Sénégal) ». THIAW, Ibrahima (dir.). Espaces, culture matérielle et identités en Sénégambie. Dakar : CODESRIA, 2010, p. 18-40.
48 – La non implication dans le discours mémoriel ne signifie pas cependant désintérêt pour la préservation de l’île. De nombreux édifices ont été réhabilités et un important programme de protection de Gorée contre l’érosion marine sera élaboré et une recherche de financement entreprise. De même la requalification du Palais Roume en Auberge du Penseur a également été proposée par le Président Wade, sans connaître un début d’exécution.
49 – Poète, écrivain, homme politique, Léopold Sédar Senghor reprend la notion sur la Négritude, introduite par Aimé Césaire dès 1935, en la définissant ainsi : « La Négritude est la simple reconnaissance du fait d’être noir, et l’acceptation de ce fait, de notre destin de Noir, de notre histoire et de notre culture ». Fervent défenseur de la culture, la Négritude est pour lui « l’ensemble des valeurs culturelles de l’Afrique noire ». VAILLANT, Janet G. Vie de Léopold Sédar Senghor. Noir, Français et Africain. Paris : Karthala, 2006. DIAGNE, Bachir « In Praise of the Post-racial. Negritude beyond Negritude ». Third Text, Vol. 24, Issue 2, March, 2010, p. 241-248.
50 – Voir le site : http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/senghor/senghobiographie.asp [consulté le 02/07/2011].
51 – Voir le site : http://www.au-senegal.com/Festival-mondial-des-arts-negres,2982.html [consulté le 06/06/2011] ; Second Congrès des artistes et écrivains noirs. Paris : Présence Africaine, n° 27-28, t. 1, février-mai 1959, p. 417.
52 – Léopold Sédar Senghor, 19 mars 1966, allocution radiodiffusée.
53 – Le premier Festival Mondial des Arts Nègres. Bruxelles : Marci, 1966. Le président du Festival Alioune Diop préside également l’Association du Festival Mondial des Arts Nègres. Trente-sept pays participent à ce premier festival, dont trente pays africains. Grâce au soutien financier du gouvernement du Sénégal et de la Société Africaine de Culture, ce festival s’organise autour de plusieurs manifestations : – un colloque sur « Fonction et signification sur l’Art Nègre dans la vie du peuple et pour le peuple (30 mars-8 avril) » (Condé-sur-Noireau : Présence Africaine, 1967) ; – un spectacle tous les soirs par des artistes, danseurs, musiciens de chaque pays participant au Festival ; – une exposition « L’Art Nègre, Sources Évolution Expansion » (Dakar-Paris, 1966.).
54 – Voir le site : http://www.ina.fr/art-et-culture/musique/video/CAF89027584/festival-des-arts-negres-a-dakar.fr.html [consulté le 06/06/2011].
55 – À la demande des Sénégalais, le ministère français de la Coopération met à leur disposition Jean Mazel, qui a déjà réalisé en 1958 le spectacle de Marrakech. Le scénario est monté à partir des recherches menées par le département de l’IFAN sur l’histoire de Gorée. Ce scénario devait servir de canevas à un texte d’Aimé Césaire qui fut remplacé par Jean Brière, un Haïtien installé au Sénégal depuis 1964. Archives Nationales du Sénégal, FMAN 33 : Commission des spectacles. Spectacle féerique de Gorée. Opéra populaire en huit tableaux créé à l’occasion du premier Festival mondial des arts nègres. 1-24 avril 1966, Dakar. D’après Cyr Descamps, le spectable aurait été conçu en collaboration avec Charles Carrère.
56 – Dans les premières séquences du film Little Senegal de Richard Bouchareb, les touristes noirs américains sont saisis par l’émotion lors de la visite de la Maison des Esclaves. BOUCHAREB, Richard. Little Senegal, Tadrart Film, 2000, 1h38, long métrage algérien, français, allemand.
57 – Extrait de l’« Appel du Directeur général pour la sauvegarde de Gorée, 22 décembre 1980 ». Les Nouvelles de l’Unesco, n°41, 5 janvier 1981, p. 1-3. L’engouement des Américains pour la généalogie remonte à 1976, avec la parution de l’ouvrage de HALEY, Max. Roots. The Saga of an American Family, repris dans les séries télévisées Roots de 1977 et 1979. L’île de Gorée y est présentée comme « gataway to Roots ». Sur la marchandisation touristique de l’île de Gorée : EBRON, Paulla A. « Tourists as pilgrims: Commercial fashioning of transatlantic politics « . American Ethnologist, nov. 1999, 26, 4, p. 910-932. http://www.nyu.edu/classes/bkg/tourist/ebron-africa.pdf [consulté le 26/02/2013]
58 – Voir le site : http://www.goreediasporafestival.org/accueil.html [consulté le 06/06/2011].
59 – Île de Gorée. Zone urbaine de Dakar. Paris : Eurétudes, 1968. Le programme d’aménagement insiste sur cinq recommandations essentielles : la restauration et l’amélioration de l’urbanisme général du site par la création d’un complexe hôtelier moderne sur le Castel, le développement du centre de pêche sportive par une extension de la capacité d’accueil des installations au niveau du Relais de l’Espadon, la réalisation d’un équipement portuaire favorisant l’amélioration de la liaison maritime avec la ville de Dakar et enfin l’édification de nouvelles maisons d’un type particulier.
60 – Voir le site : http://archiwebture.citechaillot.fr/awt/asso/FRAPN02_AADOC_REPERAGE.pdf [consulté le 21/06/2011].
61 – Voir le site : http://www.senegalmetis.com/Senegalmetis/30_ans_de_classement.html [consulté le 21/06/2011].
62 – Descamps, Cyr. Préservation et mise en valeur du patrimoine national (décembre 1969 – janvier 1970). Paris : UNESCO, 1970.
63 – Convention et recommandations de l’UNESCO relatives à la protection du patrimoine culturel. Paris : UNESCO, 1983.
64 – Le critère VI de 1972 est d’« être directement ou matériellement associé à des événements ou des traditions vivantes, des idées, des croyances ou des œuvres artistiques et littéraires ayant une signification universelle exceptionnelle ». En 1977, le critère d’inscription de l’île de Gorée mentionne qu’elle : « … occupe une place de choix dans le patrimoine sénégalais en tant que vestige de choc de deux civilisations différentes, et le témoin d’une expérience humaine sans précédent dans l’histoire des peuples. En effet, Gorée est pour la conscience universelle, le symbole de la traite négrière avec son cortège de souffrance, de larme et de mort. L’attention que les autorités sénégalaises portent à cette île ne se réfère pas à un désir de s’attarder sur le passé à jamais enfoui, mais à une volonté de faire de l’île de Gorée l’archétype de la souffrance de l’homme noir à travers les âges à l’instar de tant d’autres lieux tristement célèbres où l’aveuglement et la haine ont naguère sévi. De plus, par-delà cet aspect historique, l’île de Gorée constitue en elle-même un ensemble architectural digne d’intérêt dont la conservation tel quel, est une des priorités du programme sénégalais de protection du patrimoine […] » (Formulaire de proposition d’inscription n° CC-77/WS/64. Dans GONODOU, Alain, ASSOMO, Lazare Éloundou. État de conservation de l’île de Gorée, rapport de mission ICOMOS (28 mars – 3 avril 2004). Centre du patrimoine mondial – ICOMOS, 2004, p. 7, en ligne : http://whc.unesco.org/archive/2004/mis-26-2004.pdf [consulté le 25/04/2011]).
65 – GRÉGOIRE, A. Sénégal. Monuments historiques de l’île de Gorée et de Saint-Louis du Sénégal. Paris : UNESCO, mai 1974, mss. dactyl. http://unesdoc.unesco.org/images/0001/000102/010200FB.pdf [consulté le 25/07/2011].
66 – FRAPOLLI, Jean-Pierre, CLERC, Maurice. Plan directeur de rénovation de l’île de Gorée. Aspects juridiques et financiers du programme de rénovation de l’île. Paris : UNESCO, 1975. http://unesdoc.unesco.org/images/0001/000161/016127fb.pdf [consulté le 25/07/2011].
67 – PARENT, Michel. L’avenir de Gorée. Paris : UNESCO, 1977, FMR/ CCT/ CH/ 77/ 184.
68 – LABLAUDE, Pierre-André. Réhabilitation du site historique de l’île de Gorée. Projet touristique de la Petite Côte. Sénégal. Paris : UNESCO, 1978. FMR/CC/CH/78/260(BIRD) ; 9988.SEN/21.
69 – UNESCO. Plan d’action pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l’île de Gorée. 1981. http://unesdoc.unesco.org/images/0004/000459/045955fb.pdf [consulté le 26/04/2011].
70 – Il s’agit de Michel Van der Meerschen (depuis le classement de l’île en 1978, jusqu’en 1982), puis de Françoise Descamps et Dirk Defraeije (en poste à partir de 1982).
71 – UNESCO. Gorée, island of memories. Paris : Unesco, 1985 (en anglais) : http://www.worditude.com/ebooks/unescopdf/goree.pdf [consulté le 06/04/2011]. L’UNESCO a aussi contribué à l’émission de timbres, [voir ad. Internet]. Au cours des années 2000, l’UNESCO a conçu un site internet pour une visite virtuelle de Gorée : http://webworld.unesco.org/goree/fr/index.shtml [consulté 07/04/2011].
72 – Gorée, île mémoire : Campagne internationale de sauvegarde. 1985, réd. 2008. http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001803/180301m.pdf [consulté le 26/07/2011].
73 – « Appel du Directeur général pour la sauvegarde de Gorée, 22 décembre 1980 ». Les Nouvelles de l’UNESCO, n°41, 5 janvier 1981, p. 1-3.
74 – Gorée, Guide de l’île et du musée historique. Dakar : IFAN, Musée Historique, 1993.
75 – LABLAUDE, Pierre-André. Préservation et restauration de l’île de Gorée. Paris : UNESCO, 1982. http://unesdoc.unesco.org/images/0005/000511/051197fo.pdf [consulté le 25/07/2011].
76 – Godonou, Alain, Assomo, Lazare Éloundou. État de conservation de l’île de Gorée, rapport de mission ICOMOS (28 mars – 3 avril 2004). Centre du patrimoine mondial – ICOMOS, 2004, p. 7. http://whc.unesco.org/archive/2004/mis-26-2004.pdf [consulté le 25/04/2011].
77 – Ce sont des « travaux de réparation consécutifs à l’effondrement d’un mur porteur au rez-de-chaussée »… « Les restaurations effectuées concernent certains éléments décoratifs supposés avoir disparu ». (Camara, Abdoulaye, Benoist, Joseph-Roger (de). Histoire de Gorée. Paris : Maisonneuve et Larose, 2003, p. 110).
78 – En 1990-1991, une nouvelle campagne de restauration de la Maison des esclaves a été entreprise avec l’aide financière du Comité France-Liberté. Les travaux devaient permettre de reconstituer à l’étage « une pièce d’habitation d’époque, décorée de meubles et d’objets pour la plupart d’origine », et de présenter une exposition de documents sur la vie quotidienne à Gorée au XVIIIe siècle.
79 – Adolphe d’Hastrel de Rivedoux, peintre, aquarelliste, lithographe, embrasse la carrière militaire et devient capitaine d’artillerie dans la marine. Au cours de ses périples, il fait escale au Sénégal en 1836 et y séjourne à nouveau en 1839. Lors de ce dernier passage, il réalise notamment une série d’aquarelles d’une grande précision sur Gorée, qu’il reproduira lui-même dans un album lithographique qu’il publie près de dix ans plus tard sous le titre « Colonie française du Sénégal ». Deux aquarelles nous donnent un état de la Maison dite des esclaves en 1839. Une vue de la cour intérieure de la Maison dite d’Anna Colas (ou Annacolas Pépin), portant la date du 20 février 1839. La vue a été inversée lors de la reprise lithographique effectuée par d’Hastrel lui-même. Une première épreuve de travail porte la mention en bas à gauche : À Gorée 20 février 1839 et à droite, après la signature [illisible]. Cette lithographie porte ensuite le titre : Une habitation à Gorée (Maison d’Anna Colas) pour être insérée comme la planche n°8 de l’album imprimé par Auguste Bry à Paris sur la « Colonie française du Sénégal », s.d. [vers 1848]. La façade sur l’actuelle rue Saint-Germain figure sur un second dessin aquarellé, daté du jour suivant, le 21 février 1839. La lithographie de l’aquarelle est signée par Théodore du Moncel et figure dans l’album sous le n°3. Le revers de l’aquarelle porte une esquisse de la rue Saint-Germain, vue du côté opposé. MAUNY, Raymond. « Aquarelles et dessins de d’Hastrel relatifs au Sénégal (1839) ». Dans Notes africaines, n°52, octobre 1951, p. 113-116 ; RICOU, Xavier. Trésors de l’iconographie du Sénégal colonial. Marseille : Riveneuve, 2007, p. 112-113. http://fr.wikipedia.org/wiki/Adolphe_d%27Hastrel [consulté le 02/08/2011]. http://www.senegalmetis.com/Senegalmetis/Signare_E4-6_dHastrel6.html [consulté le 02/08/2011]. Aquarelle achetée en 1951 par l’IFAN et qui aurait disparu. http://www.senegalmetis.com/Senegalmetis/Signare_E7_dHastrel3.html [consulté le 02/08/2011]. Aquarelle, collection Marie-José Crespin.
80 – UNESCO. Rapport Lablaude, Préservation et restauration de l’île de Gorée. 1982, p. 14.
81 – Voir le site : http://www.geolocation.ws/v/I/5556385582830076641-5560936314785677810/maison-des-esclaves—la-porte-sans/en [consulté le 02/08/2011]. État décembre 2010 : terrasse en cours de construction.
82 – RICOU, Xavier. « Gorée, ville métisse ». Dans CAMARA, Abdoulaye et BENOIST, Joseph Roger de. Histoire de Gorée. Paris : Maisonneuve et Larose, 2003, p. 92.
83 – Les trois établissements sont : la Maison du Soudan, devenue un centre d’étude ; la Capitainerie du port, servant provisoirement d’annexe à l’Université des Mutants ; la Maison Victoria Albis, accueillant des expositions, ainsi que les locaux du Bureau d’architecture des monuments historiques et la résidence de l’expert de l’UNESCO envoyé à Gorée. HAARDT, Caroline. « Gorée, l’île aux esclaves ». Courrier de l’UNESCO, octobre 1992, p. 48-50.
84 – UNESCO, 27ème session du Comité du Patrimoine mondial : État de conservation des biens inscrits sur la liste du patrimoine en péril, référence WHC-03/27.COM/7B, 2003, p. 27, en ligne http://whc.unesco.org/archive/2003/whc03-27com-07bf.pdf [consulté le 06/04/2011].
85 – Voir le site : http://www.abolitions.org/index.php?IdPage=1173454388 [consulté le 16/07/2011].
86 – MATSUURA, Koichiro. « Discours prononcé lors du lancement de l’année internationale de la commémoration de la lutte de l’esclavage et de son abolition à Cape Coast (Ghana) en 2004 ». Bulletin d’information de l’Unesco, numéro spécial, 2004.
87 – GUEYE, Mbaye. Sites liés à la traite négrière et à l’esclavage en Sénégambie. Pour un tourisme de mémoire. UNESCO, 2005 [secteur de Gorée, p. 35-48]. http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001401/140126f.pdf.
88 – Le Musée maritime de Merseyside à Liverpool, point de départ du trafic de la traite anglaise abrite depuis 1994 une Transatlantique Slavery Gallery, qui est devenue en 2007 un musée international permanent consacré à la traite transatlantique. http://www.liverpoolmuseums.org.uk/ism/.
89 – « Gorée, La Maison des Esclaves, Sénégal ». Dakar : Foreign and Commonwealth Office/ National Museum galleries on Merseyside/The britisch Council, s. d. [2001 ?], [Brochure exposition].
90 – Voir les trois vidéos de l’exposition de Lamine Barro sur You Tube : http://www.youtube.com/watch?v=bNnQPMDjgMs ; http://www.youtube.com/watch?v=fK09VVpum2c&feature=related ; http://www.youtube.com/watch?v=HXo5Lijegrg&feature=related. L’exposition a été également présentée au Musée de l’IFAN à Dakar et dans d’autres lieux : http://www.comite-memoire-esclavage.fr/spip.php?article423.
91 – Le Soleil, 26 novembre 1976. Cette idée du président Senghor a été reprise une génération plus tard par le président Wade pour la construction de sa statue géante de La Renaissance africaine.
92 – Le Soleil, 26 novembre 1976.
93 – En 1998-1999, ce concours international a également inspiré de nombreux mémoires de Travaux personnels de fin d’études (TPFE) pour l’obtention du diplôme d’architecte DPLG dans les écoles d’architecture de Paris-la-Seine, Paris-Villemin, Grenoble, Nantes, Marne-la-Vallée, Lyon… http://portail.documentation.developpement-durable.gouv.fr/ArchiResWiki/index.php/ACC%C3%88S%C3%80_LA_BASE : Gorée [consulté le 21/07/2011].
94 – Voir les sites : http://www.unesco.org/bpi/fre/unescopresse/97-150f.htm [consulté le 21/07/2011]. http://www.odb.it/goree.htm [consulté le 01/08/2011]. http://europaconcorsi.com/projects/159587-Gor-e-Memorial/slideshow [consulté le 01/08/2011].
95 – Voir le site : http://www.uia-architectes.org/texte/nouvelles/1a1z1a.html [consulté le 21/07/11].
96 – Le Soleil, 14 janvier 1998. Allocution du président de la République du Sénégal lors de la remise des prix aux lauréats du Mémorial de Gorée.
97 – Voir le site : http://www.unesco.org/bpi/fre/unescopresse/98-07f.htm [consulté le 21/07/2011].
98 – WHC-10/34.COM/8E.Add.2. Brasilia, 1er août 2010, http://whc.unesco.org/archive/2010/whc10-34com-8E.Add2f.pdf [consulté le 21/07/2011].
99 – Voir le site : http://www.memorial-goree.com/ [consulté le 21/07/2011].
100 – Voir le site : http://www.gudev.cz/ [consulté le 21/07/2011].
101 – Le projet de 2011 réapparaît en novembre 2012, porté ( ?) par le ministre de la culture avec l’aide d’Amadou Lamine Sall. Le symbole du navire est repris, dessiné par le studio tchèque Helika. http://www.helika.cz/#/projekty/aktualni/1619 [consulté le 27/02/2013].
102 – Thiam, Alassane, Thilmans, Guy. « Gorée l’île musée, Création d’un musée historique ». Museum, volume XXXII, n° 3, p. 119-129.
103 – Gorée, Guide de l’île et du musée historique. IFAN : Musée Historique, 1993. Pour l’histoire du musée historique : DESCAMPS, Cyr et CAMARA, Abdoulaye. « Le Musée Historique : cinquante ans de présence à Gorée (1954-2004) ». Senegalia. Études sur le patrimoine ouest-africain. Saint-Maur-des-Fossés, Sépia, 2006, p. 150-160.
104 – Voir le site : http://mufem.org/index.php [consulté le 21/08/2011].
105 – Pour l’histoire de ce musée : http://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_de_la_Femme_Henriette-Bathily [consulté le 13/10/2011].
106 – En avril 2011, ce Musée de la Femme était fermé depuis quelques mois.t. Deux ans plus tard, la décision de délocaliser ce musée sur le continent est effective . Les expositions sont en cours de démontage.
107 – MONOD, Théodore. « Le musée de la mer, Gorée, Sénégal ». Museum international, vol. 14, déc. 1961, p. 1-11.
108 – UNESCO-BREDA (Bureau Régional de Dakar). Répertoire des musées du Sénégal. Dakar : Grafiti, 2008, en ligne : http://wamponline.org/Repertoire_des_musees_du_senegal.pdf [consulté le 21/06/2011].
109 – Parmi les partenaires il faut citer l’Association des amis du musée, et le projet Chélonée.
110 – TOULIER, Bernard. « Architecture coloniale, identités culturelles et patrimoine en Afrique francophone ». Dans ANDRIEUX, Jean-Yves (dir.). Patrimoine, sources et paradoxes de l’identité. Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2011, p. 117-142.
111 – LABLAUDE, Pierre-André. « À Gorée au Sénégal : l’île aux esclaves ». Monuments Historiques, n°162, fév.-mars 1989, p. 88-92. L’auteur prône une « pratique [patrimoniale] métissée, parfois lointaine des préceptes rigides d’une Charte de Venise vieillie et perçue de plus en plus comme attardée dans une guerre de tranchée post-viollet-le-ducienne, à la dialectique trop exclusivement européenne ».
112 – BOCOUM, Hamady. « Gorée et les mémoires de la Traite atlantique ». Dans Samb, Djibril (dir.). « Gorée et l’esclavage », Actes du Séminaire sur « Gorée dans la traite atlantique : mythes et réalités ». Gorée, 7-8 avril 1997. Dakar : IFAN-CAD, Initiations et Études Africaines, 38, juillet 1997, p. 200.
113 – FRANK, Robert. « La mémoire et l’histoire ». Dans VOLDMAN, Danièle (dir.). La Bouche de la vérité ? « La recherche historique et les sources orales ». Les cahiers de l’Institut d’histoire du temps présent, n°21, nov. 1992, p. 65-72.
















 Publié par jcdurbant
Publié par jcdurbant 


















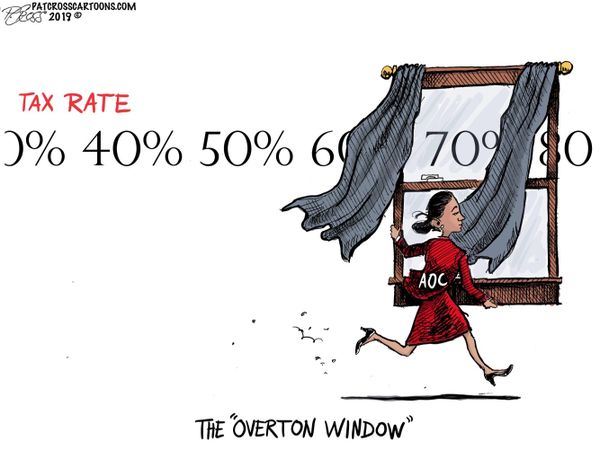


















 Nous sommes entrés dans un mouvement qui est de l’ordre du religieux. Entrés dans la mécanique du sacrilège : la victime, dans nos sociétés, est entourée de l’aura du sacré. Du coup, l’écriture de l’histoire, la recherche universitaire, se retrouvent soumises à l’appréciation du législateur et du juge comme, autrefois, à celle de la Sorbonne ecclésiastique.
Nous sommes entrés dans un mouvement qui est de l’ordre du religieux. Entrés dans la mécanique du sacrilège : la victime, dans nos sociétés, est entourée de l’aura du sacré. Du coup, l’écriture de l’histoire, la recherche universitaire, se retrouvent soumises à l’appréciation du législateur et du juge comme, autrefois, à celle de la Sorbonne ecclésiastique.  L‘anglais ? Ce n’est jamais que du français mal prononcé.
L‘anglais ? Ce n’est jamais que du français mal prononcé. 

 Il n’y a plus ni Juif ni Grec, il n’y a plus ni esclave ni homme libre, il n’y a plus ni homme ni femme; car tous vous êtes un en Jésus-Christ.
Il n’y a plus ni Juif ni Grec, il n’y a plus ni esclave ni homme libre, il n’y a plus ni homme ni femme; car tous vous êtes un en Jésus-Christ.  Parmi les hommes, ce sont ordinairement ceux qui réfléchissent le moins qui ont le plus le talent de l’imitation. Buffon
Parmi les hommes, ce sont ordinairement ceux qui réfléchissent le moins qui ont le plus le talent de l’imitation. Buffon