Tu ne prendras pas pour autre épouse la sœur de ta femme, car tu provoquerais des rivalités entre elles en ayant des relations avec la sœur, tant que ta femme est en vie. Lévitique 18: 18
C’est à cause de la dureté de votre coeur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes; au commencement, il n’en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. (…) Laissez les petits enfants, et ne les empêchez pas de venir à moi; car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Jésus (Matthieu 19: 8-14)
J’ai une prémonition qui ne me quittera pas: ce qui adviendra d’Israël sera notre sort à tous. Si Israël devait périr, l’holocauste fondrait sur nous. Eric Hoffer
Tuez-les, crachez-leur au visage, et écrasez-les avec vos voitures. Jihadiste français (Etat islamique)
Aujourd’hui, c’est le jour du marché aux esclaves. C’est le jour de la distribution, et si Dieu le veut, chacun aura sa part. Militant de l’Etat islamique
Si vous pouvez tuer un incroyant américain ou européen – en particulier les méchants et sales Français – ou un Australien ou un Canadien, ou tout […] citoyen des pays qui sont entrés dans une coalition contre l’État islamique, alors comptez sur Allah et tuez-le de n’importe quelle manière. (…) Tuez le mécréant qu’il soit civil ou militaire. (…) Frappez sa tête avec une pierre, égorgez-le avec un couteau, écrasez-le avec votre voiture, jetez-le d’un lieu en hauteur, étranglez-le ou empoisonnez-le. Abou Mohammed al-Adnani (porte-parole de l’EI)
What do we want? Dead cops! When do we want it? Now! Manifestants de New York (13.12.14)
Plus de 1.000 combattants européens enrôlés dans ses rangs sont revenus dans l’espace Schengen. (…) L’adversaire n’est plus seulement aux portes de l’Europe, il en a franchi le seuil. [d’où] la nécessité d’intégrer encore plus dans notre réflexion le retour de l’armée de terre sur son milieu naturel, celui du sol national, pour pourvoir y faire face, avec les forces de sécurité, à tous types de menaces dont celles que ces vingt dernières années avaient confinées à l’extérieur. Général Jean-Pierre Bosser (chef d’état-major de l’armée de terre)
C’est la peur aussi sciemment installée d’une religion, l’Islam, qui de façon inacceptable est présentée par certains comme incompatible avec la République, alors que la République a toujours respecté les religions, et que les religions ont toujours été capables de comprendre les valeurs qui devaient être respectées. Le fait nouveau, c’est que ces vents mauvais soufflent de plus en plus, et pas seulement en France, partout en Europe. C’est pourquoi il nous faut une fois encore reprendre le combat et faire en sorte de répondre et de ne rien laisser passer, en montrant d’abord la force de l’intégration. François Hollande
De nouveaux détails ont émergé sur le calvaire que subissent les femmes otages et esclaves sexuelles de l’État islamique. Un site d’informations irakien affirme avoir trouvé une grille de tarifs de vente des yazidies et des chrétiennes capturées par les combattants de Daech. Quiconque ne respecte pas ces prix sera exécuté, met en garde cette note, dont l’authenticité n’a pas été contestée à ce jour. Elle rappelle qu’un homme ne peut pas «acquérir» plus de trois femmes, sauf, précision étrange, s’il est un étranger originaire de Syrie, de Turquie, d’Arabie saoudite ou des Émirats. Les femmes les plus chères sont les plus jeunes. Pour une enfant âgée de moins de 10 ans, il en coûtera 200.000 dinars (138 euros). Pour une jeune femme de moins de 20 ans 100.000 dinars (104 euros). Pour une trentenaire 75.000 dinars (52 euros). Pour une femme quadragénaire 50.000 dinars (35 euros). Le document déplore même que «le marché de la femme soit à la baisse, ce qui a nui aux finances de l’État islamique». Une vidéo, tournée à Mossoul et traduite il y a quelques jours en anglais, donne une illustration glaçante de ces pratiques. On y voit des combattants islamiques échanger des conseils pour bien négocier les prix. «Aujourd’hui, c’est le jour du marché aux esclaves. C’est le jour de la distribution, et si Dieu le veut, chacun aura sa part», se réjouit un militant. (…) D’après des ONG, plus de 4.600 femmes yazidies sont portées disparues depuis l’offensive de Daech en Syrie et en Irak. Dans les premières semaines, des otages arrivaient encore à contacter des associations décrivant des bordels où les femmes étaient traitées comme du bétail et où certaines étaient violées plus de 30 fois par jour. Mais désormais, c’est le silence le plus total. D’après des témoignages de djihadistes, l’État islamique a fait de son trafic de femmes un argument de recrutement, faisant miroiter aux nouveaux venus une abondance de concubines. Le Figaro
Peut-on imaginer personnage littéraire plus désagréable que le Dieu de l’Ancien Testament? Jaloux et en étant fier; obsédé de l’autorité, mesquin, injuste et impitoyable; vengeur et sanguinaire tenant de l’épuration ethnique; tyrannique, misogyne, homophobe, raciste, infanticide, génocidaire, fillicide, pestilentiel, mégalomane, sadomasochiste et capricieusement diabolique. Richard Dawkins (2006)
Je m’ennuie follement dans la monogamie, même si mon désir et mon temps peuvent être reliés à quelqu’un et que je ne nie pas le caractère merveilleux du dévelopement d’une intimité. Je suis monogame de temps en temps mais je préfère la polygamie et la polyandrie. Carla Bruni
Avec la crise économique dans mon pays, peu d’hommes peuvent entretenir plusieurs épouses. En France, c’est différent, tous ces enfants sont une source de revenus. Oumar Dicko (ministre chargé des Maliens de l’extérieur)
Mais les fils n’ont pas ce choix. Ils ont grandi dans les basses couches de la société, sans les compétences intellectuelles nécessaires pour améliorer leur position. Ce sont ces garçons qui mettent le feu à Paris, ou dans des quartiers de Brême. Certains d’entre eux parviennent jusqu’à l’université et deviennent des leaders pour les autres – pas des pauvres, mais de jeunes hommes de rang social peu élevé, qui croient être opprimés à cause de leur confession musulmane, alors qu’en réalité c’est le système social qui a créé cette classe de perdants. Gunnar Heinsohn
Certains islamistes peuvent se montrer respectueux des lois et raisonnables, mais ils font partie d’un mouvement totalitariste et, à ce titre, doivent être considérés comme des meurtriers potentiels. Daniel Pipes
Il arriverait, si nous savions mieux analyser nos amours, de voir que souvent les femmes ne nous plaisent qu’à cause du contrepoids d’hommes à qui nous avons à les disputer. Proust
Ceux qui considèrent l’hébraïsme et le christianisme comme des religions du bouc émissaire parce qu’elles le rendent visible font comme s’ils punissaient l’ambassadeur en raison du message qu’il apporte. René Girard
De nombreux commentateurs veulent aujourd’hui montrer que, loin d’être non violente, la Bible est vraiment pleine de violence. En un sens, ils ont raison. La représentation de la violence dans la Bible est énorme et plus vive, plus évocatrice, que dans la mythologie même grecque. (…) Il est une chose que j’apprécie dans le refus contemporain de cautionner la violence biblique, quelque chose de rafraîchissant et de stimulant, une capacité d’indignation qui, à quelques exceptions près, manque dans la recherche et l’exégèse religieuse classiques. (…) Une fois que nous nous rendons compte que nous avons à faire au même phénomène social dans la Bible que la mythologie, à savoir la foule hystérique qui ne se calmera pas tant qu’elle n’aura pas lynché une victime, nous ne pouvons manquer de prendre conscience du fait de la grande singularité biblique, même de son caractère unique. (…) Dans la mythologie, la violence collective est toujours représentée à partir du point de vue de l’agresseur et donc on n’entend jamais les victimes elles-mêmes. On ne les entend jamais se lamenter sur leur triste sort et maudire leurs persécuteurs comme ils le font dans les Psaumes. Tout est raconté du point de vue des bourreaux. (…) Pas étonnant que les mythes grecs, les épopées grecques et les tragédies grecques sont toutes sereines, harmonieuses et non perturbées. (…) Pour moi, les Psaumes racontent la même histoire de base que les mythes mais retournée, pour ainsi dire. (…) Les Psaumes d’exécration ou de malédiction sont les premiers textes dans l’histoire qui permettent aux victimes, à jamais réduites au silence dans la mythologie, d’avoir une voix qui leur soit propre. (…) Ces victimes ressentent exactement la même chose que Job. Il faut décrire le livre de Job, je crois, comme un psaume considérablement élargi de malédiction. Si Job était un mythe, nous aurions seulement le point de vue des amis. (…) La critique actuelle de la violence dans la Bible ne soupçonne pas que la violence représentée dans la Bible peut être aussi dans les évènements derrière la mythologie, bien qu’invisible parce qu’elle est non représentée. La Bible est le premier texte à représenter la victimisation du point de vue de la victime, et c’est cette représentation qui est responsable, en fin de compte, de notre propre sensibilité supérieure à la violence. Ce n’est pas le fait de notre intelligence supérieure ou de notre sensibilité. Le fait qu’aujourd’hui nous pouvons passer jugement sur ces textes pour leur violence est un mystère. Personne d’autre n’a jamais fait cela dans le passé. C’est pour des raisons bibliques, paradoxalement, que nous critiquons la Bible. (…) Alors que dans le mythe, nous apprenons le lynchage de la bouche des persécuteurs qui soutiennent qu’ils ont bien fait de lyncher leurs victimes, dans la Bible nous entendons la voix des victimes elles-mêmes qui ne voient nullement le lynchage comme une chose agréable et nous disent en des mots extrêmement violents, des mots qui reflètent une réalité violente qui est aussi à l’origine de la mythologie, mais qui restant invisible, déforme notre compréhension générale de la littérature païenne et de la mythologie. René Girard
Le seul point sur lequel les Etats, les théologiens et les juristes musulmans font une quasi-unanimité, c’est la question de l’interdiction de la polygamie réclamée par certaines associations féminines. Une telle interdiction serait illicite, de leur point de vue, parce qu’elle équivaudrait à rendre illicite ce que Dieu a déclaré licite, puisque c’est le Coran lui-même qui a explicitement défini le statut juridique de la polygamie. (…) De nombreux auteurs estiment que la polygamie se justifiait, au temps de la Révélation, du fait des circonstances très particulières de l’époque. On cite souvent, à ce propos, l’exemple du Prophète, qui s’est marié à plusieurs femmes, pendant les dix dernières années de sa vie, du temps de son séjour à Médine. « C’était une période de guerres, et il y avait un très grand nombre de femmes qui n’avaient personne pour s’enquérir de leur sort. La plupart des femmes du Prophète étaient veuves ou âgées. Beaucoup d’entre elles avaient des enfants de leurs ex-maris. » D’après ces auteurs, la polygamie peut continuer de se justifier, dans les temps modernes, dans des circonstances exceptionnelles. Par exemple, à la suite d’une guerre meurtrière qui a décimé les hommes au front, le nombre de femmes en âge de se marier peut largement dépasser celui des hommes. Khalid Chraibi
Our goal was to understand why monogamous marriage has become standard in most developed nations in recent centuries, when most recorded cultures have practiced polygyny. The emergence of monogamous marriage is also puzzling for some as the very people who most benefit from polygyny — wealthy, powerful men — were best positioned to reject it. Our findings suggest that institutionalized monogamous marriage provides greater net benefits for society at large by reducing social problems that are inherent in polygynous societies. (…) The scarcity of marriageable women in polygamous cultures increases competition among men for the remaining unmarried women. Prof. Joseph Henrich (University of British Columbia)
Considered the most comprehensive study of polygamy and the institution of marriage, the study finds significantly higher levels rape, kidnapping, murder, assault, robbery and fraud in polygynous cultures. According to Henrich and his research team, which included Profs. Robert Boyd (UCLA) and Peter Richerson (UC Davis), these crimes are caused primarily by pools of unmarried men, which result when other men take multiple wives. Science Daily
Selon les données anthropologiques disponibles, environ 85 % des sociétés humaines passées ont permis aux hommes d’avoir plus d’une épouse par un mariage polygame. On pourrait empiriquement penser que l’accroissement de la richesse des « élites » devraient favoriser encore plus les mariages polygames18. Or, la tendance est contraire : le mariage monogame s’est propagé à travers l’Europe, et plus récemment dans le monde, même chez les « élites », alors même que les écarts de richesse ont grandi. Peter Richerson et son équipe (Université UC Davis, Californie) ont utilisé les données criminologiques disponibles pour comparer sociétés polygames et monogames. Elles laissent penser que les cultures monogames connaissent moins de viol, d’enlèvement, assassinat et maltraitance d’enfants, et d’autres crimes que les sociétés polygames. Comparativement, selon cette étude, l’institutionnalisation du mariage ou couple monogame semble apporter plus d’avantages nets pour la société. Une explication proposée par les auteurs est que dans les sociétés polygames, de nombreux hommes sont contraints au célibat et laissés pour compte, avec moins d’espoir de pouvoir vivre avec une femme. Ils seraient alors plus susceptibles de violence et de comportements asociaux ; Peter Richerson pose l’hypothèse que la monogamie institutionnalisée est associée à un modèle culturel mieux adapté au monde moderne, réduisant la compétition intrasexuelle chez les jeunes, et réduisant par suite le taux de criminalité (dont en termes de viol, assassinat, agression, vol et fraude, ou de certains abus personnels) tout en diminuant les écarts d’âge entre conjoints, la fertilité, et l’inégalité des sexes et en déplaçant les efforts des hommes de la recherche d’une épouse vers plus d’investissement paternel, et une meilleure productivité économique. Peter Richerson estime qu’en augmentant le degré de parenté au sein des ménages, la monogamie normative réduit les conflits intra-ménage, et conduisant= à moins de négligence envers les enfants, moins d’abus, de mort accidentelle et d’homicide. Wikipedia
Viols, enlèvements, assassinats, maltraitance d’enfants, vols, fraudes, inégalités homme-femme …
A l’heure où après avoir exposé au monde, dans les textes sacrés les plus violents de l’histoire de l’humanité et d’Abraham à Jacob et de David à Salomon, tous les travers et méfaits imaginables des relations homme-femme …
Et démontré enfin avec la monogamie tout le bien-fondé d’une singularité judéo-chrétienne que nos élites s’étaient imposées contre leurs intérêts immédiats mêmes …
Nos sociétés dites avancées n’ont pas de mots plus durs pour la source de leurs avancées …
Et, après l’exaltation de la sérialité (polygamique ou monogamique) et du métissage, nous matraquent à présent avec l’aberration du « mariage homosexuel » …
Pendant qu’entre enlèvements, ventes et massacres de femmes et d’enfants et du Proche-Orient au Sous-continent indien et en passant par l’Afrique, la religion de paix et d’amour démontre chaque jour un peu plus malgré les premiers revers le véritable fond de sa pensée …
Et que poussés au passage à l’acte par la fureur djihadiste ou la victimose ambiante et leur faisant éprouver à leur tour ce que subit depuis des années Israël, s’installent durablement en leur sein même, de New York à Ottawa et de Sydney à New York ou de Tours à Dijon, une véritable classe de perdants …
Comment ne pas voir avec une récente étude canadienne …
L’une des évidentes sources, via le surplus de jeunes désoeuvrés et frustrés qu’elle produit, de la violence spécifique des sociétés musulmanes …
A savoir sous couvert de défense de la veuve et de l’orphelin suite à leurs incessantes guerres …
La tolérance de la polygamie ?
Monogamy reduces major social problems of polygamist cultures
Science Daily
January 24, 2012
Source:
University of British Columbia
Summary:
In cultures that permit men to take multiple wives, the intra-sexual competition that occurs causes greater levels of crime, violence, poverty and gender inequality than in societies that institutionalize and practice monogamous marriage. That is a key finding of a new study that explores the global rise of monogamous marriage as a dominant cultural institution. The study suggests that institutionalized monogamous marriage is rapidly replacing polygamy because it has lower levels of inherent social problems.
In cultures that permit men to take multiple wives, the intra-sexual competition that occurs causes greater levels of crime, violence, poverty and gender inequality than in societies that institutionalize and practice monogamous marriage.
That is a key finding of a new University of British Columbia-led study that explores the global rise of monogamous marriage as a dominant cultural institution. The study suggests that institutionalized monogamous marriage is rapidly replacing polygamy because it has lower levels of inherent social problems.
« Our goal was to understand why monogamous marriage has become standard in most developed nations in recent centuries, when most recorded cultures have practiced polygyny, » says UBC Prof. Joseph Henrich, a cultural anthropologist, referring to the form of polygamy that permits multiple wives, which continues to be practiced in some parts of Africa, Asia, the Middle East and North America.
« The emergence of monogamous marriage is also puzzling for some as the very people who most benefit from polygyny — wealthy, powerful men — were best positioned to reject it, » says Henrich, lead author of the study that was recently published in the journal Philosophical Transactions of the Royal Society. « Our findings suggest that institutionalized monogamous marriage provides greater net benefits for society at large by reducing social problems that are inherent in polygynous societies. »
Considered the most comprehensive study of polygamy and the institution of marriage, the study finds significantly higher levels rape, kidnapping, murder, assault, robbery and fraud in polygynous cultures. According to Henrich and his research team, which included Profs. Robert Boyd (UCLA) and Peter Richerson (UC Davis), these crimes are caused primarily by pools of unmarried men, which result when other men take multiple wives.
« The scarcity of marriageable women in polygamous cultures increases competition among men for the remaining unmarried women, » says Henrich, adding that polygamy was outlawed in 1963 in Nepal, 1955 in India (partially), 1953 in China and 1880 in Japan. The greater competition increases the likelihood men in polygamous communities will resort to criminal behavior to gain resources and women, he says.
According to Henrich, monogamy’s main cultural evolutionary advantage over polygyny is the more egalitarian distribution of women, which reduces male competition and social problems. By shifting male efforts from seeking wives to paternal investment, institutionalized monogamy increases long-term planning, economic productivity, savings and child investment, the study finds. Monogamy’s institutionalization has been assisted by its incorporation by religions, such as Christianity.
Monogamous marriage also results in significant improvements in child welfare, including lower rates of child neglect, abuse, accidental death, homicide and intra-household conflict, the study finds. These benefits result from greater levels of parental investment, smaller households and increased direct « blood relatedness » in monogamous family households, says Henrich, who served as an expert witness for British Columbia’s Supreme Court case involving the polygamous community of Bountiful, B.C.
Monogamous marriage has largely preceded democracy and voting rights for women in the nations where it has been institutionalized, says Henrich, the Canadian Research Chair in Culture, Cognition and Evolution in UBC’s Depts. of Psychology and Economics. By decreasing competition for younger and younger brides, monogamous marriage increases the age of first marriage for females, decreases the spousal age gap and elevates female influence in household decisions which decreases total fertility and increases gender equality.
Story Source:
The above story is based on materials provided by University of British Columbia. Note: Materials may be edited for content and length.
Journal Reference:
J. Henrich, R. Boyd, P. J. Richerson. The puzzle of monogamous marriage. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 2012; 367 (1589): 657 DOI: 10.1098/rstb.2011.0290
In cultures that permit men to take multiple wives, the intra-sexual competition that occurs causes greater levels of crime, violence, poverty and gender inequality than in societies that institutionalize and practice monogamous marriage.
That is a key finding of a new University of British Columbia-led study that explores the global rise of monogamous marriage as a dominant cultural institution. The study suggests that institutionalized monogamous marriage is rapidly replacing polygamy because it has lower levels of inherent social problems.
« Our goal was to understand why monogamous marriage has become standard in most developed nations in recent centuries, when most recorded cultures have practiced polygyny, » says UBC Prof. Joseph Henrich, a cultural anthropologist, referring to the form of polygamy that permits multiple wives, which continues to be practiced in some parts of Africa, Asia, the Middle East and North America.
« The emergence of monogamous marriage is also puzzling for some as the very people who most benefit from polygyny — wealthy, powerful men — were best positioned to reject it, » says Henrich, lead author of the study that was recently published in the journal Philosophical Transactions of the Royal Society. « Our findings suggest that that institutionalized monogamous marriage provides greater net benefits for society at large by reducing social problems that are inherent in polygynous societies. »
Considered the most comprehensive study of polygamy and the institution of marriage, the study finds significantly higher levels rape, kidnapping, murder, assault, robbery and fraud in polygynous cultures. According to Henrich and his research team, which included Profs. Robert Boyd (UCLA) and Peter Richerson (UC Davis), these crimes are caused primarily by pools of unmarried men, which result when other men take multiple wives.
« The scarcity of marriageable women in polygamous cultures increases competition among men for the remaining unmarried women, » says Henrich, adding that polygamy was outlawed in 1963 in Nepal, 1955 in India (partially), 1953 in China and 1880 in Japan. The greater competition increases the likelihood men in polygamous communities will resort to criminal behavior to gain resources and women, he says.
According to Henrich, monogamy’s main cultural evolutionary advantage over polygyny is the more egalitarian distribution of women, which reduces male competition and social problems. By shifting male efforts from seeking wives to paternal investment, institutionalized monogamy increases long-term planning, economic productivity, savings and child investment, the study finds. Monogamy’s institutionalization has been assisted by its incorporation by religions, such as Christianity.
Monogamous marriage also results in significant improvements in child welfare, including lower rates of child neglect, abuse, accidental death, homicide and intra-household conflict, the study finds. These benefits result from greater levels of parental investment, smaller households and increased direct « blood relatedness » in monogamous family households, says Henrich, who served as an expert witness for British Columbia’s Supreme Court case involving the polygamous community of Bountiful, B.C.
Monogamous marriage has largely preceded democracy and voting rights for women in the nations where it has been institutionalized, says Henrich, the Canadian Research Chair in Culture, Cognition and Evolution in UBC’s Depts. of Psychology and Economics. By decreasing competition for younger and younger brides, monogamous marriage increases the age of first marriage for females, decreases the spousal age gap and elevates female influence in household decisions which decreases total fertility and increases gender equality.
Story Source:
The above story is based on materials provided by University of British Columbia. Note: Materials may be edited for content and length.
Journal Reference:
J. Henrich, R. Boyd, P. J. Richerson. The puzzle of monogamous marriage. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 2012; 367 (1589): 657 DOI: 10.1098/rstb.2011.0290
Voir aussi:
Biblical Polygamy Does Not Turn out Well
Curated by Mike Schultz
Though polygamy is clearly allowed in the Bible, it almost always leads to really bad situations. Of the three religions coming out of the Bible, Christianity (early) and Judaism (much later) ended polygamy while Islam continued it.
Jacob Marries Two Sisters: Rachel and Leah
Source: biblegateway.com
There are several stories of polygamy in the Bible, and they almost all turn out badly.
In Genesis 29 (see this article attached to this learning for the complete story), Jacob has fled Canaan from his murderous brother Esau after deceptively obtaining Esau’s blessing from Isaac. He makes his way to Haran, to his uncle Laban’s house. There he ends up marrying Laban’s two daughters, Leah and Rachel, as well as their two handmaidens, Bilhah and Zilpah. But he only married Leah because he was tricked into it, and as verse 29:31 records, Leah was hated. Some translations offer the nicer « unloved » or « not loved, » but the literal Hebrew is quite clearly hate.
Reading through this chapter, and the explanations that Leah gives to the names each of her children receives, it’s heart-wrenching to see what it can be like for one wife when a different wife is clearly preferred by her husband. And when they’re sisters, of course, it’s that much worse.
This dynamic doesn’t end – the children of Rachel are preferred by Jacob to the children of Leah, leading to a lot of resentment and ultimately the brothers’ selling Joseph (Rachel’s son) down to Egypt.
Later on in the Bible, the reality that it’s not such a good idea to marry two sisters is turned into a proper prohibition:
« You shall not take a woman as a wife after marrying her sister, as her rival, to uncover her nakedness beside the other during her lifetime. » (Vayikra 18:18)
Abraham, Sarah and Hagar: Hagar Is Banished
Source: torah.org
A couple of generations earlier, Abraham’s wife, Sarah, who he loves, is barren for many years. So she suggests that Abraham take her maidservant, Hagar, as his second wife. But she ends up regretting it pretty quickly, as Hagar starts disrespecting her from the moment that she becomes pregnant. In two separate episodes, Sarah demands that Abraham banish Hagar, first when she is pregnant and then after Hagar’s teenaged son, Ishmael, is mistreating Sarah’s young son, Isaac (don’t let the image trick you – Ishmael is 13 years older than Isaac, not the same age as in this painting). In each case, Hagar and Ishmael almost perish in the desert but are miraculously saved.
So Sarah and Hagar did really poorly as co-wives. This post retells the full story and suggests based on a rabbinic source that Sarah acted inappropriately. Here maybe the message is not to marry your wife and her servant.
Very interestingly, after Sarah dies, the midrash suggests that Isaac took an unusual step. Abraham’s servant was off searching for a wife for Isaac. Isaac, according to the midrash, felt that the least he could in return was make sure his father wasn’t alone. So in Genesis 24:62, he went to the Well of the Eternal One Who Sees, the well named by Hagar after her miraculous salvation. Why did he go there? The midrash suggests that this is where Hagar went to live after having been sent away the second time. (Interestingly, I believe Islam says the same thing – this is the Zamzam well outside of Mecca.) And Isaac went there to bring Hagar back to be his father’s wife once more.
So there you have quite a co-wife dynamic: the son of the preferred wife encouraging his father to remarry the rejected wife after his preferred wife passes away. And then after Abraham dies, it says in 25:11 that Isaac went back to the Well again, to ensure that Hagar remains part of the family.
Rival Wives: Hannah and Peninah
Source: biblehub.com
Even when there’s no prior relationship between two wives, it still can go quite badly. In the beginning of the Book of Samuel, as you can read in this post, Elkanah has two wives, and as usual the one he loves better (Hannah) is barren while the one he loves less (Peninah) has kids. And just as this painting captures, Peninah does not hesitate to torture Hannah with incessant reminders of her barrenness.
In Biblical Hebrew, the word tzarah means both « trouble » and « co-wife. » So that makes it pretty clear, I’d say – no illusions here about whether co-wives were likely to get along happily.
King David & King Solomon and Their Many Wives
Source: mechon-mamre.org
When it came to the kings, they can’t say they weren’t warned. Deuteronomy 17:16-17 warns, « The king must not acquire great numbers of horses for himself or make the people return to Egypt to get more of them, for the Lord has told you, « You are not to go back that way again. » He must not take many wives, or his heart will be led astray. »
King David took at least 22 wives and concubines, and suffered greatly from the infighting as to who would inherit his throne.
But King Solomon’s story offers more of a warning. This learning takes you to I Kings 11, where we read of King Solomon’s 1000 wives (which doesn’t include the Queen of Sheba, pictured here, with whom he had a more ambiguous relationship, but the Ethiopian Orthodox Church claims descent from their union, as well as the resulting possession of the holy Ark of the Covenant).
Just as Deuteronomy warned, they lead him astray, building sites of idol worship in his old age, as a result of which he is punished by having the kingdom torn in two in the next generation.
Why (and When) Did Christianity Outlaw Polygamy?
Source: en.wikipedia.org
If polygamy was so clearly allowed in the Hebrew Bible, how did it come to pass that the early Church prohibited it?
You could say they were good readers of the Hebrew Bible and saw how this didn’t go so well. But this Wikipedia article suggests that a major driving force may have been the fact that Roman marriage had to be monogamous. And since Christianity began within the Roman empire, that may well have had a major impact.
As you can see in this article, there is debate as to what the Christian Bible has to say about polygamy. Though there are several Biblical passages that seem to outlaw it, none of them are 100% clear, leaving open the possibility that the Christian prohibition came only after the Bible.
TLC’s Sister Wives: Mormonism and Polygamy
Source: learni.st
It’s well known, thanks to shows like Big Love and the TLC’s series of documentaries of real-life families, that an offshoot of the Mormon church still practices polygamy today.
This documentary from Discovery highlights TLC’s « Sister Wives » featuring Kody Brown and his four wives. There’s also an interesting learning about the history of polygamy in the US and the original position of the Mormon church on the question.
Finally, there’s a learning that looks at this issue from a totally different perspective. Many traditional African societies today have polygamy, and in this learning the author argues why polygamy is a good thing.
Maasai Tribe: The Meaning of Love & Polygamy
Source: youtube.com
From the BBC show « Tribal Wives » (where British women get integrated into indigenous tribes around the world), this video provides some interesting perspective on polygamy. If marriage is not about love but about successfully running a household, then polygamy could take on a totally different feel. In the Bible, it kind of feels like marriage is about both love and practicality, or sometimes one and sometimes the other.
Does Jewish Law Forbid Polygamy?
Source: chabad.org
In Judaism, there’s no mention of polygamy in the rabbinic period (~2000 years ago), so it seems to have been a permitted but very uncommon practice. But 1000 years ago, the head of the Ashkenazi (Northern European) Jewish community, Rabbeinu Gershom, put out a new decree. Among other things (like forbidding reading other people’s mail), Rabbeinu Gershom outlawed polygamy.
This article suggests 5 different reasons for Rabbeinu Gershom’s decree, most of them to do with ensuring greater happiness within the home, either because of infighting between the wives or a husband not being nice to all his wives or just because of the financial strain.
However, this decree did not apply to the Sephardic Jewish communities in Spain and later on North Africa and the Middle East.
Jewish Polygamy
Source: jewishencyclopedia.com
This 1906 entry from the Jewish Encyclopedia gives a very thorough look at polygamy in Judaism, from a close reading of the Bible (When did polygamy start? What was the ideal, as represented by Adam and Eve? Why did the Judges take multiple wives? Why did the Prophets not do so?) through the rabbinic period and into the last millenia. Polygamy in the Sephardic world was certainly rare, but it remained a possibility until recent years, when there were basically almost no Jews left living in countries that permitted polygamy.
Why Polygamy Is Allowed in Islam
Source: patheos.com
This blog post written by a Muslim woman attempts to explain the underlying reason behind Islam’s allowing a man to take up to four wives. In addition, she offers suggestions to the women for how to make it work.
In Islam, explicit in the Quran and Hadith (oral teachings of the Prophet Muhammad), a man is allowed to marry up to 4 women. It’s neither encouraged nor discouraged, just allowed. The author argues, based on the context in the Quran of these teachings, that after a time of war, with so many fallen men, polygamy is a means of caring for the widows and orphans.
Islam requires the husband to treat all his wives equally – to divide his time and financial resources evenly and provide similar housing for each.
Towards the end of this post, the author provides an interesting collection of tips and advice for women considering marrying someone who is already married.
Polygyny in Islam: The Historical Context
Source: en.wikipedia.org
Among many interesting pieces in this Wikipedia article, two in particular jump out as worth paying attention to:
1) The historical context. In the Arabian peninsula in the time of the Prophet Muhammad, there were no limits on the number of wives a man could take. There was also in general a good deal of variety of the kinds of marriages allowed by different societies in the region. It was most definitely not a Christian-ruled area with monogamy as the norm. It’s quite possible that Islam actually greatly limited polygamy and added protections for that time period.
2) A current list of Muslim countries with some restrictions on polygamy and what those restrictions are.
Voir enfin:
La charia et la polygamie (1/4)
La polygamie en question
Khalid Chraibi
Oumma.com
25 septembre 2009
Afin de réduire les méfaits importants et amplement documentés de la polygamie, les associations féminines du monde musulman réclament une application plus stricte des prescriptions coraniques en la matière, voire même l’interdiction de la polygamie, comme le fit la Tunisie en 1956. Mais, les Etats musulmans, ultimes décideurs en la matière, ont des points de vue très divergents sur ce qu’il est approprié de faire en ce domaine. D’une part, les versets coraniques relatifs à la polygamie (et en particulier les conditions qu’ils imposent) sont interprétés différemment, d’un Etat à l’autre. D’autre part, pendant treize siècles, un état de laisser-faire a prévalu sur cette question, que les responsables politiques et religieux sont réticents à bousculer trop vigoureusement.
A propos de l’auteur
Khalid Chraibi
Economiste (U. de Paris, France, et U. de Pittsburgh, USA), a occupé des fonctions de consultant économique à Washington D.C., puis de responsable à la Banque Mondiale, avant de se spécialiser dans le montage de nouveaux projets dans son pays.
A Rachida Benchemsi
« Une vie conjugale heureuse dépend de la sincérité, de la tolérance, du sacrifice et de l’harmonie dans le couple. Toutes ces qualités sont menacées lorsqu’il y a polygamie. » Mortada Motahari (1)
Dans les sociétés islamiques, les hommes sont autorisés à épouser jusqu’à 4 femmes à la fois, à la condition de pouvoir les traiter avec équité et d’avoir des ressources suffisantes pour pouvoir subvenir aux besoins de plusieurs ménages.
Mais, dans la pratique, ces conditions sont rarement respectées. Compte tenu de ce dérapage dans l’application des conditions instituées dans le Coran pour la pratique de la polygamie, et des effets néfastes de cette pratique sur la vie quotidienne des femmes et des enfants vivant dans un foyer polygame, tant sur le plan matériel que moral, les ONG féminines réclament, depuis plusieurs décennies, soit son interdiction pure et simple, soit, si cela n’est pas possible, du moins l’institution de contrôles sévères pour réduire ses effets pernicieux sur les familles et sur la société.
Du fait que le statut de la polygamie est défini dans des versets coraniques, les oulémas sont concernés au premier plan par cette question. Dans leur majorité, ils sont partisans du maintien du laisser-faire qui a prévalu jusqu’ici dans ce domaine. Ils estiment que chaque homme est responsable de ses actes devant Dieu, comme l’enseignent les juristes musulmans depuis les temps de la Révélation.
Mais, au 19è s., le mufti d’Egypte Muhammad Abduh a ouvert la voie à de nouveaux axes de réflexion sur cette question, en affirmant qu’en droit musulman, non seulement le mari, mais sa femme également, a des droits institués par la charia. D’après lui, ces derniers doivent être respectés au même titre que ceux du mari.
Analysant le dossier de la polygamie dans cette nouvelle optique, il débouche sur la conclusion qu’il est licite, en droit musulman, d’interdire la polygamie, compte tenu de tous ses effets pernicieux sur les familles et sur la société, qui dépassent très largement tous les « bienfaits » que les hommes peuvent en retirer, sur un plan purement sexuel.
La polygamie en perspective
La polygamie (ou plus exactement la polygynie, c’est-à-dire le mariage d’un homme avec plusieurs femmes) a communément existé dans les sociétés humaines depuis les temps les plus anciens. Les différentes religions l’ont explicitement acceptée ou tacitement tolérée pendant des siècles, avant de l’interdire parfois, comme ce fut le cas du Judaïsme et du Christianisme.(2) (3)
En Arabie, au début du 7è siècle, les Arabes pratiquaient une polygamie débridée, certains hommes prenant jusqu’à 10 épouses et plus, à la fois, en fonction de leurs moyens. L’Islam réforma cet état des choses, plafonnant à quatre le nombre de femmes qu’un homme pouvait épouser en même temps, et uniquement s’il remplissait certaines conditions. Mais, il appartenait à chaque individu de déterminer par lui-même s’il les satisfaisait.
Depuis le milieu du 20e siècle, sous la pression conjointe des mouvements féministes, des mouvements nationalistes et des intellectuels, certains Etats ont institué des procédures de contrôle du régime de la polygamie, qui diffèrent d’ailleurs d’un pays à l’autre. Ces procédures ont été, dans l’ensemble, peu efficaces, parce qu’elles se basent sur des critères d’ordre qualitatif, qui laissent une grande marge de manœuvre à l’appréciation des magistrats et des notaires chargés de leur application.
Cependant, aujourd’hui, dans la majorité des sociétés islamiques, la polygamie est sur le déclin, du fait de nombreux facteurs, dont les conditions socio-économiques plus difficiles et le niveau d’éducation plus élevé. Elle concerne, le plus souvent, moins du dixième des foyers, et est plus répandue en milieu rural qu’urbain. Son taux est particulièrement élevé dans les familles aux revenus modestes, et au faible niveau d’éducation, alors qu’elle diminue de manière considérable, au fur et à mesure que le niveau de revenu et d’éducation du chef du foyer augmente. ( 4) Depuis quelques années, elle retrouve une nouvelle vigueur dans certains pays, du fait de sa promotion par les groupes fondamentalistes.
La polygamie en question
La polygamie se justifie-t-elle dans le monde musulman, en ce début du 21e siècle ? Les associations de défense des droits des femmes répondent par la négative. Elles soulignent ses effets néfastes sur la femme, les enfants et la vie quotidienne au foyer, lorsque le mari prend une nouvelle épouse. De plus, la polygamie réduit de manière considérable les ressources du foyer, quand le même revenu du mari doit être redistribué de manière équitable entre plusieurs épouses et leurs enfants. La communauté elle-même se trouve concernée, parce que des femmes et des enfants en grands nombres se retrouvent abandonnés sans ressources et sans abri, par un mari et un père parti vivre avec sa nouvelle femme.
Afin de réduire les méfaits importants et amplement documentés de la polygamie, les associations féminines du monde musulman réclament une application plus stricte des prescriptions coraniques en la matière, (5) voire même l’interdiction de la polygamie, comme le fit la Tunisie en 1956. (6)
Mais, les Etats musulmans, ultimes décideurs en la matière, ont des points de vue très divergents sur ce qu’il est approprié de faire en ce domaine. D’une part, les versets coraniques relatifs à la polygamie (et en particulier les conditions qu’ils imposent) sont interprétés différemment, d’un Etat à l’autre. D’autre part, pendant treize siècles, un état de laisser-faire a prévalu sur cette question, que les responsables politiques et religieux sont réticents à bousculer trop vigoureusement.
Le seul point sur lequel les Etats, les théologiens et les juristes musulmans font une quasi-unanimité, c’est la question de l’interdiction de la polygamie réclamée par certaines associations féminines. Une telle interdiction serait illicite, de leur point de vue, parce qu’elle équivaudrait à rendre illicite ce que Dieu a déclaré licite, puisque c’est le Coran lui-même qui a explicitement défini le statut juridique de la polygamie.
Le statut juridique de la polygamie
Les versets 3 et 129 de la sourate « an-Nissa » (n° 4) du Coran énoncent les règles de base concernant la pratique de la polygamie dans la société musulmane :
« 3. Si vous craignez de n’être pas équitables en matière d’orphelins… alors épousez ce qui vous plaira d’entre les femmes, par deux, ou trois, ou quatre. Mais si vous craignez de n’être pas justes, alors seulement une, ou contentez-vous de votre droite propriété, plus sûr moyen d’échapper à la partialité. »
« 129. Vous ne pourrez être justes envers vos épouses, même si vous y veillez. Du moins, n’allez pas jusqu’au bout de votre penchant, jusqu’à laisser la (défavorisée) comme en l’air. » (7)
Pour bien saisir le sens de ces versets, et l’importance des règles qu’ils instituent, il faut les replacer dans le contexte de l’époque de leur Révélation.
En Arabie, avant l’Islam, les tribus étaient souvent en conflit, et subissaient de lourdes pertes en hommes. Il en résultait, au niveau de la communauté, un excédent de femmes en état de se marier, par rapport aux hommes. En fonction de leur libido, de leur état de santé et de leurs moyens financiers, les hommes avaient pour habitude d’épouser autant de femmes qu’ils le voulaient, ce qui aidait à résorber une partie de cet excédent.
La polygamie, qui était pratiquée sans aucune restriction, à l’époque, répondait ainsi à un besoin social, même si ses adeptes ne pensaient qu’à satisfaire leurs désirs sexuels personnels. Cependant, les épouses ne jouissaient d’aucun droit et servaient, avant toute chose, à satisfaire les désirs de leur mari. (8)
Par ailleurs, à l’époque de Révélation de ces versets, il y avait à Médine de nombreuses filles orphelines disposant de richesses personnelles, vivant sous la tutelle d’hommes qui envisageaient de les épouser pour mettre la main sur leurs biens. Mais, ces hommes se demandaient, malgré tout, en toute sincérité, si cela était compatible avec les enseignements de la foi à laquelle ils s’étaient convertis.
Le verset 3 s’inscrit dans le contexte de cette situation. Il décourage les hommes de tels agissements, leur recommandant de chercher d’autres femmes à épouser, en dehors de celles sous leur tutelle. Mais, il réforme à cette occasion le statut de la polygamie. Il plafonne à quatre le nombre maximum d’épouses par homme, et établit des conditions et des exigences que l’homme doit satisfaire, « de telle sorte que se marier avec plus d’une femme n’est pas donné à n’importe qui, n’importe comment. » (9)
La condition d’équité envers toutes les épouses
D’après les juristes, le verset 3 impose à l’homme la nécessité de réserver un traitement juste et égal à toutes ses épouses, dans tous les domaines, sur le plan matériel, en respectant scrupuleusement les droits de chacune, sans témoigner de préférence à aucune d’elles par rapport aux autres. S’il craint de ne pas pouvoir faire cela, il doit se limiter à une seule épouse. De telles règles constituaient une innovation fondamentale en Arabie.
Le verset 3 impose également au mari d’avoir des ressources financières adéquates pour subvenir aux besoins de plusieurs foyers, avant qu’il n’ait le droit de prendre plus d’une femme. Les capacités physiques et sexuelles du mari sont également des facteurs dont il doit être tenu compte.
L’islam n’encourageait donc pas la polygamie. Bien au contraire, il la restreignait, puisqu’il limitait, désormais, à quatre le nombre de femmes qu’un homme pouvait prendre simultanément, et établissait la contrainte de l’équité à respecter.
Le verset 129 avertissait, pour sa part, les hommes qu’ils ne pourraient pas faire preuve d’équité (dans les sentiments qu’ils ressentiraient, en leur for intérieur), envers plusieurs épouses. (10) Mais il n’interdisait pas la pratique. Il appartenait à chaque homme de prendre ses responsabilités en la matière, de décider en son âme et conscience s’il serait capable de faire preuve d’équité, sur le plan matériel, et s’il serait capable de subvenir aux besoins de toutes ses femmes dans les conditions fixées par le Coran.
Justification de la polygamie dans des circonstances exceptionnelles
De nombreux auteurs estiment que la polygamie se justifiait, au temps de la Révélation, du fait des circonstances très particulières de l’époque. (11) On cite souvent, à ce propos, l’exemple du Prophète, qui s’est marié à plusieurs femmes, pendant les dix dernières années de sa vie, du temps de son séjour à Médine. « C’était une période de guerres, et il y avait un très grand nombre de femmes qui n’avaient personne pour s’enquérir de leur sort. La plupart des femmes du Prophète étaient veuves ou âgées. Beaucoup d’entre elles avaient des enfants de leurs ex-maris. » (12)
D’après ces auteurs, la polygamie peut continuer de se justifier, dans les temps modernes, dans des circonstances exceptionnelles. Par exemple, à la suite d’une guerre meurtrière qui a décimé les hommes au front, le nombre de femmes en âge de se marier peut largement dépasser celui des hommes. (13) De même, si l’épouse est stérile, ou si elle est atteinte d’une maladie qui l’empêche d’avoir des rapports sexuels avec son mari, la majorité des auteurs pensent que le mari devrait pouvoir prendre une deuxième femme. (14)
Mais, tous les juristes soulignent que la pratique de la polygamie n’est légitime, en Islam, que lorsqu’elle est assortie des conditions et des limites prescrites dans le Coran ; et uniquement lorsque ces conditions sont scrupuleusement et rigoureusement respectées.
Or, observe le philosophe Mortada Motahari à ce propos : « Pour être équitable, il faut dire que le nombre de ceux qui respectent la lettre et l’esprit de toutes les conditions prescrites par l’Islam concernant la polygamie, est insignifiant. » (15)
Notes
(1) Mortada Motahari, « L’Islam et les droits de la femme », Ed. Al Bouraq, 2000, p. 305
(2) Gamal A. Badawi, « Polygamy in Islamic law »
(3) Eric Chaumont, article “Polygamie”, Dictionnaire du Coran, Robert Laffont, Bouquins, Paris, 2007
(4) Mohamed Chafi, “La polygamie”, Marrakech, 2000
(5) Sisters in Islam, Malaysia, Reform of the Islamic family laws on Polygamy, 11 December 1996, a memorandum to the Malaysian authorities
(6) Collectif 95 Maghreb-Egalité : “Cent mesures et dispositions pour une codification égalitaire des Codes de Statut Personnel”, 1995
(7) Le Coran, Traduction par Jacques Berque, Edition de poche, Albin Michel, Paris, 2002, p. 95 et p. 113
(8) Muhammad Abduh, « fatwa fi ta’addud al-zawjate » (fatwa sur la polygamie) dans “al-A’mal al kamila” (Oeuvres complètes éditées par Muhammad Amara) tome 2, 1ère éd. Beyrouth, (1972), p. 91
(9) Mortada Motahari, ibid, p. 260
(10) Muhammad Abduh, « fatwa fi ta’addud al-zawjate », ibid, p. 93
(11) Riffat Hassan, “al-Islam wa huquq al mar’a” (L’Islam et les droits de la femme), Casablanca, 2000, pp. 88-92
(12) Mortada Motahari, ibid, p. 319
(13) Mortada Motahari, ibid, p. 324
(14) Muhammad Abduh, « ta’addud al-zawjate » (La polygamie) dans “al-A’mal al kamila” (Oeuvres complètes éditées par Muhammad Amara) tome 2, p. 87, 1ère éd. Beyrouth, (1972) et « fatwa fi ta’addud al-zawjate », ibid, p. 95
(15) Mortada Motahari, ibid, p. 322
Voir également:
Le trafic de femmes, une source de revenus pour Daech
Le Figaro
06/11/2014
Un site d’informations irakien dit avoir mis la main sur une «grille de tarifs» à appliquer sur les marchés où sont vendues les femmes chrétiennes et yazidies. Des profits qu’empoche ensuite l’organisation terroriste.
De nouveaux détails ont émergé sur le calvaire que subissent les femmes otages et esclaves sexuelles de l’État islamique. Un site d’informations irakien affirme avoir trouvé une grille de tarifs de vente des yazidies et des chrétiennes capturées par les combattants de Daech. Quiconque ne respecte pas ces prix sera exécuté, met en garde cette note, dont l’authenticité n’a pas été contestée à ce jour. Elle rappelle qu’un homme ne peut pas «acquérir» plus de trois femmes, sauf, précision étrange, s’il est un étranger originaire de Syrie, de Turquie, d’Arabie saoudite ou des Émirats.
Les femmes les plus chères sont les plus jeunes. Pour une enfant âgée de moins de 10 ans, il en coûtera 200.000 dinars (138 euros). Pour une jeune femme de moins de 20 ans 100.000 dinars (104 euros). Pour une trentenaire 75.000 dinars (52 euros). Pour une femme quadragénaire 50.000 dinars (35 euros).
Un marché aux esclaves à Mossoul
Le document déplore même que «le marché de la femme soit à la baisse, ce qui a nui aux finances de l’État islamique». Une vidéo, tournée à Mossoul et traduite il y a quelques jours en anglais, donne une illustration glaçante de ces pratiques. On y voit des combattants islamiques échanger des conseils pour bien négocier les prix. «Aujourd’hui, c’est le jour du marché aux esclaves. C’est le jour de la distribution, et si Dieu le veut, chacun aura sa part», se réjouit un militant.
Un marchand propose d’échanger une fille contre un pistolet. Un djihadiste est prêt à avancer 500 dollars pour une captive. Des combattants expliquent que le montant qu’ils sont disposés à offrir dépend du physique des femmes: celles qui ont les yeux bleus ou verts sont très recherchées. Ils recommandent aussi de vérifier l’état de leurs dents.
D’après des ONG, plus de 4.600 femmes yazidies sont portées disparues depuis l’offensive de Daech en Syrie et en Irak. Dans les premières semaines, des otages arrivaient encore à contacter des associations décrivant des bordels où les femmes étaient traitées comme du bétail et où certaines étaient violées plus de 30 fois par jour. Mais désormais, c’est le silence le plus total. D’après des témoignages de djihadistes, l’État islamique a fait de son trafic de femmes un argument de recrutement, faisant miroiter aux nouveaux venus une abondance de concubines.
Voir encore:
« Pour les djihadistes les femmes sont des esclaves sexuelles »
Tatiana Chadenat
19 août 2014
Les fanatiques de l’Etat islamique vendraient des captives pour 150 dollars. Myriam Benraad, politologue spécialiste de l’Irak, nous en parle
En Irak et en Syrie les djihadistes de l’État islamique se sont emparés de vastes régions et y ont proclamé un califat. Ils capturent et « vendent les femmes pour une centaine de dollars », assure le porte-parole du ministère des Droits de l’homme irakien. S’il faut rester prudent, car les rumeurs pullulent et les combattants jouent sur une communication de la terreur, cette marchandisation semble vraisemblable. On fait le point avec Myriam Benraad, politologue spécialiste de l’Irak, chercheuse au CERI.
Lefigaro/madame.fr. – La vente de femmes dénoncée par le porte-parole du ministère des Droits de l’homme Irakien est-elle réelle ?
Myriam Benraad. Elle est vraisemblable car depuis 2003, les djihadistes sont de mèche avec des réseaux de prostitution. Pour l’État islamique les femmes doivent être assujetties et déshumanisées. Les combattants les considèrent comme des objets commerciaux et sexuels. Ils les capturent, les enferment et en font des butins de guerre. Dans le califat proclamé, la femme n’est pas une citoyenne, mais une esclave domestique et sexuelle à la merci de son mari. Récemment, ils ont imposé le voile à Mossoul, dans le Nord de l’Irak et en Syrie. Ces hommes assassinent froidement des populations. Mais la situation des femmes était déjà très périlleuse en Irak depuis 2003.
Ces violences dénoncées aujourd’hui par le porte-parole du ministre existent depuis longtemps ?
Le sort des Irakiennes s’est dégradé progressivement depuis dix ans. Le porte-parole est courageux d’avoir condamné ses exactions. Mais il faut que cela soit suivi d’actes, car jusqu’à présent le gouvernement n’a rien fait pour les protéger. Jusque dans les années 1970, les Irakiennes avait des droits. Avec le premier embargo en 1990, il y a eu une régression juridique et sociale. Dans les provinces tribales, le crime d’honneur est apparu : une femme violée est tuée par son clan car elle a été souillée. Après l’invasion américaine en 2003, l’État qui leur garantissait un statut, s’est effondré. Sans État de droit, elles sont particulièrement exposées à la violence, et ne peuvent pas faire porter leur droit devant les tribunaux. Pendant les élections en avril 2014, il y a eu des candidates, des affiches de campagne qui essayaient de mettre en avant la parité, mais en réalité cela ne changeait pas le fond du problème, les femmes restent exposées. Avec l’État islamique on parle souvent du danger encouru par les minorités, rarement du sort des Irakiennes. Or, elles sont les premières victimes de la guerre, de l’occupation américaine et des djihadistes. Il ne s’agit pas seulement de celles issues des minorités yézidis et chrétiennes, mais de l’ensemble des femmes, sunnites et chiites.
Comment expliquer cette haine des djihadistes envers la femme ?
Une femme libre est le symbole de tout ce que les djihadistes détestent : l’Occident et la liberté. Les islamistes radicaux ont interdit le port du jean ou des vêtements qui laissent apparaître la chair car ils y voient une influence néfaste et mécréante de l’Occident. Ces extrémistes pensent qu’en les soumettant, ils reviennent aux bases de l’Islam. Mais c’est faux. Il n’est écrit nul part dans le Coran qu’il faut asservir, violer, assassiner… ou même imposer le port du voile. C’est un choix personnel pas une obligation. Là aussi, il y a dérive. Les djihadistes vont chercher n’importe quelle justification dans le Coran ou certains Hadith (les paroles prêtées au prophète Mahomet), pour légitimer leurs actions, l’asservissement et le meurtre. Ils opèrent un glissement des textes. C’est une interprétation absurde et meurtrière qu’il ne faut pas chercher à expliquer rationnellement car elle relève d’une dérive salafiste et radicale. Les femmes disposent pourtant de nombreux droits dans l’Islam. Khadija bint Khuwaylid, la première épouse du prophète Mahomet, riche et indépendante, a largement contribué à son succès.
Voir de plus:
Isis morale falls as momentum slows and casualties mount
Erika Solomon in Beirut
Financial Times
December 19, 2014
Flagging morale, desertion and factionalism are starting to affect the Islamic State of Iraq and the Levant, known as Isis, testing the cohesion of the jihadi force as its military momentum slows.
Activists and fighters in parts of eastern Syria controlled by Isis said as military progress slows and focus shifts to governing the area, frustration has grown among militants who had been seen as the most disciplined and effective fighting force in the country’s civil war.
The group hurtled across western Iraq and eastern Syria over the summer in a sudden offensive that shocked the world. Isis remains a formidable force: it controls swaths of territory and continues to make progress in western Iraq. But its fighters have reached the limit of discontented Sunni Muslim areas that they can easily capture and US-led coalition air strikes partnered with offensives by local ground forces have begun to halt their progress.
The US military announced this week that air strikes had killed two senior Isis leaders — though there has been no confirmation of the claim by the group — and on Friday Kurdish peshmerga fighters broke the jihadis’ five-month siege of Mount Sinjar in Iraq.
“Morale isn’t falling — it’s hit the ground,” said an opposition activist from Isis-controlled areas of Syria’s eastern Deir Ezzor province. “Local fighters are frustrated — they feel they’re doing most of the work and the dying . . . foreign fighters who thought they were on an adventure are now exhausted.”
An activist opposed to both the Syrian regime and Isis, and well known to the Financial Times, said he had verified 100 executions of foreign Isis fighters trying to flee the northern Syrian city of Raqqa, Isis’s de facto capital. Like most people interviewed or described in this article, he asked for his name to be withheld for security reasons.
“After the fall of Mosul in June, Isis was presenting itself as unstoppable and it was selling a sense of adventure,” a US official said. He added that the dynamics have changed since the US launched air strikes in August and helped break the momentum of the Isis advance, which has helped stem the flow of foreign recruits — though he warned that the change of mood “doesn’t affect the hardcore people of Isis”.
Analyst Torbjorn Soltvedt, of Verisk Maplecroft, a UK-based risk analysis group, said morale may be taking a hit as militants grapple with the shift from mobile army to governing force.
« They feel they are the ones going to die in big numbers on the battlefield but they don’t enjoy any of the foreigners’ benefits »
“Before they were seizing territory, forcing armies in Iraq and Syria to retreat,” he said. “Now they’re basically an occupying force trying to govern.”
After flocking to Syria and Iraq during Isis’s heady days of quick victories, some foreigners may also be questioning the long, gruelling fight ahead.
Mr Solvedt said his organisation has had many reports of foreign fighters, including Britons, contacting family members and state authorities seeking ways to return home.
Isis members in Raqqa said the organisation has created a military police to crack down on fighters who fail to report for duty. According to activists, dozens of fighters’ homes have been raided and many have been arrested. Militants told a local journalist that they must now carry a document identifying them as a fighter and showing whether they are assigned to a mission.
An opposition activist in close contact with Isis fighters in Raqqa showed the Financial Times a document listing new regulations restricting jihadis’ behaviour. The paper, which could not be verified and which did not appear to have been issued in other Isis-held areas, warned that those who did not report to their offices within 48 hours of receiving the regulations would be punished.
“In Raqqa, they have arrested 400 members so far and printed IDs for the others,” the activist said.
The identification document for one fighter from the Gulf consisted of a printed form stating “name, location, section and mission assignment”, with his details filled in by hand.
“The situation is not good,” he grumbled, adding that fighters have become increasingly discontented with their leaders. He refused to give more details, saying only: “We aren’t able to speak the truth and we are forced to do useless things.”
Activists in Isis-held parts of Syria said many fighters in Raqqa were angry about being sent to Kobani, a small Kurdish town near the Syrian border with Turkey that has become a focal point for coalition strikes. The fighters argued that the town was not strategically important enough to justify the losses they were incurring. According to a December 7 report by the Syrian Observatory for Human Rights, a UK-based monitoring group with a network of activists across Syria, Isis lost about 1,400 fighters in 80 days of fighting. The US official said many Isis fighters have been killed in the town.
Foreign militants have often been the most active in major battles but opposition activists said as fighting intensifies, more demands are being made on local fighters who do not have deep-rooted loyalties to Isis.
Thousands of foreign fighters have flocked to Syria to help create an austere Islamic state harking back to the past. But as Erika Solomon, FT correspondent in Beirut, found out, they have retained their taste for modern-day snacks and gadgets. She spoke to Fiona Symon about what she discovered.
“They pledged allegiance to Isis so they could keep fighting the [Assad] regime and not have to go against Isis,” the Deir Ezzor activist said. “They feel they are the ones going to die in big numbers on the battlefield but they don’t enjoy any of the foreigners’ benefits — high salaries, a comfortable life, female slaves.”
Another problem, locals said, may be a rise in tensions among ethnic groups. Many fighters apparently group themselves by ethnicity or nationality — a practice which undermines Isis’s claim to be ridding Muslims of national borders.
A widely publicised example was a clash between Uzbek and Chechen fighters in Raqqa in early November over control of some villas near the captured Tabqa air base.
“Just like the Uzbek and Chechen issues in Tabqa, we are having similar issues in Manbij with the Tunisians,” said an activist in Syria’s northern city of Manbij. “They won’t let some of the highest level security members [of other nationalities] on to their bases.”
Residents in Raqqa also said they have seen growing signs of discontent. One man recalled a speech at the Fardous mosque last Friday by a Tunisian cleric who often appears in Isis videos.
“He urged the brothers to put aside their disputes, and said all brothers should stay together as one hand,” the man said. “Now I realise why the preacher was saying this . . . Something is wrong.”
(A journalist in Isis-held territory contributed reporting to this article. The name has been withheld for safety reasons.)
Voir enfin:
Discours d’inauguration du Musée de l’histoire de l’immigration
François Hollande
15 Décembre 2014
Présidence de la République française – Élysée.fr
Mesdames et messieurs les ministres,
Mesdames et messieurs les parlementaires,
Mesdames et messieurs les ambassadeurs,
Monsieur le Défenseur des droits,
Madame la Présidente du Conseil d’Administration, chère Mercedes ERRA,
Monsieur le Président du Conseil d’Orientation, Cher Benjamin STORA,
Monsieur le Directeur Général,
Mesdames, messieurs,
Je suis fier d’inaugurer aujourd’hui le Musée de l’Histoire de l’Immigration et de rappeler le rôle qui est le sien, dans nos institutions culturelles et éducatives.
Il s’agit de comprendre notre histoire pour aller vers l’avenir. Fernand BRAUDEL avait eu cette formule dans son dernier livre : « définir le passé de la France, c’est situer les Français dans leur propre existence ». Telle est la vocation du Musée national de l’Histoire de l’Immigration, rendre aux immigrés la place qui leur revient dans le récit national et se donner ainsi les moyens d’aborder de façon sereine la question toujours posée de l’immigration.
La vocation de votre musée est de montrer le processus continu par lequel la Nation a intégré les populations d’origine étrangère et a su préserver son unité tout en reconnaissant la diversité des origines et des cultures. Ce musée est plus qu’un symbole. C’est un message de confiance dans l’histoire de notre pays mais aussi dans ce que nous sommes et de ce que nous pouvons faire.
La France est un vieux pays d’immigration, l’un des plus vieux pays d’immigration d’Europe. Commencée dès la deuxième moitié du XIXème siècle pour répondre aux besoins de ce qu’on appelait la première révolution industrielle, l’immigration s’est poursuivie tout au long du XXème siècle et s’est amplifiée avec la reconstruction du pays après la guerre, avec la décolonisation et enfin avec la mondialisation. Aujourd’hui un Français sur quatre a au moins un grand parent étranger. Evoquer l’histoire de l’immigration, c’est évoquer l’histoire de France, c’est l’histoire, c’est notre histoire.
Et pourtant, jusqu’à récemment, l’immigration n’apparaissait que faiblement dans les manuels scolaires. Elle n’était guère présentée comme une chance pour notre récit national et était souvent ignorée des Français y compris même de ceux qui en étaient issus. Elle n’avait pas de lieu de mémoire, pas de lieu pour partager les histoires familiales pour retrouver les récits, pour suivre les parcours qui avaient fait que des hommes, des femmes, des familles étaient venus s’échouer ici en France pour mieux réussir.
Il fallait donc une initiative, et je veux rendre justice à Lionel JOSPIN d’avoir dès 2001, pris conscience de cet étrange oubli, et d’avoir eu la volonté de le réparer en proposant la création d’un musée de l’immigration. Ce projet s’est poursuivi sous la présidence de Jacques CHIRAC, qui a chargé Jacques TOUBON de la responsabilité de faire aboutir cette belle entreprise. Le Palais de la Porte Dorée, qui avait connu son heure de gloire d’une époque dépassée, fut choisi. C’était en 2004. Ce lieu qui avait été celui de l’exposition coloniale, allait devenir le musée de toutes les immigrations, de toutes les fiertés après avoir été ce lieu où des peuples avaient exposé devant le colonisateur, leurs plus belles réussites. Le Musée national a finalement ouvert ses portes en octobre 2007, c’était il y a 7 ans.
Sept ans c’est long pour une inauguration officielle. Il fallait qu’elle soit suffisamment réfléchie pour qu’elle puisse avoir lieu aujourd’hui, comme si l’immigration devait être toujours un sujet difficile dont il vaudrait mieux ne pas parler, ou alors avec certains mots et dans certaines circonstances. Mais le principal, c’est qu’aujourd’hui ce musée soit là et que la France soit dotée d’une institution destinée à conserver et à mettre en valeur le patrimoine de l’immigration, à montrer, à mesurer l’apport des immigrés et de leurs descendants, leur apport à la Nation. Par le sang versé, par le travail, par le talent, par la réussite. Ce Musée a une double volonté : la reconnaissance de toutes ces origines, de tous ces parcours, de toutes ces nationalités et en même temps, le rassemblement dans un même projet, celui de la France.
Je tiens à remercier les équipes de l’établissement qui, malgré les vicissitudes, ne se sont jamais découragées. Les efforts ont porté leurs fruits : l’exposition permanente aura vu passer 500.000 visiteurs depuis 2007. Deux mille enseignants viennent s’y former chaque année. Et les chiffres de fréquentation ne cessent d’augmenter grâce aux expositions temporaires qui s’y succèdent.
Ce musée doit être à la hauteur de l’ambition qui était celle de ses concepteurs, ce qui suppose à mes yeux de réaffirmer sa dimension culturelle et scientifique. C’est un lieu où il convient de mener un travail, un travail long, un travail obscur parfois, un travail de mémoire. Il convient de lui donner les moyens qui jusqu’à présent ne lui ont pas été accordés. C’est pourquoi une augmentation de près d’un million d’euros sera effective dès l’année prochaine, pour parvenir à un doublement de son budget en 5 ans.
Mais ce qui fait l’originalité, la spécificité de ce musée, c’est d’être à la fois une référence en matière de recherche, un espace de débat et une expression de la diversité, de la multiplicité de toutes les migrations, pour qu’il puisse y avoir cette mise en valeur des souvenirs, des mémoires ici rassemblées à travers ces objets familiers. Je remercie les donateurs qui ont fait en sorte de pouvoir par un instrument de musique, une machine, une étoffe, démontrer le lien qu’ils avaient avec la France et avec aussi leur pays d’origine. Comme si le pays d’origine venait ici s’offrir au pays d’accueil, c’est-à-dire à la France.
Comme la mémoire individuelle, la mémoire d’une Nation est capricieuse, tantôt elle est ingrate, tantôt elle est généreuse. Elle a ses propres rythmes et regarde trop souvent le passé avec les yeux du présent. C’est pourquoi nous avons besoin des historiens, c’est leur rôle. Ce sont eux qui nous rappellent que l’immigration fut à la fois le produit de nos propres nécessités, de nos propres besoins, j’entends par là ceux de la France, et en même temps des convulsions de l’Histoire, qui ont fait que des femmes et des hommes sont partis de très loin pour venir s’établir ici. D’abord ce furent des ouvriers, ce fut le labeur qui fut la justification de l’immigration.
Les premiers vinrent de tout près, ce furent les Belges, dans l’industrie textile du nord. Puis les Italiens dans l’industrie lourde de l’Est, les Polonais dans les mines. Au lendemain de la seconde guerre mondiale, les Espagnols, les Portugais, les Maghrébins, les Africains, qui contribuèrent à leur façon à la reconstruction du pays, à sa croissance à ce qu’on a appelé les trente glorieuses. Au bout de 30 ans après la guerre, on a estimé que ces forces-là auront construit l’équivalent d’un logement sur deux, d’une machine sur sept, et de 90% des autoroutes de notre pays.
Les crises des années 70 paradoxalement n’ont pas tari les flux, parce que les entreprises continuaient d’appeler de nouveaux immigrés, qui venaient chaque fois de plus loin pour pouvoir occuper des emplois que nul ne voulait occuper. Ce mouvement ne s’est arrêté que récemment.
Enfin la décolonisation poussa des populations jusque-là intimement liées à la France à venir y travailler. Je veux saluer ici, le Président Abdou DIOUF qui jusqu’à récemment était le Secrétaire Général de l’Organisation Internationale de la Francophonie, et qui est là pour nous rappeler ce lien qui unit les pays autrefois dans la communauté française, et qui aujourd’hui ont un lien qui demeure avec la France, et qui parlent en français. Ces populations venaient de cette Afrique, de ce Maghreb, et considéraient qu’elles avaient le droit de venir, ici. Elles avaient le droit parce que l’histoire leur rappelait le rôle qui avait été celui des plus anciens, ce qu’on appelait les « troupes coloniales », et qui étaient venues sauver la France. Ces troupes venaient de partout. Parmi les « Poilus » de 14-18, on comptait ainsi 180.000 Algériens, 60.000 Tunisiens, 37.000 Marocains, 134.000 soldats d’Afrique noire, 34.000 Malgaches. C’était l’empire qui était venu sauver la France.
Comment oublier 30 ans après, les 100.000 soldats africains de l’Armée de De LATTRE, qui accomplirent le débarquement de Provence, les tirailleurs sénégalais, les goumiers, les tabors, les spahis, les zouaves. Comment oublier les résistants de la MOI (Main d’Œuvre Immigrée), juifs, arméniens, les martyrs de l’affiche rouge chantés par Aragon.
Comment oublier le dernier Poilu, Lazare PONTICELLI, né en 1897 dans un petit village en Italie. Il n’était même pas français lorsqu’il s’était engagé dans une unité étrangère à 17 ans, en trichant sur son âge. En 1939, il avait demandé à être naturalisé pour participer à la seconde guerre qui venait d’être déclarée. C’était finalement plus qu’un symbole que le Musée national de l’Histoire de l’Immigration l’ait invité à célébrer son 110ème anniversaire ici-même. Tous s’étaient battus pour la France, mais pour une certaine idée de la France. Pour la France universelle, la France ouverte au monde, pour la France capable de promouvoir des idéaux de progrès. Cette France qu’ils voulaient rejoindre pour la servir, cette France qui était la terre espérée de ceux qui ont fui tout au long du 19ème et du 20ème siècle, les massacres, les pogroms, les guerres, les dictatures, et qui trouvèrent dans notre pays un refuge pour fonder leur foyer.
C’est une grande réussite de ce musée que d’évoquer toutes ces mémoires, de nous rappeler que les immigrés, les enfants d’immigrés ont apporté à la science française, à la physique à la chimie, aux mathématiques. Combien de Prix Nobel et de récompenses glorieuses, de Marie CURIE (qui s’appelait de son nom de jeune fille Maria SKLODOWSKA), à Arthur AVILA, franco-brésilien, qui a reçu la médaille Fields de Mathématiques. Tous ces étrangers, tous ces immigrés qui ont fait la fierté de la France dans les domaines qui paraissaient les plus inaccessibles. S’il fallait livrer ici tous les noms de ces milliers d’étrangers, d’immigrés, d’enfants d’immigrés devenus célèbres dans le cinéma, dans la littérature, la peinture, la musique, le sport et la mode. Je veux ici saluer cette belle exposition sur la mode. La mode fait partie de l’excellence française, la mode fait rayonner la France et nous donne à chaque fois la conviction que nous avons tout inventé. Cette mode, nous en savons maintenant toutes les origines, toutes les provenances, ce sont le plus souvent des créateurs, des créatrices qui ont permis à la France d’être toujours en avant-garde, toujours admirée, toujours reconnue. Voilà ce que montre ce musée, que notre réussite, la réussite la plus flamboyante de la France, elle est celle de tous les Français, et donc de tous ceux qui nés ici ou nés ailleurs, ont donné ce qu’ils avaient de meilleur pour la création, pour l’entreprise, pour l’innovation, pour la recherche, bref, pour la France.
Ce musée national est l’hommage de la Nation à ces millions de gens, qui sont venus en France, qui y ont donné le meilleur d’eux-mêmes et dont les enfants sont pleinement devenus Français et qui en même temps veulent que leur histoire, que leur parcours, que leur diversité, leur singularité et leur origine puissent être reconnus par la République, par celle qu’ils ont voulu servir et à laquelle ils ont profondément adhéré.
L’histoire de l’immigration rappelle néanmoins qu’elle fut toujours l’objet de controverses.
La présence de personnes étrangères a toujours suscité à toutes les époques de l’inquiétude, de la peur, de l’appréhension, surtout quand aux différences de langue, de culture, s’ajoutent des différences de couleur et de religion. Il y a toujours eu des démagogues, pour les attiser, pour utiliser les manquements aux règles communes – qu’il faut déplorer, pour justifier le rejet et démontrer qu’il y en a qui ne s’assimileront jamais. L’exploitation des questions migratoires jusqu’à la tragédie, n’est donc en rien une nouveauté et c’est ce que montre la recherche historique.
Dès août 1893, à Aigues-Mortes, des Français excités par d’absurdes rumeurs, avaient massacré des travailleurs italiens, parce qu’ils venaient prendre des emplois, occuper des villages et finalement mettre en cause les équilibres de telle ou telle famille. Puis la boue antisémite s’est déversée lors de l’affaire DREYFUS.
Les archives de ce musée sont pleines de témoignages dans lesquels des pseudo-scientifiques, mais de vrais idéologues tentaient de démontrer pourquoi les Italiens, les Polonais, les Espagnols, les Arméniens ne pourraient jamais être assimilés par la société française.
Dois-je évoquer la période si noire de la collaboration, le déchaînement des haines, les délations, les compromissions ? Puis la guerre d’Algérie qui déchaîna d’autres passions ? Les années 60 furent aussi des années de violence, des ratonnades. Les années 70 avec – on ne s’en souvient déjà plus, des attentats racistes, des assassinats ? Chaque époque fut marquée par des violences et des intolérances. On pourrait se dire que le pire est passé. Il y a toujours cette récurrence, il y a toujours ce retour.
Certes, il n’y a rien de neuf dans les discours, mais les contextes changent. Les étrangers sont toujours accusés des mêmes maux : venir prendre l’emploi des Français, bénéficier d’avantages sociaux indus quand bien même les études les plus sérieuses montrent qu’ils contribuent davantage aux comptes sociaux qu’ils n’en bénéficient.
Ce sont toujours les mêmes préjugés, les mêmes suspicions qui sont invariablement colportés. Mais le fait nouveau, et nous devons le regarder en face, c’est la pénétration de ces thèses dans un contexte de crise, qui paraît interminable, et d’une mondialisation qui est elle-même insaisissable. C’est là que réside le fait nouveau, le doute qui s’est installé sur notre capacité à vivre ensemble. Est-ce que la France sera encore la France ? Est-ce qu’elle sera en mesure d’intégrer, d’absorber, d’assimiler, de prendre le meilleur et d’éviter le pire ? C’est cette question qui taraude beaucoup de nos compatriotes. C’est la peur aussi sciemment installée d’une religion, l’Islam, qui de façon inacceptable est présentée par certains comme incompatible avec la République, alors que la République a toujours respecté les religions, et que les religions ont toujours été capables de comprendre les valeurs qui devaient être respectées.
Le fait nouveau, c’est que ces vents mauvais soufflent de plus en plus, et pas seulement en France, partout en Europe. C’est pourquoi il nous faut une fois encore reprendre le combat et faire en sorte de répondre et de ne rien laisser passer, en montrant d’abord la force de l’intégration.
Le musée restitue le parcours de ces millions d’exilés dont la plupart ont fait souche dans notre pays pour devenir français soit directement par la naturalisation. Le musée montre bien les actes qui ont été ainsi posés, ainsi délivrés. On m’a rappelé cette reconnaissance de l’artiste à qui l’on demandait si elle voulait une décoration. « La décoration ? », a-t-elle répondu, « c’est mon acte de naturalisation, me faire devenir français c’est la plus belle reconnaissance que pouvait m’accorder la République ». Il y a aussi par la succession des générations, le droit du sol, le fait que ces descendants d’étrangers sont devenus des citoyens français, pleinement français, et donc pleinement citoyens.
C’est ainsi que les immigrés d’hier et les enfants se sont fondus dans notre société, et en même temps que s’est enrichie à chaque étape, à chaque période leur contribution. Voilà ce message que le musée transmet : avoir confiance dans notre histoire pour être capable de regarder le présent avec suffisamment de sérénité, de responsabilité et de force pour ne pas nous laisser emporter là où ne voulons pas aller. Les enfants des immigrés dépeints comme inassimilables hier, sont devenus des patriotes sans avoir jamais à renier leurs origines. Parce que depuis 150 ans, la République n’est pas liée aux origines, c’est l’adhésion à un projet commun. Renan, dans sa fameuse conférence de 1882, affirmait que l’existence d’une Nation était un plébiscite de tous les jours, comme l’existence de l’individu était une affirmation perpétuelle de la vie. Savoir tous les jours que nous sommes Français, vouloir être Français, être pleinement conscient que de vivre en France, c’est une somme de devoirs et de droits. De GAULLE, lui-même, ne disait pas autre chose en disant qu’« Est Français celui qui souhaite que la France continue ». Continue dans sa marche, continue dans son destin, continue de porter le progrès, continue d’être à la hauteur de l’idéal qu’elle porte.
Pour y parvenir, l’école joue un rôle fondamental. Elle reste le creuset de l’intégration. Elle est de plus en plus sollicitée. L’école à qui l’on demande à la fois de former, avec une transmission du savoir exigeante et en même temps d’accueillir, d’accueillir parfois des enfants qui n’ont jamais été dans leur famille éduqués dans une autre langue que leur langue d’origine. On demande beaucoup à l’école, on lui demande aussi de faire en sorte que tous les enfants soient dans les mêmes conditions d’égalité. Les réussites scolaires en matière d’intégration sont multiples. Je veux saluer les enseignants qui s’y dévouent et qui parviennent à chaque fois, à chaque année qu’ils ont à recevoir des enfants, à les porter au plus haut niveau. Mais nous devons aussi regarder les échecs. Ils sont là : les décrochages concernent principalement certains quartiers et certains jeunes. Notre premier devoir est de tenir la promesse de l’égalité républicaine. C’est pourquoi la révision des cartes de l’enseignement prioritaire, les moyens donnés à l’éducation nationale, sont des leviers essentiels si nous voulons aller toujours vers une intégration réussie.
De même la lutte contre les discriminations qui existent dans l’orientation, dans la formation, dans l’accès à l’emploi, doivent être également combattues.
Le second pilier de l’intégration, c’est la laïcité. Elle est proclamée. Elle doit donc être enseignée, traduite en principes simples, intelligibles. La laïcité n’est ni la lutte contre la religion, contre une religion. La laïcité n’est pas la suspicion non plus à l’égard de telle ou telle communauté. La laïcité est une école de respect, de la règle commune, une reconnaissance de la liberté de croire ou de ne pas croire. Cette laïcité, nous devons l’ériger en valeur fondamentale mais nous devons aussi faire en sorte qu’elle puisse être, pour chaque jeune, non pas un concept mais une manière vivre, de respecter l’autre, de pouvoir être pleinement lui-même tout en étant entièrement dans la République. La laïcité n’est pas simplement un principe que l’on voudrait poser, c’est ce qui permet dans les actes de la vie quotidienne de savoir ce qu’il est possible de faire et ce qu’il n’est pas possible de montrer ou de faire.
Nous devons faire en sorte que la laïcité soit célébrée partout le 9 décembre, jour anniversaire de la loi de 1905, et en particulier dans les écoles où désormais est affichée la « Charte de la Laïcité ».
Traiter de façon républicaine la question de l’immigration, c’est imposer la vérité des faits mais c’est aussi nous obliger à agir.
La vérité, c’est de ne rien ignorer des tensions, des difficultés et des risques. L’obligation d’agir, c’est d’aller jusqu’au bout de l’intégration, de traiter avec fermeté aussi et humanité, l’immigration clandestine mais de mieux accompagner l’immigration régulière. Agir, c’est être convaincu que la République doit être sûre de ses principes, fière de ses valeurs mais ne doit jamais céder un pouce de terrain à la facilité et au repli sur soi.
C’est pourquoi, j’ai voulu que la lutte contre le racisme et l’antisémitisme devienne une grande cause nationale. Parce que lorsque l’on a notre Histoire, que l’on porte nos valeurs, lorsque l’on a cette République qui nous rassemble tous, la France ne peut tolérer qu’un citoyen soit agressé pour sa religion, sa couleur de peau, ses origines.
Rien ne sera passé sous silence. Rien ne doit rester impuni. Rien de ce qui fait une insulte à notre République, à notre Histoire, rien ne doit pouvoir passer à côté de la punition qui est justifiée.
Certains s’interrogent sur la volonté des immigrés de s’intégrer – je l’ai dit, le thème n’est pas nouveau – d’autres dissertent sur la capacité de la France à accueillir ces étrangers qui sont là depuis longtemps, ou ces enfants d’étrangers qui sont devenus Français, et se posent la question de l’avenir même de notre identité. Il y en a même qui s’inquiètent de l’efficacité de notre politique migratoire à l’échelle de l’Europe et veulent la reconsidérer.
Nous devons répondre à toutes ces questions. Nous ne devons pas faire comme si elles devaient par principe ou par précaution être écartées. Car sinon, si nous n’avons pas cette franchise entre nous, nous laisserons la place vide pour des discours qui instrumentalisent la peur, la peur de la dissolution de notre pays, de la dislocation, de la disparition.
Vous savez, ceux qui rêvent d’une France en petit, d’une France de dépit, d’une France en repli, bref d’une France qui ne serait plus la France.
C’est pourquoi, nous devons lutter contre ces thèses au nom de la France, pour la France, pour une France qui sera non seulement à la hauteur de son Histoire mais capable de porter un grand projet, de bâtir un avenir, de forger un destin.
C’est pourquoi, au sentiment de dépossession qui est entretenu avec malice, pour ne pas dire avec malignité, il nous faut rappeler à chaque fois aux Français d’où ils viennent, quelles sont les valeurs sur lesquelles notre pays s’est bâti et où nous voulons aller ensemble.
La France est un pays qui porte plus qu’une histoire mais une ambition, qui ne conçoit son destin que dans l’ouverture.
Certes nous devons nous protéger contre toutes les menaces mais la France n’a été victorieuse que lorsqu’elle a été capable de se dépasser. Un pays comme la France n’a pas besoin d’haïr les autres pour aimer les siens. Un pays qui a confiance en lui-même et d’abord dans sa jeunesse. Un pays qui croit en la place de chacun, qui pense que l’éducation est la matrice de tout ce qui fait la citoyenneté, qui fait confiance à la culture pour permettre que chacun puisse s’élever au-delà même de sa condition. Un pays qui veut aller jusqu’au bout de la citoyenneté.
C’est sur ces bases-là que nous devons définir une politique migratoire. Elle est nécessaire.
D’abord, pour ne pas affaiblir les pays d’émigration qui doivent s’appuyer sur leur dynamisme démographique pour leur développement, sur les compétences de leur jeunesse, sur la présence de leurs élites. C’est pourquoi, nous ne pouvons plus regarder le Sud avec les mêmes yeux. Le Sud et notamment l’Afrique qui est un continent de croissance, de développement qui n’a pas besoin de laisser partir sa population, qui a besoin qu’on lui apporte nos investissements, nos technologies et également notre capacité à créer ensemble.
Nous devons aussi avoir une politique migratoire parce que les pays d’accueil ne peuvent pas, justement, accorder aux migrants, notamment à ceux qui sont persécutés dans leur pays, une place digne si les conditions ne sont pas réunies. C’est-à-dire une capacité à donner un avenir et d’abord un emploi.
Nous devons enfin avoir une politique migratoire pour lutter contre les trafics, contre tous ceux qui font commerce. Il y en a toujours eu dans l’Histoire des étrangers avec des réseaux criminels qui mettent en danger la vie des hommes et des femmes chaque jour. Près de 3500 sont morts depuis janvier dans les eaux de la Méditerranée, la route la plus dangereuse du monde.
Cette politique passe par l’Europe. Notre frontière, c’est Schengen. Cet accord est né de la volonté de remplacer des contrôles aux frontières nationales qui n’avaient plus d’efficacité par des coopérations uniques et sans précédent en termes de liberté, de sécurité et de justice. Et on voudrait faire éclater Schengen ? C’est assez facile, personne ne sait exactement ce qu’est Schengen. Peut-être que certains croient que c’est un personnage dont il faudrait rechercher au plus vite l’identité et la personnalité pour le traduire en justice. Mais Schengen, c’est justement ce qui a permis à tous les pays d’Europe de s’organiser pour justement contrôler l’immigration et avoir une coordination des politiques.
Faire éclater Schengen ? Faire disparaître Schengen ? Mais cela serait reculer, aboutir à rétablir des frontières, pays par pays. Peut-être est-ce pour créer des emplois que certains nous font la proposition, mais enfin généralement ce ne sont pas les fonctionnaires qui justifient leurs sentiments les plus doux et les plus accommodants.
Nous devons donc défendre ce principe et faire que l’avenir de l’Europe soit de bâtir avec l’ensemble des Etats du voisinage, une politique permettant – je pense à la Méditerranée et au-delà – de conjuguer, la gestion des crises, l’aide au développement, et les contrôles des mouvements de population.
La France sera à l’initiative dans les mois qui viennent, non pas pour défaire Schengen mais pour mieux assurer la sécurité à l’intérieur et le contrôle à l’extérieur, et pour mieux répartir les charges qui pèsent sur les Etats membres, en Europe.
Pour la France, où la question de l’immigration revient régulièrement, un devoir de vérité s’impose.
Depuis 10 ans, notre pays accueille environ 200 000 personnes par an, soit la proportion la plus faible d’Europe, rapportée, bien sûr, à notre propre population. 200 000, certains disent que c’est trop. Qui trouve-t-on ? 90 000 viennent au titre de l’immigration familiale, c’est notamment le cas des conjoints de citoyens français : va-t-on interdire un rapprochement dès lors que le lien a pu être vérifié ? Ce serait insupportable ! Ce serait même contraire aux principes du droit européen et même du droit international.
60 000 autres arrivent chaque année comme étudiants. C’est une volonté pour notre pays, c’est un enjeu d’accueillir les élites de demain, le temps de leur formation. Devrait-on préférer qu’ils se forment ailleurs, aux Etats-Unis, au Canada ou en Australie ? Alors que tout le discours que je porte depuis deux ans et demi, c’est de dire que nous avons besoin de plus d’étudiants étrangers parce que c’est un investissement considérable pour la France, c’est une chance extraordinaire de pouvoir avoir les meilleurs talents, chercheurs qui viennent, ici, en France, étudier.
Que serait la France dans 20 ou 30 ans si elle ne les accueillait plus alors que le nombre d’étudiants dans le monde va doubler d’ici 2020 ? C’est la raison pour laquelle, les obstacles concernant les mobilités étudiantes ont été progressivement levés parce que la France doit attirer tous les talents du monde entier.
Il y a deux ans, il y avait une circulaire – je ne rappellerais pas le nom de son auteur, qu’importe- dont le seul objet était de limiter le droit au séjour des étudiants et des chercheurs. Cette circulaire a été abrogée mais notre réglementation est encore trop dissuasive. C’est pourquoi, le Gouvernement a créé les « passeports talents » ouvrant un droit à séjour de quatre ans qui seront délivrés de manière simplifiée et de plein droit dès lors que les critères prévus (les ressources, le niveau d’études, le contrat de travail) seront remplis. « Passeport talent », il ne s’agit plus là, d’étudiants, il s’agit de chefs d’entreprise, de cadres, de jeunes techniciens. Ils amplifieront le mouvement initié avec les visas « talents internationaux » qui ont permis une augmentation de 7% du nombre d’étudiants venant en France, et de 20% pour les chercheurs.
Curieux paradoxe, notre pays ! Quand un jeune Français va à l’étranger, on considère que c’est un exil, que nous n’avons pas pu le retenir. Quand un étudiant étranger vient en France, on viendrait le suspecter. Nous devons faire en sorte qu’il y ait plus d’étudiants français qui aillent aussi à l’étranger pour revenir ensuite et que nous puissions accueillir plus d’étudiants étrangers en France.
Puis, pour arriver aux 200 000, il y a l’asile, c’est-à-dire un droit constitutionnel qui fait partie de l’identité même de la France. Il n’est pas tolérable que notre système d’examen du droit d’asile fonctionne aussi mal. Le constat a été fait depuis longtemps. Plus de 18 mois pour avoir une réponse, on a réduit les délais déjà depuis deux ans mais nous devons encore accélérer parce que c’est un double risque que nous faisons courir.
Si le refus est prononcé, toute chance que celui qui est là depuis 18 mois essaie de se réfugier dans l’immigration illégale et si c’est pour une réponse favorable, pourquoi ne lui a-t-elle pas été communiquée plus tôt pour qu’il puisse pleinement s’insérer ?
Nous avons donc préparé un texte qui est en ce moment en discussion au Parlement qui va être voté – je crois avec une large majorité – pour réduire à 9 mois le délai pour traiter une réponse en termes de droit d’asile.
Quant à l’immigration économique, qui a été considérable, elle est devenue résiduelle dans notre pays. La présence de ceux qu’on appelle les travailleurs détachés et qui n’a rien avoir avec ce que l’on croit être l’immigration économique, mais plutôt un abus de situation – ces travailleurs détachés qui ne sont d’ailleurs pas en cause en tant que tels mais qui sont ceux qui viennent en France, de pays européens pour être moins payés parce que les cotisations sociales ne sont pas facturées aux employeurs.
Alors si nous devons respecter la libre circulation qui est un acquis fondamental de l’Europe, elle ne doit pas être détournée, dévoyée parce qu’aujourd’hui la question des travailleurs détachés fait que sur le plan politique il y a l’exacerbation de tensions et sur le plan économique il y a une concurrence déloyale.
Je ferai donc en sorte dans les prochains Conseils européens de clarifier cette notion de travailleur détaché et d’éviter tous les abus.
Trop de nos concitoyens issus de l’immigration se considèrent encore comme des étrangers, assignés à leurs origines. Et trop de nos compatriotes ont le sentiment qu’ils ne sont plus chez eux quand d’autres se placent en dehors des règles communes. Voilà la tension principale qui existe dans notre pays. Dans les deux cas, c’est la France qui est atteinte, qui est blessée. Nous devons donc réagir à cette double dislocation du pacte républicain pour que chacun se considère français en France et capable de vivre ensemble.
La République n’a d’avenir que si elle sait construire une politique de citoyenneté dont le principe est simple et clair : c’est l’égalité.
La République n’a d’avenir que si les droits et les devoirs sont rappelés à tous, quelle que soit leur nationalité.
La République n’a d’avenir que si aucun territoire n’est relégué, abandonné, oublié. Elle n’a d’avenir que si les quartiers ne deviennent pas des ensembles où vivent les mêmes populations dont la communauté de destin serait celle de leurs communautés supposées d’origines. C’est le sens de la politique de la ville : éviter les concentrations des mêmes sur les mêmes lieux, agir sur les causes des inégalités, multiplier les leviers d’insertion, offrir un avenir en termes de formation, d’emploi, d’accès à la culture.
Le sujet que nous avons à régler, c’est l’immigration d’hier et même d’avant-hier que nous avons à mieux appréhender, où le critère, d’ailleurs, n’est plus la nationalité mais la citoyenneté effective. Quant à l’immigration d’aujourd’hui – dont j’ai dit ici le caractère limité, elle doit être néanmoins accompagnée. C’est le sens du projet de loi sur le séjour des étrangers qui sera discuté au Parlement l’année prochaine. Toute personne qui arrivera en France, quelles qu’en soient les raisons –j’ai évoqué les sources de cette immigration- devra apprendre le français, être formé aux valeurs de la République, à ses règles, à ses usages, à ses droits, à ses devoirs.
Ce parcours d’intégration s’accompagnera de la remise de titres de séjour pluriannuels. A quoi sert-il de faire subir à des étrangers en situation régulière une attente interminable devant les Préfectures, les Sous-préfectures, pour le renouvellement de leur titre de séjour, comme pour bien les punir de ce qu’ils viennent réclamer : un titre de séjour. Ils l’ont déjà, c’est juste pour le renouvellement. Ils l’auront mais ils doivent attendre dans le froid, au petit matin, rien que pour leur montrer qu’ils ne sont pas vraiment, ici, bienvenus.
Ce n’est digne ni pour les fonctionnaires qui ont à traiter ces questions – je veux les saluer, ce n’est pas facile- ni digne pour les personnes ainsi traitées. A quoi sert-il d’instaurer une précarité inutile alors que ces étrangers ont déjà une activité professionnelle ?
Beaucoup d’étrangers, ce ne sont plus les mêmes, sont là depuis des décennies. Ils ont parfois gardé leur nationalité d’origine tout en étant parfaitement intégrés à la société française. C’était leur droit. Ils n’ont pas voulu changer de nationalité ou peut-être n’ont pas pu y accéder. C’est cette situation d’étranger depuis longtemps en France qui a justifié la revendication de leur ouvrir le droit de vote aux élections locales. Beaucoup de pays européens l’ont fait. Pour y parvenir en France, chacun en connait les conditions. Mieux vaut un langage de vérité si l’on veut éviter les passions ou les illusions. Rien ne peut se faire sans une révision de la Constitution, ce qui suppose, dans notre droit, une majorité des 3/5ème au Parlement. C’est-à-dire l’accord de toutes les forces républicaines. J’y suis pour ma part favorable, à elles de prendre leur responsabilité.
Ces difficultés – que nous connaissons depuis 30 ans – ne doivent pas nous empêcher d’agir pour favoriser l’autre versant de la citoyenneté, l’accès à la naturalisation. Il n’y a pas de meilleure preuve d’amour à la République que cette déclaration d’allégeance à ses principes et à ses valeurs. Dans le passé récent, certains ont été tentés de réduire le nombre de naturalisations, de compliquer ces procédures comme si devenir Français pour des étrangers qui étaient là depuis des années, qui avaient servi la France, constituait une menace. C’était encore une fois oublier, les vertus intégratrices de la République.
C’est pourquoi, j’ai demandé au Gouvernement, dès 2012, de fixer de nouveaux critères justes et transparents pour l’accès à la nationalité française. Des progrès ont été faits. Le nombre des naturalisations a augmenté mais il y a lieu, encore, d’accélérer les procédures, de les unifier sur le territoire et de bien fixer la nature des critères.
Je souhaite également que la République marque enfin sa reconnaissance à l’égard des vieux immigrés, ceux que l’on appelle les Chibanis. Beaucoup ont été recrutés, il y a des décennies, avec l’espoir d’un retour rapide au pays. Puis, ils ont fait souche dans le nôtre et ont contribué à sa construction.
A la France, ils ont donné leur jeunesse, leur labeur, leurs bras. Il est temps que l’on cesse de leur opposer des règles tatillonnes pour qu’ils ne puissent accéder véritablement à leurs droits ou à leurs prestations sociales.
Il est temps aussi que leur naturalisation soit facilitée, comme l’a proposé un rapport parlementaire. C’est la raison pour laquelle la loi sur le vieillissement, puisqu’il s’agit de travailleurs âgés, ouvrira la naturalisation de plein droit à tous les étrangers âgés de plus de 65 ans qui ont vécu plus de 25 ans en France et qui ont au moins un enfant français.
Il y a aussi les jeunes français qui veulent pleinement participer à la vie de notre pays. C’est toute la question de la représentation. Elle n’obéit pas à des logiques législatives, à des quotas ou des règles.
C’est une obligation pour toutes les forces politiques sociales économiques de notre pays. Faire en sorte que ceux qui parlent au nom des autres puissent ressembler aux autres. Faire en sorte que ceux qui décident pour les autres puissent être finalement comme les autres.
Ce travail-là doit être mené systématiquement parce que lorsqu’une représentation n’est plus fidèle à l’état d’une société, la société ne se reconnait plus dans celles et ceux qui les représentent.
C’est un grand enjeu. Des progrès ont été faits lors des élections locales – je sais que dans les entreprises, il y a également cette volonté – mais pourquoi y aurait-il cette facilité dans la culture, dans le sport et cette résistance dans nos institutions ou dans les entreprises ?
Bien sûr qu’il y a la méritocratie scolaire, et elle donne des résultats. Combien de jeunes qui sont de toutes les couleurs de la France ont réussi les meilleurs examens, obtenu les meilleurs diplômes ? Ils frappent à la porte, à leur tour, demandent leur part et à qui on demande plus qu’à d’autres d’attendre, d’attendre encore ? Eh bien non ! Il n’est plus temps d’attendre. Il faut que la société française puisse être représentée avec toutes les couleurs, toutes les forces, toutes les forces vives de la France.
L’immigration en France, c’est l’histoire de millions de personnes venues d’ailleurs, de très loin ou parfois de plus près qui voulurent un jour fondre leurs aspirations personnelles, familiales dans le rêve français.
C’est ainsi que notre histoire s’est faite. Notre pays ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui sans cette multiplication de talents et d’atouts. Bien sûr que cette immigration a suscité également tout au long de son histoire, frustrations, fractures, frictions, nous ne devons ni ignorer les talents ni occulter les peurs.
Cette diversité est une chance si nous savons la valoriser, l’enrichir, la dépasser, si nous savons affirmer une volonté commune de vivre ensemble, ce qui suppose une pleine adhésion à la République. Sinon c’est le piège de la division, la menace du communautarisme, la confrontation des cultures et donc, le racisme, l’antisémitisme, la détestation de l’autre.
C’est en prenant en compte ces risques qui sont là, dans la France du 21ème siècle, que nous ne pensions plus imaginer ou voir, c’est en prenant en compte ces risques que nous devons nous élever, pour faire en sorte que la Nation redevienne facteur d’espoir. La France doit avoir confiance dans la France.
C’est une responsabilité dont l’Etat a la charge pour garantir la cohésion et l’apaisement. Je l’ai dit, l’éducation en est la première condition mais l’école ne peut pas répondre à un défi aussi grand. Toutes les institutions sont concernées : les institutions publiques mais également les entreprises privées. La réussite de notre pays dépend de notre capacité à régler cette question de la citoyenneté et de l’immigration.
C’est aussi une responsabilité individuelle car l’histoire de l’immigration nous l’enseigne aussi. Vivre en France, c’est une chance. Elle doit être ressentie, comprise, saisie pour pouvoir être mise au service du destin commun.
Votre musée montre que cet espoir est possible puisqu’il apporte la preuve que des femmes et des hommes arrachés parfois dans la douleur à leur pays d’origine, qui ont connu bien des épreuves, ont été capables, sur notre propre sol, de donner le meilleur de leur vie, de faire en sorte que leurs enfants puissent être pleinement des citoyens et d’accomplir ce qui a été, un moment, leur destin.
L’histoire de l’immigration fait partie de notre histoire nationale mais la réussite de l’intégration déterminera notre destin national.
Votre musée, votre institution, votre Cité a l’immense mérite de donner à des générations d’immigrés la place qui doit leur revenir et de nous faire comprendre qu’ils ont fait le visage de la France.
Un visage qui a la couleur de la République. Celle qui unit, rassemble et fédère. Une Nation qui doit être fière d’elle-même et sûre de son destin. C’est quand la Nation est fière, quand elle sait où elle va et quand son destin est partagé que cette grande Nation qui s’appelle la France peut résister à tout pour faire le meilleur et conjurer le pire.
Merci.








 Publié par jcdurbant
Publié par jcdurbant 
 La Cour tient à souligner à ce propos que l’interdiction d’un traitement contraire à l’article 3 revêtant un caractère absolu indépendamment des agissements de la personne concernée et même en cas de danger public menaçant la vie de la nation – ou, a fortiori celle d’un individu – l’interdiction d’infliger des mauvais traitements à un individu afin de lui extorquer des informations vaut quelles que soient les raisons pour lesquelles les autorités souhaitent extorquer ces déclarations, que ce soit pour sauver la vie d’une personne ou pour permettre des poursuites pénales. En outre, le traitement que le requérant a subi doit passer pour lui avoir causé de vives souffrances mentales, ce que démontre aussi le fait que, ayant invariablement refusé de formuler des déclarations exactes jusqu’alors, l’intéressé a avoué sous l’influence de ce traitement où il avait caché J. La Cour estime dès lors que s’il avait été mis à exécution, le traitement dont le requérant a été menacé aurait été constitutif de torture. Cependant, l’interrogatoire n’a duré qu’une dizaine de minutes et, comme la procédure pénale dirigée contre les policiers a permis de l’établir (paragraphe 46 ci-dessus), a eu lieu dans une atmosphère empreinte d’une tension et d’émotions exacerbées car les policiers, totalement épuisés et soumis à une pression extrême, croyaient ne disposer que de quelques heures pour sauver la vie de J. ; ce sont des éléments qui doivent être considérés comme des circonstances atténuantes (…) D’ailleurs, les menaces de mauvais traitements ne furent pas mises à exécution et il n’a pas été démontré qu’elles aient eu de graves répercussions à long terme sur la santé du requérant.
La Cour tient à souligner à ce propos que l’interdiction d’un traitement contraire à l’article 3 revêtant un caractère absolu indépendamment des agissements de la personne concernée et même en cas de danger public menaçant la vie de la nation – ou, a fortiori celle d’un individu – l’interdiction d’infliger des mauvais traitements à un individu afin de lui extorquer des informations vaut quelles que soient les raisons pour lesquelles les autorités souhaitent extorquer ces déclarations, que ce soit pour sauver la vie d’une personne ou pour permettre des poursuites pénales. En outre, le traitement que le requérant a subi doit passer pour lui avoir causé de vives souffrances mentales, ce que démontre aussi le fait que, ayant invariablement refusé de formuler des déclarations exactes jusqu’alors, l’intéressé a avoué sous l’influence de ce traitement où il avait caché J. La Cour estime dès lors que s’il avait été mis à exécution, le traitement dont le requérant a été menacé aurait été constitutif de torture. Cependant, l’interrogatoire n’a duré qu’une dizaine de minutes et, comme la procédure pénale dirigée contre les policiers a permis de l’établir (paragraphe 46 ci-dessus), a eu lieu dans une atmosphère empreinte d’une tension et d’émotions exacerbées car les policiers, totalement épuisés et soumis à une pression extrême, croyaient ne disposer que de quelques heures pour sauver la vie de J. ; ce sont des éléments qui doivent être considérés comme des circonstances atténuantes (…) D’ailleurs, les menaces de mauvais traitements ne furent pas mises à exécution et il n’a pas été démontré qu’elles aient eu de graves répercussions à long terme sur la santé du requérant. 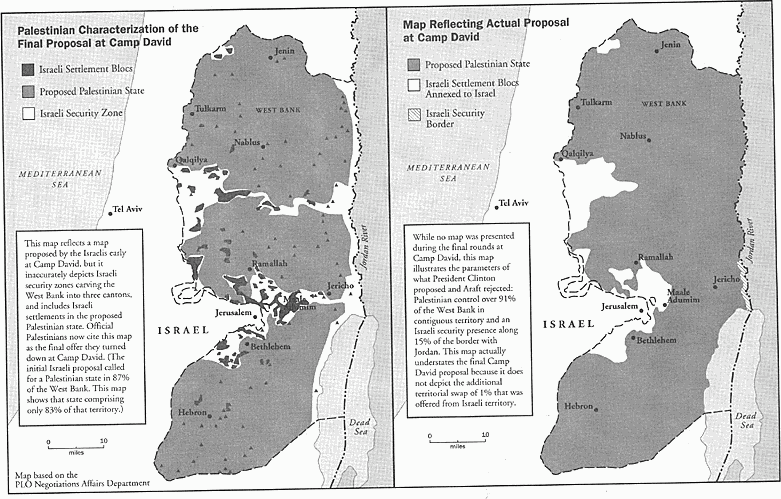


































































Israël et Moyen-Orient
Revue de la Semaine des Médias français et israéliens
21 novembre 2014
Attentat du Hamas déjoué contre un ministre israélien. Les services de sécurité israéliens ont démantelé un réseau terroriste du Hamas qui planifiait un attentat contre le ministre israélien des Affaires étrangères, A Lieberman (Le Parisien). Selon le Shin Bet, des terroristes du Hamas auraient cherché à se procurer un lance-roquette pour tirer sur la voiture du ministre israélien (RTL matin).
16 000 armes blanches saisies. Selon i24 news, le 12 novembre dernier, les douaniers israéliens auraient arrêté 5 arabes israéliens qui venaient récupérer un conteneur contenant près de 16 000 armes blanches.Israël en France. Le traitement de l’actualité israélienne en France est trop faible aujourd’hui pour faire l’objet d’une analyse éditoriale représentative. Libération et le Parisien sont les seuls médias à rendre compte de l’actualité israélienne.
Suite du massacre de la synagogue de Jérusalem. « Depuis l’attaque tout le monde est tendu » témoigne un serveur israélien » interrogé par Nicolas Rippert. « Ce n’est pas facile, il faut être tout le temps aux aguets et regarder derrière soi. », témoigne un passant sur Arte Journal (19 nov.). Il est à noter que le Parisien est le seul quotidien avec le Figaro à rendre compte régulièrement de la vie quotidienne des Israéliens depuis la série d’attentats terroristes palestiniens commis au couteau, à la hache ou à la voiture bélier.
Israel annonce une série de mesures en réponse aux attentats (Direct matin, 20 nov.). Pour prévenir de futurs attentats, le port d’armes devrait être facilité afin que les citoyens puissent se protéger des actions terroristes qui peuvent se produire dans des zones en dehors de toute protection policière (RTL-7h15 – 20 nov).
Les armes permettent parfois de prévenir les attentats (Arte journal). Ce fut le cas lors du dernier attentat au bulldozer à Jérusalem où le terroriste fut tué par un passant armé.
Les radicaux israéliens à la Une des médias français. Il faut noter une mise en avant médiatique des actions des radicaux orthodoxes israéliens, deux jours seulement après le massacre de la synagogue à Jérusalem. Pourtant, d’un point de vue éditorial et journalistique, un tel acte devrait focaliser les médias français sur la violence palestinienne, l’action de l’Autorité palestinienne ou la peine des familles des victimes israéliennes, comme l’a fait le Figaro (20 nov.)
Mais la tendance éditoriale de la majorité des médias français à l’égard d’Israël se concentre principalement cette semaine sur deux points : une très vive critique de la politique du 1er Ministre Netanyahou et de son efficacité, ainsi que sur la minorité d’extrémistes juifs qui veulent judaïser le quartier arabe de Jérusalem et reconstruire le temple (Jt de 20h de TF1-19 nov. Zoom de la rédaction de France inter, 20 oct.).
1% seulement. Il faut savoir que les résidents israéliens à Silwan ne représente qu’1 % de la population et sont au nombre de 2500 à Jérusalem Est sur 50 000 résidents. Agresseur, assaillant, pas terroriste ? Ce choix éditorial de certains médias français ainsi la non qualification de terroriste des auteurs de la tuerie que les commentaires se bornent à qualifier « d’agresseur » ou « d’assaillant » pourraient sembler une manière de justifier l’exaspération palestinienne qui aurait conduit au massacre de la synagogue.
Le 1er ministre Netanyahou contre toutes représailles communautaires. » La discrimination n’a pas sa place en Israel, a fermement prévenu le 1er ministre israélien. « La population arabe ne doit être stéréotypée à cause d’une minorité violente et bruyante »
Reconnaissance unilatérale de l’Etat palestinien à l’Assemblée nationale le 28 novembre prochain.
Depuis plus d’une semaine, les élus socialistes à l’origine de la résolution se sont exprimés dans la presse française et les médias (RTL, Libération, l’Opinion, le Parisien). Il aura fallu attendre ces derniers jours pour que se fassent entendre de points de vue différents.
Steinitz : « C’est totalement contre-productif et c’est dommageable pour le processus de paix, explique le Ministre israélien aux Affaires stratégiques (Figaro, 19). « L’Etat palestinien doit être l’aboutissement d’une négociation, le résultat de concessions réciproques. »
« Tout geste unilatéral contribue à la perpétuation de la guerre, » a prévenu le Ministre Steinitz qui a tenu à rappeler les propos tenus par M. Abbas appelant, en septembre dernier, « à protéger la mosquée Al Aqsa de la contamination juive ».
«On ne peut pas reconnaître l’Etat palestinien tant que le Hamas ne reconnaît pas Israël. » estime Jérôme Chartier, proche de l’ex 1er ministre François Fillon (Libération.fr, 19 nov.).
« Il faudrait une initiative d’Etat dans le cadre du Quartet pour obtenir du Hamas et des autorités arabes qu’ils reconnaissent» l’Etat hébreu et sa sécurité, ajoute Jérôme Chartier, membre du groupe d’études sur la Palestine (Libération.fr,19)
Soutenir ce texte, c’est soutenir le Hamas confirme le Maire de Nice, Christian Estrosi, qui s’est prononcé contre cette initiative : « Le Hamas est un groupe terroriste. Le meilleur rempart contre le terrorisme, C’est Israel. » (Journal de 8h, France Inter, 19 nov.)
«Cette initiative parlementaire pollue surtout le débat» pour l’UMP mais ce n’est pas l’avis de Benoit Hamon (Parisien, l’Opinion, RTL) ou d’Esther Benbassa (Libération, 21) pour qui « la lutte pour l’indépendance de la Palestine est le dernier combat anticolonialiste dans notre pays »
Il est à noter qu’Elie Barnavi a multiplié cette semaine les interventions médiatiques (Arte journal 18 nov. France Inter 19 nov. Figaro 20 nov.). L’ancien diplomate israélien met en accusation le gouvernement Netanyahou et affirme que pour sortir de la situation actuelle, il « faut préparer le terrain à l’internationalisation d’un processus de paix »
Israel trop critiqué ? « Le monde politique et médiatique français ne montre pas le même esprit critique à l’égard de la partie arabe palestinienne« , constate l’avocat William Goldanel dans le Figaro (20 nov.). Et de rappeler les dernières propositions de paix israéliennes refusées par les Palestiniens. « Cette constance tolérée avec trop d’indulgence explique toutes ces déconvenues dont ils sont le premiers responsables » « Accorder une satisfaction politique symbolique à cette partie sans contrepartie ne fera que l’encourager à poursuivre cette politique irrédentiste. «
Ce n’est pas le bon moment. Le président du groupe parlementaire UMP envisage de ne pas prendre part au vote (Libération.fr). Christian Jacob estime en effet que l’attentat meurtrier dans une synagogue de Jérusalem, mardi, a conforté les députés UMP dans l’idée de «ne pas en rajouter» dans ce climat d’extrême tension.
Dossier nucléaire iranien.
« Si l’Iran devient une puissance nucléaire », déclare le ministre des Affaires stratégiques israélien, Yuval Steinitz, « cela va changer le monde pour toujours et créer un dangereux ordre mondial pour des décennies ». (Direct matin).
Il s’agit de l’avenir du monde. Lors d’une interview accordée au Figaro (19 nov.), le ministre Steinitz estime que « les Iraniens ont l’air de penser qu’ils peuvent à la fois se libérer des sanctions occidentales et garder leurs capacités nucléaires ». « Il vaut mieux pas d’accord du tout qu’un mauvais accord. C’est B. Obama qu’il a dit et il a raison. «
Il faut noter la tribune de l’ambassadeur d’Iran en France parue jeudi dans Libération. Selon Ali Ahani, les relations entre la France et l’Iran « pourraient être exemplaires sans les tentatives d’intoxication de la part de certains courant en France, en Europe, Outre Atlantique, sans oublier le Moyen Orient, qui empêchent la concrétisation de cette attente ».
Un appel à la France et au commerce. La chute des échanges commerciaux avec la France explique-t-il, est « justifiée par la question nucléaire et les sanctions imposées à l’Iran ». Mais selon lui, le programme nucléaire iranien est « pacifique », l’arme nucléaire interdite par la loi islamique, et « tôt ou tard le dossier sera fermé et les sanctions derrière nous ». Il est donc pour lui indispensable que la France neutralise aujourd’hui « les efforts destructeurs et les tentatives d’intoxications. »
David Banoun – Responsable de l’Analyse des Médias