

L’oppression mentale totalitaire est faite de piqûres de moustiques et non de grands coups sur la tête. (…) Quel fut le moyen de propagande le plus puissant de l’hitlérisme? Etaient-ce les discours isolés de Hitler et de Goebbels, leurs déclarations à tel ou tel sujet, leurs propos haineux sur le judaïsme, sur le bolchevisme? Non, incontestablement, car beaucoup de choses demeuraient incomprises par la masse ou l’ennuyaient, du fait de leur éternelle répétition.[…] Non, l’effet le plus puissant ne fut pas produit par des discours isolés, ni par des articles ou des tracts, ni par des affiches ou des drapeaux, il ne fut obtenu par rien de ce qu’on était forcé d’enregistrer par la pensée ou la perception. Le nazisme s’insinua dans la chair et le sang du grand nombre à travers des expressions isolées, des tournures, des formes syntaxiques qui s’imposaient à des millions d’exemplaires et qui furent adoptées de façon mécanique et inconsciente. Victor Klemperer (LTI, la langue du IIIe Reich)
La décision de célébrer désormais le 1er mai comme un jour de lutte sociale de par le monde installe au centre de la mémoire ouvrière un crime commis par l’Amérique. Philippe Roger
Il sera organisé une grande manifestation à date fixe de manière que dans tous les pays et dans toutes les villes à la fois, le même jour convenu, les travailleurs mettent les pouvoirs publics en demeure de réduire légalement à huit heures la journée de travail et d’appliquer les autres résolutions du congrès. Attendu qu’une semblable manifestation a été déjà décidée pour le 1er mai 1890 par l’AFL, dans son congrès de décembre 1888 tenu à Saint Louis, cette date est adoptée pour la manifestation. Raymond Lavigne (Congrès de la IIe Internationale, Paris, le 20 juin 1889)
La NASA, c’est nous : la même chose se passe chez nous ! Lecteurs de Diane Vaughan
Diane Vaughan est une sociologue américaine à l’Université Columbia. Elle est principalement connue pour son travail sur les problèmes organisationnels ayant conduit au crash de la navette Challenger en 1986. Plus généralement, elle s’intéresse aux « manières dont les choses tournent mal » dans des situations très diverses : les séparations de couple, les échecs industriels etc. (…) Vaughan a travaillé sur des thèmes éclectiques, qui trouvent leur point commun dans l’étude de l’évolution des relations et des situations. Dans Uncoupling, elle montre que les séparations amoureuses ne sont pas des évènements soudains mais un détachement graduel accompagné de signaux. Elle a proposé l’expression « normalisation de la déviance, » faisant le lien entre sociologie des organisations et sociologie de la déviance, pour expliquer comment la tolérance aux dysfonctionnements augmente. De mauvaises pratiques n’ayant pas de résultats négatifs immédiats deviennent de plus en plus acceptés, menant parfois à la catastrophe (comme celle de Challenger). Wikipedia
La normalité rampante est un terme souvent utilisé pour désigner la façon dont un changement important ne peut être accepté comme normal s’il se produit lentement, par incréments inaperçus, quand il serait considéré comme inacceptable s’il a eu lieu en une seule étape ou sur une courte période. Wikipedia
Les hommes politiques parlent de « normalité rampante » pour désigner ce type de tendances lentes œuvrant sous des fluctuations bruyantes. Si l’économie, l’école, les embouteillages ou toute autre chose ne se détériorent que lentement, il est difficile d’admettre que chaque année de plus est en moyenne légèrement pire que la précédente ; les repères fondamentaux quant à ce qui constitue la « normalité » évoluent donc graduellement et imperceptiblement. Il faut parfois plusieurs décennies au cours d’une séquence de ce type de petits changements annuels avant qu’on saisisse, d’un coup, que la situation était meilleure il y a plusieurs décennies et que ce qui est considéré comme normal a de fait atteint un niveau inférieur. Une autre dimension liée à la normalité rampante est l’ « amnésie du paysage » : on oublie à quel point le paysage alentour était différent il y a cinquante ans, parce que les changements d’année en année ont été eux aussi graduels. La fonte des glaciers et des neiges du Montana causée par le réchauffement global en est un exemple (chapitre 1). Adolescent, j’ai passé les étés 1953 et 1956 à Big Hole Basin dans le Montana et je n’y suis retourné que quarante-deux plus tard en 1998, avant de décider d’y revenir chaque année. Parmi mes plus vifs souvenirs du Big Hole, la neige qui recouvrait les sommets à l’horizon même en plein été, mon sentiment qu’une bande blanche bas dans le ciel entourait le bassin. N’ayant pas connu les fluctuations et la disparition graduelle des neiges éternelles pendant l’intervalle de quarante-deux ans, j’ai été choqué et attristé lors de mon retour à Big Hole en 1998 de ne plus retrouver qu’une bande blanche en pointillés, voire plus de bande blanche du tout en 2001 et en 2003. Interrogés sur ce changement, mes amis du Montana s’en montrent moins conscients : sans chercher plus loin, ils comparaient chaque année à son état antérieur de l’année d’avant. La normalité rampante ou l’amnésie du paysage les empêchaient, plus que moi, de se souvenir de la situation dans les années 1950. Un exemple parmi d’autres qui montre qu’on découvre souvent un problème lorsqu’il est déjà trop tard. L’amnésie du paysage répond en partie à la question de mes étudiants : qu’a pensé l’habitant de l’île de Pâques qui a coupé le dernier palmier ? Nous imaginons inconsciemment un changement soudain : une année, l’île était encore recouverte d’une forêt de palmiers parce qu’on y produisait du vin, des fruits et du bois d’œuvre pour transporter et ériger les statues ; puis voilà que, l’année suivante, il ne restait plus qu’un arbre, qu’un habitant a abattu, incroyable geste de stupidité autodestructrice. Il est cependant plus probable que les modifications dans la couverture forestière d’année en année ont été presque indétectables : une année quelques arbres ont été coupés ici ou là, mais de jeunes arbres commençaient à repousser sur le site de ce jardin abandonné. Seuls les plus vieux habitants de l’île, s’ils repensaient à leur enfance des décennies plus tôt, pouvaient voir la différence. Leurs enfants ne pouvaient pas plus comprendre les contes de leurs parents, où il était question d’une grande forêt, que mes fils de dix-sept ans ne peuvent comprendre aujourd’hui les contes de mon épouse et de moi-même, décrivant ce qu’était Los Angeles il y a quarante ans. Petit à petit, les arbres de l’île de Pâques sont devenus plus rares, plus petits et moins importants. À l’époque où le dernier palmier portant des fruits a été coupé, cette espèce avait depuis longtemps cessé d’avoir une signification économique. Il ne restait à couper chaque année que de jeunes palmiers de plus en plus petits, ainsi que d’autres buissons et pousses. Personne n’aurait remarqué la chute du dernier petit palmier. Le souvenir de la forêt de palmiers des siècles antérieurs avait succombé à l’amnésie du paysage. À l’opposé, la vitesse avec laquelle la déforestation s’est répandue dans le Japon des débuts de l’ère Tokugawa a aidé les shoguns à identifier les changements dans le paysage et la nécessité d’actions correctives. Jared Diamond
N’oublions pas que les programmes spatiaux impliquent de multiples collaborations. La NASA en particulier sous-traite la majeure partie des composants de ses missions. Que des problèmes surgissent quand un grand nombre d’organisations différentes travaillent ensemble n’a rien d’exceptionnel, surtout quand il s’agit d’innovations techniques. Des erreurs sont faites en permanence dans toute organisation complexe, mais contrairement au cas de la NASA sur qui les projecteurs médiatiques sont braqués, leurs conséquences, souvent moins spectaculaires, restent généralement ignorées du grand public. (…) Je venais à l’époque de finir un livre, je n’avais rien de précis en tête, si ce n’est d’écrire un court article que l’on m’avait commandé sur la notion d’inconduite, c’est-à-dire de comportement individuel fautif. Le cas Challenger avait alors, selon l’explication officielle, toutes les apparences du parfait exemple, avec cependant la particularité de s’être produit dans une organisation gouvernementale à caractère non lucratif plutôt qu’au sein d’une entreprise. (…) Plutôt que de limiter son attention au niveau individuel, il est en effet indispensable d’examiner comment la culture d’une organisation façonne la manière dont les individus prennent des décisions en son sein. Mon analyse a montré que, pendant les années qui ont précédé l’accident, les ingénieurs et managers de la NASA ont progressivement instauré une situation qui les autorisait à considérer que tout allait bien, alors qu’ils disposaient d’éléments montrant au contraire que quelque chose allait mal. C’est ce que j’ai appelé une normalisation de la déviance : il s’agit d’un processus par lequel des individus sont amenés au sein d’une organisation à accomplir certaines choses qu’ils ne feraient pas dans un autre contexte. Mais leurs actions ne sont pas délibérément déviantes. Elles sont au contraire rendues normales et acceptables par la culture de l’organisation. (…) les erreurs sont inévitables, ne serait ce que parce que dans un système complexe, surtout lorsqu’il est innovant, il est impossible de prédire ou contrôler tous les paramètres d’une situation. Mais il est capital qu’une organisation prenne acte de la dimension sociale des erreurs produites en son sein et agisse en conséquence. Un pas dans ce sens a été accompli par exemple par certains hôpitaux américains. Ici à Boston, de nombreuses études ont abordé le problème des erreurs médicales en se penchant sur la complexité du système hospitalier. Ce qui auparavant était perçu comme l’erreur d’un individu devient une erreur dont la cause est aussi à chercher du côté du système lui-même, en particulier dans la division du travail au sein de l’hôpital. Ce n’est plus seulement la responsabilité du chirurgien ou de l’anesthésiste, mais aussi celle du système qui lui impose un planning chargé. (…) Si vous voulez vraiment comprendre comment une erreur est générée au sein d’un système complexe et résoudre le problème, il ne faut pas se contenter d’analyser la situation au niveau individuel, c’est l’organisation dans son ensemble qu’il faut considérer et, au-delà de l’organisation elle-même, son contexte politique et économique. ‘une politique de blâme individuel n’est pas suffisante car elle sort de leur contexte les « mauvaises décisions » en négligeant les facteurs organisationnels qui ont pesé sur ces décisions. Dès lors, les instances de contrôle, tout comme le public, croient à tort que, pour résoudre le problème, il suffit de se débarrasser des « mauvais décideurs ». Or, on a vu avec le cas de Challenger qu’il n’en était rien. Une stratégie punitive doit s’accompagner d’un souci de réforme des structures et de la culture de l’organisation. Diane Vaughan
Durant mes études de master puis de thèse, je me suis d’abord intéressée aux phénomènes de déviance et de contrôle social, puis j’ai découvert la littérature sur les organisations. Combinant l’un et l’autre de ces aspects, j’ai choisi d’étudier la criminalité en col blanc en tant que phénomène organisationnel. (…) Je me suis appuyée sur une étude de cas. Deux organisations sont impliquées : la première, une chaîne de pharmacies discount de l’Ohio, Revco, s’était rendue coupable de fraudes contre l’autre organisation, l’administration publique en charge de l’assurance santé (Medicaid), à qui une double facturation était transmise par voie informatique par les pharmaciens. (…) Mais, et c’est ce qui rend le cas intéressant en soi, les deux employés ont dit avoir mis en place le système des fausses prescriptions parce que les services de Medicaid rejetaient en masse les prescriptions à rembourser. C’était donc une façon détournée de recouvrer les fonds non perçus et de rééquilibrer les comptes de Revco. (…) J’ai compris combien la théorie de l’anomie de Robert K. Merton – une source d’inspiration essentielle pour moi – peut s’appliquer ici. Selon le schéma mertonien, les deux employés ont « innové » en adaptant les moyens et les règlements aux fins légitimes de l’organisation, qui étaient contrariées par le système Medicaid et donc menaçaient sa survie. Le dysfonctionnement dans le système de transaction entre les deux organisations crée une opportunité de comportement illicite ou de viol des règles pour réaliser les objectifs. (…) Alors que j’étais étudiante, j’ai rédigé un article sur la séparation conjugale, que j’ai appelée « découplage » (uncoupling) (…) J’ai approfondi le sujet lorsque j’étais à Yale, puis à Boston après mon recrutement au Wellesley College Center for Research on Women. (…) J’observais un couple, à la façon d’une organisation minuscule, au moment critique où la relation rompait ou après la séparation.(…) Des références traversent ces recherches, par exemple la théorie du signal de l’économiste « nobélisé » Michael Spence, qui peut s’appliquer autant aux entreprises qu’aux relations intimes dans le couple. Comment les organisations fondent-elles leurs choix lorsqu’elles recrutent et que les candidats sont nombreux ? La réponse est économique : il est trop coûteux de connaître à fond chaque candidat, si bien que les organisations émettent des jugements sur la base de signaux. Ces derniers sont de deux sortes : d’une part, des indicateurs qui ne peuvent pas être changés, comme l’âge ou le sexe (à l’époque, il n’était pas possible de le changer). D’autre part, des signaux d’ordre social : où avez-vous obtenu votre diplôme ? Qui vous recommande ? Quelle est votre expérience professionnelle ? Ces seconds signaux peuvent être manipulés, truqués, ce qui rapproche de la problématique de la fraude. La théorie du signal s’applique aussi dans Uncoupling : malgré l’expérience d’une rupture relationnelle soudaine, souvent vécue comme traumatique ou chaotique dans nos vies, l’hypothèse que j’ai faite était de dire par contraste que la transition est graduelle : le découplage est une suite de transitions. Je n’ai pas tardé à le vérifier durant les interviews, lors desquelles je demandais aux personnes séparées de retracer la chronologie de leur relation. Une même logique était à l’œuvre : une des deux personnes, initiatrice, commence à quitter la relation, socialement et psychologiquement, avant que l’autre ne réalise que quelque chose ne fonctionne plus. Le temps qu’elle le comprenne, qu’elle en perçoive le signal, il est trop tard pour sauver la relation. (…) Il est frappant de voir que dans ces petites organisations les gens peuvent tomber en morceaux sans même le remarquer ni agir contre. Une longue période d’incubation précède la rupture, les initiateurs envoient des signaux, les partenaires les interprètent (ou pas), mais quoi qu’il arrive, selon les buts ordinaires de l’organisation (le couple) la rupture ne fait pas partie du plan initial. Je commençais à y voir plus clair dans ces processus, analogues malgré les échelles d’analyse, mais il me manquait encore des données sur des structures bien plus grandes. J’ai envoyé le manuscrit d’Uncoupling à mon éditeur en décembre 1985. Un mois plus tard, le 28 janvier 1986, Challenger explosa. La presse a ramené l’explosion à un exemple d’inconduite organisationnelle. Cela se rapprochait de mes premiers cas d’étude – à ceci près que cela concernait une organisation à but non lucratif, la Nasa – et j’ai commencé à enquêter. (…) [Avec Columbia] Le même pattern que j’avais identifié sur le cas Challenger se reproduisait. J’étais stupéfaite par les prises de parole du responsable de la navette spatiale à la télévision : en substance, les équipes impliquées dans le programme s’étaient retrouvées dans la même situation de normalisation de la déviance. (…) J’ai pu vérifier auprès de mes collègues que le modèle causal que j’avais défini sur la catastrophe Challenger fonctionnait encore dans ce nouveau cas. Diane Vaughan
While Ken Livingstone was forcing startled historians to explain that Adolf Hitler was not a Zionist, I was in Naz Shah’s Bradford. A politician who wants to win there cannot afford to be reasonable, I discovered. He or she cannot deplore the Israeli occupation of the West Bank and say that the Israelis and Palestinians should have their own states. They have to engage in extremist rhetoric of the “sweep all the Jews out” variety or risk their opponents denouncing them as “Zionists”. George Galloway, who, never forget, was a demagogue from the race-card playing left rather than the far right, made the private prejudices of conservative Muslim voters respectable. Aisha Ali-Khan, who worked as Galloway’s assistant until his behaviour came to disgust her, realised how deep prejudice had sunk when she made a silly quip about David Miliband being more “fanciable” than Ed. Respect members accused her of being a “Jew lover” and, all of a sudden in Bradford politics, that did not seem an outrageous, or even an unusual, insult. Where Galloway led, others followed. David Ward, a now mercifully forgotten Liberal Democrat MP, tried and failed to save his seat by proclaiming his Jew obsession. Nothing, not even the murder of Jews, could restrain him. At one point, he told his constituents that the sight of the Israeli prime minister honouring the Parisian Jews whom Islamists had murdered made him “sick”. (He appeared to find the massacre itself easier to stomach.)Naz Shah’s picture of Israel superimposed on to a map of the US to show her “solution” for the Israeli-Palestinian conflict was not a one-off but part of a race to the bottom. But Shah’s wider behaviour as an MP – a “progressive” MP, mark you – gives you a better idea of how deep the rot has sunk. She ignored a Bradford imam who declared that the terrorist who murdered a liberal Pakistani politician was a “great hero of Islam” and concentrated her energies on expressing her “loathing” of liberal and feminist British Muslims instead. (…) Liberal Muslims make many profoundly uncomfortable. Writers in the left-wing press treat them as Uncle Toms, as Shah did, because they are willing to work with the government to stop young men and women joining Islamic State. While they are criticised, politically correct criticism rarely extends to clerics who celebrate religious assassins. As for the antisemitism that allows Labour MPs to fantasise about “transporting” Jews, consider how jeering and dishonest the debate around that has become. When feminists talk about rape, they are not told as a matter of course “but women are always making false rape accusations”. If they were, they would suspect that their opponents wanted to deny the existence of sexual violence. Yet it is standard in polite society to hear that accusations of antisemitism are always made in bad faith to delegitimise justifiable criticism of Israel. I accept that there are Jews who say that all criticism of Israel is antisemitic. For her part, a feminist must accept that there are women who make false accusations of rape. But that does not mean that antisemitism does not exist, any more than it means that rape never happens. Challenging prejudices on the left wing is going to be all the more difficult because, incredibly, the British left in the second decade of the 21st century is led by men steeped in the worst traditions of the 20th. When historians had to explain last week that if Montgomery had not defeated Rommel at El Alamein in Egypt then the German armies would have killed every Jew they could find in Palestine, they were dealing with the conspiracy theory that Hitler was a Zionist, developed by a half-educated American Trotskyist called Lenni Brenner in the 1980s. When Jeremy Corbyn defended the Islamist likes of Raed Salah, who say that Jews dine on the blood of Christian children, he was continuing a tradition of communist accommodation with antisemitism that goes back to Stalin’s purges of Soviet Jews in the late 1940s. It is astonishing that you have to, but you must learn the worst of leftwing history now. For Labour is not just led by dirty men but by dirty old men, with roots in the contaminated soil of Marxist totalitarianism. If it is to change, its leaders will either have to change their minds or be thrown out of office. Put like this, the tasks facing Labour moderates seem impossible. They have to be attempted, however, for moral as much as electoral reasons. (…) Not just in Paris, but in Marseille, Copenhagen and Brussels, fascistic reactionaries are murdering Jews – once again. Go to any British synagogue or Jewish school and you will see police officers and volunteers guarding them. I do not want to tempt fate, but if British Jews were murdered, the leader of the Labour party would not be welcome at their memorial. The mourners would point to the exit and ask him to leave. If it is incredible that we have reached this pass, it is also intolerable. However hard the effort to overthrow it, the status quo cannot stand. Nick Cohen
The UK Labour Party, which dates back to 1900, was long seen as the party of the working classes. Throughout most of its history, Labour has stood for social justice, equality, and anti-racism. Labour’s controversy over anti-Semitism is fairly recent. It’s often traced back to 2015, when Jeremy Corbyn became the party leader. Corbyn, seen as on Labour’s left wing, has long defended the rights of Palestinians and often been more critical than the party mainstream of Israel’s government. But during the Labour leadership contest in 2015, a then-senior Jewish Labour MP said that Corbyn had in the past showed “poor judgment” on the issue of anti-Semitism — after Corbyn unexpectedly became the frontrunner in the contest, a Jewish newspaper reported on his past meetings with individuals and organizations who had expressed anti-Semitic views. Concerns over anti-Semitism only really began to turn into a crisis, however, the year after Corbyn became leader. In April 2016, a well-known right-wing blog revealed that Labour MP Naz Shah had posted anti-Semitic messages to Facebook a couple of years before being elected. One post showed a photo of Israel superimposed onto a map of the US, suggesting the country’s relocation would resolve the Israeli-Palestinian conflict. Above the photo, Shah wrote, “Problem solved.” Shah apologized, but former Mayor of London Ken Livingstone, a long-time Labour member who was close to party leader Jeremy Corbyn, made things worse by rushing to Shah’s defense — and added an inflammatory claim that Hitler initially supported Zionism, before “he went mad and ended up killing six million Jews.” The party suspended Shah and Livingstone and launched an inquiry into anti-Semitism. But Corbyn was criticized for not acting quickly or decisively enough to deal with the problem. Afterward, claims of anti-Semitism kept resurfacing as individual examples were dug up across Labour’s wide membership. By now a narrative was building that anti-Semitism was rife within the party — and that the election of Corbyn as leader was the cause. Throughout his political career, Corbyn has protested against racism and backed left-wing campaigns such as nuclear disarmament, and was considered the long shot in the party’s leadership contest — bookmakers initially put the chance of him winning at 200 to 1. Corbyn’s victory confirmed that the New Labour project was dead. (…) Corbyn’s campaign drummed up a big grassroots following as his anti-austerity, socialist message gained traction, in a way that would later be echoed by Bernie Sanders’s 2016 campaign in the US. (…) But after Corbyn’s unexpected win, everything changed. Corbyn steered the party to the left on many issues, including proposals to nationalize the railways and possibly the energy companies, end the era of slashing state spending, and tax the rich. He also moved the party leftward on Israel and Palestine. Labour’s previously moribund membership boomed to half a million, making it one of the biggest political parties in Europe. The many newcomers were attracted by the chance to support a truly left-wing Labour Party. Claims of anti-Semitism also increased: Labour’s general secretary revealed that between April 2018 and January 2019, the party received 673 accusations of anti-Semitism among members, which had led to 96 members being suspended and 12 expelled. Part of the reason anti-Semitism claims have grown under Corbyn is that his wing of the party — the socialist left — tends to be passionately pro-Palestine. There is nothing inherently anti-Semitic about defending Palestinians, but such a position can lead to tensions between left-wing anti-Zionists and mainstream Jewish communities. This tension has at times led to a tendency on the left to indulge in anti-Semitic conspiracy theories and tropes — like blaming a Jewish conspiracy for Western governments’ support of Israel or equating Jews who support Israel with Nazi collaborators. (…) At first glance, Corbyn hardly seems like someone who would be an enabler of anti-Semitism. He has a long history of campaigning against racism — for instance, in the 1980s, he participated in anti-apartheid protests against South Africa, at the same time that former Conservative Prime Minister Margaret Thatcher was calling Nelson Mandela’s African National Congress opposition movement a “typical terrorist organization.” And he has long campaigned for Palestinian rights, while being critical of the government of Israel — including comparing Israel’s treatment of Palestinians to apartheid. But Corbyn’s anti-imperialist, anti-racist stance over the years has also led some to label him a terrorist sympathizer. Corbyn in the past advocated for negotiations with militant Irish republicans. As he did with Irish republicans, Corbyn encouraged talks with the Islamist militant groups Hamas and Hezbollah. He has also been heavily criticized for having previously referred to these groups as “friends,” which caused outrage when publicized during 2015’s Labour leadership contest. Corbyn explained that he had only used “friends” in the context of trying to promote peace talks, but later said he regretted using the word. Last March, Corbyn was also criticized for a 2012 comment on Facebook, in which he had expressed solidarity with an artist who had used anti-Semitic tropes in a London mural that was going to be torn down. After Luciana Berger tweeted about the post and demanded an explanation from the Labour Party leadership, Corbyn said that he “sincerely regretted” having not looked at the “deeply disturbing” image more closely, and condemned anti-Semitism. (…) In August 2018, the right-wing British newspaper the Daily Mail accused Corbyn of having laid a wreath at the graves of the Palestinian terrorists while in Tunisia in 2014. Corbyn acknowledges that he participated in a wreath-laying ceremony at a Tunisian cemetery in 2014, but says he was commemorating the victims of a 1985 Israeli airstrike on the headquarters of the Palestinian Liberation Organization (PLO), who were living in exile in Tunis at the time. The airstrike killed almost 50 people, including civilians, and wounded dozens more. However, the Daily Mail published photos showing Corbyn holding a wreath not far from the graves of four Palestinians believed to be involved with the 1972 Munich massacre, in which members of the Black September terrorist organization killed 11 Israeli athletes and a German police officer at the Munich Olympics. Corbyn denies he was commemorating the latter individuals, but his muddled explanations in the wake of the controversy left some unsatisfied with his response. Today, on social media, it is common to see Corbyn denounced for enabling anti-Semitism — author J.K. Rowling has even criticized him for it — while some brand him outright as an anti-Semite. When US Rep. Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY) recently tweeted that she’d had “a lovely and wide-reaching conversation” with Corbyn by phone, hundreds of commenters criticized her for speaking to Labour’s “anti-Semitic” leader. (…) Indeed, urgency is needed for Labour’s leadership to effectually tackle the party’s anti-Semitism crisis and convince other MPs not to quit. The nine MPs who’ve left have formed the Independent Group, an informal assemblage that plans to launch as an official political party before the end of the year. Several other Labour MPs are rumored to be thinking of joining them. Unless Labour moves fast, the emerging centrist party could prove an existential threat. Vox.com
Omar didn’t know that the language in which she expressed her malignant delusions was in the lineage of Jew-hatred in its Christian and European forms. Until she entered the national stage, she’d had no need to know. Omar’s malignant delusions are commonplace in the Arab and Muslim world from which she comes. They are commonplace among the leadership of the Council on American-Islamic Relations (CAIR), the Hamas-friendly front organization for the Muslim Brotherhood which supported her Congressional campaign. And they have become commonplace on the left of the Democratic party. Democrats now protest that the whites and the right have their racists too. In other words, they’re saying that two wrongs make a right. This is playground logic, and it ignores the imbalance between the two kinds of anti-Jewish racism. Firstly, no Republican leader ever posed for the cover of any other national outlet with Steve King, or Omar’s new Twitter chum David Duke. Secondly, the Republican leadership, no doubt hypnotized by the Benjamins tucked in Ivanka Trump’s suspender belt, is hostile to the white racist fringe, and the white racist fringe detests the Republican leadership. Thirdly, the white racists are nothing if not candid about their beliefs and their intentions towards the Jewish people. Ilhan Omar isn’t even honest. Omar said she was against BDS when running for the House and then revised her position as soon as she won her set. She denounces Israel and Saudi Arabia, who oppose the Muslim Brotherhood, but not Turkey or Qatar, the Muslim Brotherhood’s sponsors. She may be ignorant, but she knows exactly what she is doing. She is furtive and duplicitous, and she is successfully importing the language and ideas of racism into a susceptible Democratic party. The buffoons who lead the Democrats are allowing Omar to mainstream anti-Jewish racism. The Democratic leadership tried to co-opt the energy of the post-2008 grassroots, to give its exhausted rainbow coalition an infusion of 21st-century identity politics. The failure to issue the promised condemnation of Omar shows that a European-style ‘red-green’ alliance of hard leftists and Islamists is co-opting the party. This, like the pro-Democratic media’s extended PR work for Rashida Tlaib and that other left-Islamist pinup Linda Sarsour, reflects a turning point in American history. The metaphysical, conspiratorial hatred of Jews is a symptom of civilization in decline. So the inability of the Democratic leadership to call Omar a racist reflects more than the moral and ideological decay of a political party. Americans like to believe in their exceptionalism, and American Jews like to say America is different. We’re about see if those ideas are true. Dominic Green
Il est fini le temps de la cathédrale, si ça pouvait signifier, aussi la fin des curés. Frédéric Fromet (France inter)
Sur France Inter, radio du service public, une « chanson » abjecte sur l’incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris a été diffusée le 19 avril dernier. Et n’a suscité aucune réaction majeure depuis. Les catholiques ont-ils beaucoup d’humour ou sont-ils tout simplement inaudibles ? Toujours est-il qu’une prestation de (très) mauvais goût sur la radio France Inter le 19 avril dernier a totalement échappé aux radars de la polémique. Qu’en aurait-il été avec une pareille satire sur d’autres religions présentes dans l’Hexagone ? Lors de l’émission Par Jupiter !, présentée par Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek, « La chanson de Frédéric Fromet » portait sur l’incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Depuis, l’Observatoire de la Christianophobie a notamment relevé la chose, au milieu d’un silence médiatique total. Rappelons que France Inter, appartenant au groupe Radio France, est une radio du service public détenue à 100 % par l’État français et financée en grande partie par la redevance audiovisuelle. (…) À noter que dans cette séquence, la carte de « l’humour » cathophobe est jouée au maximum puisque Frédéric Fromet présente son « œuvre » du jour en ces termes : « L’incendie de Notre-Dame de Paris, c’est quand même du pain bénit. » De quoi susciter les ricanements de l’assistance, une voix féminine ironisant ensuite : « Oh, un Vendredi saint, mon Dieu ! » Délits d’images
This feature is proving that a fully covered hijab wearing model can confidently stand alongside a beautiful woman in a revealing bikini and together they can celebrate one another, cheer each other on, and champion each other’s successes. Young Muslim women need to know that there is a modest swimsuit option available to them so they can join the swim team, participate in swim class at school, and go with their friends to the beach. Muslim girls should feel confident taking that step and doing so comfortably while wearing a burkini. SI Swimsuit has been at the forefront of changing the narrative and conversation on social issues and preconceived notions. I’m hoping this specific feature will open doors up for my Somali community, Muslim community, refugee community, and any other community that can relate to being different. Halima Aden
La mannequin et activiste musulmane entre dans l’histoire avec ses débuts pour le magazine Sports Illustrated Swimsuit. Sports Illustrated Swimsuit continue de prôner la différence dans l’industrie de la mode. Et le nouveau numéro de 2019 est le plus diversifié de tous les temps. La mannequin et activiste américano-somalienne Halima Aden fait ses débuts pour le magazine. Il s’agit de la première fois qu’un mannequin pose avec un hijab et un burkini pour les pages de SI qui sont, habituellement très sexy et où les mannequins sont très dénudés. Halima Aden est née dans un camp de réfugiés au Kenya, où elle a vécu jusqu’à l’âge de sept ans avant de déménager aux États-Unis, elle est retournée dans son pays de naissance pour le shooting de Sport Illustrated pris par le photographe Yu Tsai. « Je n’arrête pas de penser à moi, âgé de six ans, qui vivait dans un camp de réfugiés dans ce même pays », a déclaré Halima Aden, 21 ans, à SI lors de son interview. « Donc, grandir pour vivre le rêve américain et revenir au Kenya pour un magazine de mode dans les plus belles régions du pays, je ne pense pas que ce soit une histoire que quiconque puisse inventer » a-t-elle déclaré émue. Halima a été la première femme à porter un hijab au concours de Miss Minnesota, aux États-Unis, où elle s’est classée demi-finaliste et la première à porter un burkini pour la compétition de maillot de bain… Ce qui lui a valu un contrat avec IMG Models. Peu de temps après, Halima Aden a fait ses débuts sur le podium lors de la Fashion Week de New York à l’automne 2017 en tant que modèle pour le show de la saison 5 de la marque de Kanye West. Public
In a controversial move, Sports Illustrated has unveiled photos of its first ever Baptist swimsuit model, pictured in a floor-length denim skirt, modest collared blouse, and no makeup or jewelry whatsoever, other than her purity ring. The « hot » photoshoot includes pictures of the woman lying on the beach, rolling around in the water, and reading Passion and Purity on the beach in sexy poses, all while completely covered up. Christians quickly praised the decision. « We are glad SI finally sees the value of modesty, » one leading evangelical said. « A woman mostly covered from head to toe is a great precedent to set, and we hope more models going forward will be dressed this modestly. » The woman, Becky Grace-Charity-Faith Benson, said she’s proud to represent her Baptist religious heritage. « It’s important for young Christian girls to see that beauty isn’t just being skinny or wearing b*kinis—it’s wearing a comfy pair of sneaks, a long, denim skirt you made at home, or a modest one-piece bathing suit under a swim shirt and long, flowy swim skirt. » Babylon bee
We are all cartoonists now. Antonio Branco
It’s time for the west to wake up to this kind of thing and stop appeasing radical Islam. Antonio Branco
I’m a fan of Twitter, I’m a fan of a president that talks directly to the people. Antonio Branco
Out of respect to our readers we have avoided those we felt were offensive. Many Muslims consider publishing images of their prophet innately offensive and we have refrained from doing so. Dean Baquet (NYT)
Selon les standards du Times, nous ne publions pas d’images ou d’autres matériaux offensant délibérément les sensibilités religieuses. Après concertation, les journalistes du Times ont décidé que décrire les caricatures en question donnerait suffisamment d’informations pour comprendre l’histoire. NYT
As I grew older, I learned that the fair-skinned, blue-eyed depiction of Jesus has for centuries adorned stained glass windows and altars in churches throughout the United States and Europe. But Jesus, born in Bethlehem, was most likely a Palestinian man with dark skin. Eric Copage
The Times published an appalling political cartoon in the opinion pages of its international print edition late last week. It portrayed Prime Minister Benjamin Netanyahu of Israel as a dog wearing a Star of David on a collar. He was leading President Trump, drawn as a blind man wearing a skullcap. The cartoon was chosen from a syndication service by a production editor who did not recognize its anti-Semitism. Yet however it came to be published, the appearance of such an obviously bigoted cartoon in a mainstream publication is evidence of a profound danger — not only of anti-Semitism but of numbness to its creep, to the insidious way this ancient, enduring prejudice is once again working itself into public view and common conversation. Anti-Semitic imagery is particularly dangerous now. The number of assaults against American Jews more than doubled from 2017 to 2018, rising to 39, according to a report released Tuesday by the Anti-Defamation League. On Saturday, a gunman opened fire during Passover services at a synagogue in San Diego County, killing one person and injuring three, allegedly after he posted in an online manifesto that he wanted to murder Jews. For decades, most American Jews felt safe to practice their religion, but now they pass through metal detectors to enter synagogues and schools. Jews face even greater hostility and danger in Europe, where the cartoon was created. In Britain, one of several members of Parliament who resigned from the Labour Party in February said that the party had become “institutionally anti-Semitic.” In France and Belgium, Jews have been the targets of terrorist attacks by Muslim extremists. Across Europe, right-wing parties with long histories of anti-Semitic rhetoric are gaining political strength. This is also a period of rising criticism of Israel, much of it directed at the rightward drift of its own government and some of it even questioning Israel’s very foundation as a Jewish state. We have been and remain stalwart supporters of Israel, and believe that good-faith criticism should work to strengthen it over the long term by helping it stay true to its democratic values. But anti-Zionism can clearly serve as a cover for anti-Semitism — and some criticism of Israel, as the cartoon demonstrated, is couched openly in anti-Semitic terms. The responsibility for acts of hatred rests on the shoulders of the proponents and perpetrators. But history teaches that the rise of extremism requires the acquiescence of broader society. As anti-Semitism has surged from the internet into the streets, President Trump has done too little to rouse the national conscience against it. Though he condemned the cartoon in The Times, he has failed to speak out against anti-Semitic groups like the white nationalists who marched in Charlottesville, Va., in 2017 chanting, “Jews will not replace us.” He has practiced a politics of intolerance for diversity, and attacks on some minority groups threaten the safety of every minority group. (…) A particularly frightening, and also historically resonant, aspect of the rise of anti-Semitism in recent years is that it has come from both the right and left sides of the political spectrum. Both right-wing and left-wing politicians have traded in incendiary tropes, like the ideas that Jews secretly control the financial system or politicians. (…) In the 1930s and the 1940s, The Times was largely silent as anti-Semitism rose up and bathed the world in blood. That failure still haunts this newspaper. Now, rightly, The Times has declared itself “deeply sorry” for the cartoon and called it “unacceptable.” Apologies are important, but the deeper obligation of The Times is to focus on leading through unblinking journalism and the clear editorial expression of its values. Society in recent years has shown healthy signs of increased sensitivity to other forms of bigotry, yet somehow anti-Semitism can often still be dismissed as a disease gnawing only at the fringes of society. That is a dangerous mistake. As recent events have shown, it is a very mainstream problem. The NYT Editorial Board
During the 2016 campaign, Donald J. Trump’s second campaign chairman, Paul Manafort, had regular communications with his longtime associate — a former Russian military translator in Kiev who has been investigated in Ukraine on suspicion of being a Russian intelligence agent. At the Republican National Convention in July, J. D. Gordon, a former Pentagon official on Mr. Trump’s national security team, met with the Russian ambassador, Sergey Kislyak, at a time when Mr. Gordon was helping keep hawkish language on Russia’s conflict with Ukraine out of the party’s platform. And Jason Greenblatt, a former Trump Organization lawyer and now a special representative for international negotiations at the White House, met last summer with Rabbi Berel Lazar, the chief rabbi of Russia and an ally of Russia’s president, Vladimir V. Putin. In a Washington atmosphere supercharged by the finding of the intelligence agencies that Mr. Putin tried to steer the election to Mr. Trump, as well as continuing F.B.I. and congressional investigations, a growing list of Russian contacts with Mr. Trump’s associates is getting intense and skeptical scrutiny. (…) In fact, vigorous reporting by multiple news media organizations is turning up multiple contacts between Trump associates and Russians who serve in or are close to Mr. Putin’s government. There have been courtesy calls, policy discussions and business contacts, though nothing has emerged publicly indicating anything more sinister. A dossier of allegations on Trump-Russia contacts, compiled by a former British intelligence agent for Mr. Trump’s political opponents, includes unproven claims that his aides collaborated in Russia’s hacking of Democratic targets. Current and former American officials have said that phone records and intercepted calls show that members of Mr. Trump’s 2016 presidential campaign and other Trump associates had repeated contacts with senior Russian intelligence officials in the year before the election. (…) Rabbi Lazar, who has condemned critics of Mr. Putin’s actions in Ukraine, is the leader of the Hasidic Chabad-Lubavitch group in Russia, where it is a powerful organization running dozens of schools and offering social services across the country, while maintaining links to a lucrative financial donor network. Mr. Greenblatt, who handled outreach to Jews for the campaign, said that Rabbi Lazar was one of several Chabad leaders he had met during the campaign. He said the two men did not discuss broader United States-Russia relations and called the meeting “probably less than useful.” Rabbi Lazar said they had spoken about anti-Semitism in Russia, Russian Jews in Israel and Russian society in general. While he meets with Mr. Putin once or twice a year, he said, he never discussed his meeting with Mr. Greenblatt with Kremlin officials. The NYT
Starting in 1999, Putin enlisted two of his closest confidants, the oligarchs Lev Leviev and Roman Abramovich, who would go on to become Chabad’s biggest patrons worldwide, to create the Federation of Jewish Communities of Russia under the leadership of Chabad rabbi Berel Lazar, who would come to be known as “Putin’s rabbi.” A few years later, Trump would seek out Russian projects and capital by joining forces with a partnership called Bayrock-Sapir, led by Soviet emigres Tevfik Arif, Felix Sater and Tamir Sapir—who maintain close ties to Chabad. The company’s ventures would lead to multiple lawsuits alleging fraud and a criminal investigation of a condo project in Manhattan. Meanwhile, the links between Trump and Chabad kept piling up. (…) With the help of this trans-Atlantic diaspora and some globetrotting real estate moguls, Trump Tower and Moscow’s Red Square can feel at times like part of the same tight-knit neighborhood. Now, with Trump in the Oval Office having proclaimed his desire to reorient the global order around improved U.S. relations with Putin’s government—and as the FBI probes the possibility of improper coordination between Trump associates and the Kremlin—that small world has suddenly taken on outsize importance. Founded in Lithuania in 1775, the Chabad-Lubavitch movement today has adherents numbering in the five, or perhaps six, figures. What the movement lacks in numbers it makes up for in enthusiasm, as it is known for practicing a particularly joyous form of Judaism. (…) Despite its small size, Chabad has grown to become the most sprawling Jewish institution in the world, with a presence in over 1,000 far-flung cities, including locales like Kathmandu and Hanoi with few full-time Jewish residents. (…) Chabad followers are also, according to Klein, “remarkable” fundraisers.(…) The Putin-Chabad alliance has reaped benefits for both sides. (…) With Washington abuzz about the FBI’s counterintelligence investigation of Trump world’s relationship with Putin’s Kremlin, their overlapping networks remain the object of much scrutiny and fascination. (…) To those unfamiliar with Russian politics, Trump’s world and Hasidic Judaism, all these Chabad links can appear confounding. Others simply greet them with a shrug. “The interconnectedness of the Jewish world through Chabad is not surprising insofar as it’s one of the main Jewish players,” said Boteach. “I would assume that the world of New York real estate isn’t that huge either.”Politico
The past several days have left many Jews in the United States feeling shell-shocked. Attacks against them seem to be coming from all quarters. First, on Thursday, the New York Times’ International Edition published a stunningly antisemitic cartoon on its op-ed page. It portrayed a blind President Donald Trump wearing the garb of an ultra-Orthodox Jew, replete with a black suit and a black yarmulke, with the blackened sunglasses of a blind man being led by a seeing-eye dog with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu’s face. If the message – that Jewish dogs are leading the blind American by the nose — wasn’t clear enough, the Netanyahu dog was wearing a collar with a Star of David medallion, just to make the point unmistakable. Under a torrent of criticism, after first refusing to apologize for the cartoon, which it removed from its online edition, the Times issued an acknowledment on Sunday, but has taken no action against the editors responsible. Two days after the Times published its hateful cartoon, Jews at the Chabad House synagogue in Poway, outside San Diego, were attacked by a rifle-bearing white supremacist as they prayed. (…) On the face of things, there is no meaningful connection between the Times’ cartoon and the Poway attack. In his online manifesto, Earnest presented himself as a Nazi in the mold of Robert Bowers, the white supremacist who massacred 11 Jews at the Tree of Life Synagogue last October. The New York Times, on the other hand, is outspoken in its hatred of white supremacists whom it associates with President Donald Trump, the paper’s archenemy. On the surface, the two schools of Jew hatred share no common ground. But a serious consideration of the Times’ anti-Jewish propaganda leads to the opposite conclusion. The New York Times — as an institution that propagates anti-Jewish messages, narratives, and demonizations — is deeply tied to the rise in white supremacist violence against Jews. This is the case for several reasons. First, as Seth Franzman of the Jerusalem Post pointed out, Bowers and Earnest share two hatreds – for Jews and for Trump. Both men hate Trump, whom they view as a friend of the Jews. Earnest referred to Trump as “That Zionist, Jew-loving, anti-White, traitorous c**ks****er.” Bowers wrote that he opposed Trump because he is supposedly surrounded by Jews, whom Bowers called an “infestation” in the White House. The New York Times also hates Trump. And like Bowers and Earnest, it promotes the notion in both news stories and editorials that Trump’s support for Israel harms U.S. interests to benefit avaricious Jews. In 2017, just as the Russia collusion narrative was taking hold, Politico spun an antisemitic conspiracy theory that placed Chabad at the center of the nefarious scheme in which Russian President Vladimir Putin connived with Trump to steal the election from Democratic nominee Hillary Clinton. (…) The story, titled “The Happy-Go-Lucky Jewish Group that Connects Trump and Putin,” claimed that Russia’s Chief Rabbi Berel Lazar, who is Chabad’s senior representative there, served as an intermediary between Putin and Trum-p. He did this, Politico alleged, through his close ties to Chabad rabbis in the United States who have longstanding ties to Trump. (…) In other words, the antisemitic Chabad conspiracy theory laid out by Politico, which slanderously placed Chabad at the center of a nefarious plot to steal the U.S. presidency for Trump, was first proposed by the New York Times. The Times is well known for its hostility towards Israel. But that hostility is never limited to Israel itself. It also encompasses Jewish Americans who support Israel. For instance, in a 11,000 word “analysis” of the antisemitic “boycott, divestment, sanctions” (BDS) movement published in late March, the Times effectively delegitimized all Jewish support for Israel. (…) Last week the Times erroneously claimed that Jesus was a Palestinian. The falsehood was picked up by antisemitic Rep. Ilhan Omar (D-MN). The Times waited a week to issue a correction. (…) In an op-ed following the cartoon’s publication, the Times’ in-house NeverTrump pro-Israel columnist Bret Stephens at once condemned the cartoon and the paper’s easy-breezy relationship with antisemitism, and minimized the role that antisemitism plays at the New York Times. Stephens attributed the decision to publish the cartoon in the New York Times international edition to the small staff in the paper’s Paris office and insisted that “the charge that the institution [i.e., the Times] is in any way antisemitic is a calumny.” (…) Stephens tried to minimize the Times’ power to influence the public discourse in the U.S. by placing its antisemitic reporting in the context of a larger phenomenon. But the fact is that while the New York Times has long since ceased serving as the “paper of record” for anyone not on the political left in America, it is still the most powerful news organization in the United States, and arguably in the world. The Times has the power to set the terms of the discourse on every subject it touches. Politico felt it was reasonable to allege a Jewish world conspiracy run by Chabad that linked Putin with Trump because, as Haberman suggested, the Times had invented the preposterous, bigoted theory three weeks earlier. New York University felt comfortable giving a prestigious award to the Hamas-linked antisemitic group Students for Justice in Palestine last week because the Times promotes its harassment campaign against Jewish students. (…) It has co-opted of the discourse on antisemitism in a manner that sanitizes the paper and its followers from allegations of being part of the problem. It has led the charge in reducing the acceptable discourse on antisemitism to a discussion of right wing antisemitism. Led by reporter Jonathan Weisman, with able assists from Weiss and Stephens, the Times has pushed the view that the most dangerous antisemites in America are Trump supporters. The basis of this slander is the false claim that Trump referred to the neo-Nazis who protested in Charlottesville in August 2017 as “very fine people.” As Breitbart’s Joel Pollak noted, Trump specifically singled out the neo-Nazis for condemnation and said merely that the protesters at the scene who simply wanted the statue of Robert E. Lee preserved (and those who peacefully opposed them) were decent people. The Times has used this falsehood as a means to project the view that hatred of Jews begins with Trump – arguably the most pro-Jewish president in U.S. history, goes through the Republican Party, which has actively defended Jews in the face of Democratic bigotry, and ends with his supporters. By attributing an imaginary hostility against Jews to Trump, Republicans, and Trump supporters, the Times has effectively given carte blanche to itself, the Democrats, and its fellow Trump-hating antisemites to promote Jew-hatred. John Earnest and Robert Bowers were not ordered to enter synagogues and massacre Jews by the editors of the New York Times. But their decisions to do so was made in an environment of hatred for Jews that the Times promotes every day. Following the Bowers massacre of Jewish worshippers at the Tree of Life Synagogue in Pittsburgh, the New York Times and its Trump-hating columnists blamed Trump for Bowers’s action. Not only was this a slander. It was also pure projection. Caroline Glick
À la suite d’un torrent de protestations, la direction du grand quotidien libéral a reconnu que sa caricature reprenait les clichés antisémites d’usage et a présenté ses regrets. Mais il est difficile pour autant, pour un observateur qui scrute depuis longtemps les relations judéo-américaines, de passer cet incident en pures pertes et profits. Pour différentes raisons qui se conjuguent dangereusement. Mais un mot tout d’abord sur la caricature. En dépit de l’amende honorable versée sans barguigner par le journal lui-même, certains esprits forts discutent l’aspect antisémite du dessin incriminé. J’ai cru remarquer qu’il s’agissait souvent d’antiracistes de gauche vétilleux qui sourcillent dès lors que, par exemple, on ne partage pas avec eux extatiquement le même enthousiasme pour le phénomène migratoire massif et souvent illégal. Au demeurant, le New York Times lui-même n’est pas le dernier à se proposer pour donner à autrui des leçons d’antiracisme qu’il n’a pas réclamées. Nous mettrons bien évidemment leurs contestations sur le compte de leur ignorance de l’histoire de l’antisémitisme plutôt que sur celui d’une improbable mauvaise foi. Tout d’abord, l’animalisation du Juif est un grand classique. Mais au-delà même de cet antisémitisme de facture assez classique, ce méchant dessin s’insère dans un contexte contemporain anglo-saxon de gauche fort dégradé. Il convient de comprendre que parallèlement à un conflit interne au parti travailliste britannique qui reproche, preuves à l’appui, à Jeremy Corbyn un antisémitisme caricatural (lui-même ayant reconnu un problème au sein du Labour), le parti Démocrate américain est déchiré. En cause, de nouvelles représentantes d’origine islamique ou immigrée qui multiplient les dérapages. La plus emblématique étant pour l’heure ilhan Omar, d’origine somalienne, qui enchaînent en spirales les provocations suivies d’excuses. L’un de ses griefs consistant notamment à reprocher aux politiciens juifs une double et déloyale allégeance en faveur de l’état Juif. Les réactions de l’appareil démocrate ordinairement antiraciste, se caractérisant ici par une manière de déploration paternaliste. C’est donc bien dans ce cadre général et particulier qu’il convenait d’analyser pourquoi cette caricature tombait mal, pour le journal libéral comme pour la gauche américaine en proie à ses nouveaux vieux démons, comme pour les juifs américains traditionnellement et majoritairement démocrates. Gilles-William Goldnadel
You thought that Congresswoman Ilhan Omar’s comments about foreign loyalty or “Benjamins” were problematic. The International Edition of the Times just said: “Let me show you what we can do,” with a cartoon of a yarmulke-wearing, blind US President Donald Trump being led by a dog with a Star of David collar and Prime Minister Benjamin Netanyahu’s face for a head. (…) It used to be that we were told that Trump was fostering “Trump antisemitism” and driving a new wave of antisemitism in the US. But the cartoon depicts him as a Jew. Well, which is it? Is he fostering antisemitism, or is he now a closet Jew being led by Israel, depicted as a Jewish dog? We used to say that images “conjured up memories” of 1930s antisemitism. This didn’t conjure it up; this showed us exactly what it looked like. The Nazis also depicted us as animals. They also put Stars of David on us. Antisemites have compared us to dogs, pigs and monkeys before. It used to be that it was on the far-Right that Jews were depicted as controlling the world, like an octopus or a spider. But now we see how mainstream it has become to blame the Jews and Israel for the world’s problems. There isn’t just one problem with this cartoon. There are numerous problems. Problem one is putting a yarmulke on the US president in a negative way. What is being said there? That he is secretly a Jew. Then making him blind, and having him led by Israel. That implies Israel controls US policy or controls America. Problem two: they put a dog leash with a Star of David, which is antisemitic in multiple ways. Problems three and four. You’d think that after the Holocaust, any use of the Star of David would automatically raise questions in a newsroom. But no. Then they put the Israeli prime minister’s face on a dog. On a dog. Problem number five. So this cartoon wasn’t just mildly antisemitic. It wasn’t like “whoops.” It was deeply antisemitic. The New York Times acknowledged this in a kind of pathetic way. They admitted that the cartoon “included antisemitic tropes.” It then noted, “The image was offensive and it was an error of judgement to publish it.” This should be a defining moment. It is a defining moment because one of America’s most prestigious newspapers did this, not some small town newspaper somewhere. That it was in the International Edition doesn’t make it any less harmful. In fact, it shows America’s face to the world and gives a quiet signal to other antisemites. How can we demand that there be zero tolerance for antisemitism and antisemitic tropes when this happens? Jerusalem Post
A dog with a Jewish star around its neck and the face of a Jewish leader, leading a blind, yarmulke-wearing U.S. President would be standard fare for the notorious Nazi newspaper Der Sturmer, and for its modern descendants. Unfortunately the New York Times must now be counted among those descendants. Just days after the Times published an op-ed falsely claiming Jesus was a Palestinian, the New York Times International Edition placed this cartoon on their op-ed page, depicting Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu as a dog leading a blind U.S. President Donald Trump: The cartoon is by the award-winning (aren’t they all) Portuguese cartoonist Antonio Antunes Moreira, and was distributed by the New York Times News Service and Syndicate. After a wave of criticism – perhaps among the earliest was a tweet from the left wing site Jewish Worker – the Times removed the image and tweeted this statement: A political cartoon in the international print edition of The New York Times on Thursday, included anti-Semitic tropes, depicting the Prime Minister of Israel as a guide dog with a Star of David collar leading the President of the United States, shown wearing a skullcap. The image was offensive, and it was an error of judgement to publish it. It was provided by the New York Times News Service and Syndicate, which has since deleted it. Some have termed this an apology – it is not, it is cold-blooded and at best descriptive. Neither the word apology nor any synonym for apology is employed, and there is nothing about accountability or further steps the Times will take to make sure nothing like this ever happens again. This did not happen in a vacuum, but there is nothing about the responsible editor or editors being fired, or even disciplined. There is nothing about no longer accepting or distributing cartoons from the cartoonist Antonio, who has previously used religious symbols in an offensive way. For example, in the cartoon below the Jewish Star of David is represented as controlling the United States, and a crescent moon often associated with Islam is linked with dynamite. Both the Jewish Star and the crescent are seemingly bloody. Camera
Imagine if the New York Times cartoon that depicted Israel’s Prime Minister as a dog had, instead, depicted the leader of another ethnic or gender group in a similar manner? If you think that is hard to imagine that you are absolutely right. It would be inconceivable for a Times editor to have allowed the portrayal of a Muslim leader as a dog; or the leader of any other ethnic or gender group in so dehumanizing a manner. What is it then about Jews that allowed such a degrading cartoon about one of its leaders? One would think that in light of the history of the Holocaust, which is being commemorated this week, the last group that a main stream newspaper would demonize by employing a caricature right out of the Nazi playbook, would be the Jews. But, no. Only three quarters of a century after Der Stürmer incentivized the mass murder of Jews by dehumanizing them we see a revival of such bigoted caricatures. The New York Times should be especially sensitive to this issue, because they were on the wrong side of history when it came to reporting the Holocaust. They deliberately buried the story because their Jewish owners wanted to distance themselves from Jewish concerns. They were also on the wrong side of history when it came to the establishment of the nation state of the Jewish people, following the holocaust. When it comes to Jews and Israel, the New York Times is still on the wrong side of history. I am a strong believer in freedom of speech and the New York Times has a right to continue its biased reporting and editorializing. But despite my support for freedom of speech, I am attending a protest in front of the New York Times this afternoon to express my freedom of speech against how the New York Times has chosen to exercise its. There is no inconsistency in defending the right to express bigotry and at the same time protesting that bigotry. When I defended the rights of Communists and Nazis to express their venomous philosophies, I also insisted on expressing my contempt for their philosophy. I did the same when I defended the rights of Palestinian students to fly the Palestinian flag in commemoration of the death of Arafat. I went out of my way to defend the right of students to express their support of this mass murder. But I also went out of my way to condemn Arafat and those who support him and praise his memory. I do not believe in free speech for me, but not for thee. But I do believe in condemning those who hide behind the First Amendment to express anti-Semitic, anti-Muslim, homophobic, sexist or racist views. Nor is the publication of this anti-Semitic cartoon a one-off. For years now, the New York Times op-ed pages have been one-sidedly anti-Israel. Its reporting has often been provably false, and all the errors tend to favor Israel’s enemies. Most recently, the New York Times published an op-ed declaring, on Easter Sunday, that the crucified Jesus was probably a Palestinian. How absurd. How preposterous. How predictable. In recent years, it has become more and more difficult to distinguish between the reporting of the New York Times and their editorializing. Sometimes its editors hide behind the euphemism « news analysis, » when allowing personal opinions to be published on the front page. More recently, they haven’t even bothered to offer any cover. The reporting itself, as repeatedly demonstrated by the Committee for Accuracy in Middle East Reporting in America (CAMERA), has been filled with anti-Israel errors. The publishers of the New York Times owe its readers a responsibility to probe deeply into this bias and to assume responsibility for making the Times earn its title as the newspaper of record. Any comparison between the reporting of the New York Times and that of the Wall Street Journal when it comes to the Middle East would give the New York Times a failing grade. Having said this, I do not support a boycott of the New York Times. Let readers decide for themselves whether they want to read its biased reporting. I, for one, will continue to read the New York Times with a critical eye, because it is important to know what disinformation readers are getting and how to challenge that disinformation in the marketplace of ideas. So I am off to stand in protest of the New York Times, while defending its right to be wrong. That is what the First Amendment is all about. Finally, there is some good news. One traditional anti-Semitic trope is that « the Jews control the media. » People who peddle this nonsense, often point to the New York Times, which is, in fact, published by a prominent Jewish family, the Sulzbergers. Anyone who reads the New York Times will immediately see the lie in this bigoted claim: Yes, the New York Times has long been controlled by a Jewish family. But this Jewish family is far from being supportive of Jewish values, the nation state of the Jewish people or Jewish sensibilities. If anything, it has used its Jewishness as an excuse to say about Jews and do to Jews what no mainstream newspaper, not owned by Jews, would ever do. Alan M. Dershowitz
As prejudices go, anti-Semitism can sometimes be hard to pin down, but on Thursday the opinion pages of The New York Times international edition provided a textbook illustration of it. Except that The Times wasn’t explaining anti-Semitism. It was purveying it. It did so in the form of a cartoon, provided to the newspaper by a wire service and published directly above an unrelated column by Tom Friedman, in which a guide dog with a prideful countenance and the face of Benjamin Netanyahu leads a blind, fat Donald Trump wearing dark glasses and a black yarmulke. Lest there be any doubt as to the identity of the dog-man, it wears a collar from which hangs a Star of David. Here was an image that, in another age, might have been published in the pages of Der Stürmer. The Jew in the form of a dog. The small but wily Jew leading the dumb and trusting American. The hated Trump being Judaized with a skullcap. The nominal servant acting as the true master. The cartoon checked so many anti-Semitic boxes that the only thing missing was a dollar sign. (…) The Times has a longstanding Jewish problem, dating back to World War II, when it mostly buried news about the Holocaust, and continuing into the present day in the form of intensely adversarial coverage of Israel. The criticism goes double when it comes to the editorial pages, whose overall approach toward the Jewish state tends to range, with some notable exceptions, from tut-tutting disappointment to thunderous condemnation. (…) The problem with the cartoon isn’t that its publication was a willful act of anti-Semitism. It wasn’t. The problem is that its publication was an astonishing act of ignorance of anti-Semitism — and that, at a publication that is otherwise hyper-alert to nearly every conceivable expression of prejudice, from mansplaining to racial microaggressions to transphobia. Imagine, for instance, if the dog on a leash in the image hadn’t been the Israeli prime minister but instead a prominent woman such as Nancy Pelosi, a person of color such as John Lewis, or a Muslim such as Ilhan Omar. Would that have gone unnoticed by either the wire service that provides the Times with images or the editor who, even if he were working in haste, selected it? The question answers itself. And it raises a follow-on: How have even the most blatant expressions of anti-Semitism become almost undetectable to editors who think it’s part of their job to stand up to bigotry? The reason is the almost torrential criticism of Israel and the mainstreaming of anti-Zionism, including by this paper, which has become so common that people have been desensitized to its inherent bigotry. So long as anti-Semitic arguments or images are framed, however speciously, as commentary about Israel, there will be a tendency to view them as a form of political opinion, not ethnic prejudice. But as I noted in a Sunday Review essay in February, anti-Zionism is all but indistinguishable from anti-Semitism in practice and often in intent, however much progressives try to deny this. Add to the mix the media’s routine demonization of Netanyahu, and it is easy to see how the cartoon came to be drawn and published: Already depicted as a malevolent Jewish leader, it’s just a short step to depict him as a malevolent Jew. The paper (…) owes itself some serious reflection as to how its publication came, to many longtime readers, as a shock but not a surprise. Bret L. Stephens
António Antunes a publié ses premiers dessins animés dans le quotidien de Lisbonne« République » en mars 1974. Plus tard cette année, il a rejoint l’hebdomadaire « Expresso » où il continue de publier ses œuvres. Il a reçu différents prix dont le Grand Prix du 20e Salon of Cartoons (Montréal, Canada, 1983), Le 1er prix pour Cartoon Editorial du 23ème International Salon of Cartoons (Montréal, Canada, 1986), Grand Prix D’honneur 15e Festival du Dessin Humoristique (Anglet, France, 1993), Prix d’excellence – Best Newspaper Design, SND – Stockholm, Suède (1995) Premio Internazionale Satira Politica (ex-aequo, Forte Dei Marmi, Italie, 2002), Grand Prix Stuart Carvalhais (Lisbonne, Portugal, 2005) et le Prix International Presse (Saint-Just-le-Martel, France, 2010). Il a organisé des expositions individuelles au Portugal, en France, en Espagne, au Brésil, en Allemagne et au Luxembourg. Il a été membre du jury à différents Salons de Dessin d’Humour au Portugal, au Brésil, en Grèce, en Italie, en Serbie et en Turquie. António est se dédie aussi au design graphique, à la sculpture, aux médailles et il est l’auteur de l’animation plastique de la station de métro Airport de Lisbonne, ouverte en 2012, mettant en vedette des caricatures de personnalités de premier plan dans la ville, réalisées en pierre inserée. Il est président du jury de World Press Cartoon, le Salon dont il est le directeur depuis sa fondation en 2005. Festival International de la caricature, du dessin de presse et d’humour
When the international version of the NY Times decided to publish an anti-Semitic cartoon by the Portuguese cartoonist Antonio Moreira Antunes, it was just following a long-established European post-WWII tradition. Antunes has been in the anti-Semitic image business for decades, and won an award in 1983 for his appropriation of a Warsaw ghetto photo, changing the victim of Nazis into a Palestinian victim of Israeli Jews. For this, Antunes received the top prize at the 20th International Salon of Cartoons in Montreal. So that’s the identity and history of the cartoonist who drew the more recent cartoon with Trump as a blind Jew being led by the dachshund Jew Netanyahu. So far, though, the Times hasn’t seen fit to name the person or persons who decided to publish the Trump/Netanyahu cartoon in their paper. But my guess is that this person or people who made the call is/are European as well—or, if American, has/have lived a long time abroad. To Europeans, that cartoon would likely be considered ho-hum, just business as usual—or maybe even worthy of a prize or two. They have lost the ability to see what the cartoon looks like to others because they are so used to what’s being expressed here that it’s become mainstream. It’s not as though any of this is new in Europe, although it may be somewhat new for the NY Times (even the international version) to publish this sort of thing. Prior to doing the research for this post, I had never heard of Antunes’ reworking of the Warsaw ghetto image. But for me, that blind-Trump/dachshund-Netanyahu cartoon had already conjured up the memory of another cartoon, one that had appeared in the British newspaper The Independent and was drawn by the British political cartoonist Dave Brown. (…) Ariel Sharon is naked, except for that little Likud rosette instead of a fig leaf. Not a kippah or a Jewish star in sight. So that makes the blood libel perfectly okay, apparently. In fact, the cartoon was so highly thought of that it was awarded the 2003 first prize by the British Political Cartoon Society. (…) If you think about it, it’s a wonder that the international NY Times took so long to get with the program. Legal insurrection
Attention: une normalisation de la déviance peut en cacher une autre !
En cette nouvelle Fête du travail ….
Véritable institutionnalisation, de la première bombe anarchiste de Haymarket square aux actuelles déprédations des black blocs, de la violence politique …
Pendant qu’après l’élection au Congrès de la première députée voilée explicitement antisémite, nos médias nous présentent comme nouvelle avancée historique la burkinisation d’un des modèles du numéro spécial maillots du magazine sportif américain Sports illustrated …
Comment ne pas voir …
La publication, dans les pages internationales (et parisiennes) d’un quotidien qui avait refusé la moindre caricature de Mahomet ou de Charlie hebdo …
Et entre une descente en règle de la politique israélienne, la dénonciation de la prétendue collusion de Trump avec la Russie via « son rabbin » et la palestinisation de Jésus lui-même …
D’une caricature antisémite, deux jours avant une nouvelle fusillade dans une synagogue, digne des plus beaux jours de der Sturmer ou de Je suis partout …
Comme un nouveau cas, excuses ou pas, à l’instar de ce qui arrive actuellement tant aux travaillistes britanniques qu’aux démocrates américains …
De la « normalisation de la déviance » ou de la « normalité rampante » si bien décrits par les sociologue et historien des catastrophes spatiales (Diane Vaughan) ou écologiques (Jared Diamond) …
Où rejoignant entre le détournement de la photo du ghetto de Varsovie ou un Sharon dévoreur d’enfants …
Une désormais longue et dûment primée, sauf très rares exceptions, tradition européenne …
La tolérance croissante à toute une série de petites entorses à la déontologie génère imperceptiblement une véritable culture d’entreprise de l’antisionisme …
Et derrière la banalisation de l’antisémitisme qui s’ensuit …
Sans parler bien sûr de l’antichristianisme de rigueur …
Aboutit presque inévitablement au type de fiasco actuel ?
The New York Times and the European vogue for anti-Semitic cartoons
For decades European anti-Semitic cartoons have won international prizes
New Neo
Legal insurrection
April 30, 2019
When the international version of the NY Times decided to publish an anti-Semitic cartoon by the Portuguese cartoonist Antonio Moreira Antunes, it was just following a long-established European post-WWII tradition. Antunes has been in the anti-Semitic image business for decades, and won an award in 1983 for his appropriation of a Warsaw ghetto photo, changing the victim of Nazis into a Palestinian victim of Israeli Jews. For this, Antunes received the top prize at the 20th International Salon of Cartoons in Montreal.
So that’s the identity and history of the cartoonist who drew the more recent cartoon with Trump as a blind Jew being led by the dachshund Jew Netanyahu. So far, though, the Times hasn’t seen fit to name the person or persons who decided to publish the Trump/Netanyahu cartoon in their paper. But my guess is that this person or people who made the call is/are European as well—or, if American, has/have lived a long time abroad.
To Europeans, that cartoon would likely be considered ho-hum, just business as usual—or maybe even worthy of a prize or two. They have lost the ability to see what the cartoon looks like to others because they are so used to what’s being expressed here that it’s become mainstream.
It’s not as though any of this is new in Europe, although it may be somewhat new for the NY Times (even the international version) to publish this sort of thing. Prior to doing the research for this post, I had never heard of Antunes’ reworking of the Warsaw ghetto image. But for me, that blind-Trump/dachshund-Netanyahu cartoon had already conjured up the memory of another cartoon, one that had appeared in the British newspaper The Independent and was drawn by the British political cartoonist Dave Brown.
It was early in 2003, during the Second Intifada, when Palestinians had been deliberately targeting and blowing up Israelis civilians (including Israeli children) at a rapid clip for three years. The wall had been started but was far from completion at the time the cartoon was published (January of 2003). One would think that if anyone was going to be depicted as deliberate and ghoulish child killers it would be the Palestinians, who not only supported suicide bombers who murdered children but who purposely used their own children as sacrifices, putting them in harm’s way (see also this) to make it more likely that defensive retaliatory measures by the Israelis would result in the inadvertent death of Palestinian children.
But ghoulish Palestinians wasn’t the image Brown was after (and here the reference is to the famous Goya painting “Saturn Devouring His Son“):
See? Ariel Sharon is naked, except for that little Likud rosette instead of a fig leaf. Not a kippah or a Jewish star in sight. So that makes the blood libel perfectly okay, apparently. In fact, the cartoon was so highly thought of that it was awarded the 2003 first prize by the British Political Cartoon Society. In his acceptance speech, “Brown thanked the Israeli Embassy for its angry reaction to the cartoon, which he said had contributed greatly to its publicity.”
If you think about it, it’s a wonder that the international NY Times took so long to get with the program.
Voir aussi:
A Despicable Cartoon in The Times
The paper of record needs to reflect deeply on how it came to publish anti-Semitic propaganda.
NYT
April 28, 2019
As prejudices go, anti-Semitism can sometimes be hard to pin down, but on Thursday the opinion pages of The New York Times international edition provided a textbook illustration of it.
Except that The Times wasn’t explaining anti-Semitism. It was purveying it.
It did so in the form of a cartoon, provided to the newspaper by a wire service and published directly above an unrelated column by Tom Friedman, in which a guide dog with a prideful countenance and the face of Benjamin Netanyahu leads a blind, fat Donald Trump wearing dark glasses and a black yarmulke. Lest there be any doubt as to the identity of the dog-man, it wears a collar from which hangs a Star of David.
Here was an image that, in another age, might have been published in the pages of Der Stürmer. The Jew in the form of a dog. The small but wily Jew leading the dumb and trusting American. The hated Trump being Judaized with a skullcap. The nominal servant acting as the true master. The cartoon checked so many anti-Semitic boxes that the only thing missing was a dollar sign.
The image also had an obvious political message: Namely, that in the current administration, the United States follows wherever Israel wants to go. This is false — consider Israel’s horrified reaction to Trump’s announcement last year that he intended to withdraw U.S. forces from Syria — but it’s beside the point. There are legitimate ways to criticize Trump’s approach to Israel, in pictures as well as words. But there was nothing legitimate about this cartoon.
So what was it doing in The Times?
For some Times readers — or, as often, former readers — the answer is clear: The Times has a longstanding Jewish problem, dating back to World War II, when it mostly buried news about the Holocaust, and continuing into the present day in the form of intensely adversarial coverage of Israel. The criticism goes double when it comes to the editorial pages, whose overall approach toward the Jewish state tends to range, with some notable exceptions, from tut-tutting disappointment to thunderous condemnation.
For these readers, the cartoon would have come like the slip of the tongue that reveals the deeper institutional prejudice. What was long suspected is, at last, revealed.
The real story is a bit different, though not in ways that acquit The Times. The cartoon appeared in the print version of the international edition, which has a limited overseas circulation, a much smaller staff, and far less oversight than the regular edition. Incredibly, the cartoon itself was selected and seen by just one midlevel editor right before the paper went to press.
An initial editor’s note acknowledged that the cartoon “included anti-Semitic tropes,” “was offensive,” and that “it was an error of judgment to publish it.” On Sunday, The Times issued an additional statement saying it was “deeply sorry” for the cartoon and that “significant changes” would be made in terms of internal processes and training.
In other words, the paper’s position is that it is guilty of a serious screw-up but not a cardinal sin. Not quite.
The problem with the cartoon isn’t that its publication was a willful act of anti-Semitism. It wasn’t. The problem is that its publication was an astonishing act of ignorance of anti-Semitism — and that, at a publication that is otherwise hyper-alert to nearly every conceivable expression of prejudice, from mansplaining to racial microaggressions to transphobia.
Imagine, for instance, if the dog on a leash in the image hadn’t been the Israeli prime minister but instead a prominent woman such as Nancy Pelosi, a person of color such as John Lewis, or a Muslim such as Ilhan Omar. Would that have gone unnoticed by either the wire service that provides the Times with images or the editor who, even if he were working in haste, selected it?
The question answers itself. And it raises a follow-on: How have even the most blatant expressions of anti-Semitism become almost undetectable to editors who think it’s part of their job to stand up to bigotry?
The reason is the almost torrential criticism of Israel and the mainstreaming of anti-Zionism, including by this paper, which has become so common that people have been desensitized to its inherent bigotry. So long as anti-Semitic arguments or images are framed, however speciously, as commentary about Israel, there will be a tendency to view them as a form of political opinion, not ethnic prejudice. But as I noted in a Sunday Review essay in February, anti-Zionism is all but indistinguishable from anti-Semitism in practice and often in intent, however much progressives try to deny this.
Add to the mix the media’s routine demonization of Netanyahu, and it is easy to see how the cartoon came to be drawn and published: Already depicted as a malevolent Jewish leader, it’s just a short step to depict him as a malevolent Jew.
I’m writing this column conscious of the fact that it is unusually critical of the newspaper in which it appears, and it is a credit to the paper that it is publishing it. I have now been with The Times for two years and I’m certain that the charge that the institution is in any way anti-Semitic is a calumny.
But the publication of the cartoon isn’t just an “error of judgment,” either. The paper owes the Israeli prime minister an apology. It owes itself some serious reflection as to how it came to publish that cartoon — and how its publication came, to many longtime readers, as a shock but not a surprise.
Bret L. Stephens has been an Opinion columnist with The Times since April 2017. He won a Pulitzer Prize for commentary at The Wall Street Journal in 2013 and was previously editor in chief of The Jerusalem Post.
What if the New York Times Cartoon had depicted a Muslim, a Lesbian, an African American or a Mexican as a Dog?
Alan M. Dershowitz
Gatestone
April 29, 2019
Imagine if the New York Times cartoon that depicted Israel’s Prime Minister as a dog had, instead, depicted the leader of another ethnic or gender group in a similar manner? If you think that is hard to imagine, you are absolutely right. It would be inconceivable for a Times editor to have allowed the portrayal of a Muslim leader as a dog; or the leader of any other ethnic or gender group in so dehumanizing a manner.
What is it, then, about Jews that allowed such a degrading cartoon about one of their leaders? One would think that in light of the history of the Holocaust, which is being commemorated this week, the last group that a mainstream newspaper would demonize by employing a caricature right out of the Nazi playbook, would be the Jews. But no. Only three-quarters of a century after Der Stürmer incentivized the mass murder of Jews by dehumanizing them, we see a revival of such bigoted caricatures.
The New York Times should be especially sensitive to this issue, because they were on the wrong side of history when it came to reporting the Holocaust. They deliberately buried the story because their Jewish owners wanted to distance themselves from Jewish concerns. They were also on the wrong side of history when it came to the establishment of the nation-state of the Jewish people, following the Holocaust. When it comes to Jews and Israel, the New York Times is still on the wrong side of history.
I am a strong believer in freedom of speech and the New York Times has a right to continue its biased reporting and editorializing. But despite my support for freedom of speech, I am attending a protest in front of the New York Times this afternoon to express my freedom of speech against how the New York Times has chosen to exercise its.
There is no inconsistency in defending the right to express bigotry and at the same time protesting that bigotry. When I defended the rights of Communists and Nazis to express their venomous philosophies, I also insisted on expressing my contempt for their philosophies. I did the same when I defended the rights of Palestinian students to fly the Palestinian flag in commemoration of the death of Yasser Arafat. I went out of my way to defend the right of students to express their support of this mass-murderer. But I also went out of my way to condemn Arafat and those who supported him and praise his memory. I do not believe in free speech for me, but not for thee. But I do believe in condemning those who hide behind the First Amendment to express anti-Semitic, anti-Muslim, homophobic, sexist or racist views.
Nor is the publication of this anti-Semitic cartoon a one-off. For years now, the New York Times op-ed pages have been one-sidedly anti-Israel. Its reporting has often been provably false, and all the errors tend to favor Israel’s enemies. Most recently, the New York Times published an op-ed declaring, on Easter Sunday, that the crucified Jesus was probably a Palestinian. How absurd. How preposterous. How predictable.
In recent years, it has become more and more difficult to distinguish between the reporting of the New York Times and their editorializing. Sometimes its editors hide behind the euphemism « news analysis, » when allowing personal opinions to be published on the front page. More recently, they haven’t even bothered to offer any cover. The reporting itself, as repeatedly demonstrated by the Committee for Accuracy in Middle East Reporting in America (CAMERA), has been filled with anti-Israel errors.
The publishers of the New York Times owe its readers a responsibility to probe deeply into this bias and to assume responsibility for making the Times earn its title as the newspaper of record. Any comparison between the reporting of the New York Times and that of the Wall Street Journal when it comes to the Middle East would give the New York Times a failing grade.
Having said this, I do not support a boycott of the New York Times. Let readers decide for themselves whether they want to read its biased reporting. I, for one, will continue to read the New York Times with a critical eye, because it is important to know what disinformation readers are getting and how to challenge that disinformation in the marketplace of ideas.
So I am off to stand in protest of the New York Times, while defending its right to be wrong. That is what the First Amendment is all about. Finally, there is some good news. One traditional anti-Semitic trope is that « the Jews control the media. » People who peddle this nonsense often point to the New York Times, which is, in fact, published by a prominent Jewish family, the Sulzbergers. Anyone who reads the New York Times will immediately see the lie in this bigoted claim: Yes, the New York Times has long been controlled by a Jewish family. But this Jewish family is far from being supportive of Jewish values, the nation-state of the Jewish people or Jewish sensibilities. If anything, it has used its Jewishness as an excuse to say about Jews and do to Jews what no mainstream newspaper, not owned by Jews, would ever do.
Alan M. Dershowitz is the Felix Frankfurter Professor of Law Emeritus at Harvard Law School, Distinguished Senior Fellow of Gatestone Institute and author of The Case Against The Democrats Impeaching Trump, Skyhorse Publishing, 2019.
Voir de même:
New York Times apes Der Sturmer with anti-Semitic Cartoon
Alex Safian, PhD
Camera
April 28, 2019A dog with a Jewish star around its neck and the face of a Jewish leader, leading a blind, yarmulke-wearing U.S. President would be standard fare for the notorious Nazi newspaper Der Sturmer, and for its modern descendants.
Unfortunately the New York Times must now be counted among those descendants. Just days after the Times published an op-ed falsely claiming Jesus was a Palestinian, the New York Times International Edition placed this cartoon on their op-ed page, depicting Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu as a dog leading a blind U.S. President Donald Trump:
The cartoon is by the award-winning (aren’t they all) Portuguese cartoonist Antonio Antunes Moreira, and was distributed by the New York Times News Service and Syndicate.
After a wave of criticism – perhaps among the earliest was a tweet from the left-wing site Jewish Worker – the Times removed the image and tweeted this statement:
A political cartoon in the international print edition of The New York Times on Thursday, included anti-Semitic tropes, depicting the Prime Minister of Israel as a guide dog with a Star of David collar leading the President of the United States, shown wearing a skullcap. The image was offensive, and it was an error of judgement to publish it. It was provided by the New York Times News Service and Syndicate, which has since deleted it.
Some have termed this an apology – it is not, it is cold-blooded and at best descriptive. Neither the word apology nor any synonym for apology is employed, and there is nothing about accountability or further steps the Times will take to make sure nothing like this ever happens again. This did not happen in a vacuum, but there is nothing about the responsible editor or editors being fired, or even disciplined. There is nothing about no longer accepting or distributing cartoons from the cartoonist Antonio, who has previously used religious symbols in an offensive way. For example, in the cartoon below the Jewish Star of David is represented as controlling the United States, and a crescent moon often associated with Islam is linked with dynamite. Both the Jewish Star and the crescent moon are seemingly bloody:
CAMERA has long dissected and debunked the Times’ faulty coverage of Israel, for example here, here, here, here and – the full list going back to 1992 – here. But publisher Arthur (A.G.) Sulzberger and Executive Editor Dean Baquet are seemingly oblivious to the paper’s deterioration under their watch. What kind of environment have they and their predecessors created (including under Sulzberger’s father) that this could happen?
How low does the Times have to sink for them and their senior colleagues to finally acknowledge, if only to themselves, that the paper’s foundation is rotting, and that radical repairs are urgently needed?
Update 1: The Times has today tweeted an apology and explanation for running the anti-Semitic cartoon, with a promise of “significant changes.” Below is the Times‘ tweet and then the text:
We are deeply sorry for the publication of a political cartoon last Thursday that ran in the print edition of the New York Times that circulates outside of the United States, and we are committed to making sure nothing like this happens again. Such imagery is always dangerous, and at a time when anti-Semitism is on the rise worldwide, it’s all the more unacceptable. We have investigated how this happened and learned that, because of a faulty process, a single editor acting without adequate oversight downloaded the syndicated cartoon and made the decision to include it on the Opinion page. The matter remains under review, and we are evaluating our internal processes and training. We anticipate significant changes.
Times columnist Bret Stephens also published an excellent column about the incident in today’s paper: A Despicable Cartoon in The Times. The incisive subheading of the column is “The paper of record needs to reflect deeply on how it came to publish anti-Semitic propaganda,” which is exactly what CAMERA and others had also called for.
The Times‘ apology and acknowledgement is a great improvement over their earlier, inadequate “Editors Note,” reprinted above. But, of course, the real question is what Sulzberger and Baquet actually do to fix the corrupted culture that allowed this to happen, and will that fix also be reflected in its news pages, especially when covering Israel? As CAMERA has long pointed out, and as Stephens says in his column:
How have even the most blatant expressions of anti-Semitism become almost undetectable to editors who think it’s part of their job to stand up to bigotry?
The reason is the almost torrential criticism of Israel and the mainstreaming of anti-Zionism, including by this paper, which has become so common that people have been desensitized to its inherent bigotry. So long as anti-Semitic arguments or images are framed, however speciously, as commentary about Israel, there will be a tendency to view them as a form of political opinion, not ethnic prejudice. But as I noted in a Sunday Review essay in February, anti-Zionism is all but indistinguishable from anti-Semitism in practice and often in intent, however much progressives try to deny this.
Add to the mix the media’s routine demonization of Netanyahu, and it is easy to see how the cartoon came to be drawn and published: Already depicted as a malevolent Jewish leader, it’s just a short step to depict him as a malevolent Jew.
I’m writing this column conscious of the fact that it is unusually critical of the newspaper in which it appears, and it is a credit to the paper that it is publishing it. I have now been with The Times for two years and I’m certain that the charge that the institution is in any way anti-Semitic is a calumny.
But the publication of the cartoon isn’t just an “error of judgment,” either. The paper owes the Israeli prime minister an apology. It owes itself some serious reflection as to how it came to publish that cartoon — and how its publication came, to many longtime readers, as a shock but not a surprise.
Update 2: Just days after apologizing for an anti-Semitic cartoon that ran in its International Edition, the Times published another offensive cartoon in its international paper, this one depicting Israeli Prime Minister Netanyahu as a sunglasses-wearing Moses carrying a tablet and taking a selfie, which a Times spokesperson tepidly defended as not as bad as the first cartoon:
This cartoon is by the Norwegian cartoonist Roar Hagen, who has his own history of offensive anti-Jewish cartoons.
According to an exclusive story by Lloyd Grove in the Daily Beast, after criticism for running the second cartoon, the Times then announced it will suspend publishing syndicated cartoons in its International Edition and will cut its ties to the source of the cartoon, Cartoon Arts, which the Times had long syndicated via its Times Licensing Group. Grove quoted Times spokesperson Eileen Murphy as saying:
The cartoon that ran in the international print edition of The Times last Thursday was clearly anti-Semitic and indefensible and we apologize for its publication. While we don’t think this [second] cartoon falls into that category, for now, we’ve decided to suspend the future publication of syndicated cartoons.
Of course, suspending the publication of cartoons does not really address the real problem, which is that many in the Times hierarchy are themselves reflexively critical of Israel, and so find toxic anti-Israel cartoons – and their own toxic anti-Israel news coverage – as perfectly normal and justified.
What needs to change at the Times is not whether or not there are cartoons, it is the toxic anti-Israel culture.
Finally, scholar and Jerusalem Post op-ed editor and columnist Seth Frantzman has an excellent rundown of the scandal, including a link to his own column
This cartoon didn’t end up in the International Edition of The New York Times by mistake. It was chosen; it was put on a page by someone. It was checked and re-checked.
Voir de plus:
New York Times pathetic excuse for printing antisemitic cartoon – opinion
You thought that Congresswoman Ilhan Omar’s comments about foreign loyalty or “Benjamins” were problematic. The International Edition of the New York Times just said “let me show you what we can do.”
Seth J. Frantzman
Jerusalem Post
April 28, 2019
At a time of rising antisemitism, when we have become increasingly exposed to the notion of dog whistles and tropes that are antisemitic, when there is a lively and active debate about this issue in the US, The New York Times International Edition did the equivalent of saying “hold my beer.”
You thought that Congresswoman Ilhan Omar’s comments about foreign loyalty or “Benjamins” were problematic. The International Edition of the Times just said: “Let me show you what we can do,” with a cartoon of a yarmulke-wearing, blind US President Donald Trump being led by a dog with a Star of David collar and Prime Minister Benjamin Netanyahu’s face for a head.
I didn’t believe the cartoon was real when I first saw it. Many of my colleagues didn’t believe it either. I spent all day Saturday trying to track down a hard copy. I phoned friends, I got a PDF of the edition, and even then I didn’t believe it.
I had to see for myself. So I drove to a 24-hour supermarket. There on the newsstand was the April 25 edition. I flipped gingerly through, fearing to see Page 16.
And then I found it. It stared back at me: That horrid image of a blind US President Donald Trump with a yarmulke being led by a dog with the face of Prime Minister Benjamin Netanyahu. Worse, the dog was wearing a Star of David as a collar.
This is what The New York Times thinks of us Israelis. Even if they subsequently said it was an error, they thought it was okay to print a cartoon showing the US president being blindly led by the “Jewish dog”?
And not only that, those who watched as it went to print thought it was fine to put a Jewish skullcap on the US president. Dual loyalty? No need to even wrestle with that question.
It used to be that we were told that Trump was fostering “Trump antisemitism” and driving a new wave of antisemitism in the US. But the cartoon depicts him as a Jew. Well, which is it? Is he fostering antisemitism, or is he now a closet Jew being led by Israel, depicted as a Jewish dog? We used to say that images “conjured up memories” of 1930s antisemitism. This didn’t conjure it up; this showed us exactly what it looked like.
The Nazis also depicted us as animals. They also put Stars of David on us. Antisemites have compared us to dogs, pigs and monkeys before. It used to be that it was on the far-Right that Jews were depicted as controlling the world, like an octopus or a spider.
But now we see how mainstream it has become to blame the Jews and Israel for the world’s problems.
The cartoon comes in the context of numerous similar antisemitic statements and “dog whistles.” In this case it isn’t only “the Jews” but also Israel “leading” the US president. The cartoon is clear as day. It presents the Jews, as symbolized by that Star of David collar, secretly controlling the US president. Trump is being led by Israel, by the Jewish state.
No other country or minority group is subjected to such unrelenting and systematic hatred by mainstream US newspapers. No one would dare to put an Islamic leader’s face on a dog, with Islamic symbols, leading the US president.
Of course not. The editor would stop that.
They’d be sensitive to this issue. They would err on the side of not being offensive. The night editor, the assistant editor or someone would say: “This doesn’t look right.”
Imagine the days when racists tried to depict US president Barack Obama as a closet Muslim. We know the tropes. So why put a yarmulke on Trump’s head? When it comes to Jews and Israel, there is no depth to which they will not sink.
And an apology after the fact isn’t enough.
I know. I’m an Op-ed Editor. When I used to run cartoons in my section, no fewer than four people would see it before it went to print. At the International Edition of The New York Times, it should have been more than four. And they all thought it was fine? What that tells me is that there is a culture of antisemitism somewhere in the newsroom.
THERE ISN’T just one problem with this cartoon. There are numerous problems.
Problem one is putting a yarmulke on the US president in a negative way. What is being said there? That he is secretly a Jew. Then making him blind, and having him led by Israel. That implies Israel controls US policy or controls America.
That is problem two. Then they put a dog leash with a Star of David, which is antisemitic in multiple ways.
Problems three and four. You’d think that after the Holocaust, any use of the Star of David would automatically raise questions in a newsroom.
But no. Then they put the Israeli prime minister’s face on a dog. On a dog. Problem number five.
So this cartoon wasn’t just mildly antisemitic. It wasn’t like “whoops.” It was deeply antisemitic.
The New York Times acknowledged this in a kind of pathetic way. They admitted that the cartoon “included antisemitic tropes.” It then noted, “The image was offensive and it was an error of judgement to publish it.”
That’s not enough. An error of judgment would imply that it was just a kind of mistake. “Tropes” would imply that to some people it is antisemitic, but that it’s not clear as day.
But this is clear as day.
This isn’t like some story of unclear antisemitism. This isn’t a dog whistle. This is a dog. This is antisemitic on numerous levels. It’s time to say no more. It’s time to say “They shall not pass.”
This should be a defining moment. It is a defining moment because one of America’s most prestigious newspapers did this, not some small town newspaper somewhere.
That it was in the International Edition doesn’t make it any less harmful. In fact, it shows America’s face to the world and gives a quiet signal to other antisemites. How can we demand that there be zero tolerance for antisemitism and antisemitic tropes when this happens?
People must speak up against the cartoon fiasco and demand a real accounting. And a real conversation. Not another set of excuses where we all pretend it’s not clearly antisemitism, and it’s not clearly an attack on Jews and “dual loyalty.”
We need to hear contrition and explanations. The public should be included, and The New York Times should listen to how harmful and offensive this was.
Voir encore:
Une caricature antisémite publiée dans le “New York Times” : “un dessin abject”
Le grand quotidien américain s’est excusé pour un dessin représentant Donald Trump et Benyamin Nétanyahou, paru dans son édition internationale. Plus qu’une simple erreur de jugement, dénonce un de ses propres chroniqueurs.
Courrier international
29/04/2019
“Un dessin abject dans le New York Times” : c’est le titre d’une chronique publiée le 28 avril par le New York Times lui-même. Le chroniqueur conservateur Bret Stephens n’hésite pas à critiquer l’institution qui l’emploie pour avoir publié dans son édition internationale une caricature jugée antisémite par de nombreux lecteurs
Ce dessin représente le Premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, sous l’apparence d’un chien tirant au bout de sa laisse le président américain, Donald Trump. Nétanyahou est affublé d’un collier avec une étoile de David, tandis que Trump porte une kippa et des lunettes noires. “Le Juif sous la forme d’un chien. Le Juif petit mais rusé menant l’Américain naïf et idiot. Trump, cet homme détesté, judaïsé avec une kippa. […] Le dessin était tellement rempli de traits antisémites que tout ce qui manquait, c’était le symbole du dollar”, dénonce le chroniqueur.
La caricature, œuvre du dessinateur portugais António Moreira Antunes, a d’abord été publiée par le journal de Lisbonne Expresso, a précisé le New York Times. D’après le quotidien israélien Jerusalem Post, ce dessinateur aurait déjà été accusé d’antisémitisme dans le passé.
Des excuses sont venues du New York Times à deux reprises. “Nous sommes sincèrement désolés de la publication d’un dessin antisémite jeudi dernier”, a notamment fait savoir, dimanche 28 avril, la rubrique Opinions du journal. En mettant en cause une décision prise dans la précipitation par un seul éditeur.
Pour le chroniqueur Bret Stephens, il ne s’agit pourtant pas d’une simple erreur de jugement. Si la rédaction du New York Times n’est pas coupable d’antisémitisme, elle aurait manqué de vigilance face à une image antisémite. Et cela, selon ce chroniqueur qui prend régulièrement la défense d’Israël, du fait du “flot de critiques à l’encontre d’Israël et [de] la banalisation de l’antisionisme, y compris dans ce journal. Un antisionisme devenu si courant que les gens ne perçoivent plus qu’il est intrinsèquement sectaire.”
Voir aussi:
The past several days have left many Jews in the United States feeling shell-shocked. Attacks against them seem to be coming from all quarters.
First, on Thursday, the New York Times’ International Edition published a stunningly antisemitic cartoon on its op-ed page. It portrayed a blind President Donald Trump wearing the garb of an ultra-Orthodox Jew, replete with a black suit and a black yarmulke, with the blackened sunglasses of a blind man being led by a seeing-eye dog with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu’s face.
If the message – that Jewish dogs are leading the blind American by the nose — wasn’t clear enough, the Netanyahu dog was wearing a collar with a Star of David medallion, just to make the point unmistakable.
Under a torrent of criticism, after first refusing to apologize for the cartoon, which it removed from its online edition, the Times issued an acknowledment on Sunday, but has taken no action against the editors responsible.
Two days after the Times published its hateful cartoon, Jews at the Chabad House synagogue in Poway, outside San Diego, were attacked by a rifle-bearing white supremacist as they prayed.
John Earnest, the gunman, murdered 60-year-old Lori Glibert Kaye and wounded Rabbi Yisroel Goldstein; nine-year-old Noya Dahan; and her uncle, Almog Peretz.
On the face of things, there is no meaningful connection between the Times’ cartoon and the Poway attack. In his online manifesto, Earnest presented himself as a Nazi in the mold of Robert Bowers, the white supremacist who massacred 11 Jews at the Tree of Life Synagogue last October.
The New York Times, on the other hand, is outspoken in its hatred of white supremacists whom it associates with President Donald Trump, the paper’s archenemy.
On the surface, the two schools of Jew hatred share no common ground.
But a serious consideration of the Times’ anti-Jewish propaganda leads to the opposite conclusion.
The New York Times — as an institution that propagates anti-Jewish messages, narratives, and demonizations — is deeply tied to the rise in white supremacist violence against Jews. This is the case for several reasons.
First, as Seth Franzman of the Jerusalem Post pointed out, Bowers and Earnest share two hatreds – for Jews and for Trump.
Both men hate Trump, whom they view as a friend of the Jews. Earnest referred to Trump as “That Zionist, Jew-loving, anti-White, traitorous c**ks****er.” Bowers wrote that he opposed Trump because he is supposedly surrounded by Jews, whom Bowers called an “infestation” in the White House.
The New York Times also hates Trump. And like Bowers and Earnest, it promotes the notion in both news stories and editorials that Trump’s support for Israel harms U.S. interests to benefit avaricious Jews.
In 2017, just as the Russia collusion narrative was taking hold, Politico spun an antisemitic conspiracy theory that placed Chabad at the center of the nefarious scheme in which Russian President Vladimir Putin connived with Trump to steal the election from Democratic nominee Hillary Clinton. The obscene story referred to Chabad as “an international Hasidic movement most people have never heard of.” In truth, Chabad is one of the largest Jewish religious movements in the world and the fastest-growing Jewish religious movement in the United States.
The story, titled “The Happy-Go-Lucky Jewish Group that Connects Trump and Putin,” claimed that Russia’s Chief Rabbi Berel Lazar, who is Chabad’s senior representative there, served as an intermediary between Putin and Trum-p. He did this, Politico alleged, through his close ties to Chabad rabbis in the United States who have longstanding ties to Trump.
Following the article’s publication, the New York Times‘ star reporter Maggie Haberman tweeted, “We wrote a few weeks ago about “Putin’s Rabbi” Berel Lazar reaching out to a Trump aide.”
The Times’ story alleged that there were across-the-board ties between senior Trump campaign aides and Russian officials. Among the many ties discussed was a meeting that Trump’s advisor Jason Greenblatt held with Lazar. In other words, the antisemitic Chabad conspiracy theory laid out by Politico, which slanderously placed Chabad at the center of a nefarious plot to steal the U.S. presidency for Trump, was first proposed by the New York Times.
The Times is well known for its hostility towards Israel. But that hostility is never limited to Israel itself. It also encompasses Jewish Americans who support Israel. For instance, in a 11,000 word “analysis” of the antisemitic “boycott, divestment, sanctions” (BDS) movement published in late March, the Times effectively delegitimized all Jewish support for Israel.
The article, by Nathan Thrush. purported to be an objective analysis of BDS, which calls for Israel to be destroyed and uses forms of social, economic and political warfare against Jews who support Israel to render continued support for Israel beyond the Pale.
Rather than objectively analyzing BDS, Thrall’s article promoted it — and, through it, the rticle delegitimized American Jewish support for Israel.
The article began with a description of the discussions on Israel conducted by the Democratic Party’s platform committee ahead of the 2016 Democratic National Convention. The committee was comprised of representatives of Senator Bernie Sanders (I-VT) and representatives of former Secretary of State Hillary Clinton.
Thrall wrote:
The representatives chosen by Sanders…were all minorities, including James Zogby, the head of the Arab American Institute and a former senior official on Jesse Jackson’s 1984 and 1988 presidential campaigns; the Native American activist Deborah Parker; and Cornel West, the African-American professor and author then teaching at Union Theological Seminary.
The representatives selected by Clinton and the D.N.C. who spoke on the issue were all Jewish and included the retired congressman Howard Berman, who is now a lobbyist; Wendy Sherman, a former under secretary of state for political affairs; and Bonnie Schaefer, a Florida philanthropist and Democratic donor, who had made contributions to Clinton.
In other words, the anti-Israel representatives were all civil rights activists and members of legitimate victim groups. The pro-Israel representatives were all there because of their money.
And of course, because they are all-powerful, the Jews won.
The New York Times’ promotion of anti-Jewish libels in relation to Israel and more generally is all-encompassing. The Times reacted, for example, to Trump’s designation of the Iranian Revolutionary Guard Corps (IRGC) as a terrorist organization by suggesting that he move could lead the U.S. to designate Israeli intelligence agencies as terrorist organizations.
Why? Well, because they are Israeli. And Israelis are terrorists.
The Times used the recent death of an Israeli spymaster to regurgitate a long discredited accusation that Israel stole enriched uranium from the United States. As is its wont, the Times libeled Israel in bold and then published a correction in fine print.
In addition, as part of its longstanding war against Israel’s Orthodox religious authorities, Times columnist Bari Weiss alleged falsely that Israel’s rabbinate controls circumcision, suggesting that the voluntary practice is compulsory.
Last week the Times erroneously claimed that Jesus was a Palestinian. The falsehood was picked up by antisemitic Rep. Ilhan Omar (D-MN). The Times waited a week to issue a correction.
As to Ilhan Omar, the Times falsely claimed that the only congressional Democrats who condemned her anti-Semitic tweets were Jews — when in fact the Democratic Congressional leadership, which is not comprised of Jews, condemned her anti-Jewish posts.
The paper’s hostility towards Jews is so intense and pervasive that despite the increased public attention to the paper’s hostility to Jews that its anti-Jewish cartoon of blind Trump and dog Netanyahu generated, on Sunday the Times published a feature on bat mitzvahs that portrayed the religious rite of passage for 12 year old girls as a materialist party geared entirely toward social climbing. That is, the Judaism the Times portrayed was denuded of all intrinsic meaning. Bat mitzvahs were presented as a flashy way that materialistic, vapid Jews promote their equally vapid, materialistic daughters.
All this, then, brings us to the synagogue shooting on Saturday and the larger phenomenon of growing antisemitism in America, which while relegated to the margins of the political right is now becoming a dominant force in the Democratic Party specifically and the political left more generally.
In an op-ed following the cartoon’s publication, the Times’ in-house NeverTrump pro-Israel columnist Bret Stephens at once condemned the cartoon and the paper’s easy-breezy relationship with antisemitism, and minimized the role that antisemitism plays at the New York Times. Stephens attributed the decision to publish the cartoon in the New York Times international edition to the small staff in the paper’s Paris office and insisted that “the charge that the institution [i.e., the Times] is in any way antisemitic is a calumny.”
But of course, it is not a calumny. It is a statement of fact, laid bare by the paper’s decision to publish a cartoon that could easily have been published in a Nazi publication.
And this brings us back to the issue of the Times’ responsibility for rising antisemitism in the United States.
Stephens tried to minimize the Times’ power to influence the public discourse in the U.S. by placing its antisemitic reporting in the context of a larger phenomenon. But the fact is that while the New York Times has long since ceased serving as the “paper of record” for anyone not on the political left in America, it is still the most powerful news organization in the United States, and arguably in the world.
The Times has the power to set the terms of the discourse on every subject it touches. Politico felt it was reasonable to allege a Jewish world conspiracy run by Chabad that linked Putin with Trump because, as Haberman suggested, the Times had invented the preposterous, bigoted theory three weeks earlier. New York University felt comfortable giving a prestigious award to the Hamas-linked antisemitic group Students for Justice in Palestine last week because the Times promotes its harassment campaign against Jewish students.
The Times’ active propagation of anti-Jewish sentiment is not the only way the paper promotes Jew-hatred. It has co-opted of the discourse on antisemitism in a manner that sanitizes the paper and its followers from allegations of being part of the problem. It has led the charge in reducing the acceptable discourse on antisemitism to a discussion of right wing antisemitism. Led by reporter Jonathan Weisman, with able assists from Weiss and Stephens, the Times has pushed the view that the most dangerous antisemites in America are Trump supporters. The basis of this slander is the false claim that Trump referred to the neo-Nazis who protested in Charlottesville in August 2017 as “very fine people.” As Breitbart’s Joel Pollak noted, Trump specifically singled out the neo-Nazis for condemnation and said merely that the protesters at the scene who simply wanted the statue of Robert E. Lee preserved (and those who peacefully opposed them) were decent people.
The Times has used this falsehood as a means to project the view that hatred of Jews begins with Trump – arguably the most pro-Jewish president in U.S. history, goes through the Republican Party, which has actively defended Jews in the face of Democratic bigotry, and ends with his supporters.
By attributing an imaginary hostility against Jews to Trump, Republicans, and Trump supporters, the Times has effectively given carte blanche to itself, the Democrats, and its fellow Trump-hating antisemites to promote Jew-hatred.
John Earnest and Robert Bowers were not ordered to enter synagogues and massacre Jews by the editors of the New York Times. But their decisions to do so was made in an environment of hatred for Jews that the Times promotes every day.
Following the Bowers massacre of Jewish worshippers at the Tree of Life Synagogue in Pittsburgh, the New York Times and its Trump-hating columnists blamed Trump for Bowers’s action. Not only was this a slander. It was also pure projection.
Voir aussi:
I saw the darkness of antisemitism, but I never thought it would get this dark
The party faces a huge problem that must be surmounted, if only for moral reasons
Nick Cohen
The Guardian
30 Apr 2016
Racism is not a specific illness but a general sickness. Display one symptom and you display them all. If you show me an anti-Muslim bigot, I will be able to guess his or her views on the European Union, welfare state, crime and “political correctness”. Show me a leftwing or Islamist antisemite and, once again, he will carry a suitcase full of prejudices, which have nothing to do with Jews, but somehow have everything to do with Jews.
The Labour party does not have a “problem with antisemitism” it can isolate and treat, like a patient asking a doctor for a course of antibiotics. The party and much of the wider liberal-left have a chronic condition.
As I have written about the darkness on the left before, I am not going to crow now that it has turned darker than even I predicted. (There is not much to crow about, after all.) I have nothing but respect for the Labour MPs who are trying to stop their party becoming a playpen for fanatics and cranks. It just appears to me that they face interlocking difficulties that are close to insoluble.
They must first pay the political price of confronting supporters from immigrant communities, which Labour MPs from all wings of the party have failed to do for decades. It may be high. While Ken Livingstone was forcing startled historians to explain that Adolf Hitler was not a Zionist, I was in Naz Shah’s Bradford. A politician who wants to win there cannot afford to be reasonable, I discovered. He or she cannot deplore the Israeli occupation of the West Bank and say that the Israelis and Palestinians should have their own states. They have to engage in extremist rhetoric of the “sweep all the Jews out” variety or risk their opponents denouncing them as “Zionists”.
George Galloway, who, never forget, was a demagogue from the race-card playing left rather than the far right, made the private prejudices of conservative Muslim voters respectable. Aisha Ali-Khan, who worked as Galloway’s assistant until his behaviour came to disgust her, realised how deep prejudice had sunk when she made a silly quip about David Miliband being more “fanciable” than Ed. Respect members accused her of being a “Jew lover” and, all of a sudden in Bradford politics, that did not seem an outrageous, or even an unusual, insult. Where Galloway led, others followed. David Ward, a now mercifully forgotten Liberal Democrat MP, tried and failed to save his seat by proclaiming his Jew obsession. Nothing, not even the murder of Jews, could restrain him. At one point, he told his constituents that the sight of the Israeli prime minister honouring the Parisian Jews whom Islamists had murdered made him “sick”. (He appeared to find the massacre itself easier to stomach.)
Naz Shah’s picture of Israel superimposed on to a map of the US to show her “solution” for the Israeli-Palestinian conflict was not a one-off but part of a race to the bottom. But Shah’s wider behaviour as an MP – a “progressive” MP, mark you – gives you a better idea of how deep the rot has sunk. She ignored a Bradford imam who declared that the terrorist who murdered a liberal Pakistani politician was a “great hero of Islam” and concentrated her energies on expressing her “loathing” of liberal and feminist British Muslims instead.
Shah is not alone, which is why I talk of a general sickness. Liberal Muslims make many profoundly uncomfortable. Writers in the left-wing press treat them as Uncle Toms, as Shah did, because they are willing to work with the government to stop young men and women joining Islamic State. While they are criticised, politically correct criticism rarely extends to clerics who celebrate religious assassins. As for the antisemitism that allows Labour MPs to fantasise about “transporting” Jews, consider how jeering and dishonest the debate around that has become.
When feminists talk about rape, they are not told as a matter of course “but women are always making false rape accusations”. If they were, they would suspect that their opponents wanted to deny the existence of sexual violence. Yet it is standard in polite society to hear that accusations of antisemitism are always made in bad faith to delegitimise justifiable criticism of Israel. I accept that there are Jews who say that all criticism of Israel is antisemitic. For her part, a feminist must accept that there are women who make false accusations of rape. But that does not mean that antisemitism does not exist, any more than it means that rape never happens.
Challenging prejudices on the left wing is going to be all the more difficult because, incredibly, the British left in the second decade of the 21st century is led by men steeped in the worst traditions of the 20th. When historians had to explain last week that if Montgomery had not defeated Rommel at El Alamein in Egypt then the German armies would have killed every Jew they could find in Palestine, they were dealing with the conspiracy theory that Hitler was a Zionist, developed by a half-educated American Trotskyist called Lenni Brenner in the 1980s.
When Jeremy Corbyn defended the Islamist likes of Raed Salah, who say that Jews dine on the blood of Christian children, he was continuing a tradition of communist accommodation with antisemitism that goes back to Stalin’s purges of Soviet Jews in the late 1940s.
It is astonishing that you have to, but you must learn the worst of leftwing history now. For Labour is not just led by dirty men but by dirty old men, with roots in the contaminated soil of Marxist totalitarianism. If it is to change, its leaders will either have to change their minds or be thrown out of office.
Put like this, the tasks facing Labour moderates seem impossible. They have to be attempted, however, for moral as much as electoral reasons.
Allow me to state the moral argument as baldly as I can. Not just in Paris, but in Marseille, Copenhagen and Brussels, fascistic reactionaries are murdering Jews – once again. Go to any British synagogue or Jewish school and you will see police officers and volunteers guarding them. I do not want to tempt fate, but if British Jews were murdered, the leader of the Labour party would not be welcome at their memorial. The mourners would point to the exit and ask him to leave.
If it is incredible that we have reached this pass, it is also intolerable. However hard the effort to overthrow it, the status quo cannot stand.
Voir également:
A Rising Tide of Anti-Semitism
By publishing a bigoted cartoon, The Times ignored the lessons of history, including its own.
The Editorial Board
The New York Times
April 30, 2019
The Times published an appalling political cartoon in the opinion pages of its international print edition late last week. It portrayed Prime Minister Benjamin Netanyahu of Israel as a dog wearing a Star of David on a collar. He was leading President Trump, drawn as a blind man wearing a skullcap.
The cartoon was chosen from a syndication service by a production editor who did not recognize its anti-Semitism. Yet however it came to be published, the appearance of such an obviously bigoted cartoon in a mainstream publication is evidence of a profound danger — not only of anti-Semitism but of numbness to its creep, to the insidious way this ancient, enduring prejudice is once again working itself into public view and common conversation.
Anti-Semitic imagery is particularly dangerous now. The number of assaults against American Jews more than doubled from 2017 to 2018, rising to 39, according to a report released Tuesday by the Anti-Defamation League. On Saturday, a gunman opened fire during Passover services at a synagogue in San Diego County, killing one person and injuring three, allegedly after he posted in an online manifesto that he wanted to murder Jews. For decades, most American Jews felt safe to practice their religion, but now they pass through metal detectors to enter synagogues and schools.
Jews face even greater hostility and danger in Europe, where the cartoon was created. In Britain, one of several members of Parliament who resigned from the Labour Party in February said that the party had become “institutionally anti-Semitic.” In France and Belgium, Jews have been the targets of terrorist attacks by Muslim extremists. Across Europe, right-wing parties with long histories of anti-Semitic rhetoric are gaining political strength.
This is also a period of rising criticism of Israel, much of it directed at the rightward drift of its own government and some of it even questioning Israel’s very foundation as a Jewish state. We have been and remain stalwart supporters of Israel, and believe that good-faith criticism should work to strengthen it over the long term by helping it stay true to its democratic values. But anti-Zionism can clearly serve as a cover for anti-Semitism — and some criticism of Israel, as the cartoon demonstrated, is couched openly in anti-Semitic terms.
The responsibility for acts of hatred rests on the shoulders of the proponents and perpetrators. But history teaches that the rise of extremism requires the acquiescence of broader society.
As anti-Semitism has surged from the internet into the streets, President Trump has done too little to rouse the national conscience against it. Though he condemned the cartoon in The Times, he has failed to speak out against anti-Semitic groups like the white nationalists who marched in Charlottesville, Va., in 2017 chanting, “Jews will not replace us.” He has practiced a politics of intolerance for diversity, and attacks on some minority groups threaten the safety of every minority group. The gunman who attacked the synagogue in San Diego claimed responsibility for setting a fire at a nearby mosque, and wrote that he was inspired by the deadly attack on mosques in New Zealand last month.
A particularly frightening, and also historically resonant, aspect of the rise of anti-Semitism in recent years is that it has come from both the right and left sides of the political spectrum. Both right-wing and left-wing politicians have traded in incendiary tropes, like the ideas that Jews secretly control the financial system or politicians.
The recent attacks on Jews in the United States have been carried out by men who identify as white supremacists, including the killing of 11 people in a Pittsburgh synagogue last year. But the A.D.L. reports that most anti-Semitic assaults, and incidents of harassment and the vandalism of Jewish community buildings and cemeteries, are not carried out by the members of extremist groups. Instead, the perpetrators are hate-filled individuals.
In the 1930s and the 1940s, The Times was largely silent as anti-Semitism rose up and bathed the world in blood. That failure still haunts this newspaper. Now, rightly, The Times has declared itself “deeply sorry” for the cartoon and called it “unacceptable.” Apologies are important, but the deeper obligation of The Times is to focus on leading through unblinking journalism and the clear editorial expression of its values. Society in recent years has shown healthy signs of increased sensitivity to other forms of bigotry, yet somehow anti-Semitism can often still be dismissed as a disease gnawing only at the fringes of society. That is a dangerous mistake. As recent events have shown, it is a very mainstream problem.
As the world once again contends with this age-old enemy, it is not enough to refrain from empowering it. It is necessary to stand in opposition.
Voir de :
The anti-Semitism crisis tearing the UK Labour Party apart, explained
Labour leader Jeremy Corbyn is being accused of mishandling claims of anti-Semitism in the party.
Darren Loucaides
Vox.com
Mar 8, 2019
LONDON — The UK’s Labour Party is in the midst of a full-blown anti-Semitism crisis.
Recently, nine members of Parliament (MPs) quit the center-left party in protest of the current leadership, citing their handling of allegations of anti-Semitism as well as dissatisfaction over the party’s stance on Brexit.
“I cannot remain in a party that I have today come to the sickening conclusion is institutionally anti-Semitic,” Labour MP Luciana Berger said at a February 18 press conference explaining her decision to leave. Berger, who is Jewish, has received a torrent of anti-Semitic abuse online over the past few years.
While rumors have circulated for months about a possible Labour split due to the UK’s upcoming, chaotic divorce from the European Union, the resignations — particularly Berger’s — sent shock waves through the party, and many felt that the party leadership should have done more to protect Berger from the abuse she’d been receiving.
If you’re wondering how the situation has escalated to this point, don’t worry. We’ve got you covered.
The anti-Semitism controversy in the Labour Party is fairly recent
The UK Labour Party, which dates back to 1900, was long seen as the party of the working classes. Throughout most of its history, Labour has stood for social justice, equality, and anti-racism.
Labour’s controversy over anti-Semitism is fairly recent. It’s often traced back to 2015, when Jeremy Corbyn became the party leader. Corbyn, seen as on Labour’s left wing, has long defended the rights of Palestinians and often been more critical than the party mainstream of Israel’s government.
But during the Labour leadership contest in 2015, a then-senior Jewish Labour MP said that Corbyn had in the past showed “poor judgment” on the issue of anti-Semitism — after Corbyn unexpectedly became the frontrunner in the contest, a Jewish newspaper reported on his past meetings with individuals and organizations who had expressed anti-Semitic views.
Concerns over anti-Semitism only really began to turn into a crisis, however, the year after Corbyn became leader. In April 2016, a well-known right-wing blog revealed that Labour MP Naz Shah had posted anti-Semitic messages to Facebook a couple of years before being elected.
One post showed a photo of Israel superimposed onto a map of the US, suggesting the country’s relocation would resolve the Israeli-Palestinian conflict. Above the photo, Shah wrote, “Problem solved.”
Shah apologized, but former Mayor of London Ken Livingstone, a long-time Labour member who was close to party leader Jeremy Corbyn, made things worse by rushing to Shah’s defense — and added an inflammatory claim that Hitler initially supported Zionism, before “he went mad and ended up killing six million Jews.”
The party suspended Shah and Livingstone and launched an inquiry into anti-Semitism. But Corbyn was criticized for not acting quickly or decisively enough to deal with the problem. Afterward, claims of anti-Semitism kept resurfacing as individual examples were dug up across Labour’s wide membership.
By now a narrative was building that anti-Semitism was rife within the party — and that the election of Corbyn as leader was the cause.
The unlikely rise of Jeremy Corbyn
Jeremy Corbyn became Labour’s leader in 2015, to pretty much everyone’s surprise.
The 69-year-old became politically active in his 20s and had been a so-called “backbencher” — an MP without an official position in the government or the opposition parties — since 1983.
Throughout his political career, Corbyn has protested against racism and backed left-wing campaigns such as nuclear disarmament, and was considered the long shot in the party’s leadership contest — bookmakers initially put the chance of him winning at 200 to 1.
The three other candidates were considered centrist or center-left. Two had served in government during the New Labour era, when Tony Blair swung the party to the center ground. Corbyn’s victory confirmed that the New Labour project was dead.
Some MPs later admitted they only backed him as one of the leadership candidates so that a representative of the party’s left-wing would be on the ballot; they never thought he would win.
Corbyn’s campaign drummed up a big grassroots following as his anti-austerity, socialist message gained traction, in a way that would later be echoed by Bernie Sanders’s 2016 campaign in the US.
Shocking the establishment and against all odds, Corbyn went on to decisively win the leadership contest. When, the following year, MPs on the right of the party revolted and forced a leadership contest, Corbyn yet again won convincingly.
Ever since Tony Blair helmed the party from 1994 to 2007, Labour had been dominated by more centrist than left-leaning MPs. Under Blair, Labour embraced neoliberal economics alongside more traditionally liberal social policies, such as a minimum wage.
But after Corbyn’s unexpected win, everything changed. Corbyn steered the party to the left on many issues, including proposals to nationalize the railways and possibly the energy companies, end the era of slashing state spending, and tax the rich.
He also moved the party leftward on Israel and Palestine.
Labour’s previously moribund membership boomed to half a million, making it one of the biggest political parties in Europe. The many newcomers were attracted by the chance to support a truly left-wing Labour Party.
Claims of anti-Semitism also increased: Labour’s general secretary revealed that between April 2018 and January 2019, the party received 673 accusations of anti-Semitism among members, which had led to 96 members being suspended and 12 expelled.
Part of the reason anti-Semitism claims have grown under Corbyn is that his wing of the party — the socialist left — tends to be passionately pro-Palestine. There is nothing inherently anti-Semitic about defending Palestinians, but such a position can lead to tensions between left-wing anti-Zionists and mainstream Jewish communities.
This tension has at times led to a tendency on the left to indulge in anti-Semitic conspiracy theories and tropes — like blaming a Jewish conspiracy for Western governments’ support of Israel or equating Jews who support Israel with Nazi collaborators.
Corbyn’s defenders point out that the media has inordinately focused on Labour while giving less attention to cases of racism and Islamophobia among the Conservatives and other parties. But if it wasn’t clear already, recent events have confirmed that anti-Semitism is a crisis for Labour.
Many of the MPs who resigned from Labour two weeks ago had long been threatening to go, and have deeply held political differences with Labour’s more radically progressive leadership. But Luciana Berger resigned because of anti-Semitism, and Labour’s failure to prevent her from leaving on this count is impossible to ignore.
Is Corbyn to blame for Labour’s current crisis?
At first glance, Corbyn hardly seems like someone who would be an enabler of anti-Semitism.
He has a long history of campaigning against racism — for instance, in the 1980s, he participated in anti-apartheid protests against South Africa, at the same time that former Conservative Prime Minister Margaret Thatcher was calling Nelson Mandela’s African National Congress opposition movement a “typical terrorist organization.”
And he has long campaigned for Palestinian rights, while being critical of the government of Israel — including comparing Israel’s treatment of Palestinians to apartheid.
But Corbyn’s anti-imperialist, anti-racist stance over the years has also led some to label him a terrorist sympathizer. Corbyn in the past advocated for negotiations with militant Irish republicans. As he did with Irish republicans, Corbyn encouraged talks with the Islamist militant groups Hamas and Hezbollah.
He has also been heavily criticized for having previously referred to these groups as “friends,” which caused outrage when publicized during 2015’s Labour leadership contest. Corbyn explained that he had only used “friends” in the context of trying to promote peace talks, but later said he regretted using the word.
Last March, Corbyn was also criticized for a 2012 comment on Facebook, in which he had expressed solidarity with an artist who had used anti-Semitic tropes in a London mural that was going to be torn down.
After Luciana Berger tweeted about the post and demanded an explanation from the Labour Party leadership, Corbyn said that he “sincerely regretted” having not looked at the “deeply disturbing” image more closely, and condemned anti-Semitism.
A few days later, Jewish groups gathered outside the UK Parliament to demonstrate against anti-Semitism. The Jewish Leadership Council, an umbrella organization for several Jewish groups and institutions in the UK, said that there was “no safe space” in the Labour Party for Jewish people.
“Rightly or wrong, Jeremy Corbyn is now the figurehead for an anti-Semitic political culture, based upon an obsessive hatred of Israel, conspiracy theories and fake news,” the chair of the Jewish Leadership Council, Jonathan Goldstein, said at the time.
The crisis didn’t end there. In August 2018, the right-wing British newspaper the Daily Mail accused Corbyn of having laid a wreath at the graves of the Palestinian terrorists while in Tunisia in 2014.
Corbyn acknowledges that he participated in a wreath-laying ceremony at a Tunisian cemetery in 2014, but says he was commemorating the victims of a 1985 Israeli airstrike on the headquarters of the Palestinian Liberation Organization (PLO), who were living in exile in Tunis at the time. The airstrike killed almost 50 people, including civilians, and wounded dozens more.
However, the Daily Mail published photos showing Corbyn holding a wreath not far from the graves of four Palestinians believed to be involved with the 1972 Munich massacre, in which members of the Black September terrorist organization killed 11 Israeli athletes and a German police officer at the Munich Olympics.
Corbyn denies he was commemorating the latter individuals, but his muddled explanations in the wake of the controversy left some unsatisfied with his response.
Today, on social media, it is common to see Corbyn denounced for enabling anti-Semitism — author J.K. Rowling has even criticized him for it — while some brand him outright as an anti-Semite. When US Rep. Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY) recently tweeted that she’d had “a lovely and wide-reaching conversation” with Corbyn by phone, hundreds of commenters criticized her for speaking to Labour’s “anti-Semitic” leader.
Corbyn’s defenders argue that there is no clear evidence that he — a lifelong campaigner against racism — is anti-Semitic.
“My mother was a refugee on the Kindertransport, and a massive friend of Corbyn — they worked terribly closely together, doing all sorts of political things to support communities in North London,” Annabelle Sreberny, emeritus professor at SOAS University of London and member of Jewish Voice for Labour — a small organization that tends to deny Labour has a problem with anti-Semitism — told me. “So the idea that he himself is an anti-Semite is just a pathetic smear.”
Sreberny told me she largely sees the portrayal of Corbyn’s Labour Party as “institutionally anti-Semitic” — which is how Berger put it when she resigned — as part of a calculated political campaign against Corbyn and his left-wing agenda.
And indeed, this perception may have actually contributed to the current crisis.
Michael Segalov, a journalist who has written and spoken extensively on this issue, told me he thinks that part of the reason Corbyn and the Labour leadership were initially slow to react to anti-Semitism was that the claims were wrongly interpreted as part of a sustained, wider campaign of personal and political attacks against Corbyn.
But like Segalov, there are many in the Labour Party who strongly disagree with the idea that the accusations of anti-Semitism are merely a political smear campaign. A poll carried out by the Jewish Chronicle newspaper in the summer of 2018 found more than 85 percent of British Jews believe Corbyn himself is anti-Semitic, and a similar number believe the level of anti-Semitism in the Labour Party is “high” or “very high.”
Jon Lansman, founder of the pro-Corbyn campaign group Momentum and now a member of Labour’s national executive committee, recently told the BBC’s Radio 4 that there were many more Labour members who held “hardcore, anti-Semitic opinions” than previously thought. Lansman, who is Jewish, also said that he felt “regret, sadness and some shame” about Berger’s resignation from the party.
Where does Labour go from here?
There seems to have been a major shift in the perspectives of party leaders since the resignation of the nine Labour MPs.
Labour’s deputy leader Tom Watson, who is seen as a centrist, recently told the BBC that he thought if Corbyn took “a personal lead” in examining accusations of anti-Semitism, it could make a big difference. Watson said that just last week, he had received a dossier from parliamentary colleagues of 50 complaints on anti-Semitism that he felt had not been dealt with adequately, and had passed them on to Corbyn.
Corbyn, perhaps heeding Watson’s advice, is in talks to appoint former Lord Chancellor Charlie Falconer to be an independent reviewer tasked with ensuring that anti-Semitism claims within the party are handled more effectively. Falconer held high office from 2003 to 2007 under Blair’s government and is respected across the party.
The recent split could prove a turning point for Labour in terms of addressing anti-Semitism as well as wider divisions within the party. “I think [Corbyn] understands now that if he is ever to be prime minister, he needs to rebuild that trust [with the British Jewish community],” said Watson, who urged the quick expulsion of members who’d made anti-Semitic comments. But as Watson added: “Time is against us.”
Indeed, urgency is needed for Labour’s leadership to effectually tackle the party’s anti-Semitism crisis and convince other MPs not to quit. The nine MPs who’ve left have formed the Independent Group, an informal assemblage that plans to launch as an official political party before the end of the year. Several other Labour MPs are rumored to be thinking of joining them.
Unless Labour moves fast, the emerging centrist party could prove an existential threat.
Darren Loucaides is a British writer who covers politics, populism, and identity.
Voir encore:
The Democrats are becoming the party of the Jew-haters
A party and a civilization in moral decline
Dominic Green
The Spectator
March 7, 2019
When Ilhan Omar says that there’s too much money in American politics, she’s stating the obvious. That’s why I support her brave campaign against the US Chamber of Commerce, the National Association of Realtors, the American Medical Association, the American Hospital Association, the Pharmaceutical Research & Manufacturers of America, General Electric, Blue Cross Blue Shield, Business Roundtable, the AARP, and Boeing.
These are America’s top 10 lobby groups, ranked by total spending over the last 20 years. In 2018, the US Chamber of Commerce spent $94.8 million on lobbying. Alphabet, Google’s parent company, spent $21.7 million and surged to Number Eight on the charts. The America-Israel Public Affairs Committee (AIPAC) ranked Number 157, and spent $3.5 million. Who knew you could buy America so cheaply?
Ilhan, that’s who. In 2012, only Ilhan was wise enough to see that ‘Israel has hypnotized the world’. Now, only Ilhan is bold enough to say that American support for Israel is ‘all about the Benjamins’, rather than a mass of reasons religious, strategic, cultural, and sentimental. And only Ilhan has the integrity to double down, and say, ‘I want to talk about the political influence in this country that says it is OK to push for allegiance to a foreign country.’
The 19th-century British prime minister Viscount Palmerston said that great powers have interests, not friends. Omar’s notion that the greatest power in history is somehow beholden to a faraway state the size of New Jersey is a delusion. So is her notion that Israel, a state which has taken to best part of seven decades to set up a railroad network, possesses diabolical powers to ‘hypnotize’ the world. So is her idea that Israel’s supporters, Jewish and not, operate by making congressmen and senators ‘pledge allegiance’, like a militia in a failed state. This last might be Omar’s biggest delusion of all. She actually believes that promises mean something in politics.
Omar’s private thoughts are nobody else’s business. It’s not as if the doctors, Jewish ones probably, have ever dissected a brain and noted hypertrophy of the Jew-hating lobe. Words and deeds are what matters, especially in public life. In which case, anyone who claims that Omar isn’t, to use Nancy Pelosi’s formulation, an ‘intentional’ Jew-hater isn’t listening. Omar has herself apologized for what she admitted was the ‘ugly sentiment’ of her ‘hypnotized’ imagery. It took seven years, but shortly after entering Congress, she disavowed that ‘anti-Semitic trope’ as ‘unfortunate and offensive’. She also apologized ‘unequivocally’ in February after the ‘Benjamins’ episode. Her defense was that she was ignorant of the ‘painful history of anti-Semitic tropes’. She intended it; she just didn’t know what it meant.
Omar didn’t know that the language in which she expressed her malignant delusions was in the lineage of Jew-hatred in its Christian and European forms. Until she entered the national stage, she’d had no need to know. Omar’s malignant delusions are commonplace in the Arab and Muslim world from which she comes. They are commonplace among the leadership of the Council on American-Islamic Relations (CAIR), the Hamas-friendly front organization for the Muslim Brotherhood which supported her Congressional campaign. And they have become commonplace on the left of the Democratic party.
Democrats now protest that the whites and the right have their racists too. In other words, they’re saying that two wrongs make a right. This is playground logic, and it ignores the imbalance between the two kinds of anti-Jewish racism. Firstly, no Republican leader ever posed for the cover of any other national outlet with Steve King, or Omar’s new Twitter chum David Duke. Secondly, the Republican leadership, no doubt hypnotized by the Benjamins tucked in Ivanka Trump’s suspender belt, is hostile to the white racist fringe, and the white racist fringe detests the Republican leadership. Thirdly, the white racists are nothing if not candid about their beliefs and their intentions towards the Jewish people. Ilhan Omar isn’t even honest.
Omar said she was against BDS when running for the House and then revised her position as soon as she won her set. She denounces Israel and Saudi Arabia, who oppose the Muslim Brotherhood, but not Turkey or Qatar, the Muslim Brotherhood’s sponsors. She may be ignorant, but she knows exactly what she is doing. She is furtive and duplicitous, and she is successfully importing the language and ideas of racism into a susceptible Democratic party.
The buffoons who lead the Democrats are allowing Omar to mainstream anti-Jewish racism. The Democratic leadership tried to co-opt the energy of the post-2008 grassroots, to give its exhausted rainbow coalition an infusion of 21st-century identity politics. The failure to issue the promised condemnation of Omar shows that a European-style ‘red-green’ alliance of hard leftists and Islamists is co-opting the party. This, like the pro-Democratic media’s extended PR work for Rashida Tlaib and that other left-Islamist pinup Linda Sarsour, reflects a turning point in American history.
The metaphysical, conspiratorial hatred of Jews is a symptom of civilization in decline. So the inability of the Democratic leadership to call Omar a racist reflects more than the moral and ideological decay of a political party. Americans like to believe in their exceptionalism, and American Jews like to say America is different. We’re about see if those ideas are true.
Dominic Green is Life & Arts Editor of Spectator USA.
Voir par ailleurs:
Diane Vaughan : les leçons d’une explosion
Diane Vaughan
La Recherche
mars 2000
Si la NASA enchaîne aujourd’hui les contre-performances sur Mars, elle avait connu en 1986 une catastrophe : l’explosion de la navette « Challenger ». Quels sont les processus qui, au sein de la culture d’une telle organisation, engendrent une déviance progressivement institutionnalisée ?
La Recherche : La NASA vient de perdre coup sur coup deux sondes martiennes. Comment réagissez-vous à ces récents déboires ?
Diane Vaughan : Ils ne me surprennent guère ! N’oublions pas que les programmes spatiaux impliquent de multiples collaborations. La NASA en particulier sous-traite la majeure partie des composants de ses missions. Que des problèmes surgissent quand un grand nombre d’organisations différentes travaillent ensemble n’a rien d’exceptionnel, surtout quand il s’agit d’innovations techniques. Des erreurs sont faites en permanence dans toute organisation complexe, mais contrairement au cas de la NASA sur qui les projecteurs médiatiques sont braqués, leurs conséquences, souvent moins spectaculaires, restent généralement ignorées du grand public.
Quelle était votre motivation pour vous pencher sur les causes de l’explosion de la navette spatiale Challenger en 1986 ?
Je venais à l’époque de finir un livre, je n’avais rien de précis en tête, si ce n’est d’écrire un court article que l’on m’avait commandé sur la notion d’inconduite, c’est-à-dire de comportement individuel fautif. Le cas Challenger avait alors, selon l’explication officielle, toutes les apparences du parfait exemple, avec cependant la particularité de s’être produit dans une organisation gouvernementale à caractère non lucratif plutôt qu’au sein d’une entreprise. Je ne m’attendais alors pas du tout à ce que mon travail remette complètement en question les conclusions obtenues par la Commission présidentielle qui avait été chargée de l’enquête après la catastrophe.
Quelles étaient les conclusions de cette Commission présidentielle ? Des responsables avaient-ils été identifiés ?
L’enquête de la Commission révéla le fait suivant : la veille du lancement de Challenger , lors d’une téléconférence tenue depuis le Marshall Space Flight Center, le centre de tir de la NASA, des ingénieurs de Morton Thiokol, l’entreprise qui fabriquait le joint annulaire d’un des boosters à l’origine de l’accident, avaient fait part aux managers de la NASA de leur opposition au lancement en invoquant les très faibles températures prévues le lendemain. Cependant, ces managers ne transmirent pas l’information à leurs supérieurs hiérarchiques et, soucieux de respecter la date du lancement, décidèrent de maintenir celui-ci au lendemain. Selon l’explication officiellement admise, une telle décision résultait de la forte pression interne qui régnait alors à la NASA : faute d’un financement suffisant du Congrès, le programme de la navette reposait en effet en partie sur les revenus procurés par les lancements de satellites commerciaux privés.
La conclusion suivante s’imposa alors à la Commission : soumis à cette pression de production, les managers du Marshall Space Flight Center ont ignoré les recommandations des ingénieurs et ont enfreint les règles de sécurité et de transmission de l’information au sein de la hiérarchie, dans le but de maintenir la date de lancement. Selon cette interprétation, il ne s’agissait donc pas d’un simple accident technique, mais d’un cas classique d’inconduite au sein d’une organisation : dans le souci de respecter les objectifs de l’organisation, certains de ses membres sont amenés à violer ses règles de fonctionnement.
Pensez-vous que la Commission présidentielle, en plaçant ainsi la responsabilité sur certains individus, ignora délibérément d’autres facteurs ?
La réponse à une telle question est très complexe. Je crois d’abord que la Commission ne s’attendait pas à trouver autre chose à l’origine de l’accident qu’un simple problème technique. Or, soudainement, cette téléconférence révélait l’existence d’un dysfonctionnement d’une tout autre nature. Cette découverte conditionna la manière même dont l’enquête se poursuivit : par exemple, ne furent appelés à témoigner que cinq ingénieurs, qui s’étaient tous opposés au lancement lors de la téléconférence. L’un des techniciens de la NASA, qui était certainement la personne la mieux avertie quant à l’histoire de ce joint annulaire, ne fut même pas interrogé. La Commission ne procéda pas aux interviews d’une manière aussi exhaustive que l’aurait fait un sociologue : elle interrogea seulement les personnes susceptibles de détenir des informations pertinentes au regard de ce qui, d’emblée, avait eu toutes les apparences d’une mauvaise décision de la part de certains managers. Pour autant, je ne crois pas qu’il faille cher- cher derrière cela une volonté délibérée de masquer d’autres facteurs ou de protéger certaines personnes plus haut placées dans la hiérarchie. Il faut plutôt se rappeler que la Commission était soumise à de fortes contraintes d’ordre pratique. Elle ne disposait que de trois mois pour rendre son rapport, alors que la quantité d’informations à analyser était phénoménale : les documents relatifs à l’accident de Challenger remplissent deux étages complets d’un immense entrepôt ! Ajoutez à cela que les membres de la Commission n’ont pas conduit eux-mêmes les interviews, pas plus qu’ils n’ont lu les comptes rendus : ils étaient seulement « briefés » par les équipes d’interviewers à qui l’on avait sous-traité les entretiens. Difficile dans ces conditions de s’imprégner de la culture d’une organisation.
Quel rôle attribuez-vous donc à la culture de la NASA dans l’accident de Challenger ?
Plutôt que de limiter son attention au niveau individuel, il est en effet indispensable d’examiner comment la culture d’une organisation façonne la manière dont les individus prennent des décisions en son sein. Mon analyse a montré que, pendant les années qui ont précédé l’accident, les ingénieurs et managers de la NASA ont progressivement instauré une situation qui les autorisait à considérer que tout allait bien, alors qu’ils disposaient d’éléments montrant au contraire que quelque chose allait mal. C’est ce que j’ai appelé une normalisation de la déviance : il s’agit d’un processus par lequel des individus sont amenés au sein d’une organisation à accomplir certaines choses qu’ils ne feraient pas dans un autre contexte. Mais leurs actions ne sont pas délibérément déviantes. Elles sont au contraire rendues normales et acceptables par la culture de l’organisation.
Quelle déviance s’est normalisée dans l’histoire de la navette, et pourquoi ?
Lorsque pour la première fois une anomalie fut constatée sur l’un des boosters au retour d’une mission, cette anomalie ne constitua pas un signal d’alarme, car la culture du programme spatial était celle d’un programme technologique de nature extrêmement innovante. Et dans ce contexte, le fait que certains des composants des boosters subissent des dommages lors d’un vol n’était pas considéré comme inacceptable, même si cela n’était pas prévu par ses concepteurs. Avoir des problèmes avec un système aussi complexe que la navette était même quelque chose d’attendu !
Pour saisir les causes de l’accident de Challenger, ne faut-il donc pas remonter seulement à la veille du lancement, mais dix ans avant ?
Absolument. Pendant près de dix ans, les boosters ont subi des dommages pratiquement lors de chaque mission. Après chacun de ces incidents, les analyses des ingénieurs conduisaient à considérer le risque comme acceptable et à recommander la poursuite du programme sans que des tests et des études supplémentaires soient nécessaires. En soi, chacune de ces décisions peut sembler logique et rationnelle. Mais leur accumulation a progressivement conduit à ce que le fait de voler avec de sérieuses anomalies devienne quelque chose de routinier, d’officiellement toléré.
Comment est fixé ce seuil d’acceptabilité du risque ?
C’est là un aspect de la culture d’une organisation qui, vu de l’extérieur, peut paraître très étrange. Au début du programme, la NASA produisit un document intitulé « The acceptable risk process », dans lequel était énoncé un ensemble de procédures à suivre. Celles-ci garantissaient que le maximum soit fait pour la sécurité d’un vol, tant au niveau des processus de prise de décision qu’au niveau purement technique. Ce qui bien sûr n’assurait pas pour autant l’élimination de tout risque. Mais, petit à petit, s’est instaurée une sorte de foi dans ces méthodes : les appliquer rigoureusement n’était plus seulement le mieux que l’on puisse faire, cela suffisait aussi à garantir la sûreté du vol. Or, l’opposition au lancement formulée par les ingénieurs de Thiokol était principalement fondée sur des intuitions. Il n’est dès lors pas étonnant qu’une telle opposition ait été jugée irrecevable par les managers de la NASA, étant donné ce contexte de croyance institutionnalisée dans les méthodes employées.
Selon vous, il n’y a donc pas eu à proprement parler inconduite de la part des responsables du Marshall Space Flight Center ?
Non, en effet, puisque aucune des règles habituelles de décision n’a été transgressée lors de cette fameuse téléconférence. Il faudrait en fait plutôt parler d’erreur : les ingénieurs de Thiokol n’ont pas été en mesure de présenter aux managers les arguments techniques nécessaires pour les convaincre du caractère exceptionnel de la température de lancement et des risques supplémentaires qui en découlaient. La décision de procéder au lancement n’a donc rien eu d’anormal dans le contexte culturel de l’époque.
Pourriez-vous décrire ce contexte culturel ? En quoi, par exemple, diffère- t-il du contexte culturel du programme Apollo , le précédent grand programme de vols habités de la NASA ?
L’ère Apollo se caractérisait par une culture d’ingénieurs purement technique. Cette culture est encore bien sûr présente à l’époque de Challenger, mais la multiplication des contrats de sous-traitance a largement transformé le travail des ingénieurs de la NASA qui assurent dorénavant surtout des tâches de coordination. Cette institutionnalisation de la sous-traitance a comme conséquence de fortement accentuer le poids de la bureaucratie, notamment dans les processus de prises de décision que nous venons d’évoquer et derrière lesquels se sont inconsciemment retranchés ingénieurs et managers.
Un autre changement culturel, peut-être encore plus décisif, résulta des difficultés budgétaires du programme : elles se traduisirent à tous les niveaux de l’organisation par une pression de production très forte, dont les conséquences ont été à juste titre soulignées par la Commission présidentielle. Apollo avait bénéficié d’un large consensus dans l’opinion, allant de pair avec un soutien financier sans faille de la part du Congrès. Ce n’était plus du tout le cas à l’époque de la navette spatiale, l’implication des Etats-Unis dans la guerre du Vietnam ayant entre-temps remis en cause les engagements du pays en matière d’exploration spatiale. Il y eut alors cette volonté politique des hauts dirigeants de la NASA de présenter à l’opinion publique le programme de la navette comme un programme opérationnel : ce n’était plus un programme expérimental comme Apollo, mais un programme suffisamment sûr pour que la NASA puisse s’engager auprès d’entreprises commerciales.
Et suffisamment sûr pour qu’on fasse voler des civils ?
Exactement. Et c’est là une troisième altération de la culture de la NASA qui découla de décisions politiques prises à la fois par les hauts dirigeants de l’agence spatiale et par la Maison Blanche. Le désastre de Challenger n’aurait sans doute pas été aussi traumatisant pour le pays s’il ne s’était trouvé à bord de la navette deux civils, dont une enseignante. Souvenez-vous que la NASA avait déjà perdu plusieurs astronautes lors d’un accident survenu sur le pas de tir d’une des missions Apollo. L’enquête qui a suivi avait été réalisée en interne par l’agence spatiale. Etant donné la nouvelle culture de la NASA, ce ne pouvait plus être le cas pour Challenger , dont la disparition prit d’emblée une dimension publique, politique.
Iriez-vous jusqu’à dire que le président de l’époque, Ronald Reagan, le Congrès et les élites dirigeantes de la NASA ont leur part de responsabilité dans l’accident de Challenger ?
Leurs décisions – celle par exemple de réduire le financement fédéral du programme – étaient bien évidemment dénuées de toute intention délibérée de rendre un pareil désastre possible. Elles n’ont de plus enfreint aucune règle, aucun impératif éthique. Mais il est certain que ces mêmes décisions ont contribué à façonner une nouvelle culture de l’organisation qui a rendu possible la normalisation de déviances techniques, et acceptable de faire voler une enseignante. Pour cette raison, les élites politiques du pays ont certainement des comptes à rendre. Et l’on peut s’étonner que ni les médias, ni l’opinion publique, ni bien sûr la Commission présidentielle ne leur en aient demandé !
Pensez-vous que la NASA ait tiré toutes les leçons de l’accident ?
Beaucoup de choses ont été changées au niveau interne après Challenger, notamment les procédures de prise de décision et de conduite de projet. Par exemple, la NASA s’assure désormais que l’avis de ses astronautes soit davantage pris en compte. Mais rien n’a changé fondamentalement en ce qui concerne la culture même du programme. Le problème du financement privé et son corollaire, la pression de production, demeurent et la NASA a même récemment recommencé à faire voler des civils !
La devise de Dan Goldin, l’actuel dirigeant de l’agence spatiale, « Better, faster and cheaper » Mieux, plus vite et moins cher ne vous paraît-elle pas être un oxymoron ?
C’est le mot en effet ! Les contraintes accrues de calendrier et de budget qui se cachent derrière le Faster et le Cheaper me semblent à l’évidence bien peu conciliables avec le Better de la devise. Mais ne m’étant pas penchée sur les nouveaux programmes, je ne peux guère vous en dire plus. A part cette observation : les gens ayant décidé des réductions de personnels et de moyens ne se sont pas davantage préoccupés qu’à l’époque de Challenger d’étudier leurs effets sur la structure et la culture de l’organisation. Or, de telles études me semblent indispensables. Le problème n’est pas tant l’absence de motivations politiques pour les mener que la nécessité de disposer des compétences de sociologues, anthropologues et autres acteurs traditionnellement absents des sphères dirigeantes d’une organisation comme la NASA.
Avez-vous eu des réactions officielles des dirigeants de la NASA après la publication de votre livre ?
Absolument aucune ! J’ai eu par contre beaucoup de réactions – d’ailleurs souvent très favorables – de personnes qui ont travaillé pour la NASA, ou de diverses organisations dont certaines m’ont dit : « La NASA, c’est nous : la même chose se passe chez nous ! »
Le cas Challenger illustre votre thèse plus générale selon laquelle les erreurs sont socialement construites et systématiquement produites par toute structure sociale. Cela implique-t-il que les erreurs soient inévitables et qu’un certain fatalisme soit dès lors de mise ?
Oui, les erreurs sont inévitables, ne serait ce que parce que dans un système complexe, surtout lorsqu’il est innovant, il est impossible de prédire ou contrôler tous les paramètres d’une situation. Mais il est capital qu’une organisation prenne acte de la dimension sociale des erreurs produites en son sein et agisse en conséquence. Un pas dans ce sens a été accompli par exemple par certains hôpitaux américains. Ici à Boston, de nombreuses études ont abordé le problème des erreurs médicales en se penchant sur la complexité du système hospitalier. Ce qui auparavant était perçu comme l’erreur d’un individu devient une erreur dont la cause est aussi à chercher du côté du système lui-même, en particulier dans la division du travail au sein de l’hôpital. Ce n’est plus seulement la responsabilité du chirurgien ou de l’anesthésiste, mais aussi celle du système qui lui impose un planning chargé.
Faut-il donc chaque fois élargir le champ de l’analyse ?
En effet. Si vous voulez vraiment comprendre comment une erreur est générée au sein d’un système complexe et résoudre le problème, il ne faut pas se contenter d’analyser la situation au niveau individuel, c’est l’organisation dans son ensemble qu’il faut considérer et, au-delà de l’organisation elle-même, son contexte politique et économique. On a vu dans le cas de Challenger que les conclusions auxquelles on aboutit alors sont bien différentes de celles délivrées par une analyse des actions individuelles.
Mais les situations ne sont-elles pas parfois trop complexes pour que cette approche soit réalisable en pratique ?
Je ne le crois pas. On peut cependant considérer, comme le fait notamment Charles Perrow dans son livre Normal Accidents1 , qu’étant donné le caractère inévitable des erreurs générées par certains systèmes en raison de leur complexité, mieux vaudrait se passer complètement de ces systèmes « trop complexes ». Les centrales nucléaires seraient un exemple de tels systèmes. Mais bien évidemment, cette position est indéfendable pour d’autres systèmes complexes comme les hôpitaux.
Quelle leçon peut-on tirer de cette approche en matière de contrôle social d’une organisation ?
Elle suggère qu’une politique de blâme individuel n’est pas suffisante car elle sort de leur contexte les « mauvaises décisions » en négligeant les facteurs organisationnels qui ont pesé sur ces décisions. Dès lors, les instances de contrôle, tout comme le public, croient à tort que, pour résoudre le problème, il suffit de se débarrasser des « mauvais décideurs ». Or, on a vu avec le cas de Chal- lenger qu’il n’en était rien. Une stratégie punitive doit s’accom-pagner d’un souci de réforme des structures et de la culture de l’organisation. Ce qui supposerait par exemple de pouvoir légalement mandater des intrusions dans ce qui est traditionnelle-ment considéré comme son domaine privé.
Vous travaillez actuellement sur le contrôle aérien. Qu’attendez-vous de cette étude ?
Les contrôleurs aériens sont connus pour être capables de détecter des anomalies avant que celles-ci ne génèrent des erreurs irrattrapables. L’histoire de Challenger montre qu’il y a eu de nombreux signaux de danger avant l’accident, qui n’ont pas été pris en compte comme tels. Il me semblait donc logique de m’intéresser à une situation où les gens peuvent expliquer comment ils identifient des signaux d’alarme et prennent les « bonnes » décisions. J’espère alors en tirer des leçons utiles aux organisations soucieuses de minimiser la gravité des erreurs qu’elles produisent systématiquement.
Propos recueillis et traduits de l’américain par Stéphanie Ruphy.
1 C. Perrow, Normal Accidents : Living with High-Risk Technologies , Princeton University Press, 1999
Voir aussi:
En théorie, tout est une question de timing
Entretien avec Diane Vaughan
Réalisé et traduit par Arnaud Saint-Martin
Zilsel/Cairn
2017/2 (N° 2), pages 185 à 222
Diane Vaughan est bien connue pour la recherche classique qu’elle a consacrée à l’accident tragique de la navette spatiale Challenger, survenu en 1986. Dans un livre important paru exactement dix ans après le crash, la sociologue étasunienne proposait une analyse très documentée de la banalisation du risque à la Nasa, qui avait conduit les ingénieurs à prendre des décisions mortelles. Cela a été lu comme largement contre-intuitif dans la presse et parmi les professionnels de la gestion des risques et des désastres, car l’interprétation qui dominait jusqu’alors consistait à individualiser la faute dans un registre très moraliste. L’explication par les structures et la culture d’une organisation aussi complexe que la Nasa montre à l’inverse comment une déviance s’est normalisée au gré des missions du programme de la navette, à travers des décisions qui ont précipité une catastrophe que personne n’avait évidemment désirée. Diane Vaughan révèle ici la force explicative d’un modèle théorique sociologique général, qu’elle s’est efforcée d’affiner et d’appliquer à plusieurs objets empiriques tout au long de sa carrière, amorcée dans les années 1970.
Dans cet entretien réalisé à New York au printemps 2014 puis complété durant l’été 2017, on suivra les itinéraires intellectuels de l’auteure, professeur à l’université Columbia depuis 2005. On y découvrira ses premières recherches sur la criminalité en col blanc et la séparation conjugale, puis les tâtonnements et révélations sur le terrain de Challenger. On ne tardera pas à repérer un pattern intellectuel très particulier en même temps qu’il vise la montée en généralité : sans se disperser, Diane Vaughan approfondit des thèmes théoriques qui lui sont chers, tout en se laissant surprendre sur le(s) terrain(s). Ses explications peuvent intéresser des publics en dehors du champ académique. C’est le cas, surtout, de son travail sur Challenger, qui l’a installée dans les médias aux États-Unis comme experte des échecs organisationnels, surtout après l’accident de l’autre navette Columbia en 2003. Cet exercice non prémédité et « par accident » [1][1]Diane Vaughan, « Public Sociologist by Accident », Social… de public sociology aura été aussi formateur qu’engageant pour une chercheuse qui se percevait au départ comme « académique ». C’était l’occasion d’enseigner la sociologie hors les murs et le confort du département universitaire. Outre les précisions apportées sur ses recherches, la conversation qui suit illustre par l’exemple les vertus de la recherche patiente et obstinée, à distance des standards du « publish or perish » ou du « demo or die ». Diane Vaughan est de ces sociologues qui ne transigent pas avec les nécessités de l’enquête et qui publient lorsqu’elles ou ils estiment que la recherche est suffisamment mûre pour l’être, et pas avant. Quitte à passer des années dans l’invisibilité, pour cause de prospection, de vérifications et de « revisites » sur le terrain. L’ouvrage sur l’accident de Challenger est un modèle en la matière, comme le sera sans doute son nouveau livre sur le contrôle du trafic aérien, dont elle avait amorcé la préparation… à la fin des années 1990. Dernier aspect remarquable qui ressort de l’entretien : au fil des enquêtes et des prises de position publiques, Diane Vaughan s’est efforcée de combiner toutes les dimensions d’une activité intellectuelle qui alterne entre les phases de recherche, d’enseignement, de conseil ou l’intervention publique, sans rien renier de l’exigence théorique élevée qui continue d’être la sienne. Chacun de ces pôles enrichit les autres sans se confondre pour autant. C’est une équation toute personnelle mais, à voir ce qu’elle promet de découvertes et d’heureuses surprises dans cette vie de recherche, il est sans doute bon de s’en inspirer.
Une certaine fascination pour le côté obscur des organisations
Zilsel — Vous avez longtemps travaillé sur les dysfonctionnements, les échecs organisationnels et ce que vous avez appelé la « normalisation de la déviance ». Votre enquête sur le crash de Challenger est votre contribution la plus connue dans ce segment des sciences sociales. Une problématique a peu à peu émergé, que vous n’avez pas cessé d’enrichir au moyen d’un modèle théorique général, celle qui concerne la relation entre les facteurs structurels et les comportements déviants ou illicites. Pour commencer, pourriez-vous revenir sur l’itinéraire qui vous a amenée à aborder ces thèmes classiques de la sociologie des organisations et de la déviance ?
Diane Vaughan — Durant mes études de master puis de thèse, je me suis d’abord intéressée aux phénomènes de déviance et de contrôle social, puis j’ai découvert la littérature sur les organisations. Combinant l’un et l’autre de ces aspects, j’ai choisi d’étudier la criminalité en col blanc en tant que phénomène organisationnel. C’est le sujet de ma thèse, que j’ai soutenue à l’université d’État de l’Ohio en 1979. Je me suis appuyée sur une étude de cas. Deux organisations sont impliquées : la première, une chaîne de pharmacies discount de l’Ohio, Revco, s’était rendue coupable de fraudes contre l’autre organisation, l’administration publique en charge de l’assurance santé (Medicaid), à qui une double facturation était transmise par voie informatique par les pharmaciens. 500 000 dollars ont ainsi été collectés de façon illégale, jusqu’à ce que les deux cadres responsables de l’opération soient pincés en 1977 suite à une enquête des autorités judiciaires. L’affaire a été aussitôt réglée : Revco a plaidé coupable, a restitué 50 000 dollars, tandis que les deux fautifs ont payé une amende de 2000 dollars chacun. Mais, et c’est ce qui rend le cas intéressant en soi, les deux employés ont dit avoir mis en place le système des fausses prescriptions parce que les services de Medicaid rejetaient en masse les prescriptions à rembourser. C’était donc une façon détournée de recouvrer les fonds non perçus et de rééquilibrer les comptes de Revco. Au-delà des agissements individuels, les organisations se trouvaient mises en cause et il n’était pas évident de savoir qui était la victime et qui était le coupable. À partir de la chronologie des événements, des données recueillies sur le cas par divers services d’investigation officiels ou de Revco, mais aussi des interviews que j’ai réalisées, je me suis efforcée d’expliquer d’une part comment et pourquoi cette fraude a été rendue possible et, d’autre part, quels moyens réglementaires et de contrôle ont été mis en place pour y faire face. En plus de l’aspect monographique, j’ai développé un modèle théorique causal. J’ai analysé notamment les effets de la pression de l’environnement concurrentiel sur les organisations et la façon dont elles y répondent, au risque d’altérer leur fonctionnement, toujours plus complexifié par la multiplication des règles et des procédures. J’ai aussi intégré le fait qu’elles offrent et reconnaissent les moyens légitimes d’accéder à des objectifs (s’agissant de Revco, tirer des revenus de la vente de médicaments), tout en créant les conditions structurelles des écarts de conduite pour les atteindre. J’ai compris combien la théorie de l’anomie de Robert K. Merton – une source d’inspiration essentielle pour moi – peut s’appliquer ici. Selon le schéma mertonien, les deux employés ont « innové » en adaptant les moyens et les règlements aux fins légitimes de l’organisation, qui étaient contrariées par le système Medicaid et donc menaçaient sa survie. Le dysfonctionnement dans le système de transaction entre les deux organisations crée une opportunité de comportement illicite ou de viol des règles pour réaliser les objectifs. Avec cette première recherche académique qui s’est transformée en un livre [2][2]Diane Vaughan, Controlling Unlawful Organizational Behavior :…, j’ai dégagé un modèle théorique général, qui permet de comprendre comment les organisations répondent aux pressions d’un environnement externe, dans la structure sociale de la société américaine. À terme, je souhaitais appliquer cette idée d’une pression structurelle sur d’autres types d’organisation, à but non lucratif en particulier.
Après la thèse, j’ai bénéficié d’une bourse postdoctorale de trois ans à l’université de Yale. En même temps que je finissais de rédiger mon premier livre, mes recherches m’ont portée vers d’autres réalités que la fraude en entreprise. Alors que j’étais étudiante, j’ai rédigé un article sur la séparation conjugale, que j’ai appelée « découplage » (uncoupling) [3][3]Diane Vaughan, « Uncoupling : The Process of Moving from One…. J’ai approfondi le sujet lorsque j’étais à Yale, puis à Boston après mon recrutement au Wellesley College Center for Research on Women. J’ai réalisé une centaine d’interviews pour cette enquête. Les gens avec qui je me suis entretenue étaient en union libre ou mariés, gays ou hétérosexuels. J’observais un couple, à la façon d’une organisation minuscule, au moment critique où la relation rompait ou après la séparation. J’ai fini par en faire un livre, Uncoupling [4][4]Diane Vaughan, Uncoupling : Turning Points in Intimate…. Des références traversent ces recherches, par exemple la théorie du signal de l’économiste « nobélisé » Michael Spence, qui peut s’appliquer autant aux entreprises qu’aux relations intimes dans le couple. Comment les organisations fondent-elles leurs choix lorsqu’elles recrutent et que les candidats sont nombreux ? La réponse est économique : il est trop coûteux de connaître à fond chaque candidat, si bien que les organisations émettent des jugements sur la base de signaux. Ces derniers sont de deux sortes : d’une part, des indicateurs qui ne peuvent pas être changés, comme l’âge ou le sexe (à l’époque, il n’était pas possible de le changer). D’autre part, des signaux d’ordre social : où avez-vous obtenu votre diplôme ? Qui vous recommande ? Quelle est votre expérience professionnelle ? Ces seconds signaux peuvent être manipulés, truqués, ce qui rapproche de la problématique de la fraude. La théorie du signal s’applique aussi dans Uncoupling : malgré l’expérience d’une rupture relationnelle soudaine, souvent vécue comme traumatique ou chaotique dans nos vies, l’hypothèse que j’ai faite était de dire par contraste que la transition est graduelle : le découplage est une suite de transitions. Je n’ai pas tardé à le vérifier durant les interviews, lors desquelles je demandais aux personnes séparées de retracer la chronologie de leur relation. Une même logique était à l’œuvre : une des deux personnes, initiatrice, commence à quitter la relation, socialement et psychologiquement, avant que l’autre ne réalise que quelque chose ne fonctionne plus. Le temps qu’elle le comprenne, qu’elle en perçoive le signal, il est trop tard pour sauver la relation. Certes pas toujours, puisque quelquefois les personnes parviennent à inverser le processus, parce qu’ils savent comment traiter l’information ; mais en général, c’est cette trame qui organise le découplage. Il est frappant de voir que dans ces petites organisations les gens peuvent tomber en morceaux sans même le remarquer ni agir contre. Une longue période d’incubation précède la rupture, les initiateurs envoient des signaux, les partenaires les interprètent (ou pas), mais quoi qu’il arrive, selon les buts ordinaires de l’organisation (le couple) la rupture ne fait pas partie du plan initial.
Je commençais à y voir plus clair dans ces processus, analogues malgré les échelles d’analyse, mais il me manquait encore des données sur des structures bien plus grandes. J’ai envoyé le manuscrit d’Uncoupling à mon éditeur en décembre 1985. Un mois plus tard, le 28 janvier 1986, Challenger explosa. La presse a ramené l’explosion à un exemple d’inconduite organisationnelle. Cela se rapprochait de mes premiers cas d’étude – à ceci près que cela concernait une organisation à but non lucratif, la Nasa – et j’ai commencé à enquêter.
Zilsel — Au moment où vous constatez les analogies avec vos premiers objets et que vous débutez le travail sur l’accident de Challenger, quel est votre niveau de familiarité avec l’astronautique et ce que pouvaient éventuellement en dire les sciences sociales ?
Diane Vaughan — J’en ignorais tout ! Je ne connaissais pas non plus les Science & Technology Studies (STS) qui m’aideront à analyser les aspects technologiques. J’ai commencé à travailler à partir de mon modèle théorique. Je n’étais pas complètement dépaysée parce que j’avais étudié le crime organisationnel au moyen de l’informatique dans mon premier livre. Lorsque j’ai amorcé le projet en 1986, je bénéficiais d’une résidence d’un an au Center for Socio-Legal Studies, à l’université d’Oxford. Deux choses importantes me sont arrivées sur place. La première : à l’issue d’un de mes exposés au Centre, un auditeur m’a suggéré de lire l’article « Unruly Technology » de Brian Wynne [5][5]Brian Wynne, « Unruly Technology : Practical Rules, Impractical…, que je ne connaissais pas. Je l’ai dévoré aussitôt et cela m’a ouvert des perspectives fantastiques, notamment la découverte des STS.
Une recherche sérendipienne et pleine d’effets inattendus
À propos de Diane Vaughan, The Challenger Launch Decision : Risky Technology, Culture, and Deviance at NASA, Chicago, University of Chicago Press, 1996.
Ce n’était certes pas prémédité, mais l’accident a bel et bien eu lieu : le 28 janvier 1986, la navette spatiale Challenger se désintégrait en plein ciel 73 secondes après son lancement. Cette tragédie nationale suivie en direct par la Nation tout entière a aussitôt remis en question l’aura d’infaillibilité de la Nasa. Le public s’était peu à peu habitué à l’idée d’une « démocratisation » prochaine de l’accès à l’espace, au moyen d’un véhicule expérimental et high tech, qui embarquait des civils dans cette vingt-cinquième mission STS-51-L, en particulier une institutrice médiatisée pour l’occasion, mais voilà que la confiance dans la sûreté de la technologie s’est aussitôt dégradée. La Commission présidentielle diligentée pour faire la lumière sur les causes de l’accident a rapidement identifié le problème : fragilisé par le froid glacial, un joint d’étanchéité du propulseur d’appoint à poudre s’éroda puis céda dès après le lancement et précipita l’explosion du segment puis la désintégration de la navette. Les directeurs de vol au centre spatial Kennedy de Cap Canaveral en étaient pourtant informés et, durant une téléconférence la veille, ils ont été de nouveau mis en garde par des ingénieurs de la compagnie Thiokol qui fabriquait les fusées d’appoint pour la Nasa. Néanmoins, ils ont finalement décidé de programmer le lancement après sept reports. Pourquoi cette décision a-t-elle été prise malgré les alertes sur la possible rupture des joints dans ces conditions ? Diane Vaughan y répond en dévoilant les mécanismes par lesquels les risques techniques ont été normalisés les années avant le désastre. Elle montre comment la culture organisationnelle des centres techniques de la Nasa, fondée sur l’exploit et l’idéologie de la frontière à dépasser (« Can do ! », p. 209), installe les déviations techniques comme autant de réalités normales.
« Immergée » dans cette culture, Diane Vaughan ne perd jamais le lecteur, ce qui est une prouesse parce que ce gros livre de 575 pages fourmille de détails techniques, de savoirs experts et d’acronymes pour ingénieurs. L’usage d’une trame chronologique s’avère ici précieux pour comprendre comment le risque a été « culturellement » construit, après que des décisions ont été prises de lancer la navette malgré la connaissance des anomalies, en fait très nombreuses et constitutives de la technologie. Les anomalies étaient la norme, notamment celles sur les joints des boosters qui avaient été décelées dans des lancements antérieurs, le risque devenait « acceptable » et n’était plus référé à la hiérarchie. La sociologue navigue entre les échelles micro des conduites et des perceptions individuelles et interindividuelles, méso des organisations (de leur structure sociale et culturelle, de leur accès aux ressources rares, en particulier les budgets), et macro de l’environnement socio-politique et de la culture étasunienne. Les facteurs extérieurs (agenda et contraintes de la politique intérieure, géopolitique, compétition internationale sur le marché de l’industrie spatiale, etc.) pèsent lourd dans la prise de décision et, plus largement, sur l’évolution des activités du secteur aérospatial, tout comme les rapports de force et les conflits « culturels » entre les acteurs, singulièrement entre les ingénieurs de la Nasa et les entreprises sous-traitantes comme Thiokol, chargée de fabriquer les fusées d’appoint. La pression sur les ingénieurs de la Nasa et des entreprises sous-traitantes était immense tout au long du programme, et tout particulièrement la veille du lancement fatal, mais ce n’est pas le seul facteur qui explique la décision malheureuse d’autoriser le lancement ; cette pression faisait partie de l’environnement de travail ordinaire des ingénieurs, qui en réalité ne faisaient que suivre un protocole normal sous contraintes organisationnelles fortes : aucune règle n’a été violée alors qu’on sait maintenant que les ingénieurs ont commis une lourde erreur (p. 68).
Diane Vaughan reconstitue cette histoire contre-intuitive dans un récit « révisionniste » extrêmement précis, qui contredit le récit qui avait cours. Ce récit mettait en scène l’évidence d’un calcul amoral (amoral calculation) de responsables, coupables d’avoir « joué à la roulette russe » pour de grosses poignées de dollars (chaque report de lancement est infiniment coûteux et menace la survie budgétaire du programme). Les chapitres qui suivent sont autant d’explorations des trois grands facteurs qui expliquent la « normalisation de la déviance » dans le processus de décision : (1) la production d’une « culture » propre à un groupe de travail (autour des fusées d’appoint) au filtre de laquelle le risque est normalisé et le processus de décision configuré (patterned), durant les premières missions où les signaux de danger potentiel avaient été distingués (chapitres 3 à 5) ; (2) la « culture de la production » avec ses normes et croyances, caractéristique des mondes de l’aérospatial (qui incluent la Nasa, les industriels, etc.), culture qui engendre une construction « indigène » de l’acceptabilité du risque (chapitre 6) ; (3) le « secret structurel » autour de la circulation contrainte et parfois même empêchée de l’information au sein de l’organisation, qui altère la perception des signaux de danger potentiel (chapitre 7). Informant cette théorie de la normalisation de la déviance, la trame chronologique coupe court avec les explications rétrospectives qui concluent à l’inévitabilité de l’explosion de la navette sans la rapporter au processus par lequel, à force de dérogations, celle-ci a été rendue possible. Abrégée en 50 pages dans le chapitre 9 faute de place ( !), la « description ethnographique dense » de la nuit qui a précédé le lancement achève de restituer l’événement, à la façon d’un scénario de film catastrophe. Le chapitre 10 propose enfin de monter en généralité : la théorie de la normalisation de la déviance est testée sur d’autres organisations, et l’auteure d’esquisser par ces comparaisons structurelles une analyse sociologique de l’organisation sociale de l’erreur (p. 394-399).
The Challenger Launch Decision est une exploration vertigineuse du « côté obscur » de l’organisation Nasa [6], de la « boîte noire » du processus de décision (p. 196). Ce livre est remarquable pour de nombreuses raisons. D’abord, c’est un modèle d’investigation empirique et théorique, la preuve en actes que l’enquête documentaire n’est pas significative sans théorie, et vice versa. Diane Vaughan a recueilli des masses de données durant plusieurs années. Il aura fallu trier dans les 200 000 documents publiés après-coup par la Nasa et les 9 000 pages de retranscription des audiences de la Commission d’enquête. « Tout au long de ce projet, écrit-elle dans l’ouverture du livre, j’avais l’impression d’être une détective, mais ce travail de détective n’avait pas l’infaillible clarté linéaire d’une enquête de Sherlock Holmes » (p. 39). Elle a procédé de façon inductive, par l’ancrage de la théorie sur le terrain, et a invité le lecteur à la suivre dans ses cheminements. Ses interprétations tirent parti de cadres théoriques formulés ailleurs. Elle prône l’usage intensif de la « théorisation analogique », qui consiste à appliquer des concepts et des schèmes théoriques sur des objets qui possèdent des caractéristiques plus ou moins communes. Ainsi l’auteure propose-t-elle un modèle théorique à la fois très indexé à un cas (très) particulier et assez souple et générique pour autoriser des applications sur d’autres objets structurellement comparables. En plus de son apport évident aux disaster studies et à la sociologie des organisations, l’ouvrage est aussi une contribution majeure à la connaissance du fonctionnement, des arcanes et de la structure sociale et culturelle d’une méga-organisation gouvernementale, légendaire par ses accomplissements depuis Apollo mais en fait assez méconnue.
La seconde chose qui m’est arrivée est que je cherchais des précédents historiques de viol des règles au moment des décisions de lancement de la navette, mais je n’en trouvais pas. L’hypothèse initiale qui était la mienne, en phase avec la compréhension traditionnelle des accidents, est que la décision résulte d’un « calcul amoral », de type coûts/bénéfices : sous la pression, les directeurs de vol connaissent les risques mais, escomptant une issue favorable, ils décident malgré tout et sciemment du lancement. Le viol des règles de sûreté est dès lors intégré dans le processus de décision qui précède l’explosion. En fait, cela contredisait mon hypothèse de départ qu’ils se conformaient à toutes les règles. J’ai commencé à examiner les documents d’ingénierie. Brian Wynne souligne que les ingénieurs qui travaillent avec des technologies peu sûres inventent des règles pour « fonctionner » avec ces données, au gré d’une pratique qui se transforme, et cela normalise le processus de façon ad hoc. Mon dieu, ce fut une révélation ! J’ai tout jeté et j’ai recommencé à zéro. Ma question était simple : pourquoi décidèrent-ils de lancer Challenger ?
Zilsel — L’enquête n’est pas facilitée par le fait que, comme vous l’avez souligné dans un article [7][7]Diane Vaughan, « The Dark Side of Organizations : Mistake,…, la Nasa est un exemple parmi d’autres de ces gigantesques bureaucraties techno-scientifiques qui génèrent des quantités littéralement astronomiques de documents. Lorsqu’on lit la monographie sur Challenger, on est frappé par la masse d’archives et de sources de statut divers – rendue accessible par les autorités – que vous avez utilisée pour documenter les processus ayant mené à l’accident. Comment avez-vous procédé pour gérer l’abondance de ces données, dont la maîtrise technique est essentielle pour bien cerner les enjeux ?
Diane Vaughan — Je n’ai pas tout lu ! Il a fallu que je m’organise pour comprendre complètement la logique des événements. Il le fallait avant de réaliser les interviews. J’ai procédé de façon chronologique, à partir des sources historiques publiquement accessibles. J’ai commencé par éplucher les cinq volumes de la commission, les uns après les autres. Le premier rassemble des synthèses, d’autres contiennent des séries de témoignages devant la commission d’enquête. Au fur et à mesure, j’ai repéré les indices d’un pattern régulier, en particulier les problèmes que la commission éprouvait pour comprendre le langage bureaucratique de la Nasa, illustrés par exemple dans le débat ésotérique au sujet des dérogations de lancement (Launch Constraint waivers) : malgré la présence d’anomalies sur les fusées d’appoint à poudre qui a causé l’accident, les ingénieurs de la Nasa et du sous-traitant Thiokol ont jugé le risque « acceptable ». J’ai commencé à saisir le langage technique, ce qui est crucial, mais aussi les différentes positions occupées par les acteurs impliqués dans le programme, le problème lié aux propulseurs d’appoint, en bref comment le système fonctionne. J’ai vite remarqué que les interprétations étaient loin de converger, parce que les gens occupaient des positions différentes dans la structure de l’organisation. Rien d’étonnant : lorsqu’on enquête sur des organisations complexes, on obtient des discours parfois très contradictoires au sujet d’un même phénomène. Cela ne signifie pas que certains mentent tandis que d’autres livrent la vérité la plus absolue ; cela signifie bien plutôt que la position de chacun dans la structure de l’organisation détermine ce qu’il sait et comment il interprète la situation.
En plus des premières lectures, je me suis rendue aux Archives nationales, à Washington DC. J’y ai visionné l’ensemble des vidéos enregistrées aux audiences. J’ai observé les dépositions des témoins, la façon dont ils exprimaient leurs sentiments, le son de leur voix, etc. Ce n’est pas vraiment lisible dans le livre, mais cela m’a été très utile. J’ai appris à les connaître. J’ai passé également trois semaines aux Archives à photocopier des transcriptions réalisées par des avocats chevronnés que la Commission Rogers avait recrutés pour l’investigation. Ils ont interviewé diverses personnes, pour documenter la veille du lancement et l’histoire de la prise de décision sur les fusées d’appoint à poudre. J’ai aussi obtenu la permission de consulter des copies de documents d’ingénierie sur les décisions de lancement. Je disposais d’un immense stock d’informations ! C’est pourquoi j’ai vite compris qu’il était plus simple de traiter ces données de manière chronologique. J’ai commencé par le premier lancement, puis je me suis intéressée aux documents sur les lancements ultérieurs et je n’ai pas cessé de répéter ce processus d’enquête itératif.
Zilsel — Vous définissez votre démarche comme relevant de l’« ethnographie historique ». Cela consiste à suivre les traces, les textes, en les situant dans des environnements pratiques particuliers. Pourriez-vous resituer la façon dont vous est venue cette idée et comment vous l’avez mise en œuvre sur le terrain ?
Diane Vaughan — J’entends par « ethnographie historique » une analyse historique de séquences d’événements basée sur les documents disponibles. Cela s’est imposé à moi parce qu’il m’était indispensable de retourner dans le passé. L’ethnographie renvoie ici à la compréhension de la signification que revêt une situation pour les personnes qui vivent dans un monde différent du vôtre. Le but est de reconstruire les croyances culturelles et une vision du monde, d’interpréter les informations dont les acteurs disposent et auxquels ils ont accès, mais aussi ce qu’ils en font. Cela peut concerner, par exemple, toute la documentation des ingénieurs sur la revue d’aptitude au vol, qui implique un vocabulaire précis, un protocole, une manière de définir la situation. Je disposais des transcriptions des témoignages et les données empiriques sur chaque revue d’aptitude au vol, ce qui me permettait de comprendre comment les acteurs décrivaient la chaîne de décisions, à comparer ensuite avec les protocoles.
J’ai étudié cela des années durant, de 1987 à 1992, et dans l’intervalle j’ai écrit les trois premiers chapitres sur la normalisation de la déviance. Puis, je suis revenue en arrière, j’ai trouvé de nouveaux éléments, j’ai sans cesse révisé mes premières interprétations du processus, qui n’étaient pas complètement correctes. C’est ainsi que j’ai repéré que cela se répétait à chaque décision de lancement, après que les responsables de vol ont décidé d’ignorer les anomalies. J’ai également compris pourquoi à tel moment au contraire, ils avaient tenu compte des anomalies. Des signaux d’alerte précoces et des signaux mêlés leur étaient parvenus. Ils ont identifié une anomalie à l’occasion d’un vol, mais trois lancements furent décidés à la suite sans accrocs. Chaque décision s’accompagne d’un degré élevé d’incertitude.
Après avoir approfondi au maximum la documentation que j’avais rassemblée, je me suis rendue en 1992 au Marshall Space Center de la Nasa, à Huntsville (Alabama), pour réaliser des interviews avec les personnes clés. J’y ai rencontré Roger Boisjoly, j’ai fini par bien le connaître. J’ai interviewé de même Leon Ray, la personne qui en savait le plus, qui n’était pas présent la nuit du lancement ; il était en charge des affaires techniques, il avait travaillé à fond sur le vol. J’ai rencontré aussi Larry Mulloy, Larry Wear – qui était l’ingénieur en chef – d’autres personnes encore, dont j’oublie les noms. J’ai réalisé des interviews téléphoniques en plus, pour compléter l’information. Toutes ces personnes sont restées en contact avec moi. Je pouvais revenir vers eux quand j’avais des questions. Il fallait à chaque instant que je maîtrise l’histoire pour que les échanges soient consistants, parce qu’ils ont compris ce que j’étais en train de faire, et saisi que je n’étais pas d’accord avec les résultats de la commission. Mais suffisamment de temps était passé depuis le crash, si bien qu’ils ont tous accepté de me parler.
Cette expérience de recherche fut incroyablement riche. D’autant plus que, pour les acteurs rencontrés, l’événement a été traumatique. J’aurais dû écrire un appendice méthodologique pour en analyser les enjeux, mais le livre était tellement long déjà… Les récits que les gens font des accidents traumatiques rappellent les ruptures dans les relations intimes, ils sont typiques parce qu’ils commencent par exprimer une confusion vis-à-vis de ce qui est arrivé. Les témoins ont besoin de revenir en arrière et de reconstruire l’histoire d’une façon ordonnée, afin de la comprendre. Mais j’étais convaincue, sur la base de tous ces enregistrements écrits et oraux du passé, que cela coïncidait avec ce qu’il s’était passé. L’histoire que je reconstituais devait être la plus détaillée possible, parce que personne ne savait tout ce que je savais après tant d’années de recherche. Tant de personnes ont publié sur l’accident, le matériau était immense… Donc, il y avait toutes ces sources sur un événement qui était devenu « historique », ce qui justifiait encore l’idée d’« ethnographie historique ».
Zilsel — Et des « descriptions denses » et parfois très techniques de l’ethnographie historique jusqu’à la modélisation sociologique, comment s’est opérée la transition ?
Diane Vaughan — L’analyse s’est peu à peu consolidée. Je combinais le niveau micro de la prise de décision et de la normalisation de la déviance et l’idée d’un pattern régulier dans l’organisation. J’ai mis en lumière l’effet de l’environnement concurrentiel sur la production de la « culture Nasa ». La pression externe sur l’agence provoquait périodiquement des changements dans l’organisation, cela affectait ce que les gens disaient et faisaient. Jusqu’à des situations-limite, où l’on impose des cadences impératives à des ingénieurs qui travaillent H24, semaine après semaine… J’enrichis ensuite par le concept de « secret structurel », à partir de l’intervention des acteurs réglementaires (regulators) externes et l’activité de ceux qui, dans l’organisation, disposent d’un statut réglementaire officiel. L’information sur les anomalies devenait toujours plus mince et réservée aux strates supérieures de la hiérarchie. Ce sont autant de pièces du puzzle. Mon modèle théorique permettait ainsi de comprendre que la décision ne relevait pas de l’inconduite intentionnelle, mais il aura fallu le démontrer, ce dont je n’étais pas sûre à 100 % au départ. C’est en étudiant à fond tous les lancements de la navette que j’y suis parvenue. J’ai compris qu’il y avait un problème lorsque le lancement était prévu un jour de froid. Quand j’ai tout mis bout à bout, je me suis rendue compte que c’était la première fois que l’on disposait d’un récit complet du processus de lancement de Challenger. Mais il me restait encore à expliquer que ce processus ne résultait pas d’une forme d’inconduite, mais plutôt d’une erreur structurellement liée à l’organisation. Des signaux ont été manqués, des pressions ont été exercées dans la production, qui ont affecté l’interprétation des données. Personne ne voulait faire exploser la navette. Personne, absolument personne. Larry Mulloy m’a confié lors d’une interview que le problème des joints sur la fusée à poudre d’appoint était l’un des moins sérieux sur la navette, les problèmes étaient nombreux et normaux parce qu’il s’agissait d’une technologie expérimentale ; ils s’attendaient à avoir des problèmes, celui-là était celui qui préoccupait le moins. Des anneaux en caoutchouc qui scellaient des joints sur les fusées et risquaient de lâcher, cela n’était rien par rapport au système de parachutes utilisé pour récupérer des fusées coûtant des milliards de dollars.
Zilsel — C’est donc une très longue histoire : entre l’accident de Challenger et la publication de votre livre, dix ans se sont écoulés…
Diane Vaughan — L’un des privilèges d’être professeure titulaire (tenure) est que vous pouvez travailler sans hâter les choses. Si j’avais été sous la pression de publier après un an seulement, le résultat aurait été dévastateur puisque je sais maintenant que je me serais trompée complètement dans l’analyse, ce que j’explique dans un des chapitres du livre… Mais comme cela prenait toujours plus de temps et que l’on s’éloignait du crash, je me suis dit que personne ne s’y intéresserait. J’ai écrit les derniers chapitres l’année avant le dixième anniversaire de l’accident de Challenger. Au moment où j’ai envoyé mon manuscrit, en juin 1995, j’ai demandé à mon éditeur s’il pouvait sortir le livre dans les six mois, ce à quoi il m’a répondu qu’en principe cela prenait plutôt une année. Qu’à cela ne tienne, j’ai accéléré la rédaction et j’y suis arrivée ! En novembre 1995, une centaine d’exemplaires a été envoyée aux médias. La publication était envisagée le 28 janvier 1996, date d’anniversaire de l’accident. Tous les journalistes chargés de couvrir l’événement se sont jetés dessus. Ce fut sportif. J’ai été occupée de novembre jusqu’à l’anniversaire, et encore des années après par d’incessantes sollicitations académiques et de conseil. En point d’orgue de cette médiatisation, Malcom Gladwell, journaliste du New Yorker qui s’intéressait au processus de décision sans me connaître, a publié le 22 janvier un long article intitulé « Blowup » [8][8]Malcolm Gladwell, « Blowup », The New Yorker, 22 janvier 1996.. Mon livre y occupait une bonne place. Il a ensuite été chroniqué des dizaines de fois dans les plus grands journaux américains, à la une du New York Times, et jusqu’en Angleterre, dans le Times et l’Independant. C’était impressionnant et inattendu que dix ans après, ce livre épais puisse attirer autant l’attention. Tous les comptes rendus étaient favorables, y compris dans les revues académiques. Quand l’accident de Columbia est survenu en 2003, tout le monde savait que j’étais la personne la plus qualifiée pour livrer mon analyse « à chaud ». Et mon livre a encore été commenté.
Les Science and Technology Studies : une rencontre fortuite
Zilsel — C’est à l’occasion de vos recherches sur Challenger que vous avez découvert les STS, et en particulier le travail de Brian Wynne qui a influé sur votre analyse des pratiques des ingénieurs. Pourriez-vous revenir sur ce moment ? Quel a été l’effet sur la suite de votre carrière ?
Diane Vaughan — Je ne suis pas devenue une « chercheuse STS », j’ai plutôt utilisé la littérature qui relève de ce domaine et j’ai rencontré des chercheurs. C’est la même chose avec les organization studies ou la sociologie de la déviance. Dans ces domaines, surtout dans les STS, c’est l’aspect totalement éclectique qui m’a séduite et qui convenait à la façon dont je travaille. Mais pour autant, ma démarche était très éloignée de ce que faisaient les autres en STS. Je me rappelle la première fois que j’ai rencontré Harry Collins, à Bristol de mémoire. Nous nous sommes installés dans son bureau et il m’a lancé, enthousiaste : « Diane vous tombez du ciel ! Comment en êtes-vous venue à travailler là-dessus ? ! » Alors que le domaine commençait à devenir visible dans le monde académique, j’apparaissais ainsi, sans prévenir ! En fait, je travaillais seule depuis une dizaine d’années, sans lien avec ces domaines. Je tirais les éléments qui m’étaient utiles de diverses littératures, dans le seul objectif de m’aider à structurer mon cadre d’analyse théorique. J’avançais de la sorte, en agrégeant ces sources et en rencontrant de nouveaux collègues, qui m’apportaient en retour de nouveaux éléments. Ce fut le cas avec l’article déclencheur de Brian Wynne.
Zilsel — Vous qualifiez les STS d’éclectiques. Le mot est sans doute bien choisi pour décrire l’état d’effervescence des premières années. Pour autant, nombreux sont les chercheurs dans le domaine qui s’efforcent de le transformer en discipline autonome, donc pas si éclectique et interdisciplinaire que cela. Comment considérez-vous cette tension entre la constitution interdisciplinaire originelle (celle qui était mise en avant au début des années 1970) et l’ambition d’institutionnaliser un segment disciplinaire relativement indépendant des disciplines canoniques (histoire, philosophie et sociologie des sciences), que l’on peut voir à l’œuvre dans les Handbooks et les Readers ?
Diane Vaughan — Je ne pense pas qu’il y ait de tension. Il me semble logique que les STS souhaitent être plus fortes dans le but de se développer. Elles sont déjà en elles-mêmes interdisciplinaires. Et puis, cela se diffuse quoi qu’il advienne, cela fonctionne. Je ne me suis pas rendue à un congrès de STS ou de la Society for Social Studies of Science (4S) depuis bien longtemps. Je suis allée à San Diego en 2013 et j’étais impressionnée par le programme. Il tenait dans un petit livret, comme une petite Bible, et vous pouviez très rapidement constater la diversité des thèmes. Des gens qui travaillent sur tout ce que vous pouvez imaginer y présentaient leurs recherches, par exemple le big data. C’est très actuel, très important. Vous savez, je ne pense pas qu’il y ait encore beaucoup d’études de laboratoire. Ce n’est plus le cœur des STS. Si vous regardez seulement les fondateurs et la façon dont leur travail a évolué à travers le temps, par exemple comment Donald McKenzie est passé des statistiques aux marchés financiers, tout en écrivant pour des publics hors des STS, via le Times Higher Education, vous constatez sans peine une certaine évolution dans les thèmes autant que dans les approches. C’est le cas également de Karin Knorr-Cetina, qui a commencé sa carrière d’ethnométhodologue dans les laboratoires et qui aujourd’hui travaille à démontrer que les marchés sont des choses matérielles ; elle n’intervient pas en dehors du monde académique, mais ses résultats se propagent au-delà de ce qui est connu en STS. On peut encore mentionner la carrière de Harry Collins, depuis les études de laboratoire jusqu’à l’expertise, et maintenant il travaille sur l’expertise profane [9][9]Voir Harry Collins, Martin Weinel et Robert Evans, « The…. Je peux voir chez certains étudiants que j’encadre les effets féconds que peut provoquer la découverte du noyau théorique des STS. Ce noyau d’idées n’a pas été oublié, les études de laboratoire sont prolongées et enrichies par de nouvelles méthodes sur des objets différents ou émergents. En même temps, ce noyau théorique est renouvelé par l’ajout d’idées et d’auteurs qui avaient disparu, comme Ludwik Fleck, ressuscité par Robert K. Merton plus de quarante ans après qu’il a publié son important ouvrage The Genesis and Development of a Scientific Fact (1935).
Zilsel — Votre livre sur l’accident de Challenger est une référence classique dans les disaster studies. Que pensez-vous de ce domaine aujourd’hui de plus en plus visible à l’heure des catastrophes et de la banalisation des risques ?
Diane Vaughan — Je n’ai pas contribué de façon explicite à ce domaine, je me suis surtout focalisé sur mes études de cas Challenger et le contrôle du trafic aérien. Au début, les disaster studies n’étaient pas perçues comme mainstream. Le sociologue des organisations Charles Perrow a publié son livre Normal Accidents bien avant le mien [10][10]Charles Perrow, Normal Accidents : Living with High-Risk…, du reste ce n’était pas classé dans les disaster studies pas plus que dans les organization studies. Puis les disaster studies ont émergé. Il aura fallu attendre la crise financière pour se rendre compte de ce que l’étude des technologies à risque pouvait apporter à l’explication. Je pense notamment au travail de Donald McKenzie, bien qu’il ne soit pas un spécialiste des organisations, mais on peut aussi mentionner les recherches de Karin Knorr-Cetina sur les marchés financiers. Les STS ont beaucoup apporté à l’analyse des désastres de l’économie financière. Mais pour revenir à ma contribution, elle a été plutôt d’ordre théorique, à travers des communications programmatiques faites dans des congrès, à la 4S ou à l’American Sociological Association, ou encore via mon enseignement, puisque j’organise un séminaire sur les échecs organisationnels et un autre sur la connaissance scientifique et la technologie, qui aborde aussi ces questions. J’ai aussi publié un article dans Social Studies of Science [11][11]Diane Vaughan, « The Role of Organization in the Production of…, qui proposait précisément d’appliquer une analyse de type organisationnel sur un sujet classique de la sociologie de la connaissance scientifique. Mais en réalité, cela existait au moins de façon latente. Harry Collins a par exemple comparé deux laboratoires travaillant sur les ondes gravitationnelles, l’un situé en Italie, l’autre aux États-Unis. Son interprétation est culturelle – au sens où il essaie de rendre compte de cultures scientifiques in situ – et l’organisation est l’unité d’analyse [12][12]Harry Collins, Gravity’s Shadow : The Search for Gravitational…. Karin Knorr-Cetina ne procède pas autrement dans Epistemic Cultures, cependant qu’elle ne fait pas usage explicitement des théories sur les organisations [13][13]Karin Knorr-Cetina, Epistemic Cultures : How the Sciences Make…. Même Donald McKenzie s’est orienté dans cette direction. Je pense en particulier à un article qu’il a consacré à la crise financière de 2008 [14][14]Donald MacKenzie, « The Credit Crisis as a Problem in the…. Il montre bien comment les marchés financiers sont couplés à des technologies, et réglés par des organisations, et il est significatif qu’il discute au passage mon analyse sur Challenger. Mais cela n’a pas été approfondi plus que cela dans ces écrits. Ce qui ne veut pas dire que ça ne le sera pas plus tard, car ces idées se diffusent, elles circulent. D’autres pourraient emboîter le pas, de la même façon que je me suis appuyée sur les STS pour les adapter à mes centres d’intérêt théoriques. Quand je m’y suis retrouvée, c’était un microcosme, très interdisciplinaire et ouvert. S’y côtoyaient géographes, philosophes, politologues, sociologues, ingénieurs, etc. Il me semble que c’est toujours le cas et c’est ce qu’il y a de plus précieux. Néanmoins, force est de constater que si les STS se diffusent dans la sociologie mainstream, l’inverse n’est pas avéré. L’engouement reste limité. Peu de sociologues travaillant sur les organisations utilisent le noyau dur des méthodes et théories des STS, à quelques rares exceptions près. Me vient en tête le nom de Wanda Orlikowskio, de la Business School de New York University, longtemps directrice de publication de la revue Organization Science. C’est la même chose dans les disaster studies.
Zilsel — J’ai l’impression que dans les STS il y a une tendance à surinvestir les problèmes philosophiques, qui a donné des controverses parfois très intenses, notamment dans le cas de la construction sociale des savoirs au début des années 1990. Comme si « théoriser », ça voulait dire « faire de la philosophie » – et alors du même coup, reléguer au second plan le travail monographique qui était stratégique dans les années 1970.
Diane Vaughan — Il y a sans doute un certain intérêt pour la théorie et la théorisation, mais les efforts restent hélas trop souvent isolés, cela ne communique pas assez. La palette des concepts utiles est certes étendue. Mon concept de « normalisation de la déviance », comme d’autres – les « conséquences inattendues de l’action » de Robert K. Merton, la « flexibilité interprétative » d’Harry Collins et Trevor Pinch –, peuvent être appliqués pour rendre compte de situations et d’objets présentant des similarités de structure, mais l’intégration des concepts est insuffisante. La « flexibilité interprétative » se diffuse entre les frontières disciplinaires alors que dans les STS ce n’est presque plus cité du tout… Tout cela me conforte dans l’impression que la perspective d’une intégration et de mise en relation de ces recherches n’est pas à l’ordre du jour. C’est très individuel, ce n’est pas cumulatif. Quand vous pensez à la formation des chercheurs des STS, leur inclination à l’interdisciplinarité, cela devrait marcher dans ce sens : les géographes s’intéressent à la diffusion des idées et sont outillés conceptuellement pour l’étudier, les sociologues de la connaissance mettent l’accent sur la production de la connaissance, cela devrait communiquer en liant ces bouts. Mais ce n’est pas vraiment le cas. Si bien que les interprétations individuelles continuent de prévaloir.
Zilsel — Pourtant au tout début des années 1970, il y avait des tentatives de développer une sociologie des organisations scientifiques, avec des visées intégratrices. Un peu plus tard, des propositions se sont consolidées, je pense par exemple à l’importante contribution de Richard Whitley, TheIntellectual and Social Organization of the Sciences [15][15]Richard Whitley, The Intellectual and Social Organization of…, qui propose d’utiles définitions, typologies et modélisations des types d’organisations scientifiques, applicables dans différentes disciplines à travers l’histoire des sciences. Cette démarche est tout à fait en phase avec le projet que vous mettez en avant. S’il n’est pas cité suffisamment, le livre n’en reste pas moins une source indispensable…
Diane Vaughan — Je ne connais pas ce livre… (Cherchant)
Zilsel — Ah ! C’est intéressant parce que dans mon esprit, c’est un classique des études organisationnelles appliquées aux STS. Richard Whitley a été actif dès le début des années 1970, puis s’est un peu éloigné du « mouvement STS » en se concentrant sur les transformations du capitalisme. Sans vouloir surinterpréter, que vous n’ayez pas connaissance de son ouvrage – dont la première édition n’était plus vraiment citée au début des années 1990, quand vous faites le lien avec les STS – me semble révélateur des circulations intellectuelles contrariées au sein des STS.
Diane Vaughan — C’est assez inquiétant que je sois passée à côté ! (Rires) J’ai travaillé et construit mon cadre théorique en m’inspirant des idées développées par d’autres, j’ai bricolé, c’est assez caractéristique de mes recherches. Et quand cela fonctionne sur les phénomènes que vous essayez d’expliquer, vous allez jusqu’au bout de l’explication sans nécessairement faire l’inventaire de toute la littérature, à tel point qu’il peut y avoir un angle mort et quelques oublis. Mais le plus important à la fin, c’est que votre explication tienne la route. Cela dit, j’ai passé un temps considérable à lire les revues de STS après que j’ai découvert l’article de Brian Wynne. J’ai beaucoup apprécié les débats dans certains numéros de Social Studies of Science. Ces lectures ont été formatrices.
Voyages et aventures des théorisations sociologiques
Zilsel — Il est frappant de constater combien il est crucial dans vos recherches d’entretenir une forme de continuité, depuis le premier ouvrage jusqu’au dernier à paraître. Au fur et à mesure, votre approche théorique se consolide, les lignes directrices sont toujours plus affirmées, tout en ménageant assez de souplesse dans les applications à de nouveaux objets. Est-ce un biais de présentation induit par le cadre même de notre entretien, qui mêle biographie et enquêtes, qui suppose donc de revenir en arrière avec linéarité et effet de reconstruction a posteriori, ou bien s’agit-il d’une sorte de trame épistémologique présente tout au long de votre carrière ?
Diane Vaughan — Il y a une forme de continuité, c’est indéniable. Elle s’enrichit de différents procédés, dont le plus essentiel est la comparaison analogique. C’est une idée dominante : les études de cas que j’ai réalisées partagent des données et des processus, mais qui varient en taille autant qu’en complexité. Cette question de l’analogie et surtout son usage dans la théorisation dans les sciences sociales m’intéressent beaucoup. Comme je l’ai soutenu dans une contribution à un livre sur la théorisation [16][16]Diane Vaughan, « Analogy, Cases, and Comparative Social…, nous y avons recours très souvent sans pour autant en avoir une pleine conscience. C’est pourquoi il me paraît nécessaire de rendre explicites ces usages, afin d’exploiter au mieux les potentialités du raisonnement analogique [17][17]Voir aussi Diane Vaughan, « Theorizing disaster : Analogy,…. Lorsque l’on achève un article ou un livre et que l’on essaie de généraliser à partir des résultats, on généralise nos résultats à des situations qui sont analogues sous certains aspects et critères.
C’est une partie de la réponse, mais je ne suis pas sûre que cela réponde à toute la question. Il faut également prendre en considération d’autres éléments, par exemple les processus d’induction et de déduction. Ils sont rituellement distingués. Les chercheurs peuvent reconnaître qu’ils usent soit de l’un, soit de l’autre, et de façon exclusive, mais en réalité je pense que dans le mouvement de la recherche les deux interviennent de concert. Dans The Discovery of Grounded Theory, qui est très lu ici à Columbia, Barney Glaser et Anselm Strauss soutenaient que vous devez vous engager dans un cadre de recherche sans rien savoir, en contrôlant rigoureusement l’induction, en « ancrant la théorie », mais on ne procède jamais ainsi lorsque l’on travaille sur les objets [18][18]Barney Glaser et Anselm Strauss, The Discovery of Grounded…. On a toujours une raison de choisir d’étudier tel ou tel objet. C’est pourquoi il importe de reconnaître l’existence d’une sorte de théorie de départ qui est vôtre lorsque vous amorcez une enquête, qui peut s’avérer juste ou erronée, mais qui, une fois ramenée au premier plan, explicitée donc, n’en permet pas moins d’établir des comparaisons analogiques ou de théoriser analogiquement. En d’autres termes, il y a cette théorie initiale, née d’autres expériences de recherche notamment, mais le processus de découverte demeure aussi inductif parce que nous importons des idées en même temps que nous avançons et découvrons de nouvelles choses. Par exemple, dans le cas de Challenger, j’étais en train de travailler sur mes données et je me rendais compte que j’employais toujours l’expression « moyens légitimes » pour les interpréter. Puis j’ai cherché à en trouver l’origine. Je me suis vite rendue compte en allant vérifier que cela venait de Merton, ce qui m’a amenée à renforcer un raisonnement qui n’était qu’intuitif au départ. Importer sciemment ce schème d’analyse lié à la théorie mertonienne de l’anomie a ainsi modifié ma perspective.
Cela arrive en permanence dans les dynamiques de recherche, et pourtant il est rare que l’on accorde à ces aspects l’importance qu’ils méritent. Nous devrions être bien plus attentifs à nos propres processus de théorisation. Cela peut être d’ordre analogique ou bien basé sur des différences par rapport à des choses que nous connaissons, mais je pense que c’est une façon de faire prendre conscience aux chercheurs qu’ils adoptent une démarche, qu’ils sont inspirés par des concepts et des ressources théoriques. C’est une dimension du travail intellectuel que je mets en avant dans mon enseignement, c’est extrêmement important. Cela aiderait à saisir de façon plus immédiate les intérêts théoriques sous-jacents, qui ne sont pas toujours manifestes, comme s’ils allaient de soi. Il arrive souvent de lire l’ultime version d’un article ou d’un projet de recherche sans savoir vraiment comment ni pourquoi son auteur en est venu à développer les idées qu’il défend. C’est en soi un problème de sociologie de la connaissance très intéressant.
Zilsel — Donc il y a des déplacements analogiques dans votre recherche ainsi que des références par moments appuyées sur le travail de divers auteurs, qui sont autant de sources d’inspiration. C’est le cas par exemple de Bourdieu [19][19]Diane Vaughan, « Bourdieu and Organizations : The Empirical…, dont vous montrez qu’il peut aider à l’analyse empirique des organisations comme champs ou dans des champs – ce qui ne manquera pas de surprendre en France, où la référence à Crozier est plus immédiate. On peut aussi trouver des références répétées à Merton, à Bruno Latour, à Harry Collins, etc. À première vue, cela donne l’impression d’un patchwork référentiel, mais l’on comprend que l’objectif prioritaire pour vous est de chercher des outils utiles pour votre recherche. Et peu importe que ces outils puissent paraître incompatibles, si la recherche avance.
Diane Vaughan — Là encore, je dirais que ces usages relèvent de l’analogie. J’ai été très influencée par l’article de Paul DiMaggio et Walter Powell, « La cage d’acier revisitée » [20][20]Paul J. DiMaggio et Walter W. Powell, « The Iron Cage…, et plus largement le développement de la théorie néo-institutionnaliste durant les années 1980. DiMaggio et Powell étaient enseignants à Yale lors de mon séjour postdoctoral là-bas. J’ai assisté à l’élaboration de leur cadre d’analyse. Quand ils ont fini par en tirer un livre collectif fondateur en 1991 [21][21]Walter W. Powell et Paul DiMaggio (eds.), The New…, j’étais absorbée par l’enquête sur Challenger, en particulier par l’analyse du processus de prise de décision. J’ai lu l’introduction du livre. Ils y reconnaissent que l’agency était trop peu intégrée au schéma théorique de « La cage d’acier revisitée ». Pour y pallier, ils suggèrent des pistes pour leur « nouvel » institutionnalisme : outre les références du moment en théorie des organisations, ils s’appuient sur l’approche bourdieusienne du niveau micro de l’action en termes de dispositions et de prédispositions pour consolider leur « théorie de l’action pratique » [22][22]Ibid., p. 25-26.. Cela m’a inspirée alors que j’étais en train de travailler sur le façonnement des comportements individuels par la culture organisationnelle de la Nasa. Je n’en oubliais pas moins d’utiliser cette théorie néo-institutionnaliste à un niveau plus macro pour comprendre les logiques institutionnelles qui influent sur les organisations et, par extension, les individus. J’ai essayé de connecter théoriquement toutes ces dimensions qui, dans le cadre de ma recherche, étaient objectivement liées. Si mon usage des cadres d’analyse dispositionnalistes de Bourdieu n’est pas si visible dans le livre sur Challenger, j’ai approfondi après-coup la discussion dans l’article que vous mentionnez, sans les relier explicitement à mes terrains d’enquête. Le principal problème, comme je l’ai signalé dans cet article, est que la notion d’habitus et la théorisation qui la sous-tend sont très pertinentes pour rendre compte des pratiques à l’échelle micro, mais à mon sens elle n’est pas assez approfondie sur le domaine institutionnel, alors même que c’était une des ambitions de Bourdieu, qui référait à des phénomènes de niveau macro. Une piste consisterait par exemple à mettre en évidence des « habitus organisationnels ».
Zilsel — Vous n’échapperez pas à une question rituelle des entretiens biographiques : pourriez-vous citer quelques auteurs qui vous ont influencée durant votre carrière ?
Diane Vaughan — Je peux sans doute en citer quelques-uns. J’ai déjà évoqué Merton, Spence, Wynne… Arthur Stinchcombe me vient également à l’esprit. De Merton et Stinchcombe, outre leurs contributions majeures aux domaines qui m’ont intéressée, en particulier les organisations et la théorie sociologique, j’ai retenu l’importance du concept et de sa définition la plus claire possible. C’est un souci constant chez Merton, tout comme dans les ouvrages les plus théoriques de Stinchcombe [23][23]Voir notamment Arthur Stinchcombe, Constructing Social…. Pour lier l’un et l’autre, je renverrai à l’article que Stinchcombe a publié dans le livre d’hommages à Merton que Lewis Coser, son ancien étudiant à Columbia, a fait paraître en 1975 [24][24]Lewis Coser, The Functions of Social Conflict, New York, The…. Dès la première page, vous savez où vous allez. Les marqueurs théoriques sont clairs, vous lisez une démonstration rigoureuse. Il écrit des choses comme « par structure sociale, je veux dire… ». Il propose des définitions claires des processus et des mécanismes, qui lui permettent, dans cet article, de reconstruire l’ensemble de la théorie sociale de Merton – ce qui est un tour de force théorique, que son auteur avait d’ailleurs salué. C’est pour moi un modèle que j’essaie de mettre en œuvre dans mes publications.
Zilsel — Définir les concepts, les intégrer théoriquement, se soucier de leur adéquation aux données empiriques, etc. Ce n’est pas une pratique si courante en sociologie !
Diane Vaughan — Non, mais ça le devrait ! Mais revenons de nouveau sur la diffusion des idées. La comparaison analogique en est un aspect essentiel puisqu’elle suppose de définir les concepts qui vous permettent de trouver des correspondances entre différentes choses. Un concept est analogique à la structure d’un problème et, sous certaines conditions, de comparabilité notamment, il peut être « transporté » vers un autre problème structuré de façon similaire. Or pour que ce transport soit réussi un minimum, pour que cela circule, il faut une définition à peu près stable et précise du concept en amont. Cela concerne les terminologies scientifiques amenées à circuler entre les disciplines scientifiques – leur circulation en dehors de cet espace académique est un autre aspect, sur lequel nous pourrons revenir. La normalisation de la déviance, par exemple, est un des concepts pivots du livre sur Challenger. Il a énormément circulé, plus que je ne l’aurais imaginé d’ailleurs. Si vous cherchez via Google, vous pourrez constater qu’il s’est diffusé très largement. Vous pouvez procéder de la même façon avec n’importe quel concept et voir ce qu’il est devenu en première analyse. Et aller plus loin en reconstituant l’histoire fine des circulations. Prenons la théorie de la signalisation, qui présente l’intérêt de décrire des processus à l’œuvre dans une variété de configurations sociales. Il est instructif d’en remonter la source, dans la mesure du possible.
Par exemple, dans le premier chapitre de Market signaling, Michael Spence pose sa théorie. Je l’ai interviewé afin de savoir comment l’idée lui en est venue. Il m’a raconté cette histoire passionnante. Alors qu’il travaillait sur sa thèse de doctorat, à Harvard après avoir bourlingué, il a fait la connaissance de Robert Jervis sur le campus. Sa thèse portait sur la logique des images et des perceptions dans les relations internationales [25][25]Robert Jervis, The Logic of Images in International Relations,…. Il s’intéressait aux négociations entre les États-nations, pour ce qui concerne en particulier la dissuasion nucléaire. Jervis avait suivi les cours d’Erving Goffman à l’université de Berkeley, et l’on retrouve les analyses du sociologue dans son approche des relations internationales. Et ces analyses d’influencer par la suite Michael Spence. J’ai voulu en savoir plus. Je suis allé à la rencontre de Robert Jervis, qui enseignait alors à l’université Columbia. Il m’a confirmé qu’au moment de sa thèse, il était incollable sur les livres de Goffman, comme Strategic Interaction, dans lequel on trouve une analyse des stratégies de signalisation… que Goffman développe en s’appuyant sur la thèse de Jervis [26][26]Erving Goffman, Strategic Interaction, Philadelphia, University…. Donc d’une certaine manière, ce dernier a utilisé Goffman qui l’a utilisé. Après le départ de Jervis pour Columbia, Spence est resté en contact avec lui via l’économiste et spécialiste de politique étrangère Thomas Schelling, une autre personne importante de cette histoire, avec qui Goffman a également collaboré lors d’un séjour à Harvard. Quand j’ai demandé à Michael Spence s’il s’imaginait recevoir un jour un « prix Nobel » pour cette contribution, il m’a répondu aussitôt par la négative. Et j’en suis venue à lui poser l’idée qui me taraudait le plus et qui justifiait l’entretien, à savoir l’explication du succès et de la diffusion large de son idée. Ce à quoi il a répondu qu’à l’époque où il l’a travaillée, les économistes étaient concentrés sur des problèmes structurellement similaires.
Ainsi, les théories voyagent de façon parallèle et plus ou moins en simultané… Tous les auteurs que je viens d’évoquer, Goffman, Jervis, Spence, Schelling, sont des penseurs « analogiques ». Tout comme l’était Robert K. Merton, qui est une autre source d’inspiration de Jervis, comme l’atteste l’application du paradigme mertonien des conséquences inattendues de l’action à son analyse des effets de système dans les relations internationales [27][27]Diane Vaughan, Compte rendu de Robert Jervis, System Effects,….
La sociologie publique « par accident »
Zilsel — Évoquons à présent ce qu’il est convenu d’appeler, notamment à la suite de la campagne persévérante de Michael Burawoy [28][28]Michael Burawoy, « Pour la sociologie publique », Actes de la… aux États-Unis, la « sociologie publique » (public sociology). Votre ouvrage sur Challenger vous a propulsée sur des scènes autres qu’académiques, où les questions relatives au processus de décision et au fonctionnement des organisations aussi bureaucratiques et gigantesques que la Nasa ont été posées de façon aiguë. Il vous aura fallu publiciser votre diagnostic sur la normalisation de la déviance en échangeant avec une multiplicité d’audiences. Pourriez-vous revenir sur les « voyages » de théorisation de l’échec organisationnel de Challenger, dont les conclusions ont été réactualisées lors de l’explosion d’une seconde navette Columbia en 2003 ?
Diane Vaughan — Il m’est arrivé d’intervenir hors du monde académique, en diverses occasions et de différentes manières. Mon travail sur le crash de Challenger a à voir avec la question du pouvoir, qui ne laisse pas indifférent. Il est possible de l’envisager « à froid » sous l’angle d’un système ou d’effets de système au sein d’une organisation. Y interviennent des facteurs externes, le lien avec le champ politique, le financement des programmes, mais aussi la façon dont les leaders y répondent. Les ingénieurs de la Nasa ont lu le livre sur Challenger, cela résonnait avec leur propre environnement de travail. J’ai été en contact avec le milieu des ingénieurs, par courrier électronique ou à d’autres occasions ; ils continuent à m’écrire, pas aussi régulièrement qu’avant, mais tout de même encore. Cela les a frappés parce qu’ils ont perçu comment leur monde est configuré. Surtout, ils ont été confrontés à une analyse qui ne part pas des individus pris isolément, mais les situe dans une position au sein de l’organisation. Le registre de l’analyse organisationnelle les place dans une position d’extériorité et d’explication structurelle. Le cadre théorique et les concepts sont à un niveau de généralité assez élevé pour être appropriés par quiconque est placé dans une configuration similairement structurée. Et cela permet de contredire le réflexe qui consiste à individualiser l’échec ou la faute, de surinvestir les traits de personnalité des coupables ou leur éventuel manque de compétence. L’idée de mettre en œuvre un raisonnement en termes de système et d’effets de système est ma contribution, dont les acteurs peuvent se saisir pour comprendre et transformer leur monde. Même les responsables politiques, parce qu’ils étaient impliqués, ont été forcés de reconnaître cette réalité et de l’affronter.
J’ai été surprise par l’attention très large que le livre a suscitée, bien après les premiers comptes rendus dans la presse. Je ne cessais d’être sollicitée par des grandes organisations pour donner des conférences, par exemple dans une convention IBM devant 5 000 personnes, aux services de l’US Air Force, à l’US Nuclear Operation, aux services de l’US Submarine, etc. Quelles que soient l’organisation et sa façon de considérer le risque, qu’il s’agisse d’IBM ou de l’armée de l’air, à chaque fois il était question d’échec organisationnel et des moyens à mettre en œuvre pour tenter d’y échapper. Certaines organisations ont sauté le pas et ont intégré ce paramètre dans leur fonctionnement. C’est le cas de l’US Submarine, qui a introduit des formations sur l’échec organisationnel et la normalisation de la déviance. Il était possible de tirer des leçons partout où des systèmes techniques complexes et de grande envergure posent des problèmes organisationnels. Cela inclut les hôpitaux. Je me rappelle avoir été invitée à donner une conférence inaugurale à un congrès sur les erreurs médicales à Palm Springs. C’est un secteur d’activité spécifique, mais sur lequel mes analyses peuvent parfaitement s’appliquer. Les personnes que j’y ai rencontrées me décrivaient diverses sortes d’erreurs, en les rapportant à l’organisation hospitalière. J’ai assisté à une intéressante communication, qui portait sur une erreur lourde de conséquences qui s’est produite dans un hôpital en Floride : les chirurgiens procédaient à une intervention mineure sur un enfant de 10 ans, mais ils ont injecté un produit dans ses veines qui n’était pas le bon, ce qui a provoqué sa mort. Après cette tragédie, une enquête a été menée. Elle s’est focalisée sur la division du travail, la manière dont les opérations étaient organisées et catégorisées. On comprend alors mieux pourquoi la personne qui a chargé la seringue a confondu les traitements. C’est l’ensemble du système organisationnel que constitue la salle d’opération qu’il fallait questionner et repenser ; par exemple, modifier la division du travail, les signalisations et les procédures de telle sorte que l’on puisse se rendre attentif aux signaux appropriés. Comme à l’US Submarine, des hôpitaux ont donc intégré ces changements pour faire face au risque.
Zilsel — Tout se passe comme si votre théorie agissait à la façon d’une sorte d’électrochoc ou de révélation existentielle chez les acteurs qui, de façon soudaine, comprennent pourquoi cela dysfonctionne.
Diane Vaughan — Un des effets les plus perceptibles de l’analyse organisationnelle est le décentrement de soi. Au départ, tout le monde pense en termes d’erreur individuelle et de formation défaillante ; mais d’un coup, ils sont invités à changer de perspective et se mettent à penser de façon systémique. C’est une conversion du regard. Je pense que c’est une bonne chose. Cela m’amène à l’autre question que vous souleviez, celle des raisons de l’adhésion des scientifiques, des ingénieurs ou des techniciens à la théorie de la normalisation de la déviance. Cela renvoie de nouveau au processus de diffusion des idées. J’ai cherché récemment des références faites à la normalisation de la déviance sur Google Scholar. C’est utilisé dans la vaste littérature sur les organisations bien sûr, mais ça l’est également dans des domaines aussi divers – et éloignés de la sociologie – que l’éthique du commerce, la santé publique, le travail social, les disaster studies, l’adoption et les familles d’accueil (foster care). Cela se diffuse partout où des gens considèrent qu’il faut changer un système défectueux. C’est un concept générique et transposable, ouvert à une multiplicité de réappropriations en même temps qu’il conserve une définition de base.
Zilsel — Ce processus par lequel un concept est extrait de son contexte initial de découverte et finit par circuler ailleurs rappelle – sans que l’on réfère à la source, à force d’utilisation – l’idée d’« oblitération par incorporation » proposée par Robert K. Merton. C’est une piste pour analyser la « vernacularisation » des terminologies scientifiques, laquelle peut emprunter des chemins inattendus, voire étonnants.
Diane Vaughan — Il faut tenir compte de tous les canaux de diffusion. Par exemple, on trouve des vidéos sur YouTube, dans lesquelles telle ou telle personne présente l’étude de cas sur Challenger ou introduit l’idée de normalisation de la déviance. L’une d’entre elles met en scène Mike Mullane, ancien astronaute. À l’occasion d’une conférence donnée devant l’International Association of Fire Fighters en 2013, il revient sur la façon dont les manageurs de la Nasa ont finalement accepté de prendre des risques connus sans pour autant attendre un désastre, normalisant ainsi une forme de déviance. À aucun instant il ne cite mon ouvrage. Il présente l’explication avec une telle conviction qu’il a l’air de penser que c’est son idée ! (Rires) Cela arrive, ce n’est pas une mauvaise chose si vous partez du principe que les gens doivent utiliser l’idée, et peu importe à la rigueur qu’elle soit remaniée à la marge [29][29]Mike Mullane l’utilise non sans la réviser : dans la conférence…. Dire qu’au moment où je l’ai achevé, je pensais que personne n’allait le lire… Ce fut le contraire. Et l’expérience m’a été très bénéfique. Et d’autres se sont ajoutées. Avec Uncoupling par exemple. En 2014, alors que j’étais passée à autre chose près de trente ans après la parution du livre, la notion-clé qu’il porte réapparaît dans les médias à la faveur d’une rupture retentissante : un jour donc, Gwyneth Paltrow annonce qu’elle est en train de se séparer de son mari Chris Martin, le chanteur de Coldplay. Un communiqué officiel en fait état. Il devient aussitôt viral sur Internet. Le texte précise qu’elle et lui sont entrés dans une phase de « découplage conscient » (conscious uncoupling) [30][30]John Koblin, « A Third Party Names Their Split », The New York…, ce qui a intrigué nombre de fans et de commentateurs qui ont cherché à savoir à quoi cela renvoyait. De même que des « programmes » peuvent être mis en place pour combattre la normalisation de la déviance, on peut trouver des thérapeutes impliqués dans cette explication du « découplage conscient », qui proposent des traitements et des stages en cinq semaines pour accompagner les couples qui prennent la décision de se séparer. Ici encore, un de mes livres a été repéré puis réutilisé. Si cela n’a pas pris les proportions du débat autour de Challenger et des organisations à risque, « uncoupling » est devenu un terme vernaculaire.
Zilsel — Et ainsi l’idiome sociologique en vient à enrichir le vocabulaire ordinaire.
Diane Vaughan — Je suis une grande avocate de la sociologie vernaculaire ! (Rires) Les interprétations que j’ai pu proposer étaient basées sur les données dont je disposais. J’ai discerné un pattern qui n’était pas référé à un mot ni n’était l’objet d’une quelconque théorisation. Je lui ai donné un nom, qui décrit donc une expérience particulière. Mais ce n’est pas comme si j’inventais tout ex nihilo. Ce qui se passe dans telle situation, par exemple quand l’accident ou la déviance deviennent acceptables dans une organisation, la normalisation de la déviance pour résumer, ce processus donc est sorti du travail de conceptualisation, de l’écriture. Et dans des circonstances que l’on ne contrôle pas toujours, ces néologismes sont finalement appropriés. C’est une des voies de la sociologie publique. Difficile, d’ailleurs, d’être plus « public » que Gwyneth Paltrow !
Zilsel — C’est certain ! Évoquons donc de nouveau la sociologie publique. Vous avez été sollicitée par la Nasa après le crash de Columbia, en 2003. Vous l’évoquez longuement dans un article, « Nasa revisited » [31][31]Diane Vaughan, « NASA Revisited : Theory, Analogy, and Public…, qui vous amène à réfléchir sur les « voyages » de la théorie sociologique au-delà des frontières de son contexte d’élaboration académique. Vous soulignez que votre implication dans la recherche des causes de ce nouvel accident fut l’occasion de diffuser un « message sociologique » dans les discours publics et politiques sur l’organisation de la Nasa. Que vos analyses théoriques s’appuient sur une ethnographie rigoureusement documentée a, dites-vous, nettement favorisé l’appropriation et l’influence de ce message. Ainsi êtes-vous devenue une avocate de la sociologie publique [32][32]Diane Vaughan, « How Theory Travels : A Most Public Public…. Cette orientation était-elle implicite jusqu’alors, malgré les conférences données devant les professionnels exposés à la normalisation de la déviance que vous évoquiez plus tôt ? Le crash de Columbia et les « revisites » qu’il a suscitées ont-ils été une sorte de révélateur de votre positionnement disciplinaire ?
Diane Vaughan — C’est après Columbia que j’en ai eu vraiment conscience.. Le même pattern que j’avais identifié sur le cas Challenger se reproduisait. J’étais stupéfaite par les prises de parole du responsable de la navette spatiale à la télévision : en substance, les équipes impliquées dans le programme s’étaient retrouvées dans la même situation de normalisation de la déviance. Cela m’a surprise. Et je me suis de nouveau laissée happer, puisque j’ai accepté de faire partie de la commission d’enquête sur l’accident de Columbia. Cela a différé la réalisation de l’enquête sur le contrôle du trafic aérien, qui entrait dans sa phase d’écriture après deux ans de travail, mais cette expérience a été très intéressante parce que j’ai observé et participé à l’enquête, de l’intérieur – à la différence de l’enquête sur le crash de Challenger, où j’avais accédé aux données de la commission d’enquête après-coup. J’ai eu la chance d’être conviée dans les installations de la Nasa. J’ai par exemple visité l’énorme centre d’entraînement des astronautes à Houston. C’est un endroit extraordinaire. On y trouve la plus grande piscine du monde, une navette grandeur réelle plongée dans l’eau afin d’entraîner les astronautes à des activités extravéhiculaires. J’ai adoré travailler dans cette équipe interdisciplinaire. J’ai pu vérifier auprès de mes collègues que le modèle causal que j’avais défini sur la catastrophe Challenger fonctionnait encore dans ce nouveau cas. Si bien que le livre a eu une deuxième vie. Je dirais donc que dans ce contexte, j’ai été amenée à m’engager une nouvelle fois dans une forme de sociologie publique, sans pour autant utiliser le terme de moi-même. C’est venu après.
Zilsel — Pourriez-vous rappeler les circonstances de cette prise de conscience que vos interventions pouvaient être rangées sous cette rubrique ?
Diane Vaughan — Vous avez mentionné tout à l’heure la définition qu’en donne Michael Burawoy. Eh bien, il s’est appuyé entre autres sur mes interventions après les crashs de Challenger et Columbia pour définir ce qu’il entend par « sociologie publique ». Tout s’est déroulé au sein de l’American Sociological Association (ASA), alors qu’il en était le président. D’une façon très offensive, en bon marxiste qu’il est, il a proposé de réévaluer le potentiel de transformation sociale de la sociologie publique à l’occasion de son allocution de président (presidential address) au congrès de 2004, qui s’est tenu à l’université de Berkeley [33][33]« Michael Burawoy, For Public Sociology, Part 1 :…. Ce fut un grand moment. C’est l’un des meilleurs conférenciers qui soient ! À Berkeley, il enseigne la théorie sociologique en premier cycle (undergraduate) devant un amphithéâtre d’environ 400 étudiants. Ils s’entretueraient pour pouvoir y assister ! Non seulement il dit des choses importantes de manière accessible, mais en plus il est vraiment amusant. Lors de cette fameuse conférence de 2004, il a plaidé pour la sociologie publique. L’ambiance était survoltée, une bonne partie de la profession était présente ainsi qu’une foule d’étudiants (les siens), certains portant des tee-shirts à l’effigie de Marx. Je me souviens du début de son discours. Burawoy a commencé par évoquer sa carrière, ses débuts dans les mines de Zambie, puis son travail dans une usine à Chicago, ensuite la Sibérie et d’autres expériences encore. Il liait ces moments à des événements politiques qui avaient lieu à l’époque, il dramatisait les enjeux en rappelant que partout où il se trouvait, le chaos était toujours au rendez-vous. Pour conclure, pince-sans-rire : « après je suis devenu… le président de l’ASA ». C’était d’un comique ! (Rires) Après cette introduction, il a repris le fil de sa démonstration et, au détour d’une « thèse » sur la sociologie publique telle qu’il l’entend, il a mentionné mon enquête sur Challenger. Ce n’était pas tout à fait un hasard. Il est venu à Boston College juste au moment où l’accident de Columbia était en cours d’investigation. Je m’occupais de l’organisation des conférences de professeurs éminents invités à l’université. Alors que nous préparions la sienne, mon téléphone n’arrêtait pas de sonner. Les médias me sollicitaient sans interruption et je venais tout juste d’être réquisitionnée pour témoigner à Houston. Cela a fait « tilt » lorsqu’il a découvert combien j’étais impliquée dans cette affaire. Il cherchait à illustrer la sociologie publique. Il avait déjà lu mon livre sur Challenger, il l’a relié à cette nouvelle catastrophe et mes activités dans le cadre de la commission d’enquête. Et donc, à un moment de sa conférence, il parle de moi [34][34]« Michael Burawoy For Public Sociology, Part 3 : Thesis 2 &…. Il se rappelle les moments passés ensemble à Boston, fait rire la salle en disant qu’il a fait « une ethnographie de moi » (Rires), cela pour étayer l’idée que non seulement mon livre sur Challenger était une sorte de sociologie publique parce qu’il avait retenu une large attention en dehors du monde académique, mais qu’en plus je suis intervenue dans la foulée de l’accident de Columbia – qui était annoncé dans le livre, faute d’une prise de conscience à la Nasa. Burawoy tenait donc un exemple idéal : le cas d’une sociologie académique qui devient publique et finit par « convertir » les acteurs à la sociologie. Il rappelle que le rapport de la commission est imprégné de mon vocabulaire et en conclut que « c’est du pur Diane Vaughan ». (Sourires)
Après le congrès de l’ASA, il a continué de défendre sa conception de la sociologie publique. Il a donné d’innombrables conférences dans des community colleges américains. Les personnes qui y enseignent ne se retrouvent pas vraiment dans la sociologie académique de l’ASA. Ils travaillent sur des projets spécifiques dans les quartiers en qualité d’« animateurs communautaires » (community organizers). Ces personnes sont souvent engagées dans des causes ou sont des activistes politiques. Néanmoins, ces sociologues sont perçus comme des chercheurs de second plan, à l’ombre des sociologues rattachés à des départements de sociologie académique. Burawoy refuse ces hiérarchies et souligne au contraire que ces figures sont interdépendantes, que l’on peut aussi passer de l’une à l’autre – ce que je fais sans cesse. Quoique les enjeux fussent éloignés au premier abord, Burawoy a toujours mentionné l’explosion de Columbia dans ses interventions auprès des publics de sociologues des community colleges. Il l’a fait de nouveau dans d’autres circonstances, par exemple l’été suivant en Afrique du Sud. Puis il a continué ailleurs son travail de légitimation de la sociologie publique, notamment au sein de l’Association internationale de sociologie qu’il a présidée de 2010 à 2014. Ce travail a payé. La sociologie publique est devenue un peu plus légitime, et mon livre sur Challenger de même que mes aventures de sociologue publique y ont contribué. Ce qu’a reconnu l’ASA, qui m’a décerné en 2006 un prix « public understanding of sociology » [35][35]Voir « Diane Vaughan Award Statement », 2006,…. C’était un honneur immense, d’autant plus que nous étions deux du département de Columbia à recevoir un prix lors de cette cérémonie (Herbert Gans, récipiendaire du prix W.E.B. Du Bois career of distinguished scholarship) [36][36]ASA Awards Ceremony and Presidential Address, 2006,…. L’aspect qu’a le plus combattu Burawoy est le caractère très hiérarchique de la sociologie américaine. Il voulait transformer cet état de fait, notamment en rééquilibrant les diverses manières de la faire progresser – qu’il s’agisse des sociologies académique, critique, experte et publique. Certes, cette conception n’a pas fait consensus et a suscité d’énormes discussions, mais elle a permis de faire avancer la réflexion sur la sociologie publique. Dans mon discours de réception du prix à l’ASA en 2006, j’ai dit en substance que je n’avais pas anticipé que mon livre « universitaire » écrit dix ans plus tôt puisse être converti en exemple de manuel pour sociologue public [37][37]Voir également Diane Vaughan, « Public Sociologist by…. Mais il l’est devenu. Ces choses-là sont imprévisibles et je ne suis pas la seule à qui cela est arrivé. Je pense à l’expérience de Lewis Coser, que j’ai bien connu à Boston College. Un jour il était revenu sur le succès tardif du livre tiré de sa thèse, The Social Functions of Conflict, qu’il avait publié en 1956. « Ce livre, m’avait-il confié, est passé inaperçu jusque dans les années 1970, et soudain c’est devenu une source d’inspiration. Tout est une question de timing ». Voilà : une question de timing. C’est absolument vrai quand je repense à mon livre sur Challenger.
Notes
[1] Diane Vaughan, « Public Sociologist by Accident », Social Problems, vol. 51, n° 1, 2004, p. 103-130.
[2] Diane Vaughan, Controlling Unlawful Organizational Behavior : Social Structure and Corporate Misconduct, Chicago, University of Chicago Press, 1983.
[3] Diane Vaughan, « Uncoupling : The Process of Moving from One Lifestyle to Another », Alternative Lifestyle : Changing Patterns in Marriage, Family and Intimacy, vol. 2, Sage, 1979, p. 415-442.
[4] Diane Vaughan, Uncoupling : Turning Points in Intimate Relationships, Oxford, Oxford University Press, 1986.
[5] Brian Wynne, « Unruly Technology : Practical Rules, Impractical Discourses and Public Understanding », Social Studies of Science, vol. 18, n° 1, 1988, p. 147-167.
[6] Diane Vaughan, « The Role of the Organization in the Production of Techno-Scientific Knowledge », Social Studies of Science, vol. 29, n° 6, 1999, p. 913-943.
[7] Diane Vaughan, « The Dark Side of Organizations : Mistake, Misconduct, and Disaster », Annual Review of Sociology, vol. 25, 1999, p. 271-305.
[8] Malcolm Gladwell, « Blowup », The New Yorker, 22 janvier 1996.
[9] Voir Harry Collins, Martin Weinel et Robert Evans, « The politics and policy of the Third Wave : new technologies and society », Critical Policy Studies, vol. 4, n° 2, 2010, p. 185-201.
[10] Charles Perrow, Normal Accidents : Living with High-Risk Technologies, New York, Basic Books, 1984.
[11] Diane Vaughan, « The Role of Organization in the Production of Techno-Scientific Knowledge », Social Studies of Science, vol. 29, n° 6, 1999, p. 913-943.
[12] Harry Collins, Gravity’s Shadow : The Search for Gravitational Waves, Chicago, University of Chicago Press, 2004.
[13] Karin Knorr-Cetina, Epistemic Cultures : How the Sciences Make Knowledge, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1999.
[14] Donald MacKenzie, « The Credit Crisis as a Problem in the Sociology of Knowledge », American Journal of Sociology, vol. 116, n° 6, 2011, p. 1778-1841.
[15] Richard Whitley, The Intellectual and Social Organization of the Sciences, Oxford, Oxford University Press, 2000 [1984].
[16] Diane Vaughan, « Analogy, Cases, and Comparative Social Organization », in Richard Swedberg (ed.), Theorizing in Social Science, Stanford, Stanford University Press, 2014, p. 61-84.
[17] Voir aussi Diane Vaughan, « Theorizing disaster : Analogy, historical ethnography, and the Challenger accident », Ethnography, vol. 5, n° 3, 2004, p. 315-347.
[18] Barney Glaser et Anselm Strauss, The Discovery of Grounded Theory : Strategies for Qualitative Research, New Brunswick, Transaction Publishers, 1967.
[19] Diane Vaughan, « Bourdieu and Organizations : The Empirical Challenge », Theory and Society, vol. 37, n° 1, 2008, p. 65-81.
[20] Paul J. DiMaggio et Walter W. Powell, « The Iron Cage Revisited : Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields », American Sociological Review, vol. 48, n° 2, 1983, p. 147-160.
[21] Walter W. Powell et Paul DiMaggio (eds.), The New Institutionalism in Organizational Analysis, Chicago, University of Chicago Press, 1991.
[22] Ibid., p. 25-26.
[23] Voir notamment Arthur Stinchcombe, Constructing Social Theories, Chicago, University of Chicago Press, 1968.
[24] Lewis Coser, The Functions of Social Conflict, New York, The Free Press, 1956.
[25] Robert Jervis, The Logic of Images in International Relations, New York, Columbia University Press, 1969.
[26] Erving Goffman, Strategic Interaction, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1969.
[27] Diane Vaughan, Compte rendu de Robert Jervis, System Effects, Princeton University Press, 1998, Contemporary Sociology, vol. 29, n° 2, 2000, 425-427.
[28] Michael Burawoy, « Pour la sociologie publique », Actes de la recherche en sciences sociales, n° 176-177, 2009, p. 121-144. Pour une mise en perspective, voir Étienne Ollion, « Que faire de la sociologie publique ? », Actes de la recherche en sciences sociales, n° 176-177, 2009, p. 114-120.
[29] Mike Mullane l’utilise non sans la réviser : dans la conférence précédemment citée, il en fait une « tendance humaine naturelle » – « très humaine » – qui survient dans certaines circonstances et qui consiste à « accepter de baisser les standards de performance », des techniques comme des individus qui les exploitent, en ayant recours à des « raccourcis » pouvant compromettre la sûreté. C’est « très naturel », donc n’importe quel domaine d’activité exposé à des risques aigus est susceptible de « rationaliser » cette situation de telle sorte que la catastrophe ne manquera pas de survenir. Sur le site professionnel de Mike Mullane, chacun pourra se procurer le DVD de près d’une heure « Stopping Normalization of Deviance » (sous copyright) pour la somme de 750 dollars (http://mikemullane.com/product/stopping-normalization-of-deviance/, consulté le 23 mai 2017). (Note du traducteur)
[30] John Koblin, « A Third Party Names Their Split », The New York Times, 28 mars 2014. Plus tard, Gwyneth Paltrow niera avoir utilisé d’elle-même l’expression. La référence aurait été faite par des thérapeutes pour qualifier la séparation du couple. Il est piquant de noter que, en Angleterre, l’expression « customisée » de « conscious uncoupling » – qui s’inspire du processus décrit par Diane Vaughan – a suscité la dérision : le néologisme exprimerait la « psychophilie américaine » (Kunal Dutta, « Gwyneth Paltrow denies using phrase “conscious uncoupling” to describe split from Chris Martin », Independant, 3 août 2015). (Note du traducteur)
[31] Diane Vaughan, « NASA Revisited : Theory, Analogy, and Public Sociology », American Journal of Sociology, vol. 112, n° 2, 2006, p. 353-393.
[32] Diane Vaughan, « How Theory Travels : A Most Public Public Sociology », dossier « Public Sociology in Action », Footnotes, novembre-décembre 2003, http://www.asanet.org/sites/default/files/savvy/footnotes/nov03/fn7.html. Voir aussi Diane Vaughan, « How Theory Travels : Analogy, Models, and the Diffusion of Ideas », conférence donnée au congrès annuel de l’American Sociological Association, San Francisco, août 1998.
[33] « Michael Burawoy, For Public Sociology, Part 1 : Introduction », YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=8NxvPKGtkUQ. Voir également la version publiée de la conférence : Michael Burawoy, « For Public Sociology », American Sociological Review, vol. 70, n° 1, p. 4-28.
[34] « Michael Burawoy For Public Sociology, Part 3 : Thesis 2 & 3 », YouTube, en ligne : https://www.youtube.com/watch?v=Fdbix7b-iyQ, à partir de la huitième minute.
[35] Voir « Diane Vaughan Award Statement », 2006, http://www.asanet.org/news-and-events/member-awards/public-understanding-sociology-asa-award/diane-vaughan-award-statement.
[36] ASA Awards Ceremony and Presidential Address, 2006, https://vimeo.com/203499881.
[37] Voir également Diane Vaughan, « Public Sociologist by Accident », Social Problems, vol. 51, n° 1, 2004, p. 103-130.
Voir enfin:
Pourquoi certaines sociétés prennent-elles des décisions catastrophiques ?
LieuxCommuns
8 juin 2016
Chapitre éponyme (14) du livre de Jared Diamond, « Effondrement. Comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie » (2005, Gallimard 2006).
L’éducation est un processus qui implique deux groupes de participants supposés jouer des rôles différents : les enseignants, qui transmettent un savoir aux élèves, et les élèves, qui absorbent la connaissance qu’ils leur apportent. En réalité, comme chaque enseignant le découvre, l’éducation consiste aussi pour les élèves à transmettre des connaissances à leurs enseignants, à mettre au défi leurs présuppositions et à poser des questions auxquelles ils n’avaient pas pensé auparavant. J’en fis moi-même l’expérience à mon séminaire à l’université de Californie à Los Angeles (UCLA), où je testais la matière de ce livre auprès de mes étudiants. Lors des échanges, l’un d’entre eux me posa une question qui me laissa sans voix : que se dit à lui-même le Pascuan [habitant de l’île de Pâques] qui abattit le dernier arbre ? Les dommages infligés à l’environnement se font-ils en toute connaissance de cause ? Les étudiants se demandaient si – à supposer qu’il y ait encore des Terriens vivants dans cent ans – les hommes du XXIIe siècle seront aussi stupéfaits de notre aveuglement que nous le sommes de celui des habitants de l’île de Pâques.
Historiens et archéologues professionnels ne laissent pas d’être étonnés par les décisions catastrophiques qu’ont prises nombre de sociétés. Le livre peut-être le plus cité sur les effondrements de sociétés est dû à la plume de l’archéologue Joseph Tainter, The Collapse of Complex Societies ( 1990). Examinant les diverses interprétations possibles des effondrements anciens, Tainter se montre sceptique quant à l’hypothèse selon laquelle la cause en fut la diminution des ressources environnementales : « Cette conception présuppose que ces sociétés contemplent les risques sans mener d’actions correctrices. Les sociétés complexes se caractérisent par une prise de décision centralisée, des flux d’informations importants, une forte coordination de leurs différentes parties, des canaux de commandement formels et la mise en commun de leurs ressources. Cette structure semble avoir la capacité, voire le but délibéré, d’équilibrer les fluctuations et les déficiences de la productivité. Fortes de leur structure administrative et de la capacité à encadrer l’allocation du travail et des ressources, la gestion de l’adversité environnementale est sans doute l’une des choses que les sociétés complexes font le mieux. Il est curieux qu’elles se soient effondrées alors qu’elles étaient confrontées précisément à ces situations qu’elles étaient équipées pour circonvenir [ … ]. Lorsqu’il devient évident pour les membres ou les fonctionnaires d’une société complexe qu’une base de ressources se détériore, il semble plus raisonnable de supposer que des pas rationnels sont franchis pour trouver une solution. L’autre présupposé — l’idiotie en face du désastre — exige un acte de foi devant lequel on peut légitime ment hésiter. »
Tainter estimait donc qu’il est peu probable que les sociétés complexes puissent s’effondrer en vertu de l’échec de leur gestion des ressources environnementales. Et pourtant, il est clair, au vu de tous les cas analysés dans ce livre, que c’est précisément un tel échec qui s’est produit de façon répétée. Comment autant de sociétés ont-elles pu commettre d’aussi funestes erreurs ?
La question renvoie à un phénomène déconcertant : à savoir, des échecs dans la prise de décision en groupe de la part de sociétés tout entières ou d’autres groupes. Un problème lié assurément à celui des échecs intervenant dans la prise de décision individuelle, mais qui ne s’y résume pas. Des facteurs supplémentaires entrent en ligne de compte dans les échecs de la prise de décision en groupe – tels les conflits d’intérêts entre membres du groupe ou la dynamique de groupe, par exemple. Sujet complexe pour lequel il n’existe pas une seule et unique réponse adaptée à toutes les situations.
J’entends plutôt proposer, à partir des exemples plus amplement développés dans les chapitres précédents, un guide des facteurs qui contribuent à la prise de décision en groupe. Je regrouperai ces facteurs en quatre catégories souples. En premier, un groupe peut échouer à anticiper un problème avant qu’il ne survienne vraiment. Deuxièmement, lorsque le problème arrive, le groupe peut échouer à le percevoir. Ensuite, une fois qu’il l’a perçu, il peut échouer dans sa tentative pour le résoudre. Enfin, il peut essayer de le résoudre, mais échouer. Les analyses des raisons expliquant les échecs et les effondrements ne sont pas seulement déprimantes, elles ont aussi un revers : les décisions qui réussissent. Comprendre les raisons pour lesquelles les groupes prennent souvent de mauvaises décisions, c’est s’armer de connaissances pour mieux orienter les groupes à prendre de judicieuses décisions.
Premier chapitre de mon guide : les groupes peuvent causer des catastrophes parce qu’ils ne parviennent pas à anticiper un problème avant qu’il surienne, et ce pour plusieurs raisons. L’une est qu’ils peuvent ne pas avoir d’expérience antérieure de problèmes similaires et ne sont donc pas sensibilisés à la possibilité qu’ils adviennent.
Un exemple de choix est le désordre que les colons britanniques ont créé en introduisant les lapins et les renards en Australie dans les années 1800. Aujourd’hui, ce sont deux des exemples les plus désastreux de l’impact d’animaux sur un environnement où ils n’étaient pas présents à l’origine (voir chapitre 13). Ces introductions sont des plus tragiques parce qu’elles ont été menées à bien intentionnellement et moyennant beaucoup d’efforts ; elles ne résultent pas de minuscules semences transportées par inadvertance, comme dans beaucoup de cas de mauvaises herbes nocives. Les renards sont devenus les prédateurs de nombreuses espèces de mammifères primitifs australiens qu’ils ont exterminés parce que ceux-ci ne possédaient pas l’ expérience évolutionniste des renards, tandis que les lapins consomment une grande partie du fourrage destiné aux moutons et au bétail, concurrencent les mammifères herbivores autochtones et minent le terrain avec leurs terriers.
Rétrospectivement, nous considérons comme incroyablement stupide que les colons aient intentionnellement lâché en Australie deux espèces étrangères de mammifères dont la maîtrise, et non pas l’éradication, a exigé des milliards de dollars, après qu’elles ont causé des milliards de dollars de dégâts. Nous admettons aujourd’hui, en nous appuyant sur maints autres exemples de ce type, que ces introductions se révèlent souvent désastreuses pour des raisons inattendues. C’est pourquoi, lorsqu’on entre en Australie ou aux États-Unis comme visiteur ou comme résident rentrant chez lui, l’une des premières questions posées par les agents de l’immigration est de savoir si l’on transporte des plantes, des semences ou des animaux – afin de réduire le risque qu’ils s’échappent et s’établissent dans ces pays. Cette expérience antérieure nous a appris (souvent, mais pas toujours) à anticiper les périls potentiels que représente l’introduction de nouvelles espèces. Mais il est toujours difficile, même pour des écologues professionnels, de prédire quelles introductions réussiront, lesquelles se révéleront désastreuses et pourquoi la même espèce s’introduit en certains sites et pas en d’autres. Par conséquent, nous ne devrions pas être surpris par le fait que les Australiens du XIXe siècle, qui n’avaient pas notre expérience, n’ont pas réussi à anticiper les effets des lapins et des renards.
Dans nos enquêtes, nous avons rencontré d’autres exemples de sociétés n’ayant pas réussi à anticiper un problème faute d’en avoir l’expérience. Lorsqu’ils ont investi massivement dans la chasse au morse afin d’exporter de l’ivoire en Europe, les Norvégiens du Groenland ne pouvaient se douter que les croisades élimineraient à terme l’ivoire de morse en rouvrant aux Européens l’accès à l’ivoire d’éléphant d’Asie et d’Afrique ni que les glaces gêneraient les transports vers l’Europe. Sans scientifiques spécialistes des sols, les Mayas de Copàn ne pouvaient prévoir que la déforestation des pentes des collines déclencherait une érosion au détriment du fond des vallées.
Une expérience antérieure ne garantit pas nécessairement qu’une société anticipera un problème, pour peu que cette expérience ait été faite longtemps auparavant et qu’elle soit oubliée. C’est en particulier un problème pour les sociétés sans écriture, qui ont moins que les sociétés avec écriture la capacité à conserver les annales d’événements lointains : la transmission orale des informations est plus limitée que la transmission écrite. Nous avons vu au chapitre 4 que la société anasazi du Chaco Canyon a survécu à plusieurs sécheresses avant de succomber à la grande sécheresse du XIIe siècle après J.-C. Mais, faute de disposer de l’écriture et d’archives, les Anasazis du XIIe siècle n’avaient pas les acquis des mêmes épisodes climatiques antérieurs de plusieurs siècles. De même, les basses terres mayas de l’époque classique ont succombé à une sécheresse au IXe siècle, alors que cette même région avait été touchée par la sécheresse des siècles plus tôt (chapitre 5). Bien que les Mayas disposassent d’une écriture, celle-ci rapportait les hauts faits des rois et les événements astronomiques plutôt que la météorologie, de sorte que la sécheresse du IIIe siècle n’a été d’aucune aide pour anticiper celle du IXe.
Dans les sociétés modernes et contemporaines dont les écrits abordent d’autres questions que celles des rois et des planètes, cela n’implique pas nécessairement que les sociétés s’appuient sur leur expérience passée. Elles ont une tendance à l’oubli. Pendant les deux années qui suivirent les pénuries d’essence liées à la crise du pétrole du Golfe en 1973, les Américains se sont détournés des automobiles à forte consommation, puis ils ont oublié et font aujourd’hui bon accueil aux 4 x 4, malgré tout ce qui a été et est imprimé sur les événements de 1973. Lorsque la ville de Tucson, en Arizona, a connu une grave sécheresse dans les années 1950, ses citoyens en émoi ont juré leurs grands dieux qu’ils géreraient mieux leur eau, mais ils ont vite repris le gaspillage lié à la construction de parcours de golf et à l’arrosage des jardins.
Une autre raison expliquant l’échec d’une société à anticiper un problème tient au raisonnement par mauvaise analogie. Le raisonnement par analogie est pertinent si les situations ancienne et nouvelle sont vraiment de même type. Mais les similitudes peuvent n’être que de surface. Les Vikings qui ont émigré en Islande à partir de 870 après J.-C. venaient de Norvège et de Grande-Bretagne, pays dotés de sols lourds déposés par les glaciers et qui, même privés de leur couvert végétal, ne peuvent être emportés par l’érosion. Lorsque les colons vikings ont rencontré en Islande beaucoup d’espèces d’arbres qu’ils connaissaient déjà en Norvège et en Grande-Bretagne, ils ont été trompés par la similitude apparente du paysage (chapitre 6). Malheureusement, les sols islandais ne sont pas nés de l’usure glaciaire, mais de vents apportant des cendres légères soufflées par des éruptions volcaniques. Une fois que les Vikings ont défriché les forêts islandaises pour créer des pâturages pour leur cheptel, les sols légers ont été exposés au vent et une bonne partie des sols islandais de surface a été érodée.
La préparation de l’armée française à la Seconde Guerre mondiale est un célèbre exemple contemporain de raisonnement par mauvaise analogie. Après l’horrible bain de sang de la Première, la France a admis qu’il était vital pour elle de se protéger contre la possibilité d’une autre invasion allemande. Malheureusement, le haut commandement de l’armée a présupposé qu’une nouvelle guerre se livrerait de la même façon que la Première Guerre mondiale, au cours de laquelle le front Est entre la France et l’Allemagne s’est stabilisé par la guerre de tranchées. Les forces défensives d’infanterie avaient bâti des tranchées fortifiées sophistiquées et elles étaient parvenues à repousser les attaques d’infanterie, alors que les forces d’offensive n’avaient déployé les chars tout juste inventés que de façon individuelle et uniquement en soutien aux attaques de fantassins. Dès lors, la France a construit la ligne Maginot, un système encore plus sophistiqué et coûteux de fortifications. Le haut commandement allemand, vaincu lors de la Première Guerre mondiale, avait admis, lui, qu’une nouvelle stratégie s’imposait. Il utilisa des chars regroupés en divisions distinctes pour lancer des attaques éclairs, contourna la ligne Maginot en empruntant des forêts auparavant jugées impénétrables aux chars et occupa Paris en six semaines seulement. Raisonnant faussement par analogie avec la Première Guerre mondiale, l’état-major français commit une erreur très répandue : faire des plans pour la guerre à venir comme si c’était la répétition de la précédente, d’autant que cette dernière avait été remportée.
Deuxième chapitre de mon guide, après l’anticipation, le fait qu’une société peut percevoir ou non qu’un problème se pose vraiment. Il existe au moins trois raisons expliquant de tels échecs, toutes communes au monde des affaires et à l’Université.
Premièrement, les origines de certains problèmes ne peuvent littéralement pas être perçus. Par exemple, les nutriments responsables de la fertilité des sols sont invisibles à l’œil nu et on ne les mesure par des analyses chimiques que depuis l’époque contemporaine. En Australie, à Mangareva, dans certaines parties du Sud-Ouest américain et en bien d’autres lieux, la plus grande partie des nutriments avait déjà été lessivée et détachée des sols par suite des pluies avant que les hommes ne viennent s’établir. Quand les colons ont entrepris de faire pousser des cultures, celles-ci ont rapidement épuisé les nutriments qui restaient, de sorte que l’agriculture a été un échec. Et pourtant, ces sols pauvres en éléments nutritifs portaient souvent une végétation luxuriante en apparence, pour la raison que la plupart des nutriments de l’écosystème sont contenus dans la végétation plutôt que dans les sols. Les premiers colons d’Australie et de Mangareva n’avaient aucun moyen de percevoir ce problème d’ épuisement nutritif des sols par défrichement – non plus que les agriculteurs des régions salées en profondeur (comme l’est du Montana et certaines parties de l’Australie et de la Mésopotamie) ne pouvaient percevoir la salinisation en cours, non plus que certains mineurs·ne pouvaient percevoir que les eaux rejetées par les mines regorgeaient de cuivre et d’acide toxique dissous.
Une autre raison qui explique l’absence de perception d’un problème une fois qu’il se pose, c’est la distance des gestionnaires, le problème est potentiel dans toute société ou entreprise importante. Par exemple, la plus grande firme propriétaire terrienne et d’exploitation forestière au Montana aujourd’hui n’est pas basée dans l’État, mais à quatre cents kilomètres, à Seattle, dans l’État de Washington. Faute de proximité géographique, les cadres de l’entreprise peuvent ignorer un problème à ses commencements sur leurs propriétés forestières. Les entreprises bien gérées évitent de telles surprises en envoyant périodiquement des responsables « sur le terrain » pour observer ce qui s’y passe réellement. De même, si les Tikopiens vivant sur leur île minuscule et les montagnards de Nouvelle-Guinée dans leurs vallées ont réussi à gérer leurs ressources pendant plus de mille ans, c’est grâce à une connaissance exacte du territoire dans son entier dont dépend leur société.
La circonstance la plus répandue d’un échec de perception est celle d’une tendance lourde marquée par des fluctuations. Le réchauffement global en est l’exemple de choix à l’époque contemporaine. Nous comprenons désormais que les températures de par le monde ont monté au cours des décennies récentes, en grande partie du fait des changements atmosphériques causés par les hommes. Cependant, le climat n’a pas exactement augmenté de 0,01 degré par an. Il fluctue de façon erratique d’une année sur l’autre : trois degrés de plus un été que le précédent, deux degrés de plus l’été suivant, quatre degrés de moins le suivant, un degré de moins encore le suivant, puis cinq degrés de plus, etc. Compte tenu de ces fluctuations importantes et imprévisibles, il a fallu longtemps pour discerner la tendance moyenne à la hausse de 0,01 degré. C’est pourquoi la plupart des climatologues professionnels, auparavant sceptiques quant à la réalité du réchauffement global, ne sont convaincus que depuis quelques années. À l’époque où j’écris ces lignes, le président George W. Bush n’était toujours pas convaincu de sa réalité et il estime qu’il faut poursuivre les recherches. À l’époque médiévale, les habitants du Groenland éprouvaient de semblables difficultés à admettre que leur climat se refroidissait progressivement, et les Mayas et les Anasazis à discerner que le leur devenait plus sec.
Les hommes politiques parlent de « normalité rampante » pour désigner ce type de tendances lentes œuvrant sous des fluctuations bruyantes. Si l’économie, l’école, les embouteillages ou toute autre chose ne se détériorent que lentement, il est difficile d’admettre que chaque année de plus est en moyenne légèrement pire que la précédente ; les repères fondamentaux quant à ce qui constitue la « normalité » évoluent donc graduellement et imperceptiblement. Il faut parfois plusieurs décennies au cours d’une séquence de ce type de petits changements annuels avant qu’on saisisse, d’un coup, que la situation était meilleure il y a plusieurs décennies et que ce qui est considéré comme normal a de fait atteint un niveau inférieur.
Une autre dimension liée à la normalité rampante est l’ « amnésie du paysage » : on oublie à quel point le paysage alentour était différent il y a cinquante ans, parce que les changements d’année en année ont été eux aussi graduels. La fonte des glaciers et des neiges du Montana causée par le réchauffement global en est un exemple (chapitre 1). Adolescent, j’ai passé les étés 1953 et 1956 à Big Hole Basin dans le Montana et je n’y suis retourné que quarante-deux plus tard en 1998, avant de décider d’y revenir chaque année. Parmi mes plus vifs souvenirs du Big Hole, la neige qui recouvrait les sommets à l’horizon même en plein été, mon sentiment qu’une bande blanche bas dans le ciel entourait le bassin. N’ayant pas connu les fluctuations et la disparition graduelle des neiges éternelles pendant l’intervalle de quarante-deux ans, j’ai été choqué et attristé lors de mon retour à Big Hole en 1998 de ne plus retrouver qu’une bande blanche en pointillés, voire plus de bande blanche du tout en 2001 et en 2003. Interrogés sur ce changement, mes amis du Montana s’en montrent moins conscients : sans chercher plus loin, ils comparaient chaque année à son état antérieur de l’année d’avant. La normalité rampante ou l’amnésie du paysage les empêchaient, plus que moi, de se souvenir de la situation dans les années 1950. Un exemple parmi d’autres qui montre qu’on découvre souvent un problème lorsqu’il est déjà trop tard.
L’amnésie du paysage répond en partie à la question de mes étudiants : qu’a pensé l’habitant de l’île de Pâques qui a coupé le dernier palmier ? Nous imaginons inconsciemment un changement soudain : une année, l’île était encore recouverte d’une forêt de palmiers parce qu’on y produisait du vin, des fruits et du bois d’œuvre pour transporter et ériger les statues ; puis voilà que, l’année suivante, il ne restait plus qu’un arbre, qu’un habitant a abattu, incroyable geste de stupidité autodestructrice. Il est cependant plus probable que les modifications dans la couverture forestière d’année en année ont été presque indétectables : une année quelques arbres ont été coupés ici ou là, mais de jeunes arbres commençaient à repousser sur le site de ce jardin abandonné. Seuls les plus vieux habitants de l’île, s’ils repensaient à leur enfance des décennies plus tôt, pouvaient voir la différence. Leurs enfants ne pouvaient pas plus comprendre les contes de leurs parents, où il était question d’une grande forêt, que mes fils de dix-sept ans ne peuvent comprendre aujourd’hui les contes de mon épouse et de moi-même, décrivant ce qu’était Los Angeles il y a quarante ans. Petit à petit, les arbres de l’île de Pâques sont devenus plus rares, plus petits et moins importants. À l’époque où le dernier palmier portant des fruits a été coupé, cette espèce avait depuis longtemps cessé d’avoir une signification économique. Il ne restait à couper chaque année que de jeunes palmiers de plus en plus petits, ainsi que d’autres buissons et pousses. Personne n’aurait remarqué la chute du dernier petit palmier. Le souvenir de la forêt de palmiers des siècles antérieurs avait succombé à l’amnésie du paysage. À l’opposé, la vitesse avec laquelle la déforestation s’est répandue dans le Japon des débuts de l’ère Tokugawa a aidé les shoguns à identifier les changements dans le paysage et la nécessité d’actions correctives.
Le troisième chapitre de mon guide des échecs est le plus nourri, car traitant d’une situation la plus courante : souvent les sociétés échouent même à résoudre un problème qu’elles ont perçu.
Beaucoup des raisons tiennent à ce que les économistes et d’autres spécialistes de sciences sociales appellent le « comportement rationnel », fruit de conflits d’intérêts. Certains individus, par raisonnement, concluent qu’elles peuvent favoriser leurs intérêts en adoptant un comportement qui est, en réalité, dommageable à d’autres mais que la loi autorise de fait ou par non-application. Ils se sentent en sécurité parce qu’ils sont concentrés (peu nombreux) et très motivés par la perspective de réaliser des profits importants, certains et immédiats, alors que les pertes se distribuent sur un grand nombre d’individus. Cela donne aux perdants peu de motivation pour se défendre, parce que chaque perdant perd peu et n’obtiendrait que des profits réduits, incertains et lointains, quand bien même réussissait-il à défaire ce que la minorité a accompli. C’est le cas, par exemple, des subventions à effets pervers : ces budgets que les gouvernements dépensent pour soutenir des activités qui ne seraient pas rentables sans ces aides, comme la pêche, la production de sucre aux États-Unis et celle du coton en Australie (subventionnées indirectement par le gouvernement qui supporte les coûts liés à l’irrigation). Les pêcheurs et les cultivateurs peu nombreux font pression avec ténacité pour obtenir les subventions qui représentent une bonne part de leurs revenus, tandis que les perdants – tous les contribuables – se font moins entendre parce que la subvention concernée n’est financée que par une petite fraction des impôts acquittée par les contribuables. Les mesures bénéficiant à une petite minorité aux dépens d’une large majorité sont en particulier susceptibles d’être prises dans certains types de démocraties où le pouvoir de faire pencher la balance repose sur certains petits groupes : par exemple, les sénateurs des petits États au Sénat américain ou les petits partis religieux en Israël, à un degré par ailleurs inenvisageable dans le système parlementaire hollandais.
Un type fréquent de comportement rationnel pervers est de l’ordre de l’égoïsme. Prenons un exemple simple. La plupart des pêcheurs du Montana pêchent la truite. Quelques-uns préfèrent pêcher le brochet, gros poisson carnivore qui n’existe pas naturellement dans l’ouest du Montana, mais a été introduit subrepticement et illégalement dans certains lacs et rivières de cette contrée. Il y a ruiné la pêche à la truite, suite à la disparition des truites. Or les pêcheurs de brochets sont moins nombreux que ne l’étaient les pêcheurs de truites.
Nous avons un autre exemple engendrant plus de perdants et des pertes financières plus importantes : jusqu’en 1971, les compagnies minières du Montana, lorsqu’elles fermaient une mine, laissaient son cuivre, son arsenic et son acide s’écouler dans les rivières, faute de législation de l’État pour les contraindre à nettoyer les sites. En 1971, une telle loi a été promulguée. Les entreprises ont·alors découvert qu’elles pouvaient extraire le minerai de valeur, puis se déclarer en faillite avant d’avoir à assumer les coûts d’un nettoyage. Résultat : les citoyens du Montana ont dû acquitter cinq cents millions de dollars de frais de nettoyage, alors que les sociétés minières n’ont eu qu’à engranger leurs profits. D’innombrables autres exemples de comportements de ce type dans le monde des affaires pourraient être cités, mais il n’est pas aussi universel que certains· cyniques le soupçonnent. Au chapitre suivant, nous verrons dans quelle mesure ces comportements résultent de l’impératif, pour les entreprises, de gagner de l’argent dans le cadre autorisé par les règlements de l’État, le droit et la demande du public.
Une forme particulière de conflit d’intérêts est connue sous le nom de « tragédie des communs », laquelle est intimement liée aux conflits appelés « dilemme du prisonnier » et « logique de l’action collective ». Prenez une situation dans laquelle beaucoup de consommateurs récoltent une ressource qu’ils possèdent en commun, tels des pêcheurs qui prennent du poisson dans une zone de l’océan ou des bergers qui font paître leurs moutons sur un pâturage commun. Si chacun surexploite la ressource concernée, elle diminuera par surpêche ou surpâturage et finira par disparaître. Tous les consommateurs en souffriront. Il serait donc dans l’intérêt commun de tous les consommateurs d’exercer une contrainte et de ne pas surexploiter cette ressource. Mais tant qu’il n’existe pas de régulation efficace fixant la quantité de la ressource que chaque consommateur pourra récolter, chaque consommateur a raison de se dire : « Si je n’attrape pas ce poisson ou si je ne laisse pas mes moutons brouter cette herbe, un autre pêcheur ou un autre berger le fera ; je n’ai donc pas de raison de me retenir de surpêcher ou de surrécolter. » Le comporte ment rationnel correct consiste ici à récolter avant que l’autre consommateur puisse le faire, même si cela peut avoir pour résultat la destruction des biens communs, et donc nuire à tous les consommateurs.
En réalité, alors que cette logique a conduit nombre de biens communs à être surexploités et détruits, d’autres ont été préservés pendant des centaines, voire des milliers d’années. Parmi les conséquences malheureuses, on trouve la surexploitation et la disparition de la plupart des grandes zones de pêche et l’extermination de la grande faune (gros mammifères, oiseaux et reptiles) sur chaque île océanique ou continent colonisé par les humains pour la première fois au cours des cinquante mille dernières années. Les conséquences heureuses comprennent la préservation de nombreuses zones de pêche locales, de forêts, de sources d’eau, comme les zones de pêche à la truite et les systèmes d’irrigation du Montana que j’ai décrits au chapitre 1. La chose est aisément explicable par trois types différents de dispositions qui ont évolué pour préserver une ressource commune tout en permettant une récolte durable.
Une solution évidente consiste pour le gouvernement ou une autre force extérieure à intervenir, avec ou sans l’invitation des consommateurs, et à imposer des quotas, comme le shoghun et le daimyo dans le Japon des Tokugawas, les empereurs incas dans les Andes et les princes et les propriétaires terriens de l’Allemagne du XVIe siècle l’ont fait pour la coupe de bois. Cependant, la chose n’est pas possible dans certaines situations (par exemple, une île en plein océan) et cela implique des coûts d’administration et de police excessifs dans d’autres situations. Une deuxième solution consiste à privatiser la ressource, c’est-à-dire à la diviser en lots individuels que chaque propriétaire sera motivé à gérer avec prudence dans son propre intérêt. Cette pratique a été appliquée dans certaines forêts possédées par des villages dans le Japon des Tokugawas. Cependant, là encore, certaines ressources (comme les animaux et le poisson migrateur) sont impossibles à subdiviser et les propriétaires individuels peuvent éprouver encore plus de difficultés que les gardes-côtes ou la police publique à refouler les intrus.
Face à la tragédie des communs , la solution qui demeure consiste pour les consommateurs à reconnaître leurs intérêts communs et à imaginer, suivre et imposer eux-mêmes des quotas de récolte prudents. Cela n’est possible que si toute une série de conditions sont satisfaites : les consommateurs forment un groupe homogène ; ils ont appris à se faire confiance et à communiquer entre eux ; ils comptent avoir un avenir commun et transmettre la ressource concernée aux jeunes générations ; ils ont la capacité, ou la permission, de s’organiser et de se surveiller eux-mêmes, et on le leur permet ; les frontières de la ressource et de son ensemble de consommateurs sont bien définies. Le cas des droits s l’eau pour l’irrigation au Montana, analysé au chapitre 1, en est un bon exemple. Alors que l’attribution de ces droits a force de loi écrite, les ranchers obéissent surtout au délégué à l’eau qu’ils ont élu et ils ne tranchent plus leurs litiges devant les tribunaux. Parmi les autres exemples de groupes homogènes gérant avec prudence les ressources qu’ils veulent transmettre à leurs enfants, on trouve les habitants de l’île de Tikopia, les montagnards de Nouvelle-Guinée, les membres de castes indiennes et d’autres groupes analysés au chapitre 9. Ces petits groupes, avec les Islandais (chapitre 6) et les Japonais de l’ère Tokugawa, qui forment des groupes plus importants, ont de plus été motivés à parvenir à un accord par leur isolement de fait : il était évident pour tout le groupe qu’il ne survivrait que grâce à ses ressources dans un avenir proche. De tels groupes savaient qu’ils ne pouvaient invoquer l’excuse classique ( « ce n’est pas mon problème ») pour justifier leur mauvaise gestion.
Des conflits d’intérêts impliquant un comportement rationnel peuvent advenir lorsque, au contraire de la société dans son ensemble, le principal consommateur n’a pas intérêt à long terme à préserver la ressource concernée. Par exemple, une bonne part de l’exploitation commerciale de la forêt tropicale humide est aujourd’hui assurée par des compagnies forestières internationales, lesquelles en général signent des baux à court terme dans un pays, coupent la forêt sur tout le terrain qu’elles ont loué, puis vont dans un autre pays. Les bûcherons ont bien vu qu’une fois qu’ils ont payé le loyer de leur location, il est de leur intérêt de couper les forêts aussi vite que possible, de ne pas tenir leur promesse de reforestation et de s’en aller. C’est ainsi qu’ils ont détruit la plus grande partie des forêts des basses terres de la péninsule de Malaisie, puis de Bornéo, puis des îles Salomon et de Sumatra, maintenant des Philippines, et bientôt de la Nouvelle-Guinée, de l’Amazonie et du bassin du Congo. Ce qui est bon pour les bûcherons est mauvais pour la population locale, qui perd sa source de produits forestiers et doit subir les conséquences de l’érosion des sols et de la sédimentation. C’est mauvais aussi pour le pays d’accueil dans son ensemble, qui perd ainsi une part de sa biodiversité ·et de la possibilité de se doter d’une activité forestière durable. Ce conflit d’intérêts résultant de la location de terres à court terme contraste avec les résultats fréquemment obtenus lorsque les sociétés forestières possèdent la terre, car alors elles anticipent des récoltes répétées et -tout comme la population locale et le pays ont intérêt à adopter une perspective à long terme. Dans les années 1920, les paysans chinois ont noté un contraste similaire quand ils ont évalué les avantages comparés de l’exploitation par deux types différents de seigneurs de la guerre. Il était dur d’être exploité par un « bandit à demeure », un seigneur de la guerre implanté localement, mais il laissait au moins aux paysans assez de ressources pour qu’ils lui procurent plus de butin dans les années à venir. Le pire était d’être exploité par un « bandit errant », un seigneur de la guerre qui, telle une compagnie forestière louant des terres à court terme, ne laissait rien aux paysans d’une région et s’en allait seulement piller ceux d’une autre.
Le comportement rationnel peut également dicter à des élites repliées dans leur sphère des décisions nuisibles au reste de la société à l’écart de laquelle elles se maintiennent.
On en a vu, au cours de notre enquête, des exemples divers – la dictature Trujillo en République dominicaine, ou les élites possédantes en Haïti, ou bien encore la politique foncière des zones de résidences huppées sous haute protection sécuritaire aux États-Unis. Il n’y a guère, Barbara Tuchman dressait dans The March of Folly [1] la longue liste des décisions politiques qui, de la guerre de Troie à la guerre du Viêt Nam, furent causes de catastrophes. Il ne faisait, à ses yeux, aucun doute que « la plus importante des forces qui affectent la sottise politique, c’est la soif du pouvoir que Tacite a appelée ’la plus flagrante de toutes les passions’ ». C’est ce même désir que nous avons vu à l’ œuvre chez les chefs de l’île de Pâques ou les rois mayas : elle les poussa, par la rivalité mimétique, à ériger des statues et des monuments toujours plus élevés. Tout chef ou roi qui aurait construit des statues ou des monuments de moindre dimension afin d’épargner les forêts aurait perdu son prestige, donc son rang, et par conséquent sa fonction. La compétition pour le prestige fait rarement bon ménage avec la vision à long terme.
A l’inverse, l’immersion de l’élite dans la société oblige les dirigeants à être conscients des effets de leurs actions. Nous verrons au dernier chapitre que la forte conscience environnementale des Hollandais – y compris celle de leurs hommes politiques – tient au fait qu’une bonne partie de la population, dirigeants et dirigés, vit sur des terres situées en dessous du niveau de la mer, et que tous partagent les mêmes risques en cas de mauvaise gestion des digues. De même, les grands hommes de Nouvelle-Guinée en zone montagnarde vivent dans le même type de huttes que les hommes sans qualité, vont avec ces derniers piocher du bois à brûler et du bois d’œuvre dans les mêmes endroits et sont ainsi très motivés pour élaborer une activité forestière durable (chapitre 9).
D’autres échecs s’expliquent par le « comportement irrationnel », c’est-à-dire le comportement dommageable non plus à certains ni à la majorité, mais. à tous. Un tel comportement irrationnel survient souvent quand chacun, individuellement, est travaillé par un conflit de valeurs : on veut ignorer un mauvais statu quo parce qu’il résulte de l’application des valeurs auxquelles on tient profondément. « La persistance dans l’erreur », « le raidissement », « le refus de tirer les conclusions qui s’imposent à partir de signes négatifs », « l’immobilisme, la stagnation mentale » sont les causes que Barbara Tuch man recense. Les psychologues, eux, parlent d’ « effet de ruine » pour désigner un trait voisin : l’hésitation à abandonner une politique – ou à vendre une action – dans laquelle il a été déjà beaucoup investi.
Certaines motivations irrationnelles courantes tiennent au fait que l’opinion peut ne pas apprécier ceux qui perçoivent un problème les premiers et le dénoncent – comme le parti vert de Tasmanie qui a le premier protesté contre l’introduction de renards en Tasmanie. Ou bien, les avertissements peuvent ou non être entendus du fait de mises en garde antérieures qui se sont révélées de fausses alertes. Ou bien encore, l’opinion peut décider de n’avoir tout simplement pas d’avis sur la question.
Mais il est un facteur clé : les valeurs religieuses. Profondément implantées, elles sont donc de fréquentes causes de comportement désastreux. Par exemple, une bonne partie de la déforestation dans l’île de Pâques résultait d’une motivation religieuse : il fallait disposer de troncs d’arbres pour transporter et ériger les statues géantes de pierre qui étaient des objets de vénération. Au même moment, mais à six mille kilomètres de là et dans l’autre hémisphère, les Norvégiens du Groenland suivaient simplement leurs valeurs chrétiennes. Ces mêmes valeurs qui leur permirent de survivre pendant des siècles les empêchèrent d’opérer des changements drastiques dans leur style de vie et d’adopter certaines technologies inuits qui les auraient aidés à survivre plus long temps.
Le monde moderne et contemporain nous offre de nombreux exemples d’admirables valeurs profanes auxquelles nous tenons par-dessus tout alors qu’elles n’ont plus de sens. Les Australiens ont apporté de Grande-Bretagne la tradition d’élever des moutons pour la laine, des valeurs rurales fortes et une identiication à la Grande-Bretagne ; ils ont ainsi réalisé l’exploit de bâtir une démocratie digne du Premier Monde loin de toute autre (à l’exception de la Nouvelle-Zélande) ; aujourd’hui, ils commencent cependant à découvrir que ces valeurs ont aussi un revers. Si les habitants du Montana ont tant répugné à résoudre leurs problèmes causés par les mines, l’exploitation forestière et les ranches, c’est parce que ces trois activités, piliers de l’économie du Montana, étaient liées à l’esprit pionnier et à l’identité de cet État. L’attachement des pionniers à la liberté individuelle et à l’autosuffisance les ont empêchés longtemps d’admettre que désormais ils avaient besoin de planification publique et de contrepoids aux droits individuels. La détermination de la Chine communiste à ne pas répéter les erreurs du capitalisme l’a conduite à mépriser le souci de l’environnement : on sait où cela l’a conduite. L’idéal rwandais des grandes familles était adapté à l’époque traditionnelle où la mortalité infantile était élevée, mais il a conduit aujourd’hui à une désastreuse explosion démographique. Il me semble qu’une bonne part de l’opposition rigide que rencontre le souci pour l’environnement dans le Premier Monde s’explique par des valeurs acquises il y a longtemps et jamais réexaminées. Ce qu’en d’autres termes Barbara Tuchman décrit comme la préservation par « des dirigeants ou responsables politiques [des] idées avec lesquelles ils ont commencé leur carrière ».
Concernant ses valeurs fondamentales, jusqu’à quel point un individu préfère-t-il mourir plutôt que de faire des compromis et vivre ? Des millions de gens, à l’époque contemporaine, ont été confrontés à la décision de savoir si, pour sauver leur vie, ils seraient ou non disposés à trahir leurs amis ou leurs proches, à complaire à un dictateur, à vivre en esclavage ou à préférer l’exil. Les nations et les sociétés ont parfois à prendre collectivement des décisions similaires.
Toutes ces décisions impliquent ·des paris sur l’avenir, faute de la certitude que la perpétuation de certaines valeurs conduise à l’échec et leur préservation au succès. En tentant de continuer à être des agriculteurs chrétiens, les Norvégiens du Groenland ont préféré mourir en tant que tels plutôt que de vivre comme des Inuits ; ils ont perdu leur pari. Parmi les cinq petits pays d’Europe de l’Est confrontés à la puissance irrésistible des armées russes, les Estoniens, les Lettons et les Lituaniens ont renoncé à leur indépendance en 1939 sans combattre, alors que les Finlandais se sont battus en 1939-1940 et ont sauvegardé leur indépendance ; les Hongrois, eux, se sont battus en 1956 et ils ont été défaits. Qui d’entre nous peut dire quel pays a été plus sage ? Qui d’entre nous aurait pu prévoir que seuls les Finlandais gagneraient leur pari ?
Peut-être une clé du succès ou de l’échec pour une société est-elle de savoir à quelles valeurs fondamentales se tenir et lesquelles écarter, voire remplacer par de nouvelles. Au cours des soixante dernières années, des pays parmi les plus puissants ont renoncé à certaines valeurs qui paraissaient centrales dans leur image nationale : la Grande-Bretagne et la France ont renoncé à leur rôle centenaire de puissances mondiales agissant de façon indépendante ; le Japon a renoncé à sa tradition militaire et à ses forces armées ; et la Russie a abandonné sa longue expérience du communisme. Les États-Unis ont abandonné en substance – mais pas complètement – leurs anciennes valeurs de discrimination raciale légale, d’homophobie légale, de subordination des femmes et de répression sexuelle. L ’Australie révise aujourd’hui son statut de société. rurale agricole structurée par une identité britannique. Se pourrait-il que les sociétés qui réussissent soient celles qui ont le courage de prendre ces décisions difficiles et ont la chance de gagner leurs paris ?
Beaucoup d’échecs en partie irrationnels s’expliquent par le conflit entre des motivations à court terme et à long terme chez le même individu. Les paysans rwandais et haïtiens, ainsi que des milliards d’autres gens dans le monde aujourd’hui, sont désespérément pauvres et ne pensent qu’à la façon dont ils vont se nourrir le lendemain. Les pêcheurs pauvres des récifs tropicaux se servent de dynamite et de cyanure pour tuer les poissons du récif (et incidemment détruire les récifs eux-mêmes) afin de nourrir leurs enfants aujourd’hui, tout en sachant que, ce faisant, ils ravagent leur cadre de vie futur. Des économistes justifient rationnellement ce souci exclusif des profits à court terme en arguant qu’il peut être de meilleur aloi de récolter une ressource aujourd’hui que demain, dès lors que les profits d’aujourd’hui peuvent être investis et que les intérêts de cet investissement entre aujourd’hui et demain tendent à rendre la récolte d’aujourd’hui plus valable que celle de demain. Quitte à ce que les conséquences néfastes soient supportées par la génération à venir, qui, par définition, n’est pas encore ici pour faire droit à une prospective à long terme.
D’autres facteurs interviennent dans les prises de décision irrationnelles. Irving Janis étudie la « pensée de groupe », forme moins prégnante et à petite échelle de la psychologie des foules, et qui peut apparaître dans un groupe de décideurs. En particulier lorsqu’un petit groupe soudé (comme les conseillers du président Kennedy pendant la crise de la baie des Cochons ou ceux du président Johnson lors de l’escalade de la guerre du Viêt Nam) essaie de parvenir à une décision dans des circonstances de stress où le besoin de soutien et d’approbation mutuels peuvent conduire à annihiler les doutes et la pensée critique, à partager des illusions, à parvenir à un consensus prématuré et finalement à prendre une décision catastrophique. La pensée de groupe – et la psychologie des foules – peut opérer sur des périodes qui ne sont pas seulement de quelques heures, mais parfois de quelques années ; toutefois, on ignore encore quelle est leur part dans des décisions catastrophiques concernant des problèmes d’environnement de longue durée (décennies ou siècles).
La dernière raison spéculative que je mentionne rai pour expliquer l’échec irrationnel dans les tentatives menées pour résoudre un problème que l’on perçoit est le déni d’origine psychologique. Si une chose perçue suscite en vous une émotion douloureuse, elle sera inconsciemment supprimée ou niée afin d’éviter cette douleur, angoisse ou peur, quitte à ce que le déni conduise à des décisions désastreuses.
Dans le domaine qui nous concerne, prenons l’exemple d’une étroite vallée sinistrée juste derrière un grand barrage. Que le barrage vienne à se rompre, l’eau emportera les habitants sur une distance considérable en aval. Quand on sonde l’opinion qui vit en aval du barrage sur sa crainte d’une éventuelle rupture, cette peur est moindre en aval, elle augmente au fur et à mesure qu’on s’approche, atteint son paroxysme à quelques kilomètres du barrage, puis décroît brutalement et tend vers zéro parmi les habitants les plus proches du barrage ! Autrement dit, ces derniers, qui sont les plus certains d’être inondés en cas de rupture, disent d’une certaine manière ne pas être concernés. Ce déni d’origine psychologique est leur seule façon de vivre dans une normalité quotidienne. Le déni d’origine psychologique est un phénomène bien attesté dans la psychologie individuelle, mais il semble s’appliquer aussi à la psychologie des groupes.
Enfin, dernier chapitre de mon catalogue, le cas où une société échoue à résoudre un problème perçu, voire anticipé : le problème peut être au-delà de nos capacités présentes de résolution, une solution peut exister, mais être trop coûteuse, ou bien encore nos ·efforts peuvent être trop minimes ou trop tardifs. Certaines solutions tentées ont un effet de retour qui fait empirer le problème, telle l’introduction de crapauds en Australie pour contrôler les insectes nuisibles ou la suppression des feux de forêts dans l’Ouest américain. Maintes sociétés du passé (comme l’Islande médiévale) n’avaient pas les connaissances écologiques détaillées qui nous permettent désormais de mieux faire face aux problèmes auxquels elles étaient confrontées. Mais certains de ces problèmes continuent aujourd’hui à résister à toute solution.
Au chapitre 8, nous avons vu qu’au Groenland, ces cinq derniers mille ans, le climat froid et les ressources limitées et variables ont conduit à l’échec quatre vagues successives de chasseurs-cueilleurs américains puis des Norvégiens. Les Inuits sont parvenus à vivre en autosuffisance au Groenland pendant sept cents ans, mais leur vie était dure et ils mouraient souvent de faim. Les Inuits contemporains ne sont plus prêts à subsister de façon traditionnelle avec des outils de pierre, des traîneaux et la pêche à la baleine au harpon : ils importent des technologies et de la nourriture. Le gouvernement du Groenland n’a pas encore développé une économie qui soit indépendante de l’aide étrangère malgré le choix de l’élevage du bétail et les subventions aux éleveurs de moutons. On comprend mieux dès lors l’échec final des Norvégiens. De même, l’échec final des Anasazis ·dans le sud-ouest des États-Unis doit être considéré à la lumière de beaucoup d’autres tentatives qui ont finalement échoué pour établir des sociétés rurales durables dans un environnement hostile à l’agriculture.
Parmi les problèmes les plus récurrents aujourd’hui, on trouve ceux que posent les espèces nuisibles, qui se révélèrent souvent impossibles à éradiquer ou à contrôler une fois introduites. Par exemple, l’État du Montana continue à dépenser plus de cent millions de dollars par an pour combattre des mauvaises herbes qui ont été introduites. Non pas parce que le Montana n’a rien fait pour les éradiquer, mais tout simplement parce que ces mauvaises herbes sont impossibles à éradiquer à l’heure actuelle. Certaines. ont des racines trop profondes pour qu’on les arrache à la main et les désherbants chimiques spécifiques coûtent cher. L’Australie a tenté les haies, les renards, la chasse, les bulldozers et le virus de la myxomatose ou le virus Calici pour maîtriser les lapins, lesquels ont pour l’instant résisté à toutes ces offensives.
Le problème catastrophique des incendies de forêts dans les parties sèches de l’Ouest montagneux des États-Unis pourrait sans doute être maîtrisé grâce à des techniques de gestion, comme l’élagage mécanique des sous-bois et l’enlèvement du bois mort, visant à réduire ce qui peut brûler. Malheureusement, la mise en œuvre de cette solution sur une grande échelle est considérée comme prohibitive. Le destin du moineau de Floride illustre également l’échec dû aux coûts estimés et à la procrastination qui s’ensuit : trop peu, trop tard. L’habitat de ce moineau se réduisant, toute action a été repoussée le temps que l’on établisse si vraiment il diminuait à un point critique. Lorsque l’Office américain du poisson et de la faune sauvage a décidé à la fin des années 1980 d’acheter l’habitat restant pour le coût élevé de cinq millions de dollars, il était si dégradé que les moineaux moururent. Une polémique fit alors rage pour savoir si l’on devait accoupler les derniers spécimens en captivité avec d’autres, assez proches, puis en obtenir de plus purs en croisant les hybrides ainsi obtenus. Lorsque l’autorisation fut finalement accordée, les derniers moineaux captifs étaient devenus infertiles du fait de leur âge avancé. L’effort pour préserver l’habitat et pour accoupler les oiseaux captifs aurait été moins coûteux et davantage couronné de succès s’il avait été entrepris plus tôt.
En ouverture à ce chapitre, il y avait l’étonnement de mes étudiants et le refus de Joseph Tainter de croire qu’une société pouvait choisir l’échec. Au moment de conclure, il nous apparaît que nous sommes à l’extrême inverse : il y a quantité de raisons qui expliquent l’échec des sociétés. Mais le fait que nous soyons, moi, en train de rédiger et, vous, de lire cet ouvrage prouve que l’échec n’est pas notre destinée inéluctable. Au chapitre 9, nous avons analysé nombre de succès.
Si certaines sociétés réussissent tandis que d’autres échouent, la raison en est évidemment dans les différences entre les environnements plutôt qu’entre les sociétés. Certains environnements posent des problèmes plus difficiles que d’autres. Par exemple, le Groenland froid et isolé posait un plus grand défi que le sud de la Norvège, dont provenaient beaucoup de colons du Groenland. De même, l’île de Pâques, qui est sèche, isolée, de latitude élevée et plate, représentait pour ses colons un plus grand défi que Tahiti, humide, moins isolée, équatoriale et élevée, d’où étaient originaires des ancêtres des habitants de l’île de Pâques. Mais ce n’est que la moitié de l’histoire. Si j’affirmais que ces différences environnementales représentent la seule raison de l’échec ou de la réussite des sociétés, il serait juste de m’accuser de « déterminisme environnemental »,conception peu à l’honneur chez les spécialistes des sciences sociales. En réalité, si les conditions environnementales rendent sans doute plus difficile le maintien des sociétés humaines dans certains milieux plutôt que dans d’autres, les raisons de la réussite ou de l’échec tiennent aussi aux choix qu’opère une société.
Par exemple, pourquoi l’Empire inca a-t-il réussi à reboiser son environnement sec et froid, mais pas les habitants de l’île de Pâques ni les Norvégiens du Groenland ? La réponse dépend en partie des idiosyncrasies des individus et met au défi toute prédiction. Je crois cependant qu’une meilleure intelligence des causes potentielles d’échec recensées dans cette enquête peut aider les décideurs à en prendre conscience et à les éviter.
Un exemple frappant de l’usage d’une bonne compréhension d’une crise antérieure nous est donné par les crises consécutives mais contrastées impliquant Cuba et les États-Unis. Chaque crise donne lieu à des discussions entre le président Kennedy et ses conseillers. Début 1961, ils versent dans la pensée de groupe, et prennent donc la décision catastrophique de lancer l’invasion de la baie des Cochons, qui est un échec humiliant, et conduit à la crise bien plus dangereuse des missiles cubains. Irving Janis, dans Groupthink : Psychological Studies of Policy Decisions and Fiascoes, montre que les délibérations sur l’ expédition dans la baie des Cochons présentent toutes les caractéristiques, ou presque, de la prise de mauvaises décisions : sentiment prématuré d’unanimité, annihilation des doutes personnels et empêchement de l’expression de visions opposées, meneur – Kennedy – dirigeant la discussion de façon à minimiser les désaccords. En 1962, les délibérations sur la crise des missiles impliquent Kennedy et nombre des mêmes conseillers, mais elles suivent un processus inverse et débouchent sur des décisions fructueuses : Kennedy ordonne aux participants de penser avec scepticisme, il autorise la libre discussion, il rencontre séparément les sous-groupes et quitte parfois la salle pour éviter de trop influencer lui-même la discussion.
Au cours de ces deux crises cubaines, la prise de décision est différente en grande partie parce que Kennedy lui-même, après le fiasco de la baie des Cochons, a réfléchi aux dysfonctionnements dans le mode de décision et invité ses conseillers à faire de même.
__ Il faut qu’un dirigeant se fasse parfois visionnaire, ce qui implique du courage politique, puisqu’il doit résoudre un problème environnemental. Nous en avons rencontré quelques cas : les premiers shoguns tokugawas, qui ont réduit la déforestation du Japon longtemps avant que celle-ci n’atteigne le stade de l’île de Pâques ; Joaquin Balaguer, le dictateur qui, quelles que fussent ses motivations, soutint fortement les défenseurs de l’environnement dans la partie dominicaine d’Hispaniola, alors que ses homologues du côté haïtien ne firent rien de tel ; les chefs de Tikopia qui décidèrent d’éliminer les porcs nocifs pour leur île, malgré le statut prestigieux de cet animal en Mélanésie ; les dirigeants de la Chine communiste qui ont promulgué un planning familial longtemps avant que la surpopulation de leur pays atteigne le niveau du Rwanda aujourd’hui. Autant d’exemples qui sont des raisons d’espérer et font de mon enquête un ouvrage optimiste.
[1] Traduction française : La marche folle de l’Histoire, Paris, Robert Laffont, 1985. Citations respectivement aux pages 374 et 376 (N.d.É.)Voir par ailleurs:
Voir par ailleurs:
As a Black Child in Los Angeles, I Couldn’t Understand Why Jesus Had Blue Eyes
As Christians prepare to celebrate Easter, a Times journalist wonders how others first visualized Jesus as a child — and what those images mean now. Share your experience in the comments.
Eric V Copage
The New York Times
April 19, 2019
I must have been no older than 6. I was in church in my hometown, Los Angeles. Parishioners fanned themselves to stay cool in the packed, stuffy room.
On one side of each fan was an illustration of an Ozzie and Harriet-like American family — father, mother, son, daughter. All were black, like the parishioners in the church. On the other side was an illustration of Jesus Christ — fair skinned, fair haired, blue eyed.
Something seemed amiss to me about that depiction of Christ. Why was he white? Why was he not black, like my family, like me?
As I grew older, I learned that the fair-skinned, blue-eyed depiction of Jesus has for centuries adorned stained glass windows and altars in churches throughout the United States and Europe. But Jesus, a Jew born in Bethlehem, presumably had the complexion of a Middle Eastern man.
Many black Americans I met over the years not only embraced that image, but also insisted upon it. In a July 2002 episode of the radio show “This American Life,” an artist, Milton Reed, who made his living painting murals inside people’s apartments in public housing projects in Chicago, said black clients often asked him to paint Jesus — and insisted that Mr. Reed paint him white.
[Use the comments to tell us what you see when you visualize Christ. Your response may be highlighted in this article.]
With the approach of Easter, and these memories at the front of my mind, I decided to dig a little into this topic.
George Yancy, who edited “Christology and Whiteness,” a collection of essays about race and Christianity, told me the desire — sometimes the psychological need — of some black Americans to see Christ as white may “simply be a habit.”
“The first time I saw images of a black Christ it was shocking,” Dr. Yancy, who is black, told me. “It was like, ‘How dare they!’ But when you’ve seen a white Jesus all your life you think that can be the only acceptable image.”
Dr. Yancy, a philosophy professor at Emory University, also said that the social cultural soup all Americans are immersed in equates white with good and pure and black with bad and evil. Consciously or subconsciously some black Americans might have bought into that.
“If you internalized that worldview,” he said, “how could a dark-skinned Christ wash sins away?”
In a few black American churches the image of a white Jesus never took root, and for at least 100 years, those churches have been depicting Christ as black, as reported in a 1994 Washington Post article.
Since the 1960s, with the civil rights and black power movements and black liberation theology, the trend to show Christ as black has steadily grown.
“It would seem to follow that as black people came to rethink and embrace their own beauty, their own self-representation, that the image of a black Christ would naturally follow,” Dr. Yancy said.
Now, even though cultures across the world may at times show a Jesus that reflects their own story, a white Jesus is still deeply embedded in the Western story of Christianity. It has become often impossible to separate Jesus and white from the American psyche.
I remain interested in the depiction of Christ among blacks, Hispanics, East Asians, South Asians and other communities of color, both American born and immigrant.
I am also interested in how white Christians feel about images of Christ. How do you feel about the possibility that Christ may not have looked the way he has been portrayed for centuries in the United States and Europe? If you’ve seen Christ depicted as a man of color, what was your reaction?
In the comments section of this article, I encourage you to share how the age-old debate over the identity of Jesus is playing out in your life and religious community.
Please include where you’re from. We may highlight a selection of responses in this article.
Correction:
Because of an editing error, an earlier version of this article referred imprecisely to Jesus’s background. While he lived in an area that later came to be known as Palestine, Jesus was a Jew who was born in Bethlehem.








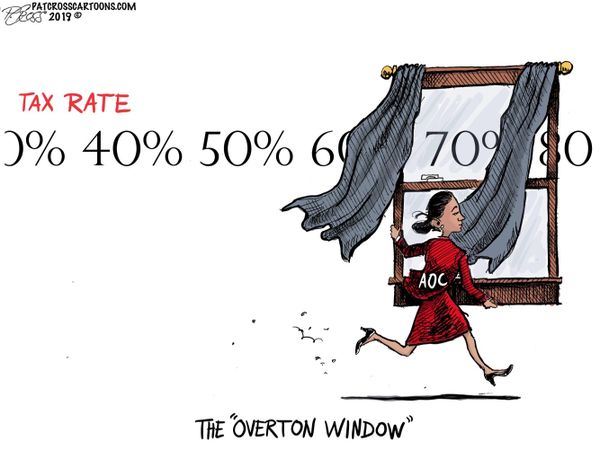







WHO WILL APOLOGIZE FOR THE APOLOGIZERS ? (What about the countless articles, editorials, and opinion pieces which damned the Israeli Prime Minister even more fatefully than this single cartoon?)
And so the New York Times has actually, finally, issued an editorial apology. I am not persuaded. This is pro forma PR. It is also a clever attempt to gaslight us. What else can it be? Suddenly, the very purveyor of poisoned propaganda against the Jewish state, presumes to stand apart from its own historical role which consisted of disappearing the 20th century Holocaust and of incitement to genocide against the Jews in the 21st century. How can it stand apart from itself? The apology concerns the “appalling political cartoon…of Prime Minister Benjamin Netanyahu.” The cartoon? What about the countless articles, editorials, and opinion pieces which damned the Israeli Prime Minister even more fatefully than this single cartoon? I do not think they can easily walk back their own culture of contempt for Prime Minister Netanyahu, for Israel in general, or for the truth in particular when it comes to the Jewish state and the Jewish people. The apology is blind. It notes “white nationalist” attacks on Jews and on mosques and the “rightward drift” of Israel and of some European nations — as if this is the primary source of anti-Semitism. As if this is the terrorism we all must fear. It fails to note that brown-skinned (wealthy and educated Muslims) just blew up brown-skinned Christians in Sri Lanka; that brown-skinned Muslims are slaughtering brown-skinned Christians all over the Arab Middle East and in Africa. It fails to note that the quantum escalation of Jew hatred is coming to us from the educated Left in the West and from the Islamic world and from Islamic community leaders in the West. (…) Photos of suffering Palestinians (who were sometimes Iraqis or Syrians) dominated the issue. Photos of Israeli dead, dismembered, shell-shocked, evacuated, did not appear at all or very often. “Gunmen” or “insurgents” were how the NYT’s referred to Arab Muslim terrorists, at least until the facts fully unfolded elsewhere and forced them to describe reality, however reluctantly, however late in the day; these corrections were always — not sometimes — buried in the back pages or in small print. On my watch, almost every single day, year after year, for almost nineteen years now, a single issue of the Gray Lady might feature anywhere from two to eight articles damning Israel. False maps, interviews with biased “experts” in so-called new stories, Op-Ed’s, Editorials by the staff, all appeared in the same issue. Every so often, a one-off piece might appear by Israel’s Ambassador, or Matti Friedman or Yossi Klein Halevi or Ruth Wisse. But such pieces did not appear every day or every week year after year as the poisoned propaganda did. (…) There is blood on their hands. The question is: Do they know it? And do they care? We shall soon see.
Phyllis Chesler
http://www.israelnationalnews.com/Articles/Article.aspx/23812?fbclid=IwAR2gJ-qDlDeHGxBLsTD9xrQMYLy_KRMOwmugfe6siB4XyW-wC_w8SIx2-KM
J’aimeJ’aime
WHAT WHACKO DEMOCRAT LAND ? (Just when we thought Rep. Rashida Tlaib couldn’t get any more anti-Semitic)
« There’s always kind of a calming feeling, I tell folks, when I think of the Holocaust, and the tragedy of the Holocaust, and the fact that it was my ancestors — Palestinians — who lost their land and some lost their lives, their livelihood, their human dignity, their existence in many ways, have been wiped out, and some people’s passports. And, just all of it was in the name of trying to create a safe haven for Jews, post-the Holocaust, post-the tragedy and the horrific persecution of Jews across the world at that time. And, I love the fact that it was my ancestors that provided that, right, in many ways, but they did it in a way that took their human dignity away and it was forced on them. »
Rep. Rashida Tlaib (D-MI)
https://townhall.com/tipsheet/mattvespa/2019/05/06/and-now-kamala-harris-is-peddling-election-truther-nonsense-n2545911
J’aimeJ’aime
BRAVE BUT NOT FOOLHARDY (After its antisemitic cartoon, guess who just quietly decided to drop all political cartoons ?)
All my professional life, I have been driven by the conviction that the unique freedom of political cartooning entails a great sense of responsibility.
In 20-plus years of delivering a twice-weekly cartoon for the International Herald Tribune first, and then The New York Times, and after receiving three OPC awards in that category, I thought the case for political cartoons had been made (in a newspaper that was notoriously reluctant to the form in past history.) But something happened. In April 2019, a Netanyahu caricature from syndication reprinted in the international editions triggered widespread outrage, a Times apology and the termination of syndicated cartoons. Last week, my employers told me they’ll be ending in-house political cartoons as well by July. I’m putting down my pen, with a sigh: that’s a lot of years of work undone by a single cartoon – not even mine – that should never have run in the best newspaper of the world.
Patrick Chappatte
https://www.chappatte.com/en/the-end-of-political-cartoons-at-the-new-york-times/
https://edition.cnn.com/2019/06/10/media/political-cartoons-new-york-times/index.html
J’aimeJ’aime
I’M TAKING MY BALL AND GOING HOME (The Jewish propaganda machine made me do it: It is as if the paper is saying “If we cannot run political cartoons that contain anti-Semitic themes, then we cannot run political cartoons at all »)
“I’m putting down my pen, with a sigh: that’s a lot of years of work undone by a single cartoon — not even mine — that should never have run in the best newspaper in the world. »
Patrick Chappatte
The New York Times’ official response to the appearance of an anti-Semitic political cartoon in its April 15 international edition has been, ironically, cartoonish. To wit, the paper will no longer publish daily political cartoons in its international edition, bringing to an end long-running contracts with cartoonists Patrick Chappatte and Heng Kim Song, editorial page editor James Bennet announced Monday. It is as if the paper is saying, “If we cannot run political cartoons that contain anti-Semitic themes, then we cannot run political cartoons at all.” The simpler fix would be simply to weed out cartoons that contain obvious anti-Jewish bigotry or any overt bigotry, for that matter. But I guess the Times does not trust that its editors could be so discerning. Though his statement suggests the decision to cut daily cartoons from the international edition was in the works well before it published a cartoon depicting a blind, yarmulke-wearing President Trump being led by Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, who is portrayed as a large-nosed, Star-of-David-sporting service dog, some are not buying it. And by “some,” I mean at least one of the contract cartoonists whom the New York Times just gave the boot. In April, after the paper published the anti-Semitic, anti-Netanyahu cartoon in its international edition, the paper initially slow-walked its response, claiming in a generic statement on social media that the “image was offensive, and it was an error of judgment to publish it.” The paper added that the bland statement would appear in print in the April 29 edition. Times spokeswoman Eileen Murphy issued a lengthier statement later on April 28 in which she made an actual attempt to apologize for the cartoon. The cartoon, which was retracted from the Times’ website soon after critics noted its obvious anti-Semitic themes, was created by Portuguese cartoonist António Moreira Antunes, the Times reported. Antunes, by the way, blamed the “Jewish propaganda machine” for the negative reaction to his cartoon, in case you were wondering what might have motivated him to draw it the way he did. Honestly, the Times’ handling of this entire ordeal could not be worse. It would be better for the paper to publish offensive materials and defend them, rather than fall back on this weird, childish I’m-taking-my-ball-and-going-home attitude. It is cowardly and censorious, neither of which is a good look for an ostensibly free and outspoken newspaper.
https://www.washingtonexaminer.com/opinion/if-the-new-york-times-cant-publish-anti-semitic-cartoons-it-wont-push-any-cartoons-at-all
J’aimeJ’aime
CORBYN M’A TUER ! (Comment, entre hausses d’impôts punitives, nationalisations massives, refus de s’engager sur le Brexit et compagnonnage antisémite, le fan de Marx et de Castro a infligé à la gauche britannique son plus grand désastre en 84 ans)
Grand perdant des législatives, le leader radical du Labour est le principal responsable de la défaite historique de son camp. Il laisse derrière lui un parti en ruines et divisé. Le résultat des élections législatives, qui ont eu lieu au Royaume-Uni ce jeudi, signe la plus grande victoire des conservateurs depuis 1987. A l’époque, le Premier ministre s’appelait… Margaret Thatcher. Tout un symbole. Mais ce scrutin signe aussi et surtout la pire défaite pour les travaillistes depuis 1935 ! Une claque historique pour le parti et son chef dont la dérive extrémiste aura définitivement scellé l’avenir politique. « Un désastre », « une débâcle », « un massacre », titre ainsi la presse anglaise assassine. « Jeremy Corbyn a confirmé son statut de leader du Labour le plus impopulaire et moins performant des temps modernes », relève le droitier Telegraph. « Ce score semble marquer un spectaculaire désaveu de son offre d’un ‘réel changement’ pour les Britanniques », concède même le gauchiste Guardian. « Les électeurs ont livré un verdict humiliant contre sa vision du socialisme », résume le Dailymail.
Il est vrai qu’en adoptant un manifeste radical, très éloigné de la raisonnable et triomphante social-démocratie des années Blair, l’ancien syndicaliste de 70 ans, fan de Marx et de Fidel Castro, a effrayé nombre d’entre-eux. « La combinaison de hausses d’impôts punitives, de nationalisations massives et la fin des réformes syndicales de l’ère Thatcher nous ramènent 40 ans en arrière, avait prévenu le Financial Times dans un éditorial cinglant. Ajoutez-y une vaste expansion de l’État – basée sur des dépenses s’élevant à 6 % du revenu national – et le plan du Labour signifie un déclin économique assuré. » Une ligne tellement subversive qu’elle a d’ailleurs reçu le soutien du Parti communiste pour « mettre fin à l’austérité et aux privatisations ». C’en était trop. Même le “Mur Rouge” du centre et nord de l’Angleterre, ce bastion travailliste, ouvrier et paupérisé qui a voté pour le Brexit en 2016, est tombé côté tory.
La position aussi lâche qu’ambiguë de Jeremy Corbyn sur le Brexit, justement, a également semé le trouble auprès de son électorat, trahi par l’establishment europhile du parti qui s’était engagé à renégocier l’accord de sortie de l’Union européenne, puis à organiser un nouveau référendum. Résultat : il s’est attiré les critiques des “Brexiters” comme des “Remainers”. Ironiquement, le chef eurosceptique de l’opposition, qui a promis un fumeux « processus de réflexion » au lieu de sa démission, a lui-même rejeté facilement la faute sur le Brexit, qui « a clivé et primé sur tout ce qui relevait du débat politique habituel ». Ce qui n’a pas empêché Ian Lavery, président du Labour, de reconnaître sur la BBC qu’« ignorer la démocratie et ses conséquences nous reviendra dans la figure ». Plusieurs pontes travaillistes modérés en colère n’ont pas attendu non plus pour condamner le leadership « désastreux » de Jeremy Corbyn.
En témoigne, notamment, sa complaisance, voire sa complicité coupable, à l’égard du cancer antisémite qui gangrène la deuxième formation politique du pays, depuis son arrivée à sa tête, il y a quatre ans. À son palmarès, ce militant propalestinien a défendu une fresque antisémite, traité les terroristes du Hamas en « amis », été proche d’une organisation négationniste et membre de groupes Facebook antisémites, fait taire un survivant de l’Holocauste, expulsé des opposants juifs d’un rassemblement anti-israélien, copiné avec des personnalités antisémites, complotistes et terroristes, été stipendié par une chaîne d’État iranienne, refusé de visiter le musée Yad Vashem, suspecté « la main d’Israël » derrière un attentat djihadiste, tenté de faire exclure l’État hébreu de l’Eurovision et s’est même recueilli sur les tombes des terroristes responsables du massacre des athlètes israéliens aux jeux Olympiques de Munich, en 1972 !
Il y a quelques jours encore, une enquête accablante du Times de Londres enfonçait le clou. « Les affirmations sur la tolérance zéro de Jeremy Corbyn sont des ‘mensonges’, selon des lanceurs d’alerte, qui ont fait fuiter des documents montrant que peu de ses mesures pour s’attaquer au racisme ont été adoptées », révélait le prestigieux journal. « Les juifs sont le mal absolu », « Hitler a raison », « le lobby sioniste contrôle le monde »… Sur les 127 plaintes enregistrées depuis l’été 2018, seule la moitié a été signalée et fait l’objet de simples « avertissements », de « formation à la diversité » inexistante, voire d’aucune sanction. « Nous sommes devenus le parti raciste, le parti malveillant en raison des agissements de notre leader et du manque d’actions de sa part, accuse la députée travailliste et juive, Ruth Smeeth, donnée perdante face aux conservateurs. Cela fait de nombreux mois qu’il aurait dû partir. »
« Cette élection a été un référendum sur Corbyn », confirme Andrew Adonis, ex-ministre sous Tony Blair. « L’idée d’attribuer tout ça à la politique du Brexit n’a aucun fondement. Parlez aux candidats et ils vous diront que pour deux portes où nous avons frappé où notre positionnement sur le Brexit a été évoqué, il y a eu huit portes où on nous a dit qu’il y avait un problème avec Jeremy Corbyn, a même reconnu un haut cadre du parti en ruines et divisé. Les gens n’ont pas compris pourquoi il ne s’excusait pas. » Ce vendredi, Lord Falconer, son conseiller sur l’antisémitisme, exhortait déjà à lui trouver « de toute urgence » un remplaçant centriste et réunificateur. Près de la moitié des électeurs déçus du Labour (46 %) ont en effet avoué « ne pas aimer Jeremy Corbyn », selon un sondage. Le chantier est immense. « C’est le début de 20 ans de règne conservateur », s’inquiète désormais un député travailliste sortant.
https://www.valeursactuelles.com/clubvaleurs/monde/elections-brexit-antisemitisme-comment-corbyn-plombe-la-gauche-britannique-113982
J’aimeJ’aime
WHAT PORTUGUESE ANTISEMITISM ?
http://www.judeanrose.com/2020/01/30/btsalmo-demands-firing-sabado-cartoonist-antisemitic-cartoon/
J’aimeJ’aime