Si quelqu’un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu’on suspendît à son cou une meule de moulin et qu’on le jetât au fond de la mer. Jésus (Matthieu 18: 6)
Il faut peut-être entendre par démocratie les vices de quelques-uns à la portée du plus grand nombre. Henry Becque
Il nous arriverait, si nous savions mieux analyser nos amours, de voir que souvent les femmes ne nous plaisent qu’à cause du contrepoids d’hommes à qui nous avons à les disputer (…) ce contrepoids supprimé, le charme de la femme tombe. Proust
L’idée que Playboy transforme les femmes en objets sexuels est ridicule. Les femmes sont des objets sexuels… C’est l’attraction entre les sexes qui fait tourner le monde. C’est pourquoi les femmes portent du rouge à lèvres et des jupes courtes. Hugh Hefner (2010)
Ces nanas sont notre ennemi naturel. Il est temps de se battre contre elles. Il est temps de se battre contre elles… Ce que je veux, c’est un article dévastateur qui démonte les féministes militantes. Hugh Hefner
Playboy traite les femmes – et les hommes aussi, d’ailleurs – comme des êtres sexuels et non comme des objets sexuels. En ce sens, je pense que Playboy a été une force efficace dans la cause de l’émancipation féminine. Hugh Hefner
Il est difficile d’imaginer que quelqu’un aurait pu savoir ce que cela aurait pu devenir. Les parents qui grandissent aujourd’hui se battent pour que leurs enfants restent purs. Les époux se battent pour garder leur mariage intact. Et de nombreuses personnes asservies et piégées dans l’industrie du divertissement pour adultes ont été dépouillées, au sens figuré et au sens propre, non seulement de leurs vêtements, mais aussi de leur valeur même en tant que personnes créées à l’image de Dieu. Si cela ne nous préoccupe pas, qu’est-ce qui va nous préoccuper ? Ed Stetzer
Il aurait été amusant de débattre de la question de savoir si un homme qui procurait, sollicitait et tirait profit de femmes vendant des services sexuels pouvait être qualifié de proxénète. Bien entendu, l’idéologie de Playboy repose sur l’idée que les femmes font ce genre de choses de leur plein gré ; qu’à 23 ans, elles ne veulent rien d’autre que sauter des octogénaires. Maintenant qu’il est mort, on parle de ce vieux dégoûtant en smoking comme d’une sorte de libérateur des femmes. Kim Kardashian est honorée d’y avoir participé. C’est vrai. Je ne sais pas vraiment quelles femmes ont été libérées par les fantasmes de Hefner. Je suppose que si vous aspiriez à être une Barbie vivante, c’était aussi fabuleux que de faire partie de l’entourage de Donald Trump. Si nous étions allés au tribunal, j’aurais aimé entendre certaines des anciennes camarades de jeu et lapins s’exprimer devant la cour – parce qu’au fil des ans, ils l’ont fait. Les récits des « quelques privilégiées » qui ont pu pénétrer dans le sanctuaire du manoir Playboy de 29 pièces en tant qu’épouses/petites amies/lapins sont assez étonnants. Dans le zoo, le harem et le bordel de Hefner, ces blondes interchangeables étaient soumises à un couvre-feu. Elles n’étaient pas autorisées à recevoir la visite d’amis. Et certainement pas de petits amis. Elles recevaient une « allocation ». Les grandes grilles métalliques du manoir, dont tout le monde prétendait qu’elles empêchaient les gens d’entrer dans ce « nirvana », ont été décrites par Holly Madison, ancienne « petite amie » de Hefner, dans son autobiographie : « J’ai fini par penser que c’était fait pour m’enfermer ». Le fantasme vendu par Hefner n’était pas un fantasme de liberté pour les femmes, mais pour les hommes. Les femmes devaient être étrangement chastes mais toujours disponibles pour un bon prix. Habiller des femmes adultes en lapins – autrefois considéré comme le summum de la sophistication – est aujourd’hui perçu comme une attitude grotesque et ironique. Certains veulent aujourd’hui célébrer la contribution de Hefner au journalisme de magazine, et je ne conteste pas le fait que Playboy a fait appel à des écrivains fantastiques. Une partie du sens des affaires de Hefner a consisté à rendre la vente de chair féminine respectable et branchée, à rendre le porno doux acceptable. Le rêve de tout homme était d’avoir le style de vie de Hefner. Apparemment. Toutes les photos de lui, jusqu’à la fin, le montrent avec son sourire de lézard entouré de clones blondes. Tous les crétins de Twitter se demandent si Hefner ira au paradis alors qu’il y a déjà vécu. Mais écoutez ce que les femmes disent de ce paradis. Chaque semaine, se souvient Izabella St James, elles devaient se rendre dans sa chambre et « attendre qu’il ramasse la crotte de chien sur le tapis – puis demander notre argent de poche ». Un millier de dollars comptés en billets de cent dollars craquants provenant d’un coffre-fort situé dans l’une de ses bibliothèques ». Si l’une d’entre elles quittait le manoir et n’était pas disponible pour les soirées du club où elle était exhibée, elle ne recevait pas son argent de poche. Les draps du manoir étaient tachés. Les petites amies ne devaient pas se chamailler. Aucun préservatif ne pouvait être utilisé. Une infirmière devait parfois être appelée dans la « grotte » de Hefner s’il avait fait une chute. Néanmoins, ces jeunes femmes devaient s’exécuter. Hefner – décrit à plusieurs reprises comme une icône de la libération sexuelle – était allongé là, avec, je suppose, une érection emblématique, bourré de Viagra jusqu’aux yeux. La petite amie principale était ensuite appelée pour lui faire une fellation. Il n’y avait ni protection ni test. Il s’en fichait, écrit Jill Ann Spaulding. Ensuite, les autres femmes se mettaient à tour de rôle sur lui pendant deux minutes, tandis que les filles en arrière-plan jouaient des scénarios lesbiens pour maintenir l’excitation de « papa ». Y a-t-il une fin à ce glamour ? Aujourd’hui, oui, bien sûr. Mais cet homme est encore célébré par des personnes qui devraient être mieux informées. On peut parler de glamour, d’oreilles de lapin et de résilles, on peut évoquer sa contribution au journalisme gonzo, on peut contextualiser sa volonté de libérer le sexe dans le cadre de la révolution sexuelle. Mais si l’on fait abstraction de tout cela, on s’aperçoit qu’il était un homme qui achetait et vendait des femmes à d’autres hommes. N’est-ce pas là la définition d’un proxénète ? Je ne saurais le dire. Suzanne Moore
En apprenant la mort du proxénète et pornographe Hugh Hefner ce matin, j’ai souhaité croire à l’enfer. (…) C’est à Hefner que l’on doit la transformation du porno en industrie. Comme l’écrit Gail Dines dans ses virulantes révélations sur l’industrie pornographique, il l’a fait passer des arrières-cours à Wall Street et, en grande partie grâce à lui, c’est aujourd’hui une industrie de plusieurs milliards de dollars par an. Hefner a opéré dans un pays où, si l’on filme un acte d’humiliation ou de torture – et si la victime est une femme – le film est à la fois un divertissement et un discours protégé. Il a causé des dommages incommensurables en faisant du porno – et donc de l’achat et de la vente du corps des femmes – un commerce légitime. Hefner détestait les femmes et les traitait de « chiennes ». En 1963, Gloria Steinem (alors journaliste indépendante) a décidé de se faire passer pour une Bunny Girl et de passer deux semaines à la Playboy Mansion. Steinem a découvert que les femmes qui y travaillaient étaient traitées comme des moins que rien. Les Bunny devaient porter des talons d’au moins cinq centimètres de haut et des corsets trop petits d’au moins cinq centimètres partout, sauf au niveau du buste, qui ne comportait que des bonnets D. Steinem a décrit cette situation comme une forme d’injustice. Steinem l’a décrit comme une forme de torture. Un éternuement pouvait faire sauter la fermeture éclair, et lorsqu’elles l’enlevaient, leur poitrine était écarlate et enflée. Steinem a constaté une misogynie grotesque à l’égard des femmes et a commenté qu’elles étaient « déshumanisées » par les clients – qui, après tout, suivaient l’exemple de Hefner. « Ces gonzesses [les féministes] sont nos ennemies naturelles. Il est temps de se battre contre elles », a écrit Hefner dans une note secrète transmise aux féministes par des secrétaires de Playboy. « Il est temps que nous nous battions contre elles… Ce que je veux, c’est un article dévastateur qui démonte les féministes militantes ». En réaction, des féministes ont commencé à dresser des piquets de grève devant ses commerces. Avouant qu’il ne pouvait avoir d’orgasme qu’en se masturbant devant de la pornographie, Hefner était un prédateur sexuel. Les jeunes femmes qui travaillaient au manoir Playboy parlaient du dégoût qu’elles éprouvaient à avoir des relations sexuelles avec lui, mais elles ajoutaient que cela « faisait partie des règles tacites ». « C’était presque comme si nous devions le faire en échange de tout ce que nous avions », avait déclaré l’une d’entre elles. Les jumelles britanniques Carla et Melissa Howe, qui ont vécu à la Playboy Mansion pendant un certain temps, ont déclaré à un journal en 2015 que la sécurité était si stricte qu’on avait l’impression d’être en prison. Elles ont également déclaré à propos des hommes qui visitaient le manoir : « C’était vraiment des tordus; toutes les filles se battaient pour s’enfuir ». Décrit comme « moderne, digne de confiance, propre et respectable » par le magazine Time en mars 1963, Hefner était régulièrement présenté comme une sorte d’attaché culturel plutôt que comme le salaud qui haïssait les femmes qu’il était. Prétendre que Hefner était un libérateur sexuel ou une idole de la liberté d’expression, c’est comme suggérer que Roman Polanski a contribué à la protection de l’enfance. J’imagine que les fabricants de pyjamas en soie pleurent Hefner, mais aucune féministe ne versera une larme à sa mort. Et les gauchistes progressistes qui expliquent avec lyrisme que Hefner soutenait les luttes antiracistes devraient peut-être se demander comment un tel champion des droits civiques a pu concilier cela avec les millions qu’il a gagnés en vendant le racisme le plus vil dans une grande partie de sa pornographie. Au moment où j’écrivais ces lignes, une émission d’information reconnue m’a demandé si j’accepterais de participer ce soir à un sujet sur l’héritage de Hefner. « Nous cherchons à savoir s’il a été une force pour le bien ou pour le mal. Hefner a-t-il révolutionné la sexualité féminine ou encouragé la dégradation des femmes en les considérant comme de simples objets de désir ? Maintenant qu’il est mort, j’imagine que les dizaines de femmes qu’il a abusées vont se manifester et forcer ses partisans progressistes à voir en lui ce qu’il était vraiment : une ordure sexiste de la plus basse espèce. Julie Bindel
Je me trouvais devant la célèbre Playboy Mansion, un magnifique château en pierre devenu synonyme de bacchanales orgiaques (est-ce une redondance ?) organisées par son propriétaire, Hugh Hefner (…) Ces fêtes – décorées par des jeunes femmes légèrement vêtues – étaient de véritables rites de passage pour des dizaines de types d’Hollywood et d’athlètes professionnels en rut. En me garant, je me suis rendu compte que quelque chose n’allait pas. Une balançoire en plastique brillant était suspendue à un arbre gracieux près de l’imposante porte d’entrée du manoir. Des jouets d’enfants étaient éparpillés. Hefner était marié à Kimberly Conrad, une ancienne Playmate de l’année. Leur fils, Marston, était tout petit. Le magazine People avait traité leur mariage de 1989 comme un miracle des temps modernes : « La semaine prochaine, l’enfer gèle », avait-il déclaré. Après sa brève incursion dans la vie domestique, Hefner est revenu à son ancien libertinage sexuel. Il a souvent été photographié avec un trio évolutif de jeunes femmes blondes et plantureuses. Je suis sûr qu’il n’y a rien de plus sexy que d’être traité de manière interchangeable par un homme qui a au moins un demi-siècle d’avance sur vous. Hefner s’est remarié en 2012 avec une femme de 60 ans sa cadette, qui est maintenant devenue sa veuve (…) J’étais venu au manoir pour interviewer Wendy Hamilton, une jeune femme de 23 ans originaire de Detroit qui avait été choisie pour être la Miss Décembre 1991 du magazine Playboy. Les responsables du magazine m’ont dit que j’étais le premier journaliste qu’ils avaient autorisé à assister à une séance de photos de la page centrale, que j’avais réalisée quelques jours plus tôt dans les studios de l’immeuble Playboy sur Sunset Boulevard. C’était la séance photo la moins sexy que j’aie jamais vue, mais c’était l’aboutissement d’un rêve de petite fille pour Hamilton. À l’âge de 10 ans, elle a vu le calendrier Playboy de son père dans le garage et lui a dit solennellement : « Un jour, papa, je serai l’une de ces filles ». Qui sait combien d’autres petites filles ont été contaminées par l’idée que se déshabiller pour des hommes serait le summum de la réussite ? Par-dessus tout, Hugh Hefner était dans le domaine des fantasmes. Des fantasmes d’hommes, bien sûr. Mais aussi les fantasmes des femmes. Pas leurs fantasmes sexuels, bien sûr. Leurs fantasmes concernant l’attention masculine, l’estime de soi et le succès. Je trouve toujours ironique que Hefner, qui prônait ce qu’il appelait une version « saine » de la sexualité féminine dans les pages de son magazine (jolis visages, gros seins, pas de pubis), ait probablement fait plus pour généraliser l’exploitation du corps des femmes que n’importe quel autre personnage de l’histoire des États-Unis. En réalité, il a réussi l’une des plus grandes escroqueries de tous les temps : Au cours des décennies où les femmes américaines se libéraient à la maison et sur le lieu de travail – et forçaient en fait la création de nouveaux concepts juridiques tels que le harcèlement sexuel et le viol par une connaissance – il a réussi à convaincre de nombreuses femmes que se déshabiller pour le plaisir des hommes n’était pas seulement une source d’autonomie, mais aussi un objectif valable en soi. La tromperie a également été extrêmement rentable ; Hefner est devenu multimillionnaire en cours de route. Il n’a pas inventé l’expression « regard masculin » (le mérite en revient à un critique de cinéma féministe), mais il en a certainement incarné l’idée. C’était la séance photo la moins sexy que j’aie jamais vue, mais c’était l’aboutissement d’un rêve de petite fille pour Hamilton. À l’âge de 10 ans, elle a vu le calendrier Playboy de son père dans le garage et lui a dit solennellement : « Un jour, papa, je serai l’une de ces filles ». Qui sait combien d’autres petites filles ont été contaminées par l’idée que se déshabiller pour des hommes serait le summum de la réussite ? Par-dessus tout, Hugh Hefner était dans le domaine des fantasmes. Des fantasmes d’hommes, bien sûr. Mais aussi les fantasmes des femmes. Pas leurs fantasmes sexuels, bien sûr. Leurs fantasmes concernant l’attention masculine, l’estime de soi et le succès. Je trouve toujours ironique que Hefner, qui prônait ce qu’il appelait une version « saine » de la sexualité féminine dans les pages de son magazine (jolis visages, gros seins, pas de pubis), ait probablement fait plus pour généraliser l’exploitation du corps des femmes que n’importe quel autre personnage de l’histoire des États-Unis. En réalité, il a réussi l’une des plus grandes escroqueries de tous les temps : Au cours des décennies où les femmes américaines se libéraient à la maison et sur le lieu de travail – et forçaient en fait la création de nouveaux concepts juridiques tels que le harcèlement sexuel et le viol par une connaissance – il a réussi à convaincre de nombreuses femmes que se déshabiller pour le plaisir des hommes n’était pas seulement une source d’autonomie, mais aussi un objectif valable en soi. La tromperie a également été extrêmement rentable ; Hefner est devenu multimillionnaire en cours de route. Il n’a pas inventé l’expression « regard masculin » (le mérite en revient à un critique de cinéma féministe), mais il en a certainement incarné l’idée. Il n’a pas inventé l’expression « le regard masculin » (le mérite en revient à une critique de cinéma féministe), mais il a certainement incarné la notion esthétique selon laquelle les images des femmes – et les femmes elles-mêmes – existent pour plaire aux hommes. « Playboy », a-t-il déclaré un jour, « traite les femmes – et les hommes aussi, d’ailleurs – comme des êtres sexuels, et non comme des objets sexuels. En ce sens, je pense que Playboy a été une force efficace dans la cause de l’émancipation féminine ». Il s’agit là d’un déni de la plus haute importance. S’il s’était vraiment engagé en faveur de « l’émancipation féminine », il aurait accepté l’idée que les femmes, et pas seulement les hommes, peuvent être sexuelles toute leur vie. Au lieu de cela, comme le montrent son mariage, ses fréquentations et les pages de son magazine, les femmes ont une durée de vie bien définie. Après, disons, l’âge de 30 ans, non seulement elles expirent, mais elles cessent également d’exister, qu’elles soient nues ou non. Hefner, vêtu d’un pyjama et fumant la pipe, restera une figure paradoxale de la culture américaine. Son magazine était le dépositaire d’un journalisme intelligent. Et dans le passé, la Fondation Playboy a soutenu des organisations vouées à des objectifs louables tels que les droits en matière de reproduction et les libertés civiles. Certes, Hefner a mené une bataille indispensable contre les forces du puritanisme américain du XXe siècle, mais malheureusement d’une manière qui a libéré les hommes (ou du moins leurs fantasmes masturbatoires) en réduisant les femmes à l’état d’objet. Finalement, comme cela devait arriver, la culture a oublié Playboy. L’internet et le téléphone portable ont contribué à rendre désuète la nudité à la Playboy. EEn 2015, le magazine a annoncé qu’il ne publierait plus de photos de femmes entièrement nues, mais seulement des photos suggestives. À ce moment-là, qui s’en soucie ? L’influence de Playboy sur la façon dont les jeunes femmes sont perçues et traitées est irrévocablement ancrée dans la culture. Ne cherchez pas plus loin que l’occupant agrippé du bureau ovale. Je voulais avoir le point de vue d’un homme sur le décès de Hefner, alors je suis allé chez mon père. À 88 ans, il est professeur d’anglais à la retraite à Cal State Northridge et est devenu lui-même un célibataire échangiste après le divorce de mes parents à la fin des années 1970. « Qu’est-ce que tu pensais de lui, papa ? demandai-je. Mon père s’est adossé à sa chaise et a regardé le plafond pendant un moment. « Eh bien », a-t-il dit, « c’était vraiment un sexiste ». Bien dit, papa. Robin Abcarian
En rendant hommage à Hugh Hefner, décédé à l’âge de 91 ans, nombreux sont ceux qui évoquent sa contribution à la culture américaine. Il convient d’ajouter que, si ces contributions sont importantes, elles jettent également une ombre considérable. Le fondateur de la marque Playboy était un pionnier des médias et une icône de la gauche, un défenseur précoce et très actif de la liberté d’expression, des droits civiques et de la libération sexuelle. Cela ne fait aucun doute : En tant que militant, « Hef » a ouvert la voie à une discussion ouverte sur le sexe et la sexualité, donnant aux gens la permission d’admettre qu’ils étaient eux aussi des êtres sexuels et qu’ils aimaient – ou du moins voulaient aimer – le sexe. Dans les clubs Playboy qu’il a ouverts dans les années 1960, il a embauché des humoristes noirs à une époque où de nombreux clubs pratiquaient une ségrégation de fait. Parallèlement, en tant qu’éditeur, il a repoussé les limites en publiant des articles (oui, les fameux « articles » que les hommes disaient rechercher dans Playboy) qui étaient révolutionnaires : des enquêtes menées par des écrivains comme Hunter S. Thompson et des entretiens avec des personnalités de premier plan comme Martin Luther King. Il était également un bel exemple du rêve américain, ayant lancé le magazine avec 600 dollars de sa poche et 1 000 dollars empruntés à sa mère. Mais il convient également de souligner, dans l’esprit du dialogue culturel ouvert qu’il a encouragé toute sa vie, que la société égalitaire de Hefner était largement envisagée et créée pour les hommes. Les termes de sa rébellion dépendaient indéniablement du fait que les femmes étaient reléguées au second plan. Après tout, ce sont les femmes dont la sexualité étaient exposée sur les couvertures et dans les pages centrales de son magazine, sans parler du fait qu’elles sont restées accrochées à son épaule, pratiquement jusqu’à sa mort. La notion de liberté d’expression de la sexualité de Hef se traduisait largement par la liberté d’exprimer le désir des hommes pour les femmes, et par le fantasme que ces femmes seraient toujours prêtes et désireuses de s’y conformer. Et il ne s’agissait pas seulement d’affaires : Hefner lui-même s’est vanté d’avoir couché avec plus d’un millier de femmes. Dans ses mémoires de 2015, « Down the Rabbit Hole », Holly Madison, ancienne playmate et petite amie de Hef, décrit le manoir Playboy comme un lieu où Hef encourageait la compétition – et les problèmes d’image corporelle – entre ses multiples petites amies. L’héritage de Hef est rempli de preuves de l’exploitation des femmes à des fins professionnelles. En créant Playboy et en maintenant sa marque pendant six décennies, Hef a défendu un monde dans lequel les femmes servent à séduire et à divertir les hommes, où leur corps est un objet, où les modifications visant à attirer les sens masculins priment souvent sur le confort (parce que qui veut vraiment des DDD ?). Les femmes sont des lapins – les « chanceuses », en tout cas. Les articles intelligents rédigés par des journalistes de renom qu’il publiait dans son magazine – même des journalistes femmes, comme Margaret Atwood – étaient destinés à enrichir l’intellect des lecteurs masculins du magazine. Même lorsque, il y a quelques années, le magazine s’est rebaptisé avec un éditorial « fini la nudité » comme moyen d’augmenter l’attrait du magazine pour les lecteurs de 20 et 30 ans (qui voulaient probablement le lire pour les articles), il est resté un endroit pour les hommes. Et, bien sûr, même si Playboy a supprimé la nudité intégrale pendant au moins un certain temps, en 2015, et a présenté pendant un certain temps des actrices et des mannequins en sous-vêtements, cela n’a rien changé au principe fondamental de l’entreprise : l’objectivation des femmes. (C’est un autre héritage de Hefner : aiguiser l’appétit pour le sexe facilement accessible, ce que l’internet fournit maintenant à profusion. Tout cela ne veut pas dire que la vie de Hefner ne doit pas être célébrée, d’une manière ou d’une autre. C’était un homme aux multiples facettes, qui a certainement marqué la société américaine. Mais nous devons reconnaître que son héritage n’est pas irréprochable. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il est complexe. Hefner était-il féministe ? Il a pu penser qu’il l’était. Mais peut-être que, comme beaucoup d’hommes d’un certain âge, sa définition de la féminité avait sûrement – et cruellement – besoin d’une révision. Peggy Drexler
Nous ne sommes que trois dans ce métier. Nabokov l’a écrit, Balthus l’a peint et moi, je l’ai photographié. David Hamilton
Avais-je fait à Dolly, peut-être, ce que Frank Lasalle, un mécanicien de cinquante ans, avait fait à Sally Horner, une fillette de onze ans, en 1948 ? Vladimir Nabokov
Je me retrouve plongé dans une civilisation qui permet à un homme de vingt-cinq ans de courtiser une fille de seize ans mais pas une fille de douze ans. Humbert Humbert (Lolita, Vladimir Nabokov, 1955)
Est-ce qu’on va toujours vivre comme çà en faisant toutes sortes de choses dégoûtantes dans des lits d’auberges ? (…) Le mot juste est inceste. (…) Je devrais appeler la police et leur dire que tu m’as violée. Dolly (Lolita, Nabokov)
Lolita n’est pas une jeune fille perverse, c’est une pauvre enfant que l’on débauche, dont les sens ne s’éveillent jamais sous les caresses de l’immonde monsieur Humbert. (…) il est assez intéressant de se pencher comme disent les journalistes, sur le problème de la dégradation inepte que le personnage de la nymphette que j’ai inventé en cinquante cinq a subi dans l’esprit du gros public. Non seulement la perversité de cette pauvre enfant a été grotesquement exagérée, mais son aspect physique, son âge, tout a été modifié par des illustrations dans des publications étrangères. Des filles de vingt ans, ou davantage, de grandes dindes, des chattes de trottoir, des modèles bon marché, que sais-je ou des simples criminelles aux longues jambes sont baptisées nymphettes ou Lolita dans des reportages de magazines italiens, français, allemand etc.… et les couvertures des traductions turques, arabes atteignent le comble de l’ineptie. (…) ils représentent une jeune femme aux contours opulents comme on disait dans le temps et à la crinière blonde, imaginées par des nigauds qui n’ont jamais lu mon livre. En réalité, Lolita, je le répète, est une jeune fille de 12 ans, tandis que monsieur Humbert est un homme mûr, et c’est l’abîme entre son âge et celui de la fillette qui produit le vide, ce vertige, la séduction, l’attrait d’un danger mortel. En second lieu, c’est l’imagination du triste satyre qui fait une créature magique de cette petite écolière américaine aussi banale et normale dans son genre que le poète manqué Humbert dans le sien. En dehors du regard maniaque de monsieur Humbert, il n’y a pas de nymphette, Lolita la nymphette n’existe qu’à travers la hantise qui détruit Humbert. Et voici un aspect essentiel d’un livre singulier qui a été faussé par une popularité factice. Nabokov
Ici, on vous met en prison si vous couchez avec une fille de 12 ans alors qu’en Orient, on vous marie avec une gamine de 11 ans. C’est incompréhensible! Klaus Kinski (1977)
Did you hear about the midnight rambler Well, honey, it’s no rock ‘n’ roll show (…) Well you heard about the Boston… It’s not one of those Well, talkin’ ’bout the midnight…sh… The one that closed the bedroom door I’m called the hit-and-run raper in anger The knife-sharpened tippie-toe… Or just the shoot ’em dead, brainbell jangler You know, the one you never seen before. Mick Jagger
Young teacher, the subject of schoolgirl fantasy She wants him so badly Knows what she wants to be Inside her there’s longing This girl’s an open page Book marking – she’s so close now This girl is half his age (…) Don’t stand so close to me (…) Strong words in the staffroom The accusations fly It’s no use, he sees her He starts to shake and cough Just like the old man in That book by Nabokov. Sting
Sweet Little Sixteen. She’s got the grown-up blues tight dresses and lipstick. She’s sportin’ high-heel shoes. Oh but tomorrow morning, she’ll have to change her trend and be sweet sixteen. And back in class again. Chuck Berry (“Sweet Little Sixteen”)
I slept with Sable when she was 13. Her parents were too rich to do anything, She rocked her way around L.A., ‘Til a New York Doll carried her away. Iggy Pop (Look away)
I can see that you’re fifteen years old No I don’t want your I.D. And I can see that you’re so far from home But it’s no hanging matter It’s no capital crime Oh yeah, you’re a strange stray cat. Mick Jagger-Keith Richards
Long ago, and, oh, so far away I fell in love with you before the second show Your guitar, it sounds so sweet and clear But you’re not really here, it’s just the radio Don’t you remember, you told me you loved me baby? You said you’d be coming back this way again baby Baby, baby, baby, baby, oh baby I love you, I really do Loneliness is such a sad affair And I can hardly wait to be with you again. Leon Russell and Bonnie Bramlet
From the window of your rented limousine, I saw your pretty blue eyes One day soon you’re gonna reach sixteen, Painted lady in the city of lies. (…) Lips like cherries and the brow of a queen, Come on, flash it in my eyes Said you dug me since you were thirteen, then you giggle as you heave and sigh. Robert Plant-Jimmy Page (Sick again, Led Zeppelin)
It’s a shame to see these young chicks bungle their lives away in a flurry and rush to compete with what was in the old days the goodtime relationships we had with the GTOs and people like that. When it came to looning, they could give us as much of a looning as we could give them. It’s a shame, really. If you listen to ‘Sick Again,’ a track from Physical Graffiti, the words show I feel a bit sorry for them. ‘Clutching pages from your teenage dream in the lobby of the Hotel Paradise/Through the circus of the L.A. queen how fast you learn the downhill slide.’ One minute she’s 12 and the next minute she’s 13 and over the top. Such a shame. They haven’t got the style that they had in the old days… way back in ’68. Robert Plant
Tomorrow brings another town, another girl like you. Have you time before you leave to greet another man. Richard Wright
Yeah! You’re a star fucker (…) Yeah, I heard about your Polaroids Now that’s what I call obscene Your tricks with fruit was kind a cute I bet you keep your pussy clean (…) Yeah, Ali McGraw got mad with you For givin’ head to Steve McQueen, Yeah, and me we made a pretty pair Fallin’ through the Silver Screen Yeah, I’m makin’ bets that you gonna get John Wayne before he dies. Mick Jagger
People always give me this bit about us being a macho band, and I always ask them to give me examples. « Under My Thumb »… Yes, but they always say Starf–ker, and that just happened to be about someone I knew. There’s really no reason to have women on tour, unless they’ve got a job to do. The only other reason is to f–k. Otherwise they get bored, they just sit around and moan. It would be different if they did everything for you, like answer the phones, make the breakfast, look after your clothes and your packing, see if the car was ready, and f–k. Sort of a combination of what (road manager) Alan Dunn does and a beautiful chick. Mick Jagger
Some girls take my money Some girls take my clothes Some girls get the shirt off my back And leave me with a lethal dose French girls they want Cartier Italian girls want cars American girls want everything in the world You can possibly imagine English girls they’re so prissy I can’t stand them on the telephone Sometimes I take the receiver off the hook I don’t want them to ever call at all White girls they’re pretty funny Sometimes they drive me mad Black girls just wanna get fucked all night I just don’t have that much jam Chinese girls are so gentle They’re really such a tease You never know quite what they’re cookin’ Inside those silky sleeves (…) Some girls they’re so pure Some girls so corrupt Some girls give me children I only made love to her once Give me half your money Give me half your car Give me half of everything I’ll make you world’s biggest star So gimme all your money Give me all your gold Let’s go back to Zuma beach I’ll give you half of everything I own. Mick Jagger
Goodbye Ruby Tuesday Who could hang a name on you? When you change with every new day Still I’m gonna miss you. Brian Jones
She’s my little rock ‘n’ roll My tits and ass with soul baby Keith Richards
The plaster’s gettin’ harder and my love is perfection A token of my love for her collection, her collection Plaster caster, grab a hold of me faster And if you wanna see my love, just ask her And my love is the plaster And yeah, she’s the collector. Gene Simmons
Come on, babe on the round about, ride on the merry-go-round We all know what your name is, so you better lay your money down. Led Zeppelin
Like to tell ya about my baby You know she comes around She about five feet four A-from her head to the ground. Van Morrison
Well, she was standing by my dressing room after the show Asking for my autograph and asked if she could go Back to my motel room But the rest is just a tragic tale Because five short minutes of lovin’ Done brought me twenty long years in jail Well, like a fool in a hurry I took her to my room She casted me in plaster while I sang her a tune. Jim Croce
This girl is easy meat I seen her on the street See-through blouse an’ a tiny little dress Her manner indiscreet…i knew she was Easy, easy, easy meat (…) She wanna take me home Make me sweat and moan Rub my head and beat me off With a copy of rollin’ stone Frank Zappa
Hey all you girls in these Industrial towns I know you’re prob’ly gettin’ tired Of all the local clowns They never give you no respect They never treat you nice So perhaps you oughta try A little friendly advice And be a CREW SLUT Hey, you ‘ll love it Be a CREW SLUT It’s a way of life Be a CREW SLUT See the world Don’t make a fuss, just get on the bus CREW SLUT Add water, makes its own sauce Be a CREW SLUT So you don’t forget, call before midnite tonite The boys in the crew Are fust waiting for you. Frank Zappa
I was an innocent girl, but the way it happened was so beautiful. I remember him looking like God and having me over a table. Who wouldn’t want to lose their virginity to David Bowie? Lorie Maddox
It’s not about being physically mature. It’s emotional maturity that matters. I don’t think most 16-year-olds are ready. I think the age of consent should be raised to 18 at a minimum, and some girls aren’t even ready then. I know, I know. People will find that odd, coming from me. But I think I do know what I’m talking about here. You are still a child, even at 16. You can never get that part of your life, your childhood, back. I never could. Mandy Smith
What happened was I got this class assignment from my college art teacher on the same weekend that a bunch of rock bands were due to come into town for a big ‘Dick Clark Caravan’ show. Back then, I was just a teen-age virgin dying to meet rock stars. When the teacher suggested we go out and make a plaster cast of something hard, I knew exactly what I wanted to do. What started out as a way to meet rock bands ended up turning into a pop art form. I mean, you really ought to see these casts all lined up together in a row. Seriously, it looks like some amazing chorus line. Cynthia Plaster Caster
They had groupies too, just like rock stars and movie stars. they were world heroes, and there wer women – especially down at the Cape – who chased them. I was at a party one night in Houston. A woman standing behind me, who had no idea who I was, said ‘I’ve slept with every astronaut who has been to the Moon.’ … I said ‘Pardon me, but I don’t think so. Joan Roosa
The Bible loves a good redemption story, but forgiveness only goes so far. These religious leaders who fell from grace shocked the world when their crimes and scandals became public. The fallen pastors and leaders include famous men like Ted Haggard, one of many anti-gay activitists caught being gay, and Tony Alamo, who was sentenced to 175 years in prison for pedophilia and marrying an eight-year-old girl. The pastors who have fallen into sin have all kinds of excuses: it wasn’t technically illegal, it was a youthful mistake, it was a conspiracy orchestrated by the Vatican. But none of that excuses the hypocrisy of religious « authorities » preaching one standard for their flock and then flaunting those rules in their private lives. The names of fallen pastors are famous, from Bill Gothard to Jim Bakker. And don’t forget Josh Duggar––apparently molesting his own sisters isn’t one of the things the Duggars can’t do. Genevieve Carlton
They’re known in rugby social circles as « jersey pullers ». Unabashed about their targets and dismissive of other halves, they are the stuff of which WAGs’ nightmares are made. The new phenomenon, which has spawned a range of T-shirts, mugs and social networking sites, is defined in the urban dictionary as girls who attach themselves to a member of a team. And they’re stalking a player near you. Their maxim? « If she can’t keep him – she shouldn’t have him. » And they’re not about to let a little stumbling block such as a girlfriend – or even a wife – get in their way. (…) Lions coach Warren Gatland was the first in the camp to acknowledge the issue publicly during the recent tour of Australia. He baulked at how a group of girls – dolled up to the nines – would « happen to be passing through » a restaurant or pub every time one of the players made the mistake of tweeting their location. « It’s crazy, » he said, wide-eyed at the phenomenon. The jersey pullers have even followed players to far-flung destinations, jetting thousands of miles for the chance to hang out by the pool or in a nightclub while the stars are in holiday mood. And far away from the prying eyes of home. Such was the intense interest in the Lions rugby players that Gatland was moved to hire a team of burly security guards for the tour in order to « control » the situation. The Independent
Sable Starr(born Sable Hay Shields; August 15, 1957 – April 18, 2009) was a noted American groupie, often described as the « queen of the groupie scene » in Los Angeles during the early 1970s. She admitted during an interview published in the June 1973 edition of Star Magazine that she was closely acquainted with Iggy Pop, Mick Jagger, Rod Stewart, Alice Cooper, David Bowie, and Marc Bolan. Starr first attended concerts around Los Angeles with older friends who had dropped out of school in late 1968. She lost her virginity at age 12 with Spirit guitarist Randy California after a gig at Topanga, California. She had a younger sister, Corel Shields (born 1959), who was involved with Iggy Pop at age 11, although he was also acquainted with Starr. Iggy Pop later immortalized his own involvement with Starr, in the 1996 song « Look Away » (…) Starr became one of the first « baby groupies » who in the early 1970s frequented the Rainbow Bar and Grill, the Whiskey A Go Go, and Rodney Bingenheimer’s English Disco; these were trendy nightclubs on West Hollywood’s Sunset Strip. The girls were named as such because of their young age. She got started after a friend invited her to the Whiskey A Go Go at the age of 14. (…) In 1973 she gave a candid interview for the short-lived Los Angeles-based Star Magazine, and boasted to the journalist that she considered herself to be « the best » of all the local groupies. She also claimed that she was closely acquainted with some of rock music’s leading musicians such as Jeff Beck, David Bowie, Mick Jagger, Rod Stewart, Marc Bolan, and Alice Cooper, adding that her favorite rock star acquaintance was Led Zeppelin’s lead singer, Robert Plant. When asked how she attracted the attention of the musicians, she maintained it was because of the outrageous glam rock clothing she habitually wore. She was often photographed alongside well-known rock musicians; these photos appeared in American rock magazines such as Creem and Rock Scene. (…) She ran away from home when she was 16 after meeting Johnny Thunders, guitarist in the glam rock band the New York Dolls. Wikipedia
Pamela Des Barres, connue comme groupie des groupes rock dans les années 1960 et 1970, est une femme de lettres, née Pamela Ann Miller à Reseda, Californie le 9 septembre 1948. (…) Lorsqu’elle était encore enfant, elle idolâtrait les Beatles et Elvis Presley, et fantasmait à l’idée de rencontrer son Beatle favori, Paul McCartney. Un amie du secondaire a introduit Des Barres auprès de Don Van Vliet, mieux connu sous le pseudonyme de Captain Beefheart, un musicien et ami de Frank Zappa. Vliet l’a, à son tour, introduite auprès de Charlie Watts et Bill Wyman des Rolling Stones, qui l’ont conduite à la scène rock au Sunset Strip de Los Angeles. Pamela a donc ensuite commencé à passer son temps avec The Byrds et quelques autres groupes. Quand elle est diplômée du secondaire, en 1966, elle multiplie les petits boulots qui lui permettent d’habiter près du Sunset Strip et d’entretenir plus de relations avec des musiciens rock : Nick St. Nicholas, Mick Jagger, Keith Moon, Jim Morrison, Jimmy Page, Chris Hillman, Noel Redding, Jimi Hendrix, Ray Davies, Frank Zappa et l’acteur Don Johnson. Membre des GTO’s (Girls Together Outrageously), un groupe uniquement constitué de chanteuses, formé par Frank Zappa. Le groupe a commencé sous le nom de Laurel Canyon Ballet Company, et a commencé par des premières parties des concerts de Zappa et des Mothers of Invention. Le spectacle était principalement constitué par des « performances », mélange de musique et de paroles parlées, puisqu’aucun de ses membres ne savait chanter ou jouer correctement d’un instrument. Elles ont sorti un album, Permanent Damage en 1969, couvertes par Zappa et Jeff Beck. Le groupe a été dissous par Zappa un mois après le lancement de l’album parce que quelques-uns de ses membres avaient été arrêtés pour possession de drogue. Elle se marie avec Michael Des Barres, chanteur principal de Power Station et de Detective, le 29 octobre 1977. Ils ont un enfant, Nicholas Dean Des Barres, né le 30 septembre 1978. Le couple divorce en 1991, en raison des infidélités répétées de Michael Des Barres. Des Barres a écrit deux livres à propos de son expérience de groupie : I’m With The Band (1987) (publié en Allemagne sous le titre anglophone Light my fire) et Take Another Little Piece of My Heart: A Groupie Grows Up (1993), ainsi qu’un autre livre, Rock Bottom: Dark Moments in Music Babylon.Wikipedia
Si je ne l’ai pas présentée à mes parents, c’est parce qu’elle n’a que quinze ans. Antoine (1966)
Quatorze automnes et quinze étés un petit animal, que cette Melody Nelson,une adorable garçonne et si délicieuse enfant. Serge Gainsbourg (1971)
Tu as treize ans, j’en ai trente qui sonnent. Georges Brassens (1972)
Viens, donne tes seize ans au bonheur qui prend forme pour que ton corps d’enfant peu à peu se transforme. Charles Aznavour (1974)
Je voudrais aimer une enfant. Michel Sardou (1974)
Une femme de seize ans, ce n’est guère qu’une enfant (…) Il paraît que c’est un délit. Georges Moustaki (1979)
20 ans, 18, 17 ans à la limite, je ressuscite, Sea, sex and sun, toi petite, tu es d’la dynamite. Serge Gainsbourg (1978)
Des gamines? affirmatif, de quel âge? ooh, ooh, ooh. Serge Gainsbourg (1984)
Inceste de citron, Lemon incest, Je t’aime t’aime, je t’aime plus que tout, Papapappa, Naïve comme une toile du Nierdoi Sseaurou, Tes baisers sont si doux, Inceste de citron, Lemon incest, Je t’aime t’aime, je t’aime plus que tout, Papapappa, L’amour que nous ne ferons jamais ensemble, Est le plus rare le plus troublant, Le plus pur le plus enivrant, Exquise esquisse…Inceste de citron… Serge Gainsbourg
Annie aime les sucettes Les sucett’s à l’anis Les sucett’s à l’anis D’Annie Donn’nt à ses baisers Un goût ani-Sé lorsque le sucre d’orge Parfumé à l’anis Coule dans la gorge d’Annie Elle est au paradis Pour quelques pennies Annie A ses sucettes à L’anis Ell’s ont la couleur de ses grands yeux La couleur des jours heureux … Serge Gainsbourg (Les Sucettes, 1966)
Les Sucettes est une chanson écrite par Serge Gainsbourg pour France Gall en 1966. Cette chanson est principalement connue pour ses deux niveaux de lecture : l’un décrit la scène innocente d’une fillette, Annie, friande de sucettes qu’elle va acheter au drugstore, l’autre décrit implicitement une fellation. Wikipedia
Je n’en comprenais pas le sens et je peux vous certifier qu’à l’époque personne ne comprenait le double sens. (…) Avant chaque disque (…), Serge me demandait de lui raconter ma vie (…) ce que vous avez fait pendant les vacances. Alors, je lui ai dit que j’avais été à Noirmoutier chez mes parents. Là-bas, il n’y a pas grand-chose à faire, sauf que, tous les jours, j’allais m’acheter une sucette à l’anis…(….) Et quand il a écrit la petite chanson, je me voyais aller acheter ma sucette. C’était l’histoire d’une petite fille qui allait acheter ses sucettes à l’anis, et quand elle n’en avait plus, elle allait retourner en acheter… Mais en même temps, je sentais que ce n’était pas clair… C’était Gainsbourg quand même ! (…) Mais (…) il me l’a jouée au piano, comme ça, et je l’ai tout de suite trouvée très jolie, je lui ai dit : Serge, j’adore ta chanson ! (…) Et puis, je pars au Japon et là j’apprends qu’il y a tout un truc là-dessus, c’était horrible. (…) Ça a changé mon rapport aux garçons. (…) Ça m’a humiliée, en fait. France Gall
La mort a pour moi le visage d’une enfant Au regard transparent Son corps habile au raffinement de l’amour Me prendra pour toujours Elle m’appelle par mon nom Quand soudain je perds la raison Est-ce un maléfice Ou l’effet subtil du cannabis? (…) La mort ouvrant sous moi ses jambes et ses bras S’est refermée sur moi Son corps m’arrache enfin les râles du plaisir Et mon dernier soupir. Serge Gainsbourg (Cannabis, 1970)
Avoir pour premier grand amour un tel homme fait que le retour à la réalité est terrible. A seize ans je découvrais des sommets et ne pouvais ensuite que tomber de ce piédestal. Constance Meyer
Pendant les cinq dernières années de sa vie, de 1985 à 1991, Serge Gainsbourg a fréquenté une jeune femme alors qu’il vivait avec Bambou. Elle s’appelle Constance Meyer, avait à l’époque 16 ans, soit quarante-et-un de moins que le chanteur, et raconte tout dans un livre qui paraît demain, La Jeune Fille Et Gainsbourg, aux éditions de L’Archipel.En 1985, cette fan de l’homme à la tête de chou se pointe comme de nombreux, et surtout nombreuses, fans au domicile du chanteur pour y déposer une lettre accompagnée de son numéro de téléphone. Visiblement touché, Gainsbourg appelle la jeune fille et l’invite à dîner. Suivront cinq années d’une histoire d’amour qui durera presque jusqu’au décès de l’artiste en 1991. Constance Meyer précise que Bambou, qui partageait la vie de Gainsbourg à l’époque, était au courant de la situation et s’en accommodait : à elle les week-ends, à Constance le reste de la semaine. Gala (2010)
Les temps ont changé : ce n’est plus avec leurs femmes que l’on trompe aujourd’hui les copains, mais avec leurs filles. Le Monde (1977)
Pourquoi une adolescente de quatorze ans ne pourrait-elle aimer un monsieur de trente-six ans son aîné ? Cent fois, j’avais retourné cette question dans mon esprit. Sans voir qu’elle était mal posée, dès le départ. Ce n’est pas mon attirance à moi qu’il fallait interroger, mais la sienne. Vanessa Springora
La conversation autour de #MeToo en France a été indéniablement intense. Mais lorsque des Françaises se sont élevées contre des réalisateurs (Luc Besson, Roman Polanski) et des intellectuels (Tariq Ramadan), elles ont toujours été confrontées à l’habituel blâme de la victime. D’où des avis partagés, des poursuites avortées et des méditations sur l’art français de la séduction. Il semble toutefois que quelque chose se soit passé avec l’affaire concernant le célèbre écrivain Gabriel Matzneff, dont le goût pour les adolescentes françaises et les jeunes garçons asiatiques n’est pas un secret – il a beaucoup écrit sur cette habitude pendant des années – mais qui, depuis ce mois-ci, est finalement inculpé pour avoir encouragé l’abus sexuel d’enfants. Cette inculpation intervient peu après la publication du livre de Vanessa Springora, directrice d’une maison d’édition parisienne, dont les mémoires sur sa relation abusive avec M. Matzneff semblent avoir enfin fait sauter le barrage. La force de cette histoire tient à la différence d’âge des protagonistes : Mme Springora a eu une relation sexuelle avec M. Matzneff au milieu des années 80, alors qu’elle avait 14 ans et lui 50. (…) Un jour, je l’espère, nous regarderons ces mois et nous verrons qu’ils ont marqué la fin d’une longue confusion autour de l’adolescente française, la « jeune fille », cette créature libérée, audacieuse, lettrée. (…) Un jour, je l’espère, nous regarderons ces mois et nous verrons qu’ils ont marqué la fin d’une longue confusion autour de l’adolescente française, la « jeune fille », cette créature libérée, audacieuse, lettrée. Ma mère, qui avait 18 ans lors de la révolution de mai 1968, m’a raconté qu’un homme qui passait dans la rue lui a demandé si elle voulait coucher avec lui. Non, lui a-t-elle dit, elle ne voulait pas. « L’homme lui a craché dessus : « Sale bourgeoise ! On imagine les difficultés auxquelles ont dû faire face les jeunes filles prises entre la joie d’être libérées sexuellement et l’injonction de l’être. Et, à l’horizon, l’exigence de ne pas trop se libérer. A l’époque, une femme ne pouvait voter ou hériter de biens qu’à 21 ans, mais pouvait se marier à 15 ans : il y avait de quoi être dérouté. (…) L’histoire de Matzneff m’a rappelé le procès en pédophilie d’une petite élite intellectuelle qui jouait avec la transgression sexuelle jusqu’à la folie en 1968. (…) [comme] Maurice Pialat, Éric Rohmer, Claude Miller, Benoît Jacquot, tous des réalisateurs fascinés par les adolescentes et cherchant à les comprendre, dans des efforts tantôt généreux et délicats, tantôt dérangeants. Leurs personnages de filles étaient intelligents, profonds et précoces, et leurs tourments étaient pris au sérieux. Les parents sont souvent absents, les hommes, plus ou moins rassurants, ne sont jamais loin. Il ne s’agissait pas de films d’adolescents édifiants, mais de films pour adultes dépeignant les filles d’une manière qui a probablement façonné celles d’entre nous qui les regardaient en retour. Mon mari, qui est américain, est scandalisé par le film de Rohmer « Pauline à la plage », dans lequel un petit groupe de jeunes adultes partage des sujets de cœur avec une jeune fille de 15 ans. Je suis presque offensée par son indignation, car j’aimerais penser que mon adolescente était Pauline, plus clairvoyante dans ses propres désirs que les adultes qui l’entouraient. L’étais-je ? Je lui épargnerai « Noce Blanche », dans lequel Vanessa Paradis, 16 ans, a une liaison avec son professeur de philosophie d’âge mûr, ou « Beau Père », qui raconte l’histoire d’une liaison entre une adolescente de 14 ans et son beau-père presque comme s’il s’agissait d’une comédie, ou « Un moment d’égarement » – réalisé à l’origine en 1977, puis remanié en 2015 – dans lequel une adolescente couche avec le meilleur ami de son père. « Les temps ont changé : ce n’est plus avec leurs femmes que les gens trompent leurs amis, mais avec leurs filles », avait déclaré le critique du Monde lors de la sortie du film original. Mais que voulaient vraiment les filles de la vraie vie ? Le réalisateur de « Noce Blanche », qui a connu un grand succès en France, a finalement été condamné pour harcèlement sexuel sur deux actrices. Mais nous l’apprendrons plus tard. Il est facile d’imaginer que l’histoire de Vanessa Springora et Gabriel Matzneff aurait pu faire un film typiquement français des années 80 : l’adolescente parisienne lettrée et l’écrivain scandaleux, une liaison fascinante et dangereuse dans le quartier arty de Saint-Germain-des-Prés. Il y aurait eu un rôle de soutien ambigu pour la mère, un peu confuse, un peu jalouse. Le film se serait terminé par leur rupture. Nous aurions peut-être secrètement envié cette fille qui avait vécu une telle aventure interdite. Un écrivain que je connais, qui a le même âge que Mme Springora et qui a grandi à St-Germain-des-Prés, m’a dit : « J’ai eu la chance de ne jamais rencontrer Matzneff, parce que j’étais complètement fascinée par lui ». Dans son livre, Mme Springora ne nie pas avoir consenti à cette liaison. Pourtant, il ne fait aucun doute pour le lecteur qu’elle est une victime. Suite à la publication de son livre, le philosophe Alain Finkielkraut a répété, avec la même passion que lorsqu’il a défendu M. Polanski, qu' »un adolescent et un enfant, ce n’est pas la même chose » et qu’il s’agissait d’une autre époque. Le livre de Mme Springora démontre que ces deux affirmations sont peut-être vraies, mais qu’elles ne constituent en aucun cas un argument. Comme l’a dit Nabokov, « en dehors du regard maniaque de M. Humbert, il n’y a pas de nymphette ». La grande contribution de Mme Springora est d’exposer les ravages d’une relation qui aurait pu être désirée. Elle renvoie la responsabilité à l’adulte par une simple phrase : « Ce n’est pas mon attirance qu’il faut remettre en question, c’est la sienne ». Quelque chose a changé au royaume de la jeune fille. Quelques semaines avant la sortie du livre, l’actrice Adèle Haenel a choqué le public français en accordant une interview capitale au magazine en ligne Mediapart, dans laquelle elle raconte avoir été abusée entre 12 et 15 ans par un réalisateur de 36 ans, Christophe Ruggia, qui pensait qu’ils étaient « amoureux ». On imagine la stupéfaction du vaniteux M. Matzneff lorsqu’il réalise qu’on se souvient de lui et que les jeunes filles ne disparaissent pas en grandissant. Elles vieillissent, elles deviennent des femmes capables de parler au nom des très jeunes filles qu’elles ont été et qui se sont laissées piéger par les rêves des autres. Valentine Faure
La suggestion que j’avais couché avec Tony Leung sur le plateau était une allégation dégoûtante. Jean-Jacques Annaud y était pour beaucoup – il essayait de promouvoir le film. Aujourd’hui, je réagirais très différemment, mais à l’époque – quand j’étais en plein milieu de l’affaire et que j’étais une enfant – c’était très, très dur. Je me suis sentie exploitée par lui. Il n’a jamais dissipé les rumeurs. Il entrait dans une pièce et se montrait ambigu, ce qui mettait le feu aux poudres. Partout où j’allais dans le monde, la rumeur me suivait. Jane March
L’Indochine, dans les années 1930. Une Française de 15 ans et demi vit avec sa mère, une institutrice besogneuse, et ses deux frères, pour lesquels elle éprouve un étrange mélange de tendresse et de mépris. Sur le bac qui la conduit vers Saïgon et son pensionnat, elle fait la connaissance d’un élégant Chinois au physique de jeune premier. L’homme a l’air sensible à son charme et le lui fait courtoisement savoir. Elle accepte de le revoir régulièrement. Dans sa garçonnière, elle découvre le vertige des sens. Il est follement épris, elle prétend n’en vouloir qu’à son argent. La mère de la jeune fille tolère tant bien que mal cette liaison… Télérama
She was only 18 when she made the movie, after being spotted by Annaud on the cover of Just Seventeen. He said he was captivated by ‘this little girl with a faintly bored air and the look of revolt in her eyes’. It was a look he set out to exploit. Within days of the film’s release in 1992, rumours abounded that Jane had actually made love on the set with her co-star Tony Leung during steamy scenes. To add fuel to the fire, Annaud suggested that his young star had been a virgin, but had gained experience before filming began. Jane was pursued on a worldwide promotional tour by the question: ‘Did she or didn’t she?’ Annaud did absolutely nothing to put an end to the speculation and Jane was dubbed ‘the Sinner from Pinner’, after the rather dreary London suburb in which she grew up. Meanwhile, those who had known her in Pinner became rich on stories sold to tabloid newspapers and Annaud grew in stature on the back of Jane’s ignominy, which generated huge publicity for the film. Jane says she felt violated, prostituted and abandoned by Annaud. She sobbed herself into a nervous breakdown and couldn’t bring herself to speak to the director for ten years. The Daily Mail
The elements in the story are the basic stuff of common erotic fantasies: Sex between strangers separated by age, race and social convention, and conducted as a physical exercise without much personal communication. (…) Jean-Jacques Annaud’s film treats them in much the same spirit as « Emmanuelle » or the Playboy and Penthouse erotic videos, in which beautiful actors and elegant photography provide a soft-core sensuality. As an entry in that genre, « The Lover » is more than capable, and the movie is likely to have a long life on video as the sort of sexy entertainment that arouses but does not embarrass. (…) Annaud and his collaborators have got all of the physical details just right, but there is a failure of the imagination here; we do not sense the presence of real people behind the attractive facades of the two main actors. (…) Like classic pornography, it can isolate them in a room, in a bed: They are bodies that have come together for our reveries. Roger Ebert
Smooth, hard and satiny-brown, the two bodies mesh with color-coordinated seamlessness, like a pants-shirt combo purchased at the Gap. The camera looks on from a respectful middle distance, lingering with discreet languor over the puddingy smoothness of breasts, buttocks, and bellies, the whole scene bathed in a late-afternoon haze of sunlight and shadow. Sex! Passion! Voluptuous calendar-art photography! It’s time, once again, for the highfalutin cinema tease — for one of those slow-moving European-flavored specials that promise to be not merely sexy but ”erotic,” that keep trying to turn us on (but tastefully, so tastefully), that feature two beautiful and inexpressive actors doing their best to look tortured, romantic, obsessed. (…) The Lover isn’t exactly Emmanuelle — the characters do appear to be awake when they’re coupling — yet it’s one more movie that titillates us with the prospect of taking sex seriously and then dampens our interest by taking it too seriously. Why do so many filmmakers insist on staging erotic encounters as if they were some sort of hushed religious ritual? The answer, of course, is that they’re trying to dignify sex. But sex isn’t dignified — it’s messy and playful and abandoned. In The Lover, director Jean-Jacques Annaud gives us the sweating and writhing without the spontaneity and surprise. (…) In The Lover, these two are meant to be burning their way through a thicket of taboos. Yet as characters, they’re so thinly drawn that it’s hard to see anything forbidden in what they’re doing. We’re just watching two perfect bodies intertwine in solemn, Calvin Klein rapture (which, admittedly, has its charm). Owen Gleiberman
Sur un sujet dérangeant – la prostitution d’une lycéenne des beaux quartiers –, le réalisateur signe un film élégant qui s’appuie sur le talent de Marine Vacth. La Croix (2013)
François Ozon’s new film is a luxurious fantasy of a young girl’s flowering: a very French and very male fantasy, like the pilot episode of the world’s classiest soap opera. There’s some softcore eroticism and an entirely, if enjoyably, absurd final scene with Charlotte Rampling, whose cameo lends a grandmotherly seal of approval to the drama’s sexual adventure. The Guardian
Palme d’Or à Cannes, le cinquième film d’Abdellatif Kechiche, secoué par plusieurs polémiques, évoque le devenir de deux jeunes femmes traversées par une passion amoureuse. (…) Au début du récit, Emma est étudiante aux Beaux-Arts, désireuse de s’inventer un avenir d’artiste-peintre ; Adèle, lycéenne, se rêve institutrice. L’une a les cheveux bleus, de l’assurance, de l’ambition et assume son orientation sexuelle. L’autre, plus jeune, plus terrienne, moins égocentrée, se découvre, reçoit de plein fouet cette passion « hors norme » qui la plonge dans un indicible trouble, au milieu de ses amis comme de sa famille. La quête de jouissance qui accompagne cette relation donne lieu à deux longues scènes particulièrement explicites qui, elles aussi, ont suscité et susciteront la discussion. On peut les trouver crues, extrêmement appuyées, choquantes (le film, en salles, est interdit aux moins de 12 ans). Il en va ainsi du cinéma – aussi intransigeant que dérangeant – d’Abdellatif Kechiche, expérience émotionnelle, sensorielle, travail d’imprégnation progressive du spectateur, plutôt que de suggestion ou de démonstration. La Croix (2013)
Quand on a vu le film mercredi en public, quand on a découvert les scènes de sexe sur grand écran, on a été… choquées. On les a pourtant tournées. Mais, j’avoue, c’était gênant. (…) [Les conditions de tournage] C’était horrible. Léa Seydoux
C’était… bestial ! Il y a un truc électrique, un abandon… c’est chaud franchement ! (…) Je ne savais pas que la scène de cul allait durer 7 minutes, qu’il n’y aurait pas de musique. Là, il n’y a que nos respirations et le claquement de nos mains sur nos fesses ». (…) Il y avait parfois une sorte de manipulation, qu’il était difficile de gérer. Mais c’était une bonne expérience d’apprentissage, en tant qu’actrice. Adèle Exarchopoulos
Léa: The thing is, in France, it’s not like in the States. The director has all the power. When you’re an actor on a film in France and you sign the contract, you have to give yourself, and in a way you’re trapped.
Adèle: He warned us that we had to trust him—blind trust—and give a lot of ourselves. He was making a movie about passion, so he wanted to have sex scenes, but without choreography—more like special sex scenes. He told us he didn’t want to hide the character’s sexuality because it’s an important part of every relationship. So he asked me if I was ready to make it, and I said, “Yeah, of course!” because I’m young and pretty new to cinema. But once we were on the shoot, I realized that he really wanted us to give him everything. Most people don’t even dare to ask the things that he did, and they’re more respectful—you get reassured during sex scenes, and they’re choreographed, which desexualizes the act.
Léa: For us, it’s very embarrassing.
Adèle: At Cannes, all of our families were there in the theater so during the sex scenes I’d close my eyes. [Kechiche] told me to imagine it’s not me, but it’s me, so I’d close my eyes and imagined I was on an island far away, but I couldn’t help but listen, so I didn’t succeed in escaping. The scene is a little too long.
Léa: No, we had fake pussies that were molds of our real pussies. It was weird to have a fake mold of your pussy and then put it over your real one. We spent 10 days on just that one scene. It wasn’t like, “OK, today we’re going to shoot the sex scene!” It was 10 days.
Adèle: One day you know that you’re going to be naked all day and doing different sexual positions, and it’s hard because I’m not that familiar with lesbian sex.
Léa: The first day we shot together, I had to masturbate you, I think?
Adèle: [Laughs] After the walk-by, it’s the first scene that we really shot together, so it was, “Hello!” But after that, we made lots of different sex scenes. And he wanted the sexuality to evolve over the course of the film as well, so that she’s learning at the beginning, and then becomes more and more comfortable. It’s really a film about sexual passion—about skin, and about flesh, because Kechiche shot very close-up. You get the sense that they want to eat each other, to devour each other.
Adèle: (…) And the shoot was very long in general.
Léa: Five-and-a-half months. What was terrible on this film was that we couldn’t see the ending. It was supposed to only be two months, then three, then four, then it became five-and-a-half. By the end, we were just so tired.
Adèle: For me, I was so exhausted that I think the emotions came out more freely. And there was no makeup artist, stylist, or costume designer. After a while, you can see that their faces are started to get more marked. We shot the film chronologically, so it helped that I grew up with the experiences my character had.
Léa: It was horrible.
Adèle: In every shoot, there are things that you can’t plan for, but every genius has his own complexity. [Kechiche] is a genius, but he’s tortured. We wanted to give everything we have, but sometimes there was a kind of manipulation, which was hard to handle. But it was a good learning experience for me, as an actor.
Marlowe Stern: Would you ever work with Kechiche again?
Léa: Never.
Adèle: I don’t think so.
Adèle: Yeah, because you can see that we were really suffering. With the fight scene, it was horrible. She was hitting me so many times, and [Kechiche] was screaming, “Hit her! Hit her again!”
Léa: In America, we’d all be in jail.Adèle: (…) She was really hitting me. And once she was hitting me, there were people there screaming, “Hit her!” and she didn’t want to hit me, so she’d say sorry with her eyes and then hit me really hard.
Léa: [Kechiche] shot with three cameras, so the fight scene was a one-hour continuous take. And during the shooting, I had to push her out of a glass door and scream, “Now go away!” and [Adèle] slapped the door and cut herself and was bleeding everywhere and crying with her nose running, and then after, [Kechiche] said, “No, we’re not finished. We’re doing it again.”
Adèle: She was trying to calm me, because we shot so many intense scenes and he only kept like 10 percent of the film. It’s nothing compared to what we did. And in that scene, she tried to stop my nose from running and [Kechiche] screamed, “No! Kiss her! Lick her snot!” The Daily Beast
Nous devrions, a priori, nous réjouir (…) Hélas, et indépendamment de la qualité artistique du film, nous ne pourrons pas participer de cet enthousiasme : nos collègues ayant travaillé sur ce film nous ont rapporté des faits révoltants et inacceptables. La majorité d’entre eux, initialement motivés, à la fois par leur métier et le projet du film en sont revenus écœurés, voire déprimés. (…) Certains ont abandonné « en cours de route », « soit parce qu’ils étaient exténués, soit qu’ils étaient poussés à bout par la production, ou usés moralement par des comportements qui dans d’autres secteurs d’activités relèveraient sans ambiguïté du harcèlement moral ». Le Spiac-CGT
On ne vient pas faire la promo à L.A quand on a un problème avec le réalisateur. Si Léa n’était pas née dans le coton, elle n’aurait jamais dit cela. Léa n’était pas capable d’entrer dans le rôle. J’ai rallongé le tournage pour elle. Léa Seydoux fait partie d’un système qui ne veut pas de moi, car je dérange. Abdellatif Kechiche
Je n’ai pas critiqué Abdel Kechiche, j’ai parlé de son approche. On ne travaillera plus ensemble. Léa Seydoux
Muet puisque absent des César du Cinéma 2014 d’où son film La Vie d’Adèle n’est reparti qu’avec un seul prix, soulevant bien des interrogations, Abdellatif Kechiche était en revanche tout sourire, en chair et en os, du côté de Las Vegas où se déroule actuellement le salon AVN, le rendez-vous incontournable de la planète porno. (…) Abdellatif Kechiche n’aurait pas tiré un trait sur un biopic immortalisant à l’écran Marylin Chambers. En septembre dernier, on apprenait en effet que Kechiche voulait adapter à l’écran « l’histoire de Marilyn Chambers, une star du porno américain des années 1970 qui a fait scandale en couchant à l’écran avec un Noir et qui est morte l’année de l’élection d’Obama ». Au salon de Las Vegas, Carla Cat résume sa rencontre avec le réalisateur : « Il s’intéresse beaucoup au porno. Il aurait apparemment un projet. » Pour Kechiche, comme il l’avait déclaré dans Télérama, l’histoire de Marylin Chambers est « une histoire magnifique, qui raconte l’Amérique moderne et montre comment des hommes et des femmes exerçant un métier que tout le monde regarde de travers ont fait bouger les mentalités ». Pure people
I think working with actors is a little bit how a chef would work with a potato or a piece of meat. You have to kind of have a look at the potato or the piece of meat and see what kind of possibilities are in the ingredient. I know I’m using the wrong metaphor. I think my job is to see what potato is there and from there, just work under their conditions. I don’t think I have forced anybody. Bjork I may have forced here and there. For the good of the film, I just need to give them what they need. Lars von Trier
Les cinéastes et auteurs français, européens, américains et du monde entier, tiennent à affirmer leur consternation. Il leur semble inadmissible qu’une manifestation culturelle internationale, rendant hommage à l’un des plus grands cinéastes contemporains, puisse être transformée en traquenard policier. Forts de leur extraterritorialité, les festivals de cinéma du monde entier ont toujours permis aux œuvres d’être montrées et de circuler et aux cinéastes de les présenter librement et en toute sécurité, même quand certains États voulaient s’y opposer. L’arrestation de Roman Polanski dans un pays neutre où il circulait et croyait pouvoir circuler librement jusqu’à ce jour, est une atteinte à cette tradition: elle ouvre la porte à des dérives dont nul aujourd’hui ne peut prévoir les effets. Pétition pour Romain Polanski (28.09.09)
Il m’était arrivé plusieurs fois que certains gosses ouvrent ma braguette et commencent à me chatouiller. Je réagissais de manière différente selon les circonstances, mais leur désir me posait un problème. Je leur demandais : « Pourquoi ne jouez-vous pas ensemble, pourquoi m’avez-vous choisi, moi, et pas d’autres gosses? » Mais s’ils insistaient, je les caressais quand même. Daniel Cohn-Bendit (Grand Bazar, 1975)
La profusion de jeunes garçons très attrayants et immédiatement disponibles me met dans un état de désir que je n’ai plus besoin de réfréner ou d’occulter. (…) Je n’ai pas d’autre compte à régler que d’aligner mes bahts, et je suis libre, absolument libre de jouer avec mon désir et de choisir. La morale occidentale, la culpabilité de toujours, la honte que je traîne volent en éclats ; et que le monde aille à sa perte, comme dirait l’autre. Frédéric Mitterrand (”La mauvaise vie”, 2005)
J’étais chaque fois avec des gens de mon âge ou de cinq ans de moins. (…) Que vienne me jeter la première pierre celui qui n’a pas commis ce genre d’erreur. Parmi tous les gens qui nous regardent ce soir, quel est celui qui n’aurait pas commis ce genre d’erreur au moins une seule fois ? (…) Ce n’est ni un roman, ni des Mémoires. J’ai préféré laissé les choses dans le vague. C’est un récit, mais au fond, pour moi, c’est un tract : une manière de raconter une vie qui ressemble à la mienne, mais aussi à celles de beaucoup d’autres gens. Frédéric Mitterrand
C’est pas vrai. Quand les gens disent les garçons, on imagine alors les petits garçons. Ça fait partie de ce puritanisme général qui nous envahit qui fait que l’on veut toujours noircir le tableau, ça n’a aucun rapport. (…) Evidemment, je cours le risque de ce genre d’amalgame. Je le cours d’autant plus facilement ce risque-là puisqu’il ne me concerne pas. (…) Il faudrait que les gens lisent le livre et ils se rendraient compte qu’en vérité c’est très clair. Frédéric Mitterrand (émission « Culture et dépendances », le 6 avril 2005)
J’aurai raconté des histoires avec des filles, personne n’aurait rien remarqué. Frédéric Mitterrand
En tant que ministre de la Culture, il s’illustre en prenant la défense d’un cinéaste accusé de viol sur mineure et il écrit un livre où il dit avoir profité du tourisme sexuel, je trouve ça a minima choquant (…) On ne peut pas prendre la défense d’un cinéaste violeur au motif que c’est de l’histoire ancienne et qu’il est un grand artiste et appartenir à un gouvernement impitoyable avec les Français dès lors qu’ils mordent le trait. (…) Au moment où la France s’est engagée avec la Thaïlande pour lutter contre ce fléau qu’est le tourisme sexuel, voilà un ministre du gouvernement qui explique qu’il est lui-même consommateur. Benoît Hamon (porte-parole du Parti socialiste)
On ne peut pas donner le sentiment qu’on protège les plus forts, les connus, les notables, alors qu’il y a les petits qui subissent la justice tous les jours. Ce sentiment qu’il y a deux justices est insupportable.Manuel Valls (député-maire PS)
Qu’est-ce qu’on peut dire aux délinquants sexuels quand Frédéric Mitterrand est encore ministre de la Culture? Marine Le Pen (vice-présidente du FN)
A ce propos d’ailleurs, nous n’avons rien contre les homosexuels à Rue89 mais nous aimerions savoir comment Frédéric Mitterrand a pu adopter trois enfants, alors qu’il est homosexuel et qu’il le revendique, à l’heure où l’on refuse toujours le droit d’adopter aux couples homosexuels ? Pourquoi cette différence de traitement? Rue 89
C’est une affaire très française, ou en tout cas sud-européenne, parce que dans les cultures politiques protestantes du nord, Mitterrand, âgé de 62 ans, n’aurait jamais décroché son travail. Son autobiographie sulphureuse, publiée en 2005, l’aurait rendu impensable. (…) Si un ministre confessait avoir fréquenté des prostituées par le passé, peu de gens en France s’en offusquerait. C’est la suspicion de pédophilie qui fait toute la différence. (…) Sarkozy, qui a lu livre en juin [et] l’avait trouvé » courageux et talentueux » (…) s’est conformé à une tradition bien française selon laquelle la vie privée des personnes publiques n’est généralement pas matière à discussion. Il aurait dû se douter, compte tenu de la médiatisation de sa vie sentimentale, que cette vieille règle qui protège les élites avait volé en éclats. Charles Bremmer (The Times)
David Bowie was a musical genius. He was also involved in child sexual exploitation. In the 1970s, David Bowie, along with Iggy Pop, Jimmy Page, Bill Wyman, Mick Jagger and others, were part of the ‘Baby Groupies’ scene in LA. The ‘Baby Groupies’ were 13 to 15 year old girls who were raped by male rock stars. The names of these girls are easily searchable online but I will not share them here as all victims of rape deserve anonymity. The ‘Baby Groupie‘ scene was about young girls being prepared for sexual exploitation (commonly refereed to as grooming) and then sexually assaulted and raped. Even articles which make it clear that the music industry ” ignor(ed), and worse enabl(ed), a culture that still allows powerful men to target young girls” celebrate that culture and minimise the choices of adult men to rape children and those who chose to look away. This is what male entitlement to sexual access to the bodies of female children and adults looks like. It is rape culture. David Bowie is listed publicly as the man that one teenage girl ‘lost her virginity’ too.* We need to be absolutely clear about this, adult men do not ‘have sex’ with 13 to 15 year old girls. It is rape. Children cannot consent to sex with adult men – even famous rock stars. Suggesting this is due to the ‘context’ of 70s LA culture is to wilfully ignore the history of children being sexually exploited by powerful men. The only difference to the context here was that the men were musicians and not politicians, religious leaders, or fathers. David Bowie was an incredible musician who inspired generations. He also participated in a culture where children were sexually exploited and raped. This is as much a part of his legacy as his music. Louise Pennington
When we treat public figures like gods, we enable the dangerous dynamic in which famous men prey on women and girls. Bowie is part of a long line of male stars who have used their fame to take advantage of vulnerable women. Among the many celebrities who have allegedly slept with girls under the age of consent are Elvis Presley (Priscilla Beaulieu, 14), Marvin Gaye (Denise Gordy, 15), Iggy Pop (Sable Starr, 13) and Chuck Berry (Janice Escalanti, 14). R. Kelly, Woody Allen and Roman Polanski, have all been accused or convicted of sexually assaulting minors, which differs from statutory rape in that it involves force. And of course, celebrities’ sexual crimes are not limited to teenagers. The cases of Bill Cosby and Jian Ghomeshi, who both allegedly used their high profiles to sexually abuse women, are currently before the legal system. Obviously, Bowie is not in the same league as Bill Cosby, if only because Mattix, known as one of the famous “baby groupies,” doesn’t seem remotely unhappy about her experiences with Bowie. They were both part of the ‘70s rock star scene on L.A’s Sunset Strip, where blowjobs and quaaludes were given out like handshakes. Mattix looks back fondly on the experience, calling it “beautiful” in a recent interview with Thrillist. She looks back less fondly on her relationship with Jimmy Page, who allegedly kidnapped and locked her up in a hotel room. But it’s still important to acknowledge that what Bowie did was illegal. Consent laws are in place because, unlike Mattix, too many underage girls end up traumatized by the sexual experiences they have with older men. Many of those who “consented” as teens realize later that they were exploited and controlled by their older lovers. It’s incredibly hard for any victim of sexual assault to come forward, but when your perpetrator is a beloved public figure, your story becomes even more unbelievable. We know rapists don’t fit one mould, yet we’re incredulous when a person’s crimes don’t match our image of them. This phenomenon is particularly heightened with celebrities. (…) You can both write a catchy pop song and like underage sex. But too often we mistake a person’s talent for who they are as people. Celebrities know this and take advantage of the protection that comes with being a beloved public figure. As a result, their victims suffer in silence. We should acknowledge that Bowie slept with an underage woman to acknowledge his humanity. Yes, his talent was exceptional. No, he was not a monster. But we should never glorify celebrities to the point that we refuse to acknowledge that they’re capable of ugly acts. Otherwise, we send a message to the alleged victims of Roman Polanski, R. Kelly and Jian Ghomeshi that entertainment is more valuable than justice. Angelina Chapin
Since the death of David Bowie on January 10th, fans and media have dissected much of his musical and cultural legacy. Bowie stands as a towering figure over the last 45 years of music, and as a celebrity famous for an ever-changing, enigmatic approach to his life and art, there is much to be analyzed in the wake of his passing. But not all of it is pleasant or even musical. One uncomfortable facet of the iconic rocker’s past has suddenly been thrust into the center of the dialogue, and it’s raised questions about both Bowie and the world that has enabled him and so many others. The high-profile controversies surrounding contemporary stars like R. Kelly (who was famously accused of statutory rape and taken to court on child pornography charges in the early 2000s) and the backlash against rapper Tyga (following his relationship with a then-underage Kylie Jenner) have led to a broader discussion surrounding legal consent and adult male stars who engage in predatory behavior. And since his death, more fans and commentators have had to question Bowie’s own past with teen girls as well. (…) Rock star escapades from that period have been glamorized for decades with no regard for how disturbing or illegal the behavior was. It became a part of the mythos—a disgusting testament to how little the writers documenting the happenings of the day cared about taking their heroes to task. And it was right there in the music itself: The Rolling Stones sang about underage girls in “Stray Cat Blues” and Chuck Berry glorified the teenage “groupie” in “Sweet Little Sixteen” a decade earlier. But we can’t look at it with those same eyes today—not if we are sincere about protecting victims and holding celebrities accountable. It’s convenient to go after Tyga and R. Kelly when we see hashtags or trending stories, and their behavior warrants every bit of scrutiny and criticism it’s gotten. But we cannot write off the alarming behavior of superstars past just because they’re now older, greyer or in the case of Bowie, newly-departed. Because this behavior didn’t start with contemporary hip-hop and R&B acts. In addition to her time with Bowie, Mattix was also statutory raped by Led Zeppelin guitarist Jimmy Page. In the book Hammer Of the Gods, former Zeppelin road manager Richard Cole claimed that the rocker tasked him with kidnapping the teen girl. He allegedly escorted her from a nightclub and thrust her into the back of Page’s limo with the warning of stay put or “I’ll have your head.” Page kept Mattix hidden for three years to avoid legal trouble. Mattix still romanticizes her experiences with these very adult men (“It was magnificent. Can you believe it? It was just like right out of a story! Kidnapped, man, at 14!” she stated in Hammer Of the Gods) but there is no doubt that what both Page and Bowie did was unacceptable. That it was glamorized in magazines like Creem and glossed over in films like Almost Famous speaks to cultural irresponsibility. So much of our culture turns a blind eye or gleefully endorses the hypersexualizing of teen girls. And when the stories are anecdotal as opposed to ripped from the headlines, it can be easy to dismiss and minimize the acts of artists like Bowie and Page as something “of the time.” But statutory rape laws existed even in the coke-fueled hedonism of the 1970s—because someone had to be protective of young girls who were susceptible to predators with big hair and loud guitars. But as it turns out, no one cared about protecting these girls; they were too busy mythologizing the rockers who were abusing them. Early rock ‘n’ rollers Chuck Berry and Jerry Lee Lewis both saw their careers sullied by headlines involving underage girls: Lewis revealed that he was married to his 13-year-old cousin in 1958 and was subsequently blacklisted from radio, while Berry was arrested and found guilty of transporting an underage girl across state lines for immoral purposes, spending two years in jail in 1960. Eagles drummer and vocalist Don Henley was arrested in 1980 in Los Angeles and charged with contributing to the delinquency of a minor after paramedics were called to his home to save a naked 16-year-old girl who was overdosing on cocaine and Quaaludes. He was fined $2,000, given two years’ probation, and ordered into a drug counseling program. Rocker turned right-wing caricature Ted Nugent sought out underage girls, going so far as to become the legal guardian of Pele Massa when she was 17 just to be able to duck kidnapping charges. Prince kept Anna Garcia, aka “Anna Fantastic,” with him at his Paisley Park compound when she was a teenager. She would ultimately become the subject of several of his late ‘80s/early ‘90s works, like “Vicki Waiting” and “Pink Cashmere,” which he wrote for Anna on her 18th birthday. (…) Prince dated Mayte Garcia shortly thereafter, a dancer he met when she was 16. “When we met I was a virgin and had never been with anybody,” she told The Mirror last year. The two would marry in 1996, when Mayte was 22. Unlike Anna, Mayte insists Prince didn’t pursue her seriously until she was 18. (…) There have been varying stories surrounding the relationship between a young Aretha Franklin and the late Sam Cooke. She has indicated in interviews that things between them became romantic, but in his unauthorized biography, David Ritz indicated that their first encounter occurred when she was only 12 years old and visited Cooke in his motel room in Atlanta. In the Sam Cooke Legends television documentary, Aretha recalled an incident involving her being in Cooke’s room, but indicated that her father interrupted what was likely going to be a sexual encounter. (…) Marvin Gaye met Janis Hunter around the time of her 17th birthday, and the still-married Motown star pursued the teenager immediately. According to Hunter’s 2015 memoir After The Dance, Gaye took her to an Italian restaurant in Hollywood and bribed the waiter $20 to bring the underage girl apricot sours. He had sex with her shortly thereafter, and the two began a relationship, despite a 17-year age difference and the fact that Marvin was still legally married to his first wife, Anna Gordy. Gaye would famously write “Let’s Get It On” in tribute to his lust for Jan. Shortly after giving birth to a daughter, Nona, Jan and Marvin were featured in a November 1974 issue of Ebony when she was 18. They would marry in 1977, after Marvin’s divorce from Anna was finalized; but Janis would leave the singer in 1981. We can dismiss all of this as just the “way things were back then.” We can pretend that we haven’t heard countless songs about young “Lolitas” who were “just seventeen—you know what I mean.” We can ignore the racial implications in the mainstream media’s relative silence on rockers’ histories of statutory rape and its glorification. But the next time you watch Almost Famous, take note of how much younger most of the Band Aids seem compared to the world-weary rockers that are repeatedly shown taking them to bed (Kate Hudson’s Penny Lane says she’s 16 in the film). Note how the movie casually nods to Page and Mattix in a scene at the infamous Hyatt “Riot House” on Sunset Strip. And think about how many girls would’ve been better off had someone given a damn way back when, as opposed to just fawning over a guitarist with some hit songs. Former Rolling Stones bassist Bill Wyman infamously began seeing 13-year-old Mandy Smith in 1983. According to Smith, Wyman had sex with her when she was 14. They married when she turned 18 in 1989; they divorced in 1991. She spoke about her time with the ex-Stone in an interview with The Daily Mail in 2010. “It’s not about being physically mature. It’s emotional maturity that matters,” she stated, after making it clear that she regrets what happened to her. “I don’t think most 16-year-olds are ready. I think the age of consent should be raised to 18 at a minimum, and some girls aren’t even ready then.” The Daily Beast
While the UK in 2015 inexplicably draws a line at girlhood sexuality on screen, it’s San Francisco in the 1970s that provides the film’s own context – with all the temptation for nostalgic glaze that this could offer a contemporary mindset. But elsewhere in California in those years, certain teenage girls went way beyond a cut-out-and-keep relationship to the frenzied rock scene’s most desirable. They hung out on Sunset Boulevard, L.A. There you’d find the self-dubbed foxy ladies, better known in the backstage of our cultural consciousness as baby groupies: the group of teenage high schoolers who ruled over a particular mile of Sunset Boulevard in the early 70s. The queens of the scene were close confidantes Sable Starr and Lori Lightning, who, along with other teen-aged names like Shray Mecham and Queenie Glam, slept with and dated the likes of David Bowie, Jimmy Page, Mick Jagger, Jeff Beck, Marc Bolan, Alice Cooper, Robert Plant and Iggy Pop. They were, in news that will destroy your idols, very young: Starr was 14 years old when she started hanging out on the Strip, with a 13 year old Lori Lightning (real name Mattix) joining the now established gang soon afterwards. The hangouts of choice were spots like the Rainbow Bar and Grill, Whiskey a Go Go and the E Club – later renamed Rodney Bingenheimer’s English Disco. The latter club was the preferred enclave for the era’s strange new musical breed – where, as Bowie would later enthuse to Details magazine, glam rock stars and their devotees could parade their “sounds of tomorrow” dressed in “clothes of derision.” The scene was documented by the controversial, short-lived publication Star, a tome that took teenage magazine tropes to their extreme: inside, you’ll find all the usual short stories, style guides and “How to approach your crush” articles, except in this case the stories tell of romantic backstage fantasies, how to dress to catch your “superfox”, and even a step-by-step nose-job diary (in the mag’s own words, “no dream is too far-out”). Beloved by adolescent aficionados everywhere, it wasn’t long, of course, before concerned parents were knocking the publisher’s door down – five issues long, in fact. Thanks to dedicated archive digger Ryan Richardson you can gape at every single issue online – including an interview with Starr and Queenie, in the final issue, that records for posterity the startling, angsty conviction of these ultimate mean girls. (…) But even more striking than the magazine’s laugh out loud, irreverent take on the scene – in its own words, “relief from all that moral-spiritual-ethical-medical-advice” – are the clothes. (…) Star was, needless to say, a heavily glamorised chronicle of the teenage groupie girls who frequented its pages – wilfully ignoring, and worse enabling, a culture that still allows powerful men to target young girls. But like any history that plays out in the margins – in the backstage of rock music’s mythmaking – there are conflicting accounts as to how well or badly off the girls were. Lori Lightning, who claims to have fallen in love with Jimmy Page aged 14, has no regrets. As she tells fellow ex-groupie Pamela des Barres in the latter’s book, “It was such a different time – there was no AIDS – and you were free to experiment.” Nobody can ask Starr, now – the ballsy queen of the babies eventually got clean and had kids, but died aged 51 in 2009. Even now, there’s a kind of power to be found somewhere amid the gushing interviews and romanticised editorials of Star. Addressing its teen readers without patronising them, Star cut straight to the heart of the sexual desires of girlhood like no other magazine would dare. Sexually forward in their dress and their attitude, the groupies adopted acceptable male traits to go out and get what they wanted. By channelling the stars of the Sunset Strip, the magazine empowered readers to approach humdrum high school life with the same fearlessness. Though not exactly feminist in its boy-getting tips – “I’d scratch any girl’s eyes out for a guy I want” – the message that boys shouldn’t have all the fun is loud and clear. As one reader writes in of the frustrating sexual double standard, “Guys can take their going steady rings and rules and shove it up their noses!” (…) Iggy Pop (…) slept with Starr when she was just 13, and, horribly, later wrote a song about it. His words are worryingly relevant to our own fetish for history’s visuals without their story – style divorced from context, worth a fleeting Instagram like and then on to the next. Our preference for rose-tinted glasses – especially de rigour heart-shaped ones, fit for a foxy lady – is hugely problematic. But flicking through Star magazine, you begin to see its role as a link between the innocent teenyboppers of the 60s, and the rise of badass female frontwomen in the 70s and beyond. Joan Jett was first spotted on the Boulevard, outside the Rainbow Grill. Later on, Grace Jones and Courtney Love are just two examples of powerful artists who were sexually upfront in their fashion, and did things entirely on their own terms. Dazed (Aug. 10, 2015)
The dregs of the sexual revolution were what remained, and it was really sort of a counterrevolution (guys arguing that since sex was beautiful and everyone should have lots everything goes and they could go at anyone; young women and girls with no way to say no and no one to help them stay out of harmful dudes’ way). The culture was sort of snickeringly approving of the pursuit of underage girls (and the illegal argument doesn’t carry that much weight; smoking pot is also illegal; it’s about the immorality of power imbalance and rape culture). It was completely normalized. Like child marriage in some times and places. Which doesn’t make it okay, but means that, unlike a man engaged in the pursuit of a minor today, there was virtually no discourse about why this might be wrong. It’s also the context for what’s widely regarded as the anti-sex feminism of the 1980s: those women were finally formulating a post-sexual-revolution ideology of sex as another arena of power and power as liable to be abused; we owe them so much. Lori Maddox
For San Francisco in particular and for California generally, 1978 was a notably terrible year, the year in which the fiddler had to be paid for all the tunes to which the counterculture had danced. The sexual revolution had deteriorated into a sort of free-market free-trade ideology in which all should have access to sex and none should deny access. I grew up north of San Francisco in an atmosphere where once you were twelve or so hippie dudes in their thirties wanted to give you drugs and neck rubs that were clearly only the beginning, and it was immensely hard to say no to them. There were no grounds. Sex was good; everyone should have it all the time; anything could be construed as consent; and almost nothing meant no, including “no.” “It was the culture,” she wrote. “Rock stars were open about their liaisons with underage groupies.” It doesn’t excuse these men to note that there was an overwhelming, meaningful, non-dismissible sense in this decade that sex with young female teenagers was if not explicitly desirable then certainly OK. Louis Malle released “Pretty Baby” in 1978, in which an 11-year-old and sometimes unclothed Brooke Shields played a child prostitute; in Manhattan, released the following year, director Woody Allen paired his middle-aged character with a 17-year old; color photographer David Hamilton’s prettily prurient photographs of half-undressed pubescent girls were everywhere…at the end of the decade Playboy attempted to release nude photographs of a painted, vamping Shields at the age of 10 in a book titled Sugar and Spice. […] In 1977, Roman Polanski’s implicit excuse for raping a 13-year-old girl he had plied with champagne and quaaludes was that everyone was doing it. Polanski had sequestered his victim at Jack Nicholson’s Bel Air house on the grounds that he was going to take pictures of her for French Vogue. Polanski’s victim pretended she had asthma to try to get out of his clutches. It didn’t work. Afterward, he delivered the dazed, glassy-eyed child to her home, he upbraided her big sister for being unkind to the family dog. Some defended him on the grounds that the girl looked 14. Reading Solnit on this, you can understand how Lori Maddox could have possibly developed not just a sincere desire to fuck adult men but the channels to do it basically in public; why an entire scene encouraged her, photographed her, gave her drugs that made all of it feel better, loved her for it, celebrated her for it, for years. (…) It is Maddox who interests me, in the end, not Bowie. But if there’s an argument for labeling Bowie a rapist that gets me, it’s how much I owe to the inflexible spirit that calls for it. Look, what a miracle; we are talking about this, when out of all the interviews Bowie gave in his life, he seems to never have been asked on the record about Maddox or any of the other “baby groupies,” or to have said a thing about Wanda Nichols after the case was dismissed. Jezabel
Attention, un scandale peut en cacher bien d’autres !
En ces temps étranges …
Où l’on dénonce d’un côté comme le plus rétrograde les mutilations sexuelles que l’on prône de l’autre comme summum du progrès …
Où l’on fustige chez certains les mariages forcés d’enfants tout en imposant par la loi à d’autres le mensonge et l’aberration de l’imposition de « parents de même sexe » …
Où le long silence coupable sur la pédophilie que l’on condamne dans l’Eglise catholique se mue en complaisance douteuse pour les relations proprement incestueuses de certains de nos happy few, responsables politiques compris …
Où l’irresponsabilité la plus débridée dans l’habillement comme dans le comportement ou le langage cotoie la pudibonderie la plus rétrograde dans les relations hommes-femmes …
Et à l’heure où la vérité semble enfin sortir sur les pratiques supposées du photographe David Hamilton …
Alors que dans la plupart des pays les plus problématiques de ses oeuvres continuent à être publiées …
Qui rappelle …
Dans le climat général qui a permis de tels actes …
Et notamment dans la tant célébrée révolution sexuelle des années 60 …
Sans parler du « Général » de ladite révolution sexuelle Hugh Hefner lui-même …
Qui ayant réussi, dans l’une des plus grandes escroqueries de l’histoire, à faire de l’achat et de la vente du corps des femmes un commerce légitime et une industrie de plusieurs milliards de dollars par an…
Est à présent salué comme icone de la gauche, libérateur sexuel, champion des droits civiques et idole de la liberté d’expression …
La part de la musique et du cinéma qui l’ont si fièrement portée …
De ces Rolling Stones ou Bowie (ou notre propre Gainsbourg), Woodie Allen ou Malle, De Niro, Kinski, Annaud ou Jacquot…
Qu’oubliant leurs multiples Lorie Maddox ou Sheryl Brookes, l’on continue de fêter ou d’enterrer royalement …
Et surtout derrière l’inévitable phénomène de « groupies » que produit, sport, politique, religion et conquête spatiale compris, toute adulation des foules …
La vérité suggérée dans tant de chansons …
Mais explicitée dans le célèbre « Midnight rambler » des Rolling Stones …
Et d’ailleurs déjà envisagée dans le non moins célèbre « Lolita » de Nabokov …
Derrière le rock ‘n’ roll show …
A savoir, outre l’évidente apologie de la pédophilie, la violence sexuelle, voire le viol ?
Chapin: David Bowie’s magnetism had a dark side
Il y a vingt-cinq ans, Constance Meyer a vécu une histoire avec le chanteur qu’elle raconte dans un livre paru récemment, « La jeune fille et Gainsbourg » (éd. l’Archipel). Nous avons rencontré cette jeune femme aujourd’hui amoureuse et mère de famille. A peine assise, avant que l’on pose la première question, elle s’inquiète : « Surtout ne faites pas un papier trash sur notre relation qui ne ressemblait en rien à cela »… Extraits.
La rencontre
En 1985, Constance a 16 ans. Ses parents sont professeurs de faculté, elle est bonne élève au lycée Victor Duruy. « Je deviens adulte doucement auprès de ma mère, divorcée, entourée de mes frères. Un jour, sur mon Walkman, j’entends « Love on the Beat ». Le choc. Vacances en Californie l’été qui suit, je ne fais qu’écouter ce titre qui, pour moi, est une révolution. »
A la rentrée des classes, elle découvre que Gainsbourg chante au Casino de Paris. « J’enfourne mon Ciao, une heure avant le concert, il reste quelques places dans le fond de la salle. Je prends. Quand la lumière s’éteint, je rampe jusqu’au premier rang, jusqu’à toucher la scène. » « Pour moi ce type sur scène c’est une évidence, il m’est familier. On est comme cela à l’adolescence, entier. » Elle retourne le voir quatre fois.
Un signe du destin
« Ma prof d’italien nous dit qu’elle habite rue de Lille, à côté de chez Serge… Je suis dubitative, je le lui dis. « Allez donc au 5 bis, rue de Verneuil si vous ne me croyez pas », me répond-t-elle. Je m’y précipite, la maison, les tags, aucun doute. Je sonne. Pas de réponse… Sur le trottoir d’en face, j’ouvre mon sac à dos et je lui écris. Cinq pages pour dire toute ma passion, mon engouement pour sa musique, je donne mon numéro de téléphone et je termine par « Quelle folie !» »
Il est 14 h 30 à quand elle glisse la lettre sous la porte. Elle rentre chez elle faire ses devoirs.
17 h, le téléphone sonne, elle répond.
– Pourrais-je parler à Constance ?
– C’est moi…
– C’est l’homme qui a reçu la lettre… Elle est bien écrite, elle m’a touché. J’aimerais bien te rencontrer. Tu veux venir dîner avec moi ce soir?
Elle lui propose le lendemain, sa mère doit sortir….
Le RDV
5 décembre, 20 heures: elle sonne trois fois chez lui (c’est le code).
« Si je suis intimidée , il l’est plus que moi encore. Les silences s’enchaînent, il me propose d’écouter le dernier disque de Jane « Quoi ». Il met la musique à fond. Il m’emmène Chez Ravi, un indien délicieux rue de Verneuil. Tout le monde le connaît. En entrant dans le restaurant je repère un garçon qui est dans ma classe : Bertil Scali. Au restaurant, Serge, toujours timide, me raconte une foule d’histoires drôles parce qu’il ne sait trop quoi me dire. Moi je le trouve irrésistible. A la fin du repas, je lui avoue que je ne comprends pas ce que veut dire « Je t’aime moi non plus ». Une Chanson devenue un film. Il me propose de venir le voir chez lui, en cassette.
Je découvre l’étage de son hôtel particulier: moquette noire au sol avec de gros motifs blancs. Je visite sa petite bibliothèque : livres précieux, objets et sa vieille machine à écrire Remington… Il y a aussi sa collection de poupées anciennes, la salle de bain de Jane restée intacte depuis leur séparation… Serge me dit de m’installer sur le lit et je découvre les merveilles d’une technique ultra inconnue de moi : un écran descend du plafond, il lance le film et s’en va téléphoner, vaquer à ses occupations. Quand le film est terminé, il me propose de voir « Equateur », son second long-métrage…
Je suis épuisée quand le film se termine. Serge me propose de rester dormir, nous dormons ensemble. Au matin, Fulbert son homme de ménage a préparé du café… Serge a du travail … on se quitte… Sur le pas de la porte, il me fait un signe de la main quand je démarre mon Ciao .
Ils deviennent amants
Mars 1986 : « Je passe chez lui, sonne trois fois, pas de réponse. J’écris sur son mur un poème pour qu’il le voit… Il me rappelle… Me propose notre second dîner. Après le restaurant créole, cette fois, rue de Verneuil, on rentre, on parle, on se rapproche. Je découvre sa gentillesse, sa douceur, sa faculté à mettre en valeur la personne avec laquelle il se trouve… D’une certaine façon il me rend plus belle, plus importante en me mettant tellement en valeur… Sa chambre, son film préféré « Les sentiers de la gloire » de Kubrick, le lit gigantesque recouvert de vison, les bouteilles de parfum Guerlain. Je me sens bien, déjà familière en ce lieu. Après le film, il me demande si je veux faire « dodo avec lui »… J’en meurs d’envie. C’est tendre… »
« J’ai presque 17 ans, une vraie maturité, Serge ne fait pas son âge, il n’a pas d’âge. »
L’histoire se poursuit cinq ans « régulièrement », dit-elle. Beaucoup de lettres (il n’y a pas de portable à l’époque), beaucoup de télégrammes.
« Je le retrouve en fin d’après-midi, chez lui, en studio, en tournage, à l’hôtel. On reste toute la nuit ensemble, on dort peu, on parle énormément… Il me raconte sa vie, me parle de sa solitude, de ses moments de déprime, de ses doutes. »
«Il dit ne pas connaître le bonheur… Il a un stock d’anecdotes incroyables que j’adore écouter… Quand il parle de sa mère, il pleure. Il parle de sa première femme, de ses enfants, de Jane et de sa rencontre avec Bambou… et aussi de Charlotte et de Lulu. »
Elle assiste à de nombreux épisodes connus, souvent cachée dans les coulisses. Elle est ainsi présente sur le plateau de Michel Drucker quand il dit à Whitney Houston « I want to fuck you ». Malgré, ou peut-être à cause de l’éducation stricte qu’il a reçu, Serge adore la trangression. Sur « Tenue de Soirée » , elle est en studio avec Bertrand Blier, Serge compose sur un clavier électronique. Elle dit l’avoir vu dicter d’une traite le synopsis de « Charlotte Forever » à une dactylo.
Au fur et à mesure que leur histoire avance, Serge la transforme physiquement, lui demande de s’habiller autrement, de ne plus porter de vêtements informes, de se couper les cheveux.
Elle dit n’avoir que très peu connu Gainsbarre… Ce qu’elle a vu elle c’est un homme qui n’a jamais cessé d’être un enfant, timide, doux. Jamais blasé.. Quand un gamin de six ans le reconnaît dans la rue, cela le met en joie, de même lorsqu’il entend ses chansons à la radio.
« De ma vie je n’ai jamais rencontré un homme aussi généreux, attentionné et drôle. Dépourvu de vulgarité, de méchanceté. Un dandy, avec une allure folle et unique. Depuis je n’ai jamais cessé de chercher un tel homme. Si je pense à Serge , je pense à son eau de toilette Van Cleef &Arpels pour homme , bouteille noire. Il a en six exemplaires, la même veste, le même jean, les mêmes Repetto. Et détail important: il relève toujours le col de sa veste ou de sa chemise.
Il a beaucoup souffert de sa laideur; d’elle il dit : « Elle a ceci de supérieur sur la beauté c’est qu’elle dure. » Les deux dernière années, Serge fume de plus en plus, des Gitanes qu’il allume avec un Zippo, boit de l’alcool, beaucoup de pastis.
C’est en tournant « Charlotte For Ever » que la fille de Gainsbourg rencontre Constance. Celle-ci est couchée dans une chambre de l’hôtel Raphaël où elle a dormi avec Serge. « J’ai beaucoup attendu les appels de Serge pendant toutes ces années. Je ne sais jamais quand je vais le revoir. »
Dernier Acte
1989 à 1991: Plusieurs hospitalisations. Serge doit arrêter de fumer, de boire. Il est déprimé, il a peur de perdre la vue. Il se referme sur lui-même.
Dernier appel en décembre 1990… Il fume et boit à nouveau. Parle de la mort en blaguant. Dit qu’il faudrait faire un musée de sa maison, après.
« Il est mort avant de vieillir, tu es encore jeune, tu as 62 ans », lui dit-elle.
« Avoir pour premier grand amour un tel homme fait que le retour à la réalité est terrible. A seize ans je découvrais des sommets et ne pouvais ensuite que tomber de ce piédestal. »
« La jeune fille et Gainsbourg », de Constance Meyer, éd. de l’Archipel, 160 pages. 14,95 euros.
Voir de même:
Masterpiece
The Stars of ‘Blue is the Warmest Color’ On the Riveting Lesbian Love Story
It’s the interview that sparked a huge fight between director Abdellatif Kechiche and actress Léa Seydoux. The 10-minute graphic lesbian sex scene in the masterful French Drama ‘Blue is the Warmest Color,’ winner of the Palme d’Or, stunned Cannes. At Telluride, Marlow Stern spoke to the film’s two onscreen lovers about ‘that scene’ and why they’ll never work with Kechiche again.
Marlow Stern
The Daily Beast
09.01.13
Film festival reviews are, as is their wont, often prone to hyperbole. Even the most weathered of movie critics can get swept up in the wonder of it all.
But make no mistake about it: the French drama Blue is the Warmest Color is filmmaking—and acting—of the highest order.
Directed by Abdellatif Kechiche, and based on a graphic novel by Julie Maroh, Blue tells the story of Adèle (Adèle Exarchopoulos), an awkward but beautiful 15-year-old girl whose initial sexual forays leave much to be desired. All that changes when she crosses paths with Emma (Léa Seydoux), a blue-haired college student studying art. It’s love—or is it lust?—at first sight, and before long, the two are inseparable. But, like any first love, the pair’s hidden quirks and desires begin to reveal themselves, and they struggle to remain afloat.
In a Cannes Film Festival first, the Palme d’Or was awarded to the entire Blue is the Warmest Color team—Kechiche, Exarchopoulos, and Seydoux—and the three-hour film has received universal praise from critics and audiences alike for its honest and poignant portrayal of first love.
The film’s two stars, who deliver two of the best performances of the year, sat down with Marlow Stern at the Telluride Film Festival to discuss the hellish-sounding making of the film, including why they’re embarrassed by the film’s talked-about 10-minute sex scene, and how they were terrorized on set by Kechiche.
Do you remember the first time you thought you were in love?
Léa: For me, I was maybe ten years old. I was in love with my cousin, I remember. Every time he came in, I could feel my heart beating so fast. At the time, I was crazy about Barbie but I was kind of a tomboy, so I was hiding my passion for Barbie’s because he said, “I hate girls who like Barbies.” I told him my favorite color was blue, even though it was pink. Once, I remember he came in and saw me playing with my Barbies and I turned red and felt so embarrassed.
Adèle: The first people that I started to feel something for in that way were my cousins, too. You go on vacation with them, spend a lot of time with them, and they’re a little bit older than you. But when I really fell in love and discovered how stupid you can be and everything, I was about 14. But it was a bad story. I regret it.
This is a very immersive role that demanded a lot from both of you. You must have had a lot of trust in Kechiche before signing on to this.
Léa: The thing is, in France, it’s not like in the States. The director has all the power. When you’re an actor on a film in France and you sign the contract, you have to give yourself, and in a way you’re trapped.
Adèle: He warned us that we had to trust him—blind trust—and give a lot of ourselves. He was making a movie about passion, so he wanted to have sex scenes, but without choreography—more like special sex scenes. He told us he didn’t want to hide the character’s sexuality because it’s an important part of every relationship. So he asked me if I was ready to make it, and I said, “Yeah, of course!” because I’m young and pretty new to cinema. But once we were on the shoot, I realized that he really wanted us to give him everything. Most people don’t even dare to ask the things that he did, and they’re more respectful—you get reassured during sex scenes, and they’re choreographed, which desexualizes the act.
Right. They pause the action for new camera angles, etc.
Adèle: Exactly. I didn’t know [Léa] in the beginning, and during the first sex scene, I was a little bit ashamed to touch her where I thought I wanted, because he didn’t tell us what to do. You’re free, but at the same time you’re embarrassed because I didn’t really know her that well.
Wait. You two didn’t meet at all before filming?
Adèle: We met once for a camera test before, since she was already cast, but that was it until the shoot.
And was it difficult to shoot that 10-minute sex scene? I don’t remember the last time I’ve seen a sex scene that long in a movie—gay or hetero.
Léa: For us, it’s very embarrassing.
Adèle: At Cannes, all of our families were there in the theater so during the sex scenes I’d close my eyes. [Kechiche] told me to imagine it’s not me, but it’s me, so I’d close my eyes and imagined I was on an island far away, but I couldn’t help but listen, so I didn’t succeed in escaping. The scene is a little too long.
Were the sex scenes between you two unsimulated? They look so real.
Léa: No, we had fake pussies that were molds of our real pussies. It was weird to have a fake mold of your pussy and then put it over your real one. We spent 10 days on just that one scene. It wasn’t like, “OK, today we’re going to shoot the sex scene!” It was 10 days.
Adèle: One day you know that you’re going to be naked all day and doing different sexual positions, and it’s hard because I’m not that familiar with lesbian sex.
Me either.
Léa: The first day we shot together, I had to masturbate you, I think?
Adèle: [Laughs] After the walk-by, it’s the first scene that we really shot together, so it was, “Hello!” But after that, we made lots of different sex scenes. And he wanted the sexuality to evolve over the course of the film as well, so that she’s learning at the beginning, and then becomes more and more comfortable. It’s really a film about sexual passion—about skin, and about flesh, because Kechiche shot very close-up. You get the sense that they want to eat each other, to devour each other.
So are you two really good friends now? You know each other a lot more intimately than I know most of my friends.
Adèle: Yeah! [Laughs] Thankfully we’re friends.
And the shoot was very long in general.
Léa: Five-and-a-half months. What was terrible on this film was that we couldn’t see the ending. It was supposed to only be two months, then three, then four, then it became five-and-a-half. By the end, we were just so tired.
Adèle: For me, I was so exhausted that I think the emotions came out more freely. And there was no makeup artist, stylist, or costume designer. After a while, you can see that their faces are started to get more marked. We shot the film chronologically, so it helped that I grew up with the experiences my character had.
And same-sex marriage wasn’t legalized in France until May—well before you finished shooting the film. This is an important film. It’s rare to see such an honest depiction of the love between two young women onscreen.
Léa: It is amazing. In France, it’s not out yet but at Cannes it was huge, and I think this is one of the reasons. This film is very modern. It’s a new way to make films. We never saw a film like this before—a love story this realistic. And it says a lot about the youth of today. It’s a film about love. I don’t really think it’s a film about homosexuality—it’s more than that. Homosexuality is not taboo anymore—even if it isn’t considered “moral” by everyone—which is how it should be.
Adèle: Without being a militant, Adèle was already very partial towards this movement because of how she was brought up. So for her, it’s just normal. There are some things that you can’t control, so she thinks it’s very bizarre when people say it’s against nature, and has no idea why anybody would give a fuck. Before gay marriage was legalized in France, there were huge demonstrations in France with even mothers with small children shouting terrible insults.
Right. I grew up around plenty of gay people, so it’s all about experience. People are afraid of what they aren’t familiar with, or don’t understand. But sex scenes aside, what was the toughest scene for you two to film?
Léa: Any emotional scenes. [Kechiche] was always searching, because he didn’t really know what he wanted. We spent weeks shooting scenes. Even crossing the street was difficult. In the first scene where we cross paths and it’s love at first sight, it’s only about thirty seconds long, but we spent the whole day shooting it—over 100 takes. By the end of it, I remember I was dizzy and couldn’t even sit. And by the end of it, [Kechiche] burst into a rage because after 100 takes I walked by Adele and laughed a little bit, because we had been walking by each other doing this stare-down scene all day. It was so, so funny. And [Kechiche] became so crazy that he picked up the little monitor he was viewing it through and threw it into the street, screaming, “I can’t work under these conditions!”
Adèle: We were like, “Sorry, we’ve shot this 100 times and we just laughed once.” And it was a Friday and we wanted to go to Paris and see our families, but he wouldn’t let us. But me, I always took trains in secret to see my boyfriend.
So… was this filmmaking experience enjoyable for you at all? It doesn’t sound like it.
Léa: It was horrible.
Adèle: In every shoot, there are things that you can’t plan for, but every genius has his own complexity. [Kechiche] is a genius, but he’s tortured. We wanted to give everything we have, but sometimes there was a kind of manipulation, which was hard to handle. But it was a good learning experience for me, as an actor.
Would you ever work with Kechiche again?
Léa: Never.
Adèle: I don’t think so.
But you don’t think that the proof is in the pudding at all? It is such a brilliant film.
Adèle: Yeah, because you can see that we were really suffering. With the fight scene, it was horrible. She was hitting me so many times, and [Kechiche] was screaming, “Hit her! Hit her again!”
Léa: In America, we’d all be in jail.
You were really hitting her?
Adèle: Of course! She was really hitting me. And once she was hitting me, there were people there screaming, “Hit her!” and she didn’t want to hit me, so she’d say sorry with her eyes and then hit me really hard.
Léa: [Kechiche] shot with three cameras, so the fight scene was a one-hour continuous take. And during the shooting, I had to push her out of a glass door and scream, “Now go away!” and [Adèle] slapped the door and cut herself and was bleeding everywhere and crying with her nose running, and then after, [Kechiche] said, “No, we’re not finished. We’re doing it again.”
It’s funny that you mention the runny nose, because watching the scene with you two in the diner, I was really worried that the stream of snot was going to go into your mouth.
Adèle: She was trying to calm me, because we shot so many intense scenes and he only kept like 10 percent of the film. It’s nothing compared to what we did. And in that scene, she tried to stop my nose from running and [Kechiche] screamed, “No! Kiss her! Lick her snot!”
So this was clearly a grueling shoot. What was the first thing you did when shooting wrapped?
Léa: Well, thank god we won the Palme d’Or, because it was so horrible. So now it’s cool that everyone likes the film and it’s a big success. But I took five days off and did like… three films in a row.
Adèle: I went to Thailand with my boy with no cellphone, no one to tell me “do this” and “do that” and “hit her again.” I was like [flips two birds], smoking weed, massages, woo!
Voir enfin:
Des techniciens racontent le tournage difficile de « La Vie d’Adèle »
Sept intermittents du spectacle, embauchés sur le film d’Abdellatif Kechiche, décrivent un climat lourd et des comportements proches du « harcèlement moral ».
Clarisse Fabre
Le Monde
24.05.2013
Il faut parler, vider son sac, fouiller dans sa mémoire pour que certains détails finissent par revenir, enfin. Le tournage de La Vie d’Adèle, d’Abdellatif Kechiche, sélectionné en compétition officielle à Cannes, est fini depuis neuf mois. Les souvenirs se sont estompés. Mais ils ont été ravivés subitement, jeudi 23 mai, par la publication d’un communiqué musclé du Spiac-CGT. Le Syndicat des professionnels de l’industrie de l’audiovisuel et du cinéma a dénoncé tous les manquements au Code du travail durant les cinq de mois de tournage, de mars à août 2012.
Il a aussi déploré un climat lourd, des comportements proches du « harcèlement moral », au point que certains ouvriers et techniciens auraient abandonné le navire en cours de route. Chose rare, et terriblement frustrante. Le syndicat a choisi de taper fort le jour où l’équipe du film montait les marches du Palais des festivals pour la « première mondiale ».
Hier, sur la Croisette, Abdellatif Kechiche savourait les critiques dithyrambiques, tandis qu’à l’autre bout du pays, dans la région Nord-Pas-de-Calais, certains se repassaient le film du tournage. « Une grosse, grosse galère », témoigne ce salarié. « On n’a même pas été invités à la projection. Il paraît, aussi, qu’il n’y a pas de générique de fin. C’est comme si nos noms avaient été effacés, on n’existe plus ! », s’indigne un autre. Dans un communiqué, l’association regroupant les techniciens et ouvriers du cinéma du Nord-Pas-de-Calais, l’Atocan, fait cette remarque grinçante : « Si ce long-métrage devait devenir une référence artistique, nous espérons qu’il ne devienne jamais un exemple en termes de production. »
Bien sûr, un tournage n’est jamais un fleuve tranquille. Il y a toujours des moments de tension. Mais, bien souvent, il reste le sentiment joyeux d’avoir participé à une belle aventure. C’est le plus important, et ça permet d’oublier le reste. Visiblement, tout le monde n’a pas réussi à sublimer le tournage de La Vie d’Adèle. Des intermittents du spectacle, embauchés sur le tournage, ont accepté de témoigner, sous couvert d’anonymat, car ils tiennent à retrouver du travail. L’un d’eux résume : « Le tournage était prévu pour deux mois et demi. Finalement il a duré le double, à budget constant. Et pour faire du Kechiche, il faut être là à 100 %. Sur cinq mois, c’est pas tenable. »
Commençons par les tarifs au rabais, et autres entorses au droit social. Certes, La Vie d’Adèle ne sera pas le premier tournage à avoir contourné les règles. La future convention collective du cinéma, quelle qu’elle soit, est d’ailleurs censée mettre de l’ordre dans les contrats de travail. Mais, dans La Vie d’Adèle, « les choses sont allées beaucoup trop loin », constate ce technicien, rompu à tous les arrangements sur les films d’auteurs fauchés. Figurants embauchés à l’arrache, au coin d’une rue, devant le magasin d’un disquaire lillois ; planning modifiés avec des cycles de travail sur six jours payés cinq jours, etc.
BEAUCOUP DE STAGIAIRES…
La Vie d’Adèle a pourtant bénéficié d’une enveloppe de 4 millions d’euros, ce qui n’est pas rien. Mais le tournage s’est éternisé. Est arrivé le moment où il n’y avait plus d’argent : du moins, c’est ce que disait la personne chargée de la paie, issue de la société Quat’ Sous du réalisateur. Abdellatif Kechiche est aussi coproducteur du film, ce qui n’a pas arrangé les choses. « Il avait tout pouvoir », comme le dit un technicien. Il ne restait plus qu’à faire le bras de fer pour obtenir son chèque, quand une journée déclarée huit heures avait été « oubliée ». Du travail bénévole a même été proposé à certains sur le thème : travailler auprès de Kechiche est une si belle carte de visite. « C’est vrai qu’il s’entoure de jeunes, leur confie des responsabilités. On apprend énormément. Mais c’est aussi parce qu’il cherche des gens malléables. Pour lui, quelqu’un qui a trop d’expérience est formaté. » Il y avait donc beaucoup de stagiaires…
Certains, en revanche, n’ont eu « aucun problème d’argent » avec la production. Tous leurs frais ont été payés. Mais ils gardent un sentiment mêlé : l’atmosphère sur le tournage n’était « pas humaine ». « Il y a eu un mépris pour les conditions de travail, pour le repos de l’équipe, et sa vie privée, je n’ai jamais vu ça », dit cet ancien collaborateur. C’est ce qui le rend le plus mélancolique. « Kechiche peut être chaleureux avec l’équipe, demander aux uns et aux autres s’ils vont bien. Il travaille au plus près des comédiens, il y passe un temps fou. Il peut filmer un repas de famille pendant une heure et demie, en laissant improviser les acteurs, pour capter des éclats du réel, de l’intime. Le résultat est magnifique. Mais quand on connaît l’envers du décor, on se demande vraiment : ‘Elle est où cette beauté ?’ C’est à désespérer de tout. »
Le style Kechiche est mal passé, et même a fait souffrir. Sa « méthode », si l’on peut dire, consiste souvent à improviser. Le souci de privilégier l’instant est très important pour ce cinéaste qui recherche par-dessus tout l’authenticité. « Le soir, quand on quittait le plateau, parfois tard, vers 23 heures, on ne savait pas ce qui allait se passer le lendemain. » Il est arrivé à l’équipe de recevoir un courriel, dans la foulée, annonçant l’heure de la reprise. Parfois, c’est un SMS qui arrivait pendant la nuit…
Les proches du réalisateur, qui le placent très haut dans leur estime, et qui pour rien au monde ne rateraient l’aventure, se sont accommodés de ce rythme foutraque. Un technicien du Nord raconte : « Dès que Kechiche demande quelque chose, ils rappliquent autour de lui. C’est une véritable cour, ils supportent tout ! » Quitte à reporter le stress sur les autres. « Un jour, Kechiche a renvoyé une de ses fidèles. Tu es trop nerveuse, tu empêches tout le monde de travailler. Rentre chez toi ! » Une image vient à l’esprit de ce témoin : « On ne nous donnait pas les moyens de travailler. C’est comme si on vous demandait de repeindre un immense hangar avec un petit pinceau. »
« C’EST INCROYABLE LE TEMPS QU’ON A GÂCHÉ »
La nécessité de tout faire « à l’arrache » est en cause, une fois de plus. Le décor ne plaît plus à Kechiche, ou l’empêche de faire le plan dont il rêve ? Une heure avant le « prêt à tourner », le PAT, il faut démolir le mur. Autre exemple , un jour de tournage au lycée Pasteur, à Lille. « Il pleuvait, et bizarrement les costumes des comédiennes traînaient par terre. Pourquoi ? Tout simplement parce que quelqu’un a décidé d’emprunter le camion qui transportait les costumes. Et les vêtements ont été posés là, par terre, sans prévenir. Et tant pis pour ceux qui doivent ramasser ! »
Le mépris pour les techniciens revient comme un refrain. « L’histoire de la montre » est restée dans les esprits. Voici la scène : Léa Seydoux et Adèle Exarchopoulos sont habillées, assises sur un banc, prêtes à jouer. Soudain Kechiche dit à l’une d’elles : « Dans la scène, tu dois regarder l’heure, alors il te faut une montre. Allez chercher une montre ! », ordonne-t-il. Dans ces cas-là, il faut courir comme un lapin, partir toute affaire cessante. Quelqu’un fonce, donc. A son retour, il y a comme un malaise : Kechiche ne regarde même pas la montre qui vient d’être achetée. Car entre-temps, il a changé d’avis. Une autre fois, l’équipe a attendu huit heures que le tournage commence. Kechiche n’était pas prêt, ou réfléchissait. Mais personne n’avait été prévenu et tout le monde tournait en rond. « C’est incroyable le temps qu’on a gâché », se remémore un ancien salarié.
Parfois, le témoignage vire à la rigolade, ou au rire nerveux, tellement c’est gros. Cette fois-ci, l’équipe est sur le plateau. Les deux comédiennes principales ont puisé dans le stock de costumes et ont choisi elles-mêmes leurs vêtements. De toute façon, il n’y avait pas de consigne. Mais la tenue ne plaît pas au réalisateur. « Kechiche a dévisagé tous les membres de l’équipe, détaillant la façon dont chacun était habillé. Soudain, il a dit : ‘Le pull rouge, là, je le veux !' » Quelqu’un est allé négocier, demandant à la fille en question de bien vouloir prêter son pull le temps de la scène.
Morale de l’histoire ? « Je pense que Kechiche a un immense respect pour les comédiens. Mais pas pour les techniciens. » La preuve, poursuit-il, « c’était un jour de tournage dans un appartement. On était persuadés qu’on allait filmer. Au lieu de ça, Kechiche s’est assis à table, dans le décor de la cuisine, avec Léa Seydoux et Adèle Exarchopoulos. Il a demandé à l’un de ses proches d’aller chercher des huîtres et du champagne. Et ils se sont mis à manger. Nous autres, on attendait ». Heureusement, l’espace était suffisamment grand pour que chacun vaque à ses occupations, ailleurs que dans la cuisine. « On n’était pas collés devant la table, à les regarder manger ! Mais il régnait un sentiment bizarre. »
L’heure tourne. Ce technicien pourrait passer la nuit au téléphone à raconter « des tonnes d’anecdotes ». Une dernière avant de raccrocher. C’était un jour où Wild Bunch, producteur principal du film, venait assister au tournage, avec d’autres responsables. Il fallait faire bonne figure, donner l’impression que tout était sous contrôle. Il a donc été décidé de filmer quelques scènes bien ciblées, au lycée Pasteur, ou de refaire des prises qui avaient déjà été faites. A la fin de la journée, un des visiteurs a lâché : « Ben, ça se passe plutôt bien en fait… »
Voir de plus:
Muet puisque absent des César du Cinéma 2014 d’où son film La Vie d’Adèle n’est reparti qu’avec un seul prix, soulevant bien des interrogations, Abdellatif Kechiche était en revanche tout sourire, en chair et en os, du côté de Las Vegas où se déroule actuellement le salon AVN, le rendez-vous incontournable de la planète porno.
Un invité surprise découvert au détour d’une vidéo relayée ici par L’Express, où l’on suit les tribulations d’une jeune actrice X, Carla Cat, et dont c’est la première participation à ce prestigieux rendez-vous du hard. Parmi ses rencontres, un certain Abdellatif Kechiche, dont on entend une bribe de conversation, face caméra. « Je vous ai rencontrée chez un réalisateur de… Qui nous avait fait la cuisine un soir », lâche le cinéaste français. Ce à quoi l’actrice lui répond : « Vous étiez chez John B. Root [un réalisateur porno arty, NDLR] ? » « Oui, c’est mon pote », avouera le metteur en scène franco-tunisien, très souriant.
La discussion va ensuite porter sur la sulfureuse Palme d’or La Vie d’Adèle – alors même qu’Abdellatif Kechiche n’est pas venu à ce salon du X promouvoir son très beau film un brin érotique – que Carla Cat et sa complice Nikita ont découvert peu de temps auparavant. « Les scènes de sexe ont été coupées pour l’avion« , informe Abdellatif Kechiche devant le début d’enthousiasme des deux filles à propos des scènes très chaudes entre Léa Seydoux et la jeune césarisée, Adèle Exarchopoulos. Tous trois se quittent alors sur une promesse : les deux complices reverront La Vie d’Adèle dans la version sortie en salles en octobre dernier.
Mais alors, que venait faire Abdellatif Kechiche dans un lieu si éloigné de son univers artistique ? Bien qu’on sache déjà que son prochain long métrage portera sur une histoire d’amour impossible prenant place en plein Moyen Âge, Abdellatif Kechiche n’aurait pas tiré un trait sur un biopic immortalisant à l’écran Marylin Chambers. En septembre dernier, on apprenait en effet que Kechiche voulait adapter à l’écran « l’histoire de Marilyn Chambers, une star du porno américain des années 1970 qui a fait scandale en couchant à l’écran avec un Noir et qui est morte l’année de l’élection d’Obama« . Au salon de Las Vegas, Carla Cat résume sa rencontre avec le réalisateur : « Il s’intéresse beaucoup au porno. Il aurait apparemment un projet. »
Pour Kechiche, comme il l’avait déclaré dans Télérama, l’histoire de Marylin Chambers est « une histoire magnifique, qui raconte l’Amérique moderne et montre comment des hommes et des femmes exerçant un métier que tout le monde regarde de travers ont fait bouger les mentalités ». Mais bousculé avant la sortie de La Vie d’Adèle, il confiait ses envies d’abandon : « On m’encourage à la réaliser aujourd’hui, mais je crois que je vais dire non. Je n’ai plus envie de cinéma, j’ai besoin de calme. » Mais à en croire sa présence à Las Vegas, il semblerait que le metteur en scène n’ait pas totalement fermé la porte à ce biopic…
Voir par ailleurs:
Les 25 groupies qui ont marqué le rock
“Un rocker peut se sentir une vraie star quand il a au moins une groupie” : le succès des stars du rock s’évalue avec des applaudissements, des ventes d’albums et la plupart du temps avec le nombre de groupies qu’ils possèdent. Ces divas fanatiques représentent le glamour d’une époque. Certaines d’entre elles ont survécu aux excès de ce temps révolu. Voici les plus célèbres reines des coulisses…
1. Pamela Des Barres – Mick Jagger, Gram, Parsons, Jimmy Page
Pamela était connue pour sa beauté, sa personnalité captivante. Pamela a été la groupie de Mick Jagger des Rolling Stones, Gram Parsons, Jimmy Page, Keith Moon et bien d’autres…
2. Tawny Kitaen – David Coverdale, Tommy Lee
Tawny a eu une relation avec David Coverdale, Tommy Lee du groupe Motley Crue, Robbin “Ratt” Crosby et John Taylor de Duran Duran. Elle a été introduite sur la scène glam metal par son petit ami du lycée, Robbin Crosby, fondateur du groupe Ratt.
3. “Cynthia Plaster Caster” Albritton – Frank Zappa, Eric Burdon
Cynthia Albritton a obtenu son nom parce qu’elle a plâtré les membres des musiciens avec lesquels elle a couché. Albritton a couché avec beaucoup de musiciens et a même un plâtre des parties génitales de Jimi Hendrix. Le groupe KISS à dédié une chanson à Cynthia Plaster Caster. Cette chanson est intitulée à juste titre “Caster Plaster”.
4. “Sweet Connie” Connie Hamzy – David Lee Roth, Alice Cooper
Connie Hamzy était aussi connue comme “Sweet Connie” parmi les musiciens pour être une groupie très entreprenante… Elle a même été immortalisée dans une chanson de Grand Funk Railroad appelée “We’re An American Band”.
5. Bebe Buell – Steven Tyler
Bebe Buell est connue pour être l’une des plus belles et célèbres groupies, mais aussi pour être la mère de Liv Tyler. Buell lui a dit la vérité sur son vrai père (le chanteur d’Aerosmith, Steven Tyler) quand elle était adolescente. Bebe est tombée enceinte de Liv en 1977. Mais avant cela, elle était groupie et muse de nombreuses stars du rock dans les années 70.
6. Roxana Shirazi – Steven Adler, Dizzy Reed
Roxana Shirazi a détaillé ses exploits en tant que groupie dans son livre The Last Living Slut. Née en Iran, mais scolarisée en Angleterre, elle a couché avec Steven Adler, Dizzy Reed et Matt Sorum de Guns N Roses, Nikki Sixx de Motley Crue, Joe Leste de Bango Tango, The Rev de Avenged Sevenfold, Tracii Guns de LA Guns et la totalité de la bande Buckcherry.
7. Tura Santana – Elvis Presley
Tura Santana est principalement connue pour avoir couché avec le jeune Elvis. Elle a commencé comme danseuse burlesque et elle a même joué dans quelques films, y compris dans “Des friandises Pussycat!”
8. Sable Starr – Johnny Sable, David Bowie, Iggy Pop
Sable Starr était une célèbre groupie américaine, elle a été vue avec Iggy Pop, Sylvain Sylvain, Stiv Bators, BP Fallon, et plus encore… Une jeune blonde sexy avec une attitude brillante, elle était très appréciée dans le milieu de la musique. Malheureusement Sable est morte à son domicile dans le Nevada le 18 Avril 2009 d’un cancer du cerveau à l’âge de 51 ans.
9. Chris O’Dell – Ringo Starr, Bob Dylan
Chris O’Dell était la célèbre groupie et confidente de certaines des stars de la musique des années 60. Elle était connue pour sa relation avec Ringo Starr des Beatles, même si elle a aussi séduit George Harrison et Paul McCartney.
10. Lori Maddox – Jimmy Page, David Bowie, Bebe Buell
Lori Maddox a commencé à fréquenter le guitariste de Led Zeppelin, Jimmy Page, quand elle avait tout juste 14 ans. Elle a été la source d’inspiration de la chanson “Sick Again”.
11. Marianne Faithfull – Mick Jagger, Brian Jones, Jimi Hendrix, Keith Richards, David Bowie
Connue pour avoir été la petite amie de Mick Jagger. Elle était l’un des emblèmes de la révolution sexuelle. Elle a quitté son premier mari pour Jagger, leur relation était un mix de drogue et de sexe. Elle a eu de graves problèmes de dépendance à l’héroïne qui l’ont amené à vivre dans la rue.
12. Bianca Jagger – Michael Caine, Mick Jagger.
Elle a séduit l’acteur britannique Michael Caine et ensuite, le chanteur Mick Jagger.
13. Anita Pallenberg – Michael Caine, Mick Jagger
Elle est connue pour avoir été la maîtresse de trois des membres fondateurs des Rolling Stones : Brian Jones (en 1965) puis Keith Richards, et elle a eu une liaison avec Mick Jagger.
14. Incident du Mud Shark
Elle est la plus connue de toutes les groupies. En 1969, selon le livre “Hammer of the Gods” Led Zeppelin souille une groupie sans nom à Edgewater Inn Seattle.
http://www.snopes.com/music/artists/mudshark.asp
15. Nico la chanteuse – Lou Reed, Brian Jones, Jim Morrison et Iggy Pop
Nico était une icône du rock. Les conquêtes de la chanteuse allemande incluent Lou Reed, Brian Jones, Jim Morrison et Iggy Pop. Elle est morte en 1988 à 49 ans, après avoir fait une crise cardiaque alors qu’elle circulait à vélo à Ibiza.
16. Cleo Odzer la journaliste
Une journaliste spécialisée dans la musique, originaire d’une famille aisée de New York, Cleo Odzer a été surnommée par le magazine “Time” la “super Groupie”. Elle est ensuite devenue un modèle en Europe, une hippie en Inde et enfin une anthropologue aux USA.
17. Penny Trumble – Jimmy Page, Robert Palmer, Eric Clapton, Rick Springfield, Roger Daltrey, Peter Wolf
Elle s’est permise trois années sabbatiques, de 17 à 20 ans pour répondre et satisfaire les rock stars qui ont croisé son chemin. À 20 ans, elle est allée à l’université, puis s’est mariée et a écrit sa biographie. Le livre a été adapté dans le film “Almost Famous“.
18. Jane Asher – Paul McCartney
A seulement 17 ans, elle a eu la chance d’être embauchée par une émission de la BBC, où les Beatles jouaient et ils ont été captivés par sa beauté. Un an plus tard elle vivait avec Paul McCartney. Elle était très aimée par les fans qui ont vu en elle la compagne parfaite pour leur idole. Mais une nuit Jane trouva Paul avec une autre groupie, Francie Schwartz, et la relation a éclaté à partir de ce moment.
19. Pattie Boyd – Georges Harrison, Ron Wood, Eric Swayne, Mick Jagger, Rod Weston, Eric Clapton
Elle a épousé George Harrison, membre des Beatles. Leur relation a été affectée par les infidélités présumées de l’ancien Beatle. Pattie a alors quitté son mari pour se marier avec Clapton.
20. Uschi Obermaier – Mick Jagger, Keith Richards, Rainer Langhans, Matthias Schweighöfer
Elle est tombée amoureuse de Langhans et est allée vivre dans une communauté hippie. Là, elle a connu la révolution sexuelle. Elle a connu une grande passion pour Jimi Hendrix qui l’a quittée quand elle est devenue accro aux drogues dures et à l’héroïne.
21. Edie Sedgwick – Bob Dylan
Elle était l’exemple type des filles riches et bien éduquées. Elle est arrivée à New York avec l’intention de connaître le monde fou du rock et de la mode. Elle a obtenu des jobs en tant que modèle et a été la muse de nombreux musiciens. Elle est morte d’une overdose à 28 ans. Bob Dylan était le plus célèbre de ses amants.
22. Morgana Welch – Led Zeppelin
Elle a été la chef de file des groupies appelé L.A. Queens au début des années 70. A seulement 16 ans elle a été la favorite de Led Zeppelin. Elle a écrit un livre sur ses expériences appelé Hollywood Daily.
22. Morgana Welch – Led Zeppelin
Elle a été la chef de file des groupies appelé L.A. Queens au début des années 70. A seulement 16 ans elle a été la favorite de Led Zeppelin. Elle a écrit un livre sur ses expériences appelé Hollywood Daily.
24. Kim Kerrigan – Keith Moon, Rod Stewart, Ian Mclagan
Keith et Kim se sont réunis quand ils étaient encore jeunes. Kim, qui avait alors déjà passé plusieurs nuits dans le lit de Rod Stewart, était une belle et jeune femme peu timide… L’année où Keith Moon est mort, elle a épousé le pianiste Ian McLagan.
25. Chrissie Shrimpton – Mick Jagger
Ce fut la première petite amie officielle de Mick Jagger. Le chanteur avait de nombreuses maîtresses et Chrissie, furieuse, l’a quitté à de multiples reprises.. Jagger l’aura d’ailleurs suppliée de revenir avec lui, sans succès.
Voir aussi:
Lars von Trier: “I think working with actors is a little bit how a chef would work with a potato…”
It is well known that Danish director Lars von Trier has not visited America, though many of his films are set here, including his latest feature, “Antichrist,” starring Willem Dafoe and Charlotte Gainsbourg. While his films are not generally known for being light viewing, the current film, which debuted earlier this year in Cannes and screened at the recent Toronto and New York film festivals, is especially layered with disturbing (yet beautiful) imagery and psychological trauma. Seeing the expressions on people’s faces as they exited screenings in Cannes gave a slight hint that, no matter what one ultimately thought of it, “Antichrist” certainly would not be forgettable. Screenings in North America have also been polarizing with critics falling strongly on both ends of the love/hate scale.
The only two characters in the film, Dafoe and Gainsbourg play a grieving couple who retreat to “Eden,” their isolated cabin in the woods, where they hope to repair their troubled marriage and broken hearts following the accidental death of their young son. Despite their effort, things go from bad to worse, with a surreal degeneration into madness. It debuts on VOD tomorrow (October 21st) and in theaters this Friday (October 23rd) from IFC Films.
“Two years ago, I suffered from depression. It was a new experience for me. Everything, no matter what, seemed unimportant, trivial,” von Trier wrote in a statement. “I couldn’t work. Six months later, just as an exercise, I wrote a script. It was a kind of therapy, but also a search, a test to see if I would ever make another film.”
While von Trier does not travel to America, he nevertheless manages to make a presence, and insists on seeing his interviewers. So with the miracle Skype video, indieWIRE spoke with him from his Zentropa offices in Copenhagen last week. Though he speaks openly of debilitating depression and dishes out dark humor, von Trier is surprisingly funny and even jovial – at least during our 20 minutes with him.
In anticipation of speaking with him, indieWIRE solicited questions from our readers. We also threw in a few of our own for good measure. In the interview, von Trier speaks of his depression, airplanes, working with actors, and not wearing pants.
Lars von Trier: Sorry you can only see the top half of me, but I’m not wearing any pants.
Brian Brooks: (Laughs) Neither am I. I’m Brian and this is my colleague Eugene. This is my second time seeing you on video, talking about [“Antichrist”]. The first was at the Toronto [International Film Festival in September], and I know you did the same at the New York Film Festival. I’m just wondering what you think of the reactions in North America to “Antichrist” so far?
Lars von Trier: They are much more positive than I would have thought. Actually, I’m quite fine with any reaction, but I think they’ve seemed a bit more interested in the film. There was a tendency in Cannes, I think, to go a little bit after the man instead of after the ball — that it was very important, what I meant and what I felt — which is, you know, maybe not the best way to see a film.
Brian Brooks: So, as you may know, we solicited our readers for questions to ask you. So I’m gonna go ahead and start that…
Lars von Trier: Okay, so let’s see what happens… [laughs]
Brian Brooks: This is from a film student. His name is Jason Cooper. He said, “I felt that ‘Antichrist’ was very reminiscent of your early work, ‘The Element of Crime,’ and I was wondering if, at least stylistically, you were consciously moving away from your more stripped-down methods that were used in ‘The Idiots’ and ‘Breaking the Waves’?”
Lars von Trier: Yes, I must say I am. You know, doing “Dogville” and “Mandalay” kind of was an example of, you know, going to an extreme where you couldn’t go any further. So I had to kind of went one step back and used only some of the techniques I’ve used before.
Brian Brooks: This was a follow-up question from Jason. “Are you aware of the undercurrent of themes in your work (specifically in ‘Antichrist’), such as nature and its relationship with sexuality, as you write your scripts? Or is this something that comes about after the script?”
Lars von Trier: Yes, I am aware of that, but what I’m not aware of is that suddenly something turns out very simple.
Brian Brooks: Finally, was there a purpose behind only having two actors with this film thematically, or was this the ideal option because you know you would have to direct this film while suffering from depression?
Lars von Trier: No no no. It had nothing to do with that. But I think that any director at a certain time has a dream of making a film with only two persons in it. It’s almost a mini-Dogme thing. It’s interesting to see if you can make it work somehow. It’s egoistic.
Brian Brooks: Alright, different person. From Luke Moses — “Death takes grief and depression to an entirely new level. Knowing your portrayal of what a mother will do to save her child (as shown in ‘Dancer in the Dark’), is ‘Antichrist’ your view on what a mother can be capable of once these incredibly strong and forceful feelings become displaced?”
Lars von Trier: That’s a very good question. I can only say yes, I think so. Yeah, I have thought about that, but she was also in the same situation. Yeah, I can only apologize.
Eugene Hernandez: What do you mean by that?
Lars von Trier: When you put it like that, the film has the tendency to be more banal than it really is. The film is much more than just a foundation for a film. Of course, I work very much with the collisions between different things — sexuality and nature, sexuality and morals — all of these things, but when you have a mention like this, I hope the film is better than that.
Brian Brooks: Okay, probably a more straightforward question from our reader Michael Mohan, “How do you work with actors?” Has that process changed? Is the process different film to film?
Lars von Trier: Yeah, it’s different from film to film. I think working with actors is a little bit how a chef would work with a potato or a piece of meat. You have to kind of have a look at the potato or the piece of meat and see what kind of possibilities are in the ingredient. I know I’m using the wrong metaphor. I think my job is to see what potato is there and from there, just work under their conditions. I don’t think I have forced anybody. Bjork I may have forced here and there. For the good of the film, I just need to give them what they need.
Brian Brooks: Was the experience of working with Willem Dafoe different this time?
Lars von Trier: I was not feeling extremely well, so I didn’t have so much energy for the actors, and they knew that before going in. They were extremely kind to me. I think there’s an interesting thing going on with a director who’s made more than one film or a couple of films [in that] that the actors have a tendency to read your way of filmmaking. A Bergman film becomes a Bergman film because of the expectations of the actors and everyone involved [know] what they expect.
Brian Brooks: The next is from Mike Jones, a writer, “Would you ever make a horror film about flying?”
Lars von Trier: I don’t think so. If I should make a film about flying, it would be fantastic. I have been in airplanes a few times, and it is really a fantastic experience. And that’s not why I don’t go in them. You don’t need a lot of imagination to tell what could go wrong.
Eugene Hernandez: Is it that you don’t like to travel or are there means of travel that you like to avoid?
Lars von Trier: I’m very antisocial actually. Not with you guys, right now, but I’d rather stay home. I do have an auto camper. It would take me some years to be able to get back in a plane. I’m not very proud of this. It would have been nice for me to go take a look at the real world and then see the world and then tell stories about it, but that’s not how it is.
Brian Brooks: The next question is from a reader, Lucas Kollauf – a general question about Dogme. Why did you move away from the Dogme95 movement that you helped create? How does that experience influence or affect your work today if at all?
Lars von Trier: I make rules for all of my films. The Dogme rules were decided to make me concentrate on all the things I was beginning to get good at, like tracking shots. And so for every film, I had rules, I just change them so I don’t make the same film again. “Antichrist” was more of a miss in that sense. I was not on the top of my ability. But normally I would make some rules. There were rules in this film like how panning shots would turn into still shots, but not that many.
Eugene Hernandez: You’ve mentioned that you felt tormented during the film, that it was very challenging for you. Why did you feel like you had to continue making it if it was such a challenge?
Lars von Trier: First of all, I co-own the company and I couldn’t face the financial result of that. And for me, right now, I’m in a situation where I have a lot of mental problems and to me, it was important to make the film to prove to myself that I could make a film.
Eugene Hernandez: Do you feel good about the film now?
Lars von Trier: Some parts of the film I feel good about, but it took me a very long time to feel good at all about this film.
Brian Brooks: Now from Arin Crumley, he’s a filmmaker – and this is sort of a general question: “What is your belief about where fictional stories come from? How do you tap into stories when you write? And, what is the general intrigue of storytelling?”
Lars von Trier: These are questions I’m asking myself now, because I’m working on a new project. Some things that were much easier when we were younger are now much more difficult. It’s like an erection. I can’t really answer that. I wish I could because I would be better off right now.
Eugene Hernandez: What are you working on now?
Lars von Trier: I’m working on a script for a film called “Melancholia,” which has to do with some planets colliding with Earth, which is of course maybe not a happy ending, but an ending. But that doesn’t make me feel depressed at all. That’s fine. I’m just not as cheerful and good at things right now as I could be.
Brian Brooks: This is from the director of programming at Hot Docs, Sean Farnel, “What do you think is the funniest film ever made?”
Lars von Trier: There’s been some Marx Brothers film. I like very much this “Airplane!” The first time I saw it, it was extremely funny (laughs).
Eugene Hernandez: Do you watch a lot of movies while you’re in the writing process?
Lars von Trier: I might watch them, but they don’t [influence my] films. What I do is wrong right now, so maybe I should not watch films. Okay, I hope you guys cheer up before I talk to you again. [laughs]
Voir encore:
De Niro, retour sur un pseudo-martyr judiciaire. L’enquête de Frédéric N’Gguyen sur un réseau de prostitution inquiète beaucoup de monde.
Guy Benhamou
Libération
2 mars 1998
La longue plainte de Robert De Niro n’en finit pas de résonner.
Depuis trois semaines, la star américaine se livre à une véritable attaque en règle contre «la France des droits de l’homme», sa justice en général et le juge d’instruction parisien Frédéric N’Guyen en particulier. Lequel juge a osé mettre la star en garde à vue, le 10 février, afin de l’entendre à titre de témoin dans une affaire de proxénétisme international. Imprudemment soutenus dans leur croisade par le microcosme artistico-médiatique, l’artiste et ses alliés multiplient les déclarations incendiaires dénonçant la «chasse aux sorcières», le pouvoir «déplorable» accordé aux juges, la «sale besogne» d’un magistrat «narcissique», avide de «publicité». Au point que, vendredi, le Syndicat de la magistrature a fini par demander à la ministre de la Justice, Elisabeth Guigou, «d’assurer publiquement sa protection» au juge Frédéric N’Guyen, «qui fait l’objet, sans pouvoir y répondre, d’attaques personnalisées proprement inacceptables».
Injures. Pourtant, le sieur De Niro a bien bénéficié d’un traitement judiciaire particulier. Mais plutôt en sa faveur. C’est du moins ce qu’avouent en sourdine les enquêteurs, face à la multiplication des entorses aux règles judiciaires qui ont émaillé l’interpellation du célèbre témoin.
Ainsi, le mardi 10 février, lorsque les sept hommes de la Brigade de répression du proxénétisme (BRP), accompagnés d’une interprète assermentée, se présentent à l’hôtel Bristol, rue du Faubourg-Saint-Honoré, à Paris, De Niro refuse obstinément de leur ouvrir la porte de la suite numéro 450 qu’il occupe. Lorsqu’ils peuvent enfin pénétrer dans l’appartement, ouvert par un membre du personnel de l’hôtel, ils essuient sans broncher et pendant de longues minutes les bordées d’injures de l’artiste, visiblement très énervé. Ils laissent même Robert De Niro téléphoner à son avocat, Me Georges Kiejman, avant de recevoir l’ordre de quitter les lieux. Il n’existe qu’un précédent célèbre. C’était en juin 1996, lorsque les policiers accompagnant le juge Halphen s’étaient vu intimer l’ordre par leur hiérarchie de ne pas assister le magistrat lors de sa perquisition au domicile du maire de Paris, Jean Tiberi. Pour avoir couvert cette irrégularité, le patron de la police judiciaire, Olivier Foll, avait été privé pendant six mois de son habilitation de police judiciaire par la chambre d’accusation.
Au coeur du dossier. Au Bristol, les choses rentreront dans l’ordre vers 10 h 45, après l’arrivée d’un des patrons de la BRP muni d’une nouvelle commission rogatoire du juge. Robert De Niro consent alors à suivre les policiers, mais ni la fouille à corps, ni la perquisition de l’appartement, pourtant notifiées, ne seront exécutées. Alors même que ces deux exigences justifient le mode opératoire adopté. En effet, s’il s’était agi d’entendre De Niro à titre de témoin, une simple convocation aurait suffit. «Mais ce n’est pas un témoin de circonstance, explique un avocat du dossier. Monsieur De Niro n’est pas le quidam qui passe par hasard sur le lieu d’une infraction et à qui on demande de venir raconter ce qu’il a vu. Il est au coeur du dossier.» L’artiste est en effet l’un des clients présumés d’un réseau de prostitution qu’auraient mis sur pied le photographe de charme Jean-Pierre Bourgeois et une ex-mannequin suédoise, Anika Brumarck. La filière a été dénoncée par un informateur anonyme de la BRP en octobre 1996. Elle fonctionnait depuis 1994, comme l’établira rapidement l’information judiciaire, confiée au juge N’Guyen le 24 octobre 1996. Anika Brumarck gérait les opérations depuis son appartement du XVIe arrondissement parisien. Usant de sa profession de photographe, Bourgeois se serait occupé de recruter les jeunes filles, alléchées par des propositions de petits rôles au cinéma ou de modèle photo pour des campagnes publicitaires. «Il a un vrai don pour repérer des proies faciles», assure un enquêteur, qui évoque avec dégoût l’exploitation de ce «sous-prolétariat d’aspirantes à une carrière de figurantes». Catalogue. Etudiantes sans le sou, vendeuses de fast-food, filles de la Ddass se laissent attirer dans l’appartement de Bourgeois, pour une première séance de photos nues, au Polaroïd. Ces clichés sont la base du catalogue qui sera proposé aux «clients». Il comporte sept ou huit noms de prostituées professionnelles haut de gamme, et une quarantaine d’autres, non professionnelles. Ensuite, selon les témoignages de plusieurs filles, Bourgeois propose aux modèles de leur raser une partie du sexe, pour des raisons «esthétiques». Opération généralement suivi d’un rapport sexuel. A ce stade, certaines candidates se rebiffent. Quelques-unes portent plainte pour viol et tentative de viol. D’autres passent le cap, afin de préserver leurs chances de décrocher un contrat, sans savoir qu’elles vont se retrouver dans un réseau de prostitution. Et une partie de celles-ci, confrontées à la réalité de leur premier client, iront également se confier à la justice. Les accusations de violences sexuelles sont d’ailleurs si nombreuses dans ce dossier que le parquet de Paris a décidé de le couper en deux. Le juge N’Guyen instruit donc en parallèle le proxénétisme aggravé et les viols et tentatives liées au réseau, pour lequel il dispose d’une multitude de plaintes de gamines, à l’encontre des instigateurs comme de certains clients.
Branche américaine. Bourgeois se serait essentiellement occupé de la clientèle moyen-orientale, grâce notamment à ses relations avec Nazihabdulatif Al-Ladki, secrétaire du neveu du roi d’Arabie Saoudite. Bourgeois, Brumarck et Al-Ladki sont actuellement incarcérés à Fleury-Mérogis. La partie américaine aurait été l’affaire du Polonais Wojtek Fibak, ex-tennisman de renom et ex-entraîneur de Lendl et de Leconte. C’est notamment lui qui aurait présenté Bourgeois à De Niro et qui aurait assuré le développement de la clientèle américaine, tout en recrutant de son côté quelques candidates. Pas toutes consentantes, apparemment, puisque Fibak fait lui aussi l’objet d’une mise en examen pour «agression sexuelle et tentative de viol». Carnet d’adresses. La déposition de De Niro était nécessaire afin d’établir les faits de proxénétisme. Car l’artiste reconnaît avoir eu des relations sexuelles avec au moins deux jeunes femmes qui lui auraient été présentées par Bourgeois. «Dans ce cas très précis, explique un avocat de la partie civile, c’est le client qui induit le proxénétisme.» Habituellement, le client s’adresse à une fille, la paie et s’en va. Aux policiers de démontrer que le souteneur présumé reçoit une partie des sommes et qu’il vit aux crochets de la belle. «Là, c’est l’inverse, poursuit l’avocat. Le client est d’abord au contact de l’intermédiaire. Le proxénétisme est établi d’emblée. Et le juge était sans doute très intéressé par le carnet d’adresses et les agendas de l’artiste, qui auraient pu révéler d’autres contacts. Il lui fallait donc ordonner une perquisition, ce qui excluait le recours à la convocation ordinaire.»
Lors de son audition par le juge, Robert De Niro a longuement répondu aux questions. Ces informations, Frédéric N’Guyen les attendait depuis le 14 novembre 1997, date de la délivrance de sa première commission rogatoire visant l’acteur. Trois longs mois avant que les enquêteurs ne se décident. Le 6 février, ils se présentent au Bristol une heure après le départ de De Niro, retourné aux Etats-Unis pour quelques jours. Pas de chance. D’autant que ce ratage est accompagné d’une première fuite bien préparée vers la presse, qui évente l’opération. Fuite réitérée lors de l’interpellation de l’acteur, qui se retrouvera face à une meute d’objectifs et de caméras à sa sortie du palais de justice, vers 21 heures.
Offensive médiatique. A partir de ce moment, les choses tournent au vinaigre pour le juge N’Guyen. Le soir même de l’audition de De Niro, Me Kiejman dépose une plainte contre le magistrat pour «violation du secret de l’instruction» et «entrave à la liberté d’aller et venir». Après quelques jours de répit, l’offensive repart du Festival cinématographique de Berlin, passe par les pages du Monde, qui publie une longue interview de De Niro, et s’étale sur Canal +, lorsque Guillaume Durand invite la star dans Nulle part ailleurs. En fait, on apprend, grâce au Canard enchaîné, que Durand a reçu De Niro chez lui quelques jours avant. Et que, lors de cette petite sauterie organisée pour l’anniversaire de l’animateur télé, Elisabeth Guigou, ministre de la Justice, invitée elle aussi, s’est entretenue une demi-heure en tête à tête avec l’acteur, comme en convient le cabinet de la ministre. Sans compter une mystérieuse visite nocturne au bureau du juge, constatée par les gendarmes du palais de justice le 17 février. Show business. «Il y a une réelle tentative de déstabiliser le juge et de plomber le dossier, estime un avocat du côté des parties civiles. Et De Niro n’est qu’un prétexte dans cette opération.» Il pourrait dissimuler une tentative de sauvetage du producteur de cinéma Alain Sarde. Client présumé du réseau, Sarde est accusé de viol et de tentative de viol par deux jeunes femmes que lui aurait présentées Bourgeois. Sarde, qui nie les faits, est défendu par Georges Kiejman. Comme De Niro. Sarde bénéficie du soutien de grands noms du show business. Dont une partie de ceux qui défendent De Niro. Le patron de Canal +, Pierre Lescure, a adressé au juge une attestation de moralité en faveur d’Alain Sarde. Canal +, qui contrôle la société de production les Films Alain Sarde-Canal +, assure la défense de De Niro, via les interventions de Kiejman et de l’acteur sur son antenne. Effets du hasard, ou scénario bien écrit?
Voir enfin:
The sex scandal that wouldn’t lie down
John Lichfield
The Independent
15 November 1998
IT READS like the synopsis of a trashy airport novel: sex, movie stars, politicians, Arab princes, arms deals and the courageous investigation of an obstinate, incorruptible – and publicity-hungry – judge. But the evidence to be presented to a criminal court in Paris this week also has a disturbing side – or, rather, two disturbing sides.
The case uncovers the brutal methods used to snare young women – some as young as 15 – into a call-girl agency specialising in wealthy, high- profile clients. It also exposes attempts by the French government machine to block an investigation which might embarrass senior politicians and damage French interests abroad.
Six people are charged with the running of an international prostitution ring, whose call-girls entertained the actor Robert de Niro, the former tennis player, Wojtek Fibak, two senior (but unnamed) French politicians and several Gulf princes. The agency specialised in tricking, or trapping, star-struck teenage girls into selling their bodies with the promise of careers as models or actresses.
At one point, according to the report of the investigating judge, the agency became a kind of approved dealer in girls, operating with the connivance, if not the blessing, of the French foreign ministry and French secret services. By steering Middle East arms clients towards girls from a known, and closely watched, agency, there was thought to be a reduced risk of blackmail, or the leaking of secret negotiations.
Leaks from the French investigation last year suggested that the agency once brokered a $1m (pounds 625,000) deal for an Arab prince to spend a night with a Hollywood actress. The woman named by French magazines at the time has adamantly denied the story. The allegation does not form part of the final judicial report.
The two principal accused are Jean-Pierre Bourgeois, 51, a failed fashion and glamour photographer and Annika Brumark, 50, a Swedish former model and one-time beauty queen. They, and four others, will be charged before the Tribunal Correctionel in Paris tomorrow with procurement or complicity in procurement. (Prostitution is legal in France; procurement is not.) Mr Bourgeois also faces possible additional charges of rape.
The French Brigade de Repression de Proxenetisme (the equivalent of the Vice Squad) traced 89 young women – would-be models or actresses – who said they had been tricked or sometimes physically constrained by Ms Brumark and Mr Bourgeois into working for them. According to the judicial report, the girls were sometimes « sold on like cattle » to other call- girl agencies.
The files of clients’ names seized by the police are said to include many well-known members of the sports and show-business jet-set on both sides of the Atlantic. The only names to emerge so far are De Niro, Fibak and the French film producer, Alain Sarde.
De Niro, despite a much publicised « arrest » in Paris while filming a movie earlier this year, was questioned only as a witness and occasional client of the network’s prostitutes. He is suing the investigating magistrate, Frederic N’Guyen Duc Quang, following his highly publicised interrogation; the actor’s lawyers accuse the investigator of deliberate publicity-seeking. Messrs Fibak and Sarde are the subject of a separate judicial investigation.
The client list is also said to have included two senior French centre- right politicians, whose names have not been leaked. Both the French foreign and interior ministries tried to squash or limit the investigation in its early months – the interior ministry because of the possible embarrassment to senior politicians, the foreign ministry because it did not want to upset Middle Eastern buyers of French armaments.
Judge N’Guyen is one of a new breed of judicial investigators in France who refuse to bow (as their predecessors routinely did) to political pressure. Even so, he only began to make real progress when the centre- right French government fell in June last year and was replaced by a Socialist- led government.
According to Judge N’Guyen’s report, the photographer, Mr Bourgeois, hung about Parisian night clubs or casting agencies, scouting for possible victims. He picked on young women, often teenagers – mostly French, but also from Britain and eastern Europe – and invited them to his apartment in the respectable 17th arrondissement to take trial shots.
After gaining their confidence, the judge alleges, he persuaded them to pose for more revealing pictures. The girls were then convinced, if possible, that prostitution was the best way to get into modelling or movie careers. If they refused, they were blackmailed with the threat that the photographs would be sent to their families. In some cases, they were simply abducted. Several girls cited in the investigating judge’s report accuse Mr Bourgeois of rape.
Pictures of the girls were then circulated among possible clients. The presence on the client list of a well-known movie producer such as Mr Sarde allegedly helped Mr Bourgeois and Ms Brumark to perpetuate the myth that prostitution was a prelude to stardom.
The agency’s downfall came soon after it expanded to the lucrative Gulf market in 1996, with the alleged help of a third accused, Nazihbdullatif al-Ladki, a Lebanese businessman. Mr Bourgeois, according to the indictment, travelled to Latvia to scout for more victims, but his activities were reported by a local model agency and the French vice squad was alerted.
COMPLEMENT:
Now that he’s dead, the old sleaze in the Playboy mansion is being spoken of as some kind of liberator of women. Quite the opposite
Suzanne Moore
The Guardian
28 Sep 2017
Long ago, in another time, I got a call from a lawyer. Hugh Hefner was threatening a libel action against me and the paper I worked for at the time, for something I had written. Journalists live in dread of such calls. I had called Hefner a pimp. To me this was not even controversial; it was self-evident. And he was just one of the many “libertines” who had threatened me with court action over the years.
It is strange that these outlaws have recourse in this way, but they do. But at the time, part of me wanted my allegation to be tested in a court of law. What a case it could have made. What a hoot it would have been to argue whether a man who procured, solicited and made profits from women selling sex could be called a pimp. Of course, central to Playboy’s ideology is the idea that women do this kind of thing willingly; that at 23 they want nothing more than to jump octogenarians.
Now that he’s dead, the disgusting old sleaze in the smoking jacket is being spoken of as some kind of liberator of women. Kim Kardashian is honoured to have been involved. Righty ho.
I don’t really know which women were liberated by Hefner’s fantasies. I guess if you aspired to be a living Barbie it was as fabulous as it is to be in Donald Trump’s entourage. Had we gone to court, I would like to have heard some of the former playmates and bunnies speak up in court – because over the years they have.
The accounts of the “privileged few” who made it into the inner sanctum of the 29-room Playboy mansion as wives/girlfriends/bunny rabbits are quite something. In Hefner’s petting zoo/harem/brothel, these interchangeable blondes were put on a curfew. They were not allowed to have friends to visit. And certainly not boyfriends. They were given an “allowance”. The big metal gates on the mansion that everyone claimed were to keep people out of this “nirvana” were described by one-time Hefner “girlfriend no 1” Holly Madison in her autobiography thus: “I grew to feel it was meant to lock me in.”
The fantasy that Hefner sold was not a fantasy of freedom for women, but for men. Women had to be strangely chaste but constantly available for the right price. Dressing grown women as rabbits – once seen as the height of sophistication – is now seen as camp and ironic. There are those today who want to celebrate Hefner’s contribution to magazine journalism, and I don’t dispute that Playboy did use some fantastic writers.
Part of Hefner’s business acumen was to make the selling of female flesh respectable and hip, to make soft porn acceptable. Every man’s dream was to have Hefner’s lifestyle. Apparently. Every picture of him, right to the end, shows him with his lizard smirk surrounded by blonde clones. Every half-wit on Twitter is asking if Hefner will go to heaven when he already lived in it.
Hugh Hefner in 2007 introducing the new season of his TV show “Girls of the Playboy Mansion”
But listen to what the women say about this heaven. Every week, Izabella St James recalls, they had to go to his room and “wait while he picked the dog poo off the carpet – and then ask for our allowance. A thousand dollars counted out in crisp hundred dollar bills from a safe in one of his bookcases.”
If any of them left the mansion and were not available for club nights where they were paraded, they didn’t get their allowance. The sheets in the mansion were stained. There was to be no bickering between girlfriends. No condoms could be used. A nurse sometimes had to be called to Hefner’s “grotto” if he’d had a fall. Nonetheless, these young women would have to perform.
Hefner – repeatedly described as an icon for sexual liberation – would lie there with, I guess, an iconic erection, Viagra-ed to the eyeballs. The main girlfriend would then be called to give him oral sex. There was no protection and no testing. He didn’t care, wrote Jill Ann Spaulding. Then the other women would take turns to get on top of him for two minutes while the girls in the background enacted lesbian scenarios to keep “Daddy” excited. Is there no end to this glamour?
Well now there is, of course. But this man is still being celebrated by people who should know better. You can dress it up with talk of glamour and bunny ears and fishnets, you can talk about his contribution to gonzo journalism, you can contextualise his drive to free up sex as part of the sexual revolution. But strip it all back and he was a man who bought and sold women to other men. Isn’t that the definition of a pimp? I couldn’t possibly say.
To claim that Hefner was a sexual liberationist or free speech idol is like suggesting that Roman Polanski has contributed to child protection
Julie Bindel
The Independent
29 September 2017
On hearing that the pimp and pornographer Hugh Hefner had died this morning, I wished I believed in hell.
“The notion that Playboy turns women into sex objects is ridiculous,” said the sadistic pimp in 2010. “Women are sex objects… It’s the attraction between the sexes that makes the world go ‘round. That’s why women wear lipstick and short skirts.”
Hefner was responsible for turning porn into an industry. As Gail Dines writes in her searing expose of the porn industry, he took it from the back street to Wall Street and, thanks in large part to him, it is now a multibillion dollar a year industry. Hefner operated in a country where if you film any act of humiliation or torture – and if the victim is a woman – the film is both entertainment and it is protected speech.
He caused immeasurable damage by turning porn – and therefore the buying and selling of women’s bodies – into a legitimate business. Hefner hated women and referred to them as “dogs”.
In 1963, Gloria Steinem (then a freelance journalist) decided to go undercover as a Bunny Girl, spending two weeks in the role at the Playboy Mansion. What Steinem found was that the women working there were treated like dirt. Bunnies had to wear heels at least three inches high and corsets at least two inches too small everywhere except the bust, which came only with D-cups. Steinem described it as a form of torture. A sneeze could break the zip, and when peeled off their torsos were bright red and swollen.
Steinem found grotesque misogyny towards the women, and commented that they were “dehumanised” by the punters – who were, after all, following Hefner’s lead.
“These chicks [feminists] are our natural enemy. It is time to do battle with them,” wrote Hefner in a secret memo leaked to feminists by secretaries at Playboy. “It is time we do battle with them… What I want is a devastating piece that takes the militant feminists apart.” As a response, feminists began picketing his businesses.
Admitting that he could only orgasm by masturbating to pornography, Hefner was a sexual predator. The young women who worked at the Playboy Mansion have spoken of their disgust in having sex with him, but said it was, “part of the unspoken rules”. “It was almost as if we had to do it in return for all the things we had,” said one.
British twins Carla and Melissa Howe, who lived at Playboy Mansion for a time, told a newspaper in 2015 that security was so strict that it was “like being in prison”. They also said of the men that visit the Mansion: “They were really pervy; all the girls were fighting to run away.”
Described as “modern, trustworthy, clean, respectable” by Time magazine in March 1963, Hefner has been regularly rebranded as a type of cultural attache rather than the woman-hating sleazebag he was.
To claim that Hefner was a sexual liberationist or free speech idol is like suggesting that Roman Polanski has contributed to child protection.
I would imagine that silk pyjama manufacturers are mourning Hefner, but no feminist anywhere will shed a tear at his death. And the liberal leftists that wax lyrical about how Hefner was a supporter of anti-racist struggles should perhaps ask themselves how such a civil rights champion squared this with the millions he made from selling the most vile racism in much of his pornography.
As I was writing this, a flagship news programme asked if I would take part this evening in an item in Hefner’s legacy. “We’re looking to discuss whether he was a force for good or bad. Did Hefner revolutionise feminine sexuality, or encourage the degradation of women by constructing them merely as objects of desire?”
Now he is dead I would imagine the scores of women he abused will come forward and force his liberal supporters to see him for what he really was – sexist scum of the lowest order.
California Journal: Hugh Hefner preached sexual liberation, but he never stopped exploiting women’s bodies
Robin Abcarian
LA Times
Sept. 28, 2017
Years ago, I pulled into a long driveway in Holmby Hills, then stopped in front of an imposing wrought-iron gate. I had been directed to announce myself to a large boulder on my left, which I did. The gates swung open.
Suddenly, I was outside the storied Playboy Mansion, a beautiful stone chateau that had become synonymous with orgiastic bacchanals (is that redundant?) tossed by its owner, Hugh Hefner, who died Wednesday at 91. Those parties — decorated by scantily clad young women — were rites of passage for scores of horny Hollywood types and professional athletes.
As I parked, I realized something was not quite right. A bright plastic baby swing hung from a graceful tree near the mansion’s imposing front door. Children’s toys were scattered about. Hefner was married — to Kimberly Conrad, a former Playmate of the Year. Their son, Marston, was a toddler.
People magazine had treated their 1989 marriage as a modern-day miracle: “Next week, Hell freezes over,” it declared.
After Hefner’s brief foray into domesticity, he reverted to his former sexual libertinism. He was frequently photographed with an evolving trio of buxom blonde young women. I’m sure there’s nothing sexier than being treated interchangeably by a man who has got at least half a century on you.
Hefner married again, in 2012, to a woman 60 years his junior, who has now become his widow.
Anyway, I’d come to the mansion to interview Wendy Hamilton, a 23-year-old from Detroit who had been selected to be Playboy magazine’s Miss December 1991. I was told by the magazine people that I was the first reporter they’d ever allowed to witness a centerfold shoot, which I had done some days earlier in the studios of the Playboy building on Sunset Boulevard.
It was the least sexy photo shoot I’d ever seen, but it was the culmination of a girlhood dream for Hamilton. When she was 10, she saw her father’s Playboy centerfold calendar in the garage and solemnly told him, “One day, Daddy, I am gonna be one of those girls.”
Who knows how many other little girls were infected by the idea that taking off their clothes for men would be the pinnacle of achievement?
::
Above all, Hugh Hefner was in the fantasy business.
Men’s fantasies, for sure. But women’s fantasies, too. Not their sexual fantasies, mind you. Their fantasies about male attention, self-esteem and success.
It is an enduring irony to me that Hefner, who pushed what he called a “wholesome” version of female sexuality in the pages of his magazine (pretty faces, big boobs, no pubes), probably did more to mainstream the exploitation of women’s bodies than any other figure in American history.
Really, he managed one of the greatest cons of all time: In the decades that American women were liberating themselves at home and in the workplace — and actually forcing the creation of new legal concepts like sexual harassment and date rape — he managed to convince many women that taking off their clothes for men’s pleasure was not just empowering, but a worthy goal in itself. The deception was also extremely profitable; Hefner became a multimillionaire along the way.
He did not coin the phrase “the male gaze” (credit for that goes to a feminist film critic) but he certainly embodied the aesthetic notion that images of women — and women themselves — exist to please men.
“Playboy,” he once said, “treats women — and men, too, for that matter — as sexual beings, not as sexual objects. In this sense, I think Playboy has been an effective force in the cause of female emancipation.”
That is denial of the highest order. Had he been truly committed to “female emancipation,” he would have embraced the idea that women, not just men, can be sexual their entire lives.
Instead, as you can see from his marriage, his dating history and the pages of his magazine, women have a well-defined shelf life.
After, say the age of 30, they not only expire, but also cease to exist, naked or otherwise.
::
The pajama-clad, pipe-smoking Hefner will remain a paradoxical figure in American culture.
His magazine was a repository of smart journalism. And in years past, the Playboy Foundation supported organizations devoted to laudable goals like reproductive rights and civil liberties.
Certainly, Hefner waged a much-needed battle against the forces of 20th century American puritanism, but sadly, in a way that liberated men (or at least their masturbatory fantasies) by objectifying women.
Eventually, as was bound to happen, the culture passed Playboy by.
The internet and the cellphone conspired to make Playboy-style nudity quaint. In 2015, the magazine announced it would no longer publish fully naked photographs of women, just suggestive ones. By that point, who even cared?
Playboy’s effect on the way young women are viewed and treated is irrevocably ingrained in the culture. Look no further than the grabby occupant of the Oval Office.
I wanted to get a male perspective on Hefner’s passing, so I walked over to my father’s house. At 88, he’s a retired Cal State Northridge English professor and a guy who became something of a swinging single himself after my parents divorced in the late 1970s.
“What did you think of him, Dad?” I asked.
My father leaned back in his chair and looked at the ceiling for a moment. “Well,” he said, “he really was a sexist.”
Well said, Pops.
Hugh Hefner’s legacy has a dark side
Peggy Drexler
CNN
September 29, 2017
In remembering Hugh Hefner, who has died at 91, many are talking about his contributions to American culture. It must be added that – while those contributions loom large – they also cast a considerable shadow.
The founder of the Playboy brand was a media pioneer and icon of the left, an early and very vocal advocate for free speech, civil rights and sexual liberation.
There is no question: As an activist, “Hef” paved the way for open talk about sex and sexuality, giving people permission to admit that they too were sexual beings, and enjoyed – or at least wanted to enjoy – sex. In the Playboy clubs he opened in the 1960s, he hired black comics at a time when many clubs were de facto segregated. Meanwhile, as a publisher, he pushed boundaries with articles (yes, the famous “articles” that men claimed they sought in Playboy) that were groundbreaking: investigative pieces by writers like Hunter S. Thompson and interviews with heavyweights like Martin Luther King.
He was also a fine example of the American dream, having launched the magazine with $600 of his own and $1,000 borrowed from his mother.
But it’s also worth pointing out, in the spirit of the sort of open cultural dialogue he worked his whole life to encourage, that Hefner’s egalitarian society was one largely envisioned and created for men.
The terms of his rebellion undeniably depended on putting women in a second-class role. It was the women, after all, whose sexuality was on display on the covers and in the centerfolds of his magazine, not to mention hanging on his shoulder, practically until the day he died.
Hef’s notion of the freedom to express sexuality translated largely into freedom to express men’s desire for women, and the fantasy that those women would be always ready and eager to comply.
And it wasn’t just about business: Hefner himself bragged about sleeping with more than a thousand women. In her 2015 memoir, “Down the Rabbit Hole,” former Playmate and Hef girlfriend Holly Madison described the Playboy Mansion as a place where Hef would encourage competition – and body image issues –between his multiple live-in girlfriends. His legacy is full of evidence of the exploitation of women for professional gain. In creating Playboy, and maintaining its brand over six decades, Hef championed a world in which women serve to delight and entertain men, where their bodies are objects, where modification to appeal to male senses often took precedence over comfort (because who really wants DDDs?).
Why is Playboy giving up nudity?
Women were bunnies – the “lucky ones,” anyway. The smart pieces by well-known journalists that he ran in his magazine – even female journalists, like Margaret Atwood – were designed to enrich the intellect of the magazine’s male readers.
Even when, a few years back, the magazine rebranded with a “no more nudity” edict as a way to increase the magazine’s appeal to 20- and 30-something readers (who presumably did want to read it for the articles), it remained a place for men. And, of course, although Playboy did away with full nudity for at least a little while, back in 2015, and for a time featured actresses and models in their underwear, that did nothing to change the enterprise’s foundational principle: objectification of women. (Not surprisingly full nudity returned, inevitably, earlier this year.)
That’s another Hefner legacy: whetting the appetite for readily available sex, which the internet now provides in spades.
All of which is not to say that Hefner’s life should not be celebrated – in some way. He was a man of many facets, who certainly made an impression on American society.
But we should recognize that his legacy is not an unimpeachable one. It is, to say the least, a complicated one. Was Hefner a feminist? He may have thought he was. But perhaps like many men of a certain age, his definition of it was surely – and sorely – due for a tune-up.
Editor’s Note: Peggy Drexler is the author of “Our Fathers, Ourselves: Daughters, Fathers, and the Changing American Family” and “Raising Boys Without Men.” The opinions expressed in this commentary are hers.
Will the case of a prominent pedophile finally upend outdated ideas about sexually liberated French girlhood?
Valentine Faure
NYT
Feb. 20, 2020
PARIS — France has spent the last two years or so waiting for its Harvey Weinstein moment: a big trial, the fall of someone powerful, a viscerally indignant country.
The conversation around #MeToo in France has been undeniably intense. But when Frenchwomen have spoken up against film directors (Luc Besson, Roman Polanski) and intellectuals (Tariq Ramadan), they have always faced the usual victim blaming. That then leads to divided opinions, aborted prosecutions, and meditations on the French art of seduction.
Something seems to have happened, however, with the case surrounding the acclaimed writer Gabriel Matzneff, whose taste for teenage French girls and young Asian boys, is no secret — he wrote extensively about this habit for years — but who, as of this month, is finally facing charges for promoting the sexual abuse of children. The charges come shortly after the release of a book by Vanessa Springora, the head of a Paris-based publishing house, whose memoir of her abusive relationship with Mr. Matzneff seems to have finally cracked the dam.
What makes the story so powerful stems from the age difference of the protagonists — Ms. Springora became sexually involved with Mr. Matzneff in the mid-1980s, when she was 14 and he was 50. What makes this case so particular is also the fact that the victim’s account can’t be challenged; her abuser has already proudly confessed everything. But in her memoir, Ms. Springora has done more: She has unveiled the inner life of one of the children “Under 16 Years Old,” as one of Mr. Matzneff’s books was titled — one of those who, until now, inhabited his world as simply a docile character to be acted upon. In doing so, she has built a bridge between two moral revolutions.
One day, I hope, we will look back on these months and see that they marked the end of a long state of confusion around the French adolescent girl, the “jeune fille,” this liberated, daring, literate creature. My mother, who was 18 years old during the revolution of May 1968, told me that a man passing by in the street asked her if she would sleep with him. No, she told him, she wouldn’t. “Damn bourgeoise!” the man spat at her.
One can imagine the difficulties that must have faced the girls caught between the joy of being sexually liberated and the injunction to be so. And, looming on the horizon, the requirement not to be liberated too much. At that time, a woman could vote or inherit property only at age 21, but could marry at 15: things were certainly confusing. The French language doesn’t offer the linguistic crutch of “teen” years: You’re douze ans, then treize, quatorze, quinze …
The Matzneff story has brought back memories of the case for pedophilia made by a small intellectual elite who toyed with sexual transgression to the point of insanity in 1968. Most of France did not go quite so far. But the figure of the jeune fille did epitomize a confusion around a new sexual order that was not in order yet. In between the clear states of childhood and adulthood arose this new being. What would she be like? What was really permitted?
Vanessa Springora came of age at that time. I imagine that like me, she must have grown up watching movies on VHS by Maurice Pialat, Éric Rohmer, Claude Miller, Benoît Jacquot, all directors fascinated by adolescent girls and trying to understand them, in efforts that felt sometimes generous and delicate, and sometimes disturbing. Their girl characters were smart and deep and precocious, and their torments were taken seriously. Parents were often not in the picture; men, more or less reassuring, were never far away. These weren’t uplifting teen movies, but films for adults portraying girls in a way that probably shaped those of us watching in return.
My husband, who is American, is scandalized by the Rohmer movie “Pauline à la plage” (“Pauline at the Beach”), in which a small group of young adults share matters of the heart with a 15-year-old. I am almost offended by his outrage, for I would like to think of my adolescent self as Pauline, more clearsighted in her own desires than the adults around her. Was I?
I will spare him “Noce Blanche, (“White Wedding”) in which a 16-year-old Vanessa Paradis has an affair with her middle-aged philosophy teacher, or “Beau Père,” which tells the story of an affair between a 14-year-old and her stepfather almost as if it were a comedy, or “Un moment d’égarement” (“One Wild Moment”) — originally made in 1977, then remade in 2015 — in which a teenager sleeps with her father’s best friend. “Times have changed: It’s no longer with their wives that people cheat on their friends, but with their daughters,” said the critic of Le Monde when the original film came out.
But what did the real-life daughters really want? The director of “Noce Blanche,” which was a big success in France, would eventually be convicted of sexually harassing two actresses. But we would learn that later.
It is easy to imagine how the story of Vanessa Springora and Gabriel Matzneff could have made a typically French film of the ’80s: the literate Parisian teenager and the scandalous writer, a fascinating dangerous liaison in the arty St.-Germain-des-Prés neighborhood. There would have been an ambiguous supporting role for the mother, a little confused, a little jealous. The film would have ended when they broke up.
We might have secretly envied this girl, who had lived such a forbidden adventure. A writer I know, who is the same age as Ms. Springora and grew up in St.-Germain-des-Prés, told me, “I was lucky never to meet Matzneff, because I was completely fascinated by him. “
In her book, Ms. Springora does not deny that she consented to the affair. And yet there is no doubt in the mind of the reader that she is a victim. In the wake of the publication of her book, the philosopher Alain Finkielkraut has repeated, with the same passion he showed when he defended Mr. Polanski, that “a teenager and a child are not the same thing” and that it was a different era. What Ms. Springora’s book demonstrates is that these may both be true, but they are by no means an argument. As Nabokov once said, “outside of Mr. Humbert’s manic gaze, there is no nymphet.”
Ms. Springora’s great contribution is to expose the ravages of a relationship that may have been desired. She sends the responsibility back to the adult with a simple sentence: “It is not my attraction that needed to be questioned, it is his.” Something has changed in the kingdom of the jeune fille.
A few weeks before the book’s release, the actress Adèle Haenel shocked the French public with a momentous interview with the online magazine Mediapart in which she described being abused when she was 12 to 15 by a 36-year-old director, Christophe Ruggia, who thought they were “in love.”
One can imagine how amazed the vain Mr. Matzneff must be to realize how he is remembered, to find out that young girls don’t disappear when they grow up. They age; they become women able to speak for the very young girls they once were, who got trapped in the dreams of others.



























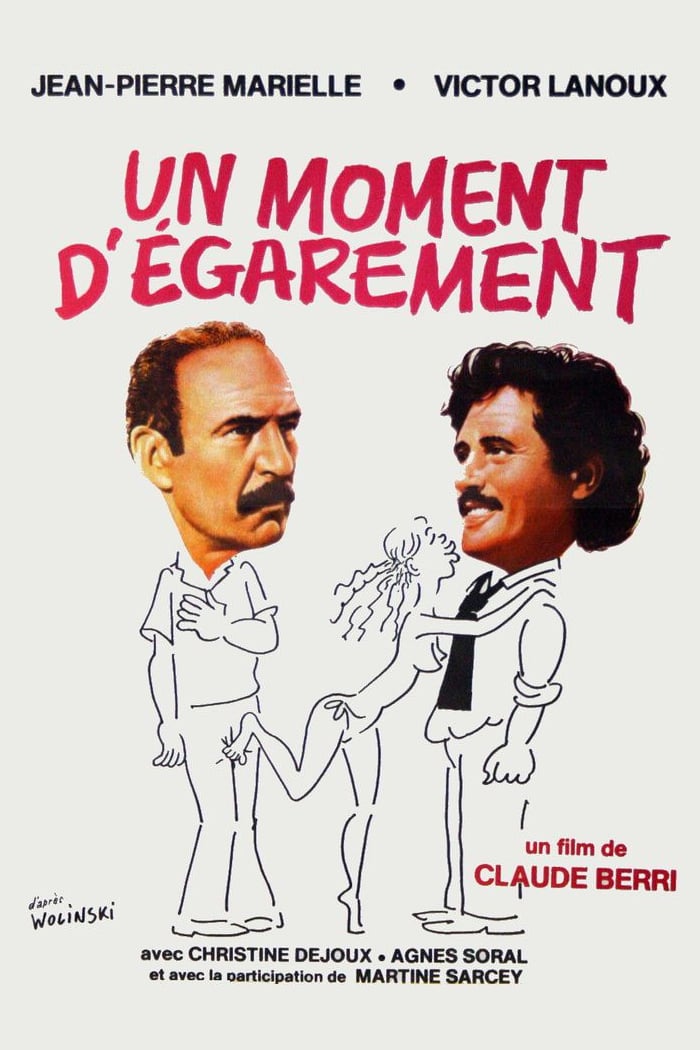

That scene wasn’t in the original script. The truth is it was Marlon who came up with the idea,’ she said. They only told me about it before we had to film the scene and I was so angry. I should have called my agent or had my lawyer come to the set because you can’t force someone to do something that isn’t in the script, but at the time, I didn’t know that. Marlon said to me: « Maria, don’t worry, it’s just a movie, » but during the scene, even though what Marlon was doing wasn’t real, I was crying real tears. I felt humiliated and to be honest, I felt a little raped, both by Marlon and by Bertolucci. After the scene, Marlon didn’t console me or apologize. Thankfully, there was just one take.’
Maria Schneider
Bertolucci claimed during the 2013 interview that he and Brando came up with the idea of the scene, which involves butter. ‘The sequence of the butter is an idea that I had with Marlon in the morning before shooting it,’ Bertulocci said in the video, published on YouTube. But, he said, he was ‘horrible’ to Schneider when he didn’t tell her about his plans. ‘I wanted her reaction as a girl, not as an actress,’ he added. ‘And I think that she hated me and also Marlon because we didn’t tell her. Bertulocci said he felt guilty but didn’t regret shooting the scene as he did. ‘I didn’t want Maria to act her humiliation, her rage. I wanted Maria to feel, not to act the rage and humiliation,’ he said. ‘Then she hated me for all her life.’
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3997724/Last-Tango-Paris-director-Bernardo-Bertolucci-admits-butter-rape-scene-non-consensual-wanted-Maria-Schneider-s-feel-rage-humiliation.html
J’aimeJ’aime
« Il faut remettre les choses dans le contexte, expliquait-elle. D’autres chanteurs avaient des relations intimes avec des jeunes filles. Ça ne choquait personne. (..) Elle lui a menti sur son âge, assure-t-elle. Il était convaincu qu’elle avait 18 ans. Et c’est vrai qu’elle faisait plus âgée. » Il ne s’est, selon Julie, rien passé lorsque sa mère avait 13 ans : « Entre eux, ça a commencé par une amitié et cela a évolué, précise-t-elle. Ma mère biologique n’était pas ce genre de fan à lui courir après. Quand elle parle de lui, elle dit que c’était une belle histoire et s’est sentie aimée. Elle le trouvait doux, sensible. »
Julie Bocquet (Fille cachée de Claude François)
http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/tv/julie-la-fille-cachee-de-cloclo-sortir-de-l-ombre-va-m-apaiser-08-02-2018-7549125.php
« Je les aime jusqu’à 17,18 ans. Après je commence à me méfier. […] Les filles commencent à réfléchir, elles ne sont plus naturelles. Ça commence même quelquefois avant . je n’aime pas les filles entre 18 et 30 ans. »
Claude François
https://www.voici.fr/news-people/actu-people/claude-francois-quand-le-chanteur-evoquait-son-penchant-pour-les-adolescentes-643500
http://www.voici.fr/news-people/actu-people/video-claude-francois-le-temoignage-accablant-de-prisca-lex-clodette-quil-a-photographiee-nue-a-14-ans-644362
« Le jour de mon arrivée, tes parents m’attendaient sur le quai. Tu te cachais derrière eux, petite fille aux yeux bleus. J’avais fait tout ce chemin, pour oublier un très grand chagrin, et je croyais que la vie pour moi, c’était fini. Bye bye, petite Julie. La suite est tout aussi troublante : « Grâce à toi j’ai retrouvé, l’univers de mes jeunes années et ta grâce et ta fraîcheur, peu à peu ont guéri mon cœur. Tu viendras me voir bientôt. »
Chanson de Claude François
http://www.voici.fr/news-people/actu-people/claude-francois-les-surprenantes-paroles-de-la-chanson-qui-font-echo-a-sa-fille-cachee-643797
J’aimeJ’aime
DUR DUR, LA VIE DE STAR (Le télécoraniste Tariq Ramadan raconte son harcèlement par les groupies et les plaster casters)
http://www.leparisien.fr/faits-divers/c-est-moi-qui-suis-harcele-ce-qu-a-dit-tariq-ramadan-aux-juges-07-06-2018-7759407.php
J’aimeJ’aime
QUE LES FILLES SE JETTENT SUR MOI
Et partout dans la rue, j’veux qu’on parle de moi
Que les filles soient nues, qu’elles se jettent sur moi
Qu’elles m’admirent, qu’elles me tuent
Qu’elles s’arrachent ma vertu …
J’aimeJ’aime
CAN’T HAVE YOUR POET AND EAT IT TOO
« I had a great appetite for the company of women and for the sexual expression of friendship. And I was very fortunate because it was the Sixties and that possibility was very very present. And for a tiny moment in social history there was a tremendous cooperation between men and women about that particular item and so I was very lucky that my appetite coincided with this very rare — what, religious, social, I don’t know what you’d call it — some kind of phenomenon that allowed men and women, boys and girls we were, to come together in that kind of union that satisfied both the appetites. »
Leonard Cohen
« It was the days of open marriage, whatever the hell that was. I don’t think it ever was successful with anybody. One of the partners was always jealous and angry and hurt and confused. I don’t know any child who came out of it not damaged by that period. We just wanted to do it all, take drugs and f*** around. . . . The children were just — they came along on the ride. They didn’t want to come along on that ride. Poets do not great make husbands, do they? You can’t own them. You can’t even own a bit of them. The irony is a man like that is a man whom every woman wants to have.”
Aviva Layton
Directed by Nick Broomfield, the new documentary Marianne & Leonard: Words of Love is intended as a tribute to the relationship that inspired one of Cohen’s best-known songs. It is actually more of an indictment. In nauseating detail, it documents the damage wrought by open relationships and other errors of the counterculture. Cohen, once he achieved success as a performer, discovered he was the Elvis of bookish depressives and indulged himself with the women who stampeded to his shows. He was living with Marianne while writing songs about hooking up with Janis Joplin at the Chelsea Hotel.
He tortured Marianne for eight years, spending less and less time with her as the relationship went on. “All the girls were panting for him,” she recalls in an interview captured in the documentary. “It hurt me so much. It destroyed me. I was on the verge of killing myself for it. I wanted to die.” She was his disposable muse. “Whatever he did while he was in New York, whether I was there or on Hydra, he never shared that with me. It was a very hard time,” she says in the film. (She lived until 2016, dying three months before Cohen.)
In interviews, Cohen marvels at a life lived without guardrails or standards or even the expectation of common decency. He kept girlfriends in cities all over. For a moment, women had been successfully convinced that sex could be a fun pastime, unencumbered by any feelings. Cohen says of this dark period:
I had a great appetite for the company of women and for the sexual expression of friendship. And I was very fortunate because it was the Sixties and that possibility was very very present. And for a tiny moment in social history there was a tremendous cooperation between men and women about that particular item and so I was very lucky that my appetite coincided with this very rare — what, religious, social, I don’t know what you’d call it — some kind of phenomenon that allowed men and women, boys and girls we were, to come together in that kind of union that satisfied both the appetites.
Marianne wasn’t so satisfied. “I wanted to put him in a cage, lock him up and swallow the key,” she recalls. She aborted her child with Cohen because he wanted nothing to do with the baby. As for a later girlfriend, Suzanne Elrod, “the word ruthless is the word that comes to mind. . . . She did what she wanted to do to bind Leonard to her by . . . any means necessary,” says Aviva Layton, a friend of Cohen’s at the time. “She knew exactly what to do and when to do it. It was like falling into a spider’s web.”
23
It’s a bit facile to say, “Some feelings may have been hurt, but everyone involved was a consenting adult.” The children involved were crushed. Layton, Cohen’s friend, recalls that all the children in a family Cohen knew on Hydra died off one by one, via suicide or alcohol or drugs. She looks back:
It was the days of open marriage, whatever the hell that was. I don’t think it ever was successful with anybody. One of the partners was always jealous and angry and hurt and confused. I don’t know any child who came out of it not damaged by that period. We just wanted to do it all, take drugs and f*** around. . . . The children were just — they came along on the ride. They didn’t want to come along on that ride.
Marianne’s son, Axel, was an infant when his mother and Cohen were living together on Hydra. As a boy, he found himself dumped in a boarding school in Canada when his mother went back to the island. Broomfield’s film shows us the plaintive, sad postcards he used to send his mother daily, begging for her love. As an adult, he dabbled in drugs, went silent for long periods of time, and wound up being institutionalized for most of his life.
Cohen later steered away from hedonism, spending years in a Buddhist monastery, and expressed distaste for abortion in one of his songs. In his youth, though, he would use his artistry to avoid all commitment, and we should keep in mind his awful treatment of Ihlen every time we hear “So Long, Marianne.” His habit was to mope piteously, sulk in anguish, and sorrowfully float away into the next woman’s arms. “Poets do not great make husbands, do they?” Layton asks. “You can’t own them. You can’t even own a bit of them. The irony is a man like that is a man whom every woman wants to have.”
https://www.nationalreview.com/2019/07/documentary-marianne-and-leonard-words-of-love
J’aimeJ’aime
AND HE BOASTED ABOUT IT IN HIS DIARIES (Champion of pedophilia: Endorsed and supported by France’s most prestigious publishers and literary, media, business and political elite, Mr. Matzneff’s books provided for decades the intellectual cover for many men to target prepubescent children or adolescent girls)
« In his (…) diaries, Mr. Matzneff writes that Dr. Barzach became the go-to gynecologist to whom he took underage girls for years after he and Ms. Gee parted in 1976. Dr. Barzach, who was also a psychoanalyst, was France’s health minister from 1986 to 1988 under President François Mitterrand. From 2012 to 2015, she was the head in France of UNICEF, the United Nation’s child protection agency. »
NYT
In her telling, Francesca Gee was out with a girlfriend, a late autumn day in Paris in 1983, when they spotted a new bookstore. As they lingered before the storefront, her friend suddenly pointed to the bottom of the window. “Look, it’s you!” Ms. Gee’s face was staring back at her from the cover of a novel, “Drunk on Lost Wine,” by Gabriel Matzneff, the writer and champion of pedophilia. A decade earlier, at 15, Ms. Gee, had gotten involved in a traumatic three-year relationship with the much older Mr. Matzneff. Now, he was using her teenage face on his novel’s cover, and her letters in its pages, without having asked her or even informing her, she said. For decades, despite Ms. Gee’s protests, Mr. Matzneff used her letters to justify pedophilia and what he cast as great love affairs with teenage girls, all the while supported by members of France’s literary, media, business and political elite. Mr. Matzneff’s books were endorsed by some of France’s most prestigious publishers, including Gallimard, which printed “Drunk on Lost Wine” (“Ivre du vin perdu”) for nearly four decades with the same cover — in effect using Ms. Gee’s face to promote the kind of relationship that has scarred some of Mr. Matzneff’s victims for life.
“I’m persecuted by this image of me, which is like a malevolent double,” Ms. Gee said.
Hers is the story of a woman unable to tell her own story — until now.
Ms. Gee, now 62, contacted The New York Times after the publication of an article that described how Mr. Matzneff openly wrote about and engaged in sex with teenage girls and prepubescent boys for decades.
After anguishing over her decision, Ms. Gee — who had a career as a journalist and speaks fluent English, French, Italian and Spanish — broke her silence of 44 years in a series of interviews over two days in southwest France, where she lives.
That decision was facilitated by a recent cultural shift in France.
Mr. Matzneff first achieved renown in the 1970s, when some French intellectuals regarded pedophilia as a form of liberation against parental oppression. Though those views fell out of favor in the 1990s, he continued to publish and prosper until late last year.
But in the past couple of months, he was charged with promoting the sexual abuse of children, stripped of state-conferred honors and dropped by his three publishers.
Gallimard stopped selling the novel with Ms. Gee’s image on the cover only in January, after the publication of “Le Consentement” (“Consent”), the first account by one of Mr. Matzneff’s underage victims, Vanessa Springora.
“Consent” turned the widely celebrated Mr. Matzneff into a social pariah overnight. While he went into hiding in Italy, his former supporters, across France’s elite, have studiously distanced themselves or jettisoned him.
When she first heard of “Consent,” Ms. Gee said, she was “elated” that the “Vanessa” in Mr. Matzneff’s books — someone she had never met but had always considered a little sister — was speaking.
“She has done the work, I don’t have to worry about it anymore,” Ms. Gee remembers thinking. “But then within a week or two, I realize that I’m very much a part of this story.”
In fact, nearly two decades before “Consent” shook up France, Ms. Gee tried — unsuccessfully — to tell her story, in 2004. She wrote a manuscript that, in detailing her involvement with Mr. Matzneff, grappled with some of the same themes and used the same vocabulary as “Consent.”
But no publisher accepted her manuscript.
At Albin Michel, a major house, an editor appeared receptive — but when he took Ms. Gee’s manuscript to a committee, it was ultimately turned down.
In a rejection letter, the editor, Thierry Pfister, explained that some committee members had expressed reservations, noting that Mr. Matzneff, was a part of “Saint-Germain-des-Prés” — shorthand for the French publishing industry concentrated in that Paris neighborhood.
“Back then, Matzneff wasn’t the old, isolated man he is today,” said Mr. Pfister, who is no longer at Albin Michel. “He was still in Paris with his network, his friends.”
“We made the decision not to go cross swords with that group,” he recalled. “There was more to lose than to gain. I spoke in her favor. They didn’t agree with me.”
Mr. Matzneff’s network of supporters was surprisingly wide.
In 1973, when Ms. Gee was 15 and Mr. Matzneff was 37, a friend of the writer introduced them to a gynecologist who agreed to prescribe contraceptive pills to underage girls without their parents’ authorization — an illegal act back then.
In his diary of the period, “Élie et Phaéton,” Mr. Matzneff writes that the gynecologist, Dr. Michèle Barzach, “at no point felt the need to lecture this man of 37 years and his lover of 15.”
Ms. Gee said she saw Dr. Barzach a half-dozen times over three years, always accompanied by Mr. Matzneff.
“He calls her and makes an appointment, and we go,” she recalled. “He’s in the waiting room while I’m with her. And then he comes in, and they talk and he pays her.”
In his other diaries, Mr. Matzneff writes that Dr. Barzach became the go-to gynecologist to whom he took underage girls for years after he and Ms. Gee parted in 1976.
Dr. Barzach, who was also a psychoanalyst, was France’s health minister from 1986 to 1988 under President François Mitterrand.
From 2012 to 2015, she was the head in France of UNICEF, the United Nation’s child protection agency. Citing privacy reasons, UNICEF refused to provide contact details for Dr. Barzach, who is no longer at the agency. Dr. Barzach did not reply to an interview request that UNICEF said had been forwarded to her.
‘Love’? Or a ‘Hostage Taking’?
For decades, Mr. Matzneff claimed that his relations with underage girls had helped them for the rest of their lives. Their initiation into art, literature, love and sex, by an older man, had left them happier and freer, he claimed.
The claim — repeated by his supporters — went unchallenged until the publication in January of “Consent,” in which Ms. Springora writes that her involvement with Mr. Matzneff, starting at age 14, left her with psychological problems for decades.
In her unpublished manuscript of 2004, Ms. Gee described her involvement with the writer as a “cataclysm that shattered me when I was 15 years old, and that changed the course of my life” — leaving her “ashamed, bitter and confused.”
The accounts by Ms. Gee and Ms. Springora are especially significant because Mr. Matzneff has often described them as two of the three great loves of his life. He devoted diaries, novels, poems and essays to each woman — material that, according to anti-pedophilia groups, provided the intellectual cover for many men to target prepubescent children or adolescent girls.
Ms. Gee recalls running into Mr. Matzneff for the first time in Paris in 1973 with her mother, who had known him years before.
David Gee, Ms. Gee’s younger brother, said their parents regularly invited the writer over for dinner parties. His presence especially pleased their father, a British journalist long based in Paris who sought his place in French society.
“It was one of those very important things, socially speaking, to be established in the intelligentsia,” Mr. Gee said. “That was more important than looking at the side effects of pedophilia.”
With her father’s approval, Ms. Gee saw the writer over three years, unable to break away from him. Ms. Gee’s father died in 2014.
Using the same methods he later would with Ms. Springora, Mr. Matzneff exercised a hold on the teenage girl. He isolated her, forbidding her to socialize with friends her age.
He pulled political strings to have Ms. Gee transferred to a high school near his home — and boasted about it in his diaries. Then he got into the habit of waiting for Ms. Gee outside her new high school, Lycée Montaigne, next to the Luxembourg Gardens.
“He came every day to make sure that everyone understood that no one was supposed to try anything with me,” Ms. Gee recalled. “It was a very specific place where he was just standing there waiting for me.”
Ms. Gee recently met with one of the detectives who began investigating Mr. Matzneff and his supporters in the aftermath of the publication of “Consent.” After she detailed her involvement with Mr. Matzneff during the five-hour meeting in Paris, she said, the detective described it as a “hostage taking.”
Trapped in His Stories
Ms. Gee turned 18 in 1976 and, after several anguished attempts, was finally able to free herself from Mr. Matzneff’s grip, having become more and more critical of him. “It was growing up, basically,” she said.
Still, she would remain hostage for decades — trapped in his storytelling and his use of her letters.
Encouraged by Mr. Matzneff, Ms. Gee had written him hundreds of amorous and sexually explicit letters during their three years together.
Some of them he published in 1974, without her authorization, in his fierce defense of pedophilia, “Les Moins de Seize Ans” (“Under 16 Years Old”). He was offering those letters, he wrote in another book, “Les Passions Schismatiques,” as evidence that “a relationship of love between an adult and a child could be for the latter extremely rich, and the source of a fullness of life.”
Ms. Gee said the words in the letters were those of a teenager manipulated by a man the age of her parents. Her letters were also used in “Ivre du vin perdu,” the novel whose cover featured an illustration of her.
“Now I consider they were extorted and used as a weapon against me,” Ms. Gee said.
In her manuscript, Ms. Gee writes that “he used me to justify the sexual exploitation of children and teenagers.”
For years, Ms. Gee’s feelings about her experience with Mr. Matzneff were “muddied.” Then in the early 1990s, her understanding became clearer.
“It was only when I was almost 35 years old that I realized this wasn’t a love story,” Ms. Gee recalled.
It was in 1992 that she contacted Mr. Matzneff, demanding that he stop using her letters and that he return them to her. Eventually, he sent her a photocopied stack — a carefully selected batch that excluded her negative correspondence.
A decade later, in 2002, it was Mr. Matzneff who wrote to her, asking, for the first time, her permission to use old photographs of her in a book. In the turquoise blue ink that he always used to pen his letters, Mr. Matzneff offered to identify the teenager as “the young girl who inspired the character of Angiolina in ‘Ivre du vin perdu.’”
Not only did Ms. Gee refuse, but she also demanded again that his books be purged of her letters and that her face be taken off the cover of “Ivre du vin perdu.” She also demanded that three old photographs of her be taken off a website devoted to Mr. Matzneff and created by an admirer, Frank Laganier. The photos were pulled only seven years later, in 2010, after Ms. Gee’s continued pressure, she said.
Mr. Laganier, who is now living in Paris, declined interview requests. His lawyer, Emmanuel Pierrat — who is representing Mr. Matzneff in a pedophilia case and is a longtime supporter of the writer — declined to be interviewed.
In 2004, Ms. Gee began preparing to sue Gallimard, the publisher of “Ivre du vin perdu,” and “La passion Francesca,” Mr. Matzneff’s diary of their relationship, but stopped because of the high legal costs. Gallimard did not respond to interview requests; Antoine Gallimard, the head of the publishing house, did not respond to an interview request sent to his email address.
Unable to stop Mr. Matzneff, Ms. Gee also could not tell her own story.
After her manuscript was rejected by Albin Michel, she took it, unsuccessfully, to several other publishing houses.
Geneviève Jurgensen, who was an editor at Bayard and met with Ms. Gee in 2004, said the manuscript’s focus was not in line with Bayard, which specialized in publishing youth books, as well as works on philosophy and religion.
Ms. Jurgensen, after recently reading excerpts from the manuscript, described it as “well written” and containing “situations that seem almost word for word those described by Vanessa Springora.”
“Obviously, it wasn’t the quality of the book that was the issue,” Ms. Jurgensen said of Ms. Gee’s failure to find a publisher in 2004. “Clearly, it was 15 years too early. The world wasn’t ready yet.”
The final rejection came from Grasset, the very same publisher that broke a taboo by issuing Ms. Springora’s “Consent” in January.
Martine Boutang, an editor at Grasset, remembers being moved by Ms. Gee’s account, she said, but couldn’t see a way to get it published: the subject was “too sensitive,” and two members of Grasset’s editorial committee were “close to Matzneff.’‘
“The question wasn’t the quality of the text,” she said.
Ms. Gee recalls feeling that Ms. Boutang was trying to stall the project by asking her to rework a manuscript that she had no intention of publishing. Ms. Boutang said she did not remember asking for a rewrite.
By contrast, Mr. Matzneff had no problems continuing to get his writings published — including “Under 16 Years Old,” the book that used Ms. Gee’s letters to justify pedophilia and sex with underage girls.
In a recent interview in the Italian Riviera, where he has been hiding, Mr. Matzneff said that if Ms. Gee “called me tomorrow, I would be delighted to see her.”
Ms. Gee would be delighted if she could stop being reminded of him. In a book published last November, more than four decades after she left him, Mr. Matzneff mentioned her no fewer than a dozen times. Ms. Gee herself is now working on a new manuscript on the writer.
Over the years, unexpected incidents have sometimes reminded her that she remains a prisoner inside Mr. Matzneff’s story.
A few years ago, she found herself waiting outside the Lycée Montaigne, her old high school, which her niece Lélia was now attending.
“I wait for her where Matzneff used to wait for me,” Ms. Gee recalled.
Over lunch, her niece, a literature student, told her that she was “working on a contemporary author called Gabriel Matzneff.”
That’s how Lélia, who is now 25, learned that the books she had been reading described a “family history,” she says. To this day, she says, she had talked little with her aunt about her days with Mr. Matzneff.
“Most of what I know about all of this comes from Gabriel Matzneff, and not my aunt,” she said. “And that’s exactly where the problem lies.”
Daphné Anglès and Constant Méheut contributed reporting.
J’aimeJ’aime
QUELLES COUPABLES COMPLAISANCES ? (Douze ans plus tard, Francesca Gee tente de faire paraître un manuscrit pour dénoncer la pédophilie de l’écrivain. Peine perdue : l’auteur est encore trop puissant. Il possède des amis dans bon nombre de maisons d’édition, et son dernier livre a été publié en novembre 2019 aux éditions Gallimard)
Tout commence en 1973, à Paris. Francesca Gee affirme avoir rencontré l’écrivain par le biais de sa mère, qui l’a connu quelques années plus tôt. L’auteur est, à l’époque, souvent convié aux dîners de famille, se souvient David, le frère cadet de Francesca. Un invité de marque qui aurait rapidement conquis leur père, un journaliste britannique soucieux de se faire une place dans la société française. Durant trois ans, Gabriel Matzneff tente d’isoler l’adolescente. Il organise le transfert de Francesca Gee au Lycée Montaigne, plus proche de son domicile, en usant de son réseau politique, comme il l’indique dans l’un de ses journaux. «Il venait tous les jours (devant l’établissement scolaire, NDLR) pour s’assurer que tout le monde comprenne bien qu’il ne fallait rien tenter à mon égard, se remémore Francesca Gee. Il se postait à un endroit bien précis, et c’est là qu’il m’attendait.» Pendant cette période, l’ex-reporter affirme que Gabriel Matzneff l’emmenait consulter le Dr Michèle Barzach, une gynécologue qui deviendrait ministre de la Santé de 1986 à 1988, sous la présidence de François Mitterrand. Cette dernière, «à aucun moment n’a cru devoir faire la morale à ce monsieur de trente-sept ans et à sa maîtresse de quinze», écrit l’auteur dans son journal de l’époque, Élie et Phaéton.
À l’âge de 18 ans, Francesca Gee parvient à se libérer de l’influence de l’écrivain, et se montre plus critique envers lui. «C’était le fait de grandir, en fait», estime-t-elle avec le recul. Mais, si elle parvient à mettre un terme à cette relation traumatisante, cessant tout contact avec l’auteur, elle est incapable de s’en défaire totalement. L’écrivain, qui l’avait encouragée à lui écrire «des centaines de lettres à connotation amoureuse ou sexuelle», selon le New York Times, les a en effet reprises dans certains de ses livres sans l’aval de la jeune fille – notamment dans Les Moins de seize ans, paru en 1974.
«Aujourd’hui, je considère qu’elles m’ont été extorquées et employées comme armes à mon encontre», poursuit Francesca Gee. Cette dernière est également au centre de son journal La Passion Francesca, daté des années 1974 à 1976 et paru en 1998. Sur la couverture d’Ivre de vin perdu, paru en 1981, figure par ailleurs une réplique d’un cliché de la jeune fille à l’âge de 15 ans. «Cette image de moi me poursuit, elle est comme un double malveillant», commente Francesca Gee dans les colonnes du quotidien américain.
C’est seulement à l’âge de 35 ans qu’elle le réalise : ce qu’elle a vécu n’était pas une histoire d’amour. En 1992, elle contacte Gabriel Matzneff pour qu’il arrête d’utiliser ses lettres et les lui rende. Il s’exécutera. Douze ans plus tard, Francesca Gee tente de faire paraître un manuscrit pour dénoncer la pédophilie de l’écrivain. «Il n’a cessé de se servir de moi pour justifier l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents», y écrit-elle notamment. Peine perdue : l’auteur est encore trop puissant. Il possède des amis dans bon nombre de maisons d’édition, et son dernier livre, L’Amante de l’Arsenal, a été publié en novembre 2019 aux éditions Gallimard. Dans son manuscrit, Francesca Gee décrivait son passé avec l’auteur comme un «cataclysme qui s’était abattu sur moi à 15 ans, et qui devait changer le cours de mon existence».
https://madame.lefigaro.fr/societe/francesca-gee-denonce-a-son-tour-la-pedophilie-de-gabriel-matzneff-310320-180538
J’aimeJ’aime
RARES SONT CEUX QUI LE RECADRENT (Devinez ce qui arrive quand on traite trop longtemps en roi un génie du cinéma ?)
« En fait, il est le roi sur le plateau. »
Hélène Darras
« Le cinéma français n’ignorait pas le comportement problématique de Gérard Depardieu.
Marc Missonnier
« Les journalistes du service public ont fait le tour du milieu du cinéma. À entendre les très nombreux témoignages récoltés, l’acteur parle aussi de sexe toutes les cinq minutes sur les plateaux. Et rares sont ceux qui le recadrent. (…) Mais, au Festival de Cannes, les célébrités tournent les talons en entendant le nom de l’acteur. (…) Seul le producteur Marc Missonnier reconnaît une responsabilité collective. « Le cinéma français n’ignorait pas le comportement problématique de Gérard Depardieu », déclare celui qui estime que Depardieu a été protégé par son image de star. Et son statut de meilleur acteur de sa génération. »
Benoît Daragon
https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/tv/nouvelle-plainte-video-choc-temoignages-ce-que-revele-le-complement-denquete-sur-gerard-depardieu-06-12-2023-GPYPASZ7HFAMDGZSSEADZ75M5E.php
J’aimeJ’aime
L’AUTRE MONSTRUOSITÉ, C’EST CELLE DES GENS QUI SONT RESTÉS INDIFFÉRENTS – DONT HÉLAS J’ETAIS (Le corporatisme de ce métier ne devrait pas empêcher la vérité d’éclore)
« J’ai vu cette émission, ça ne m’a pas étonnée parce qu’il est comme ça tout le temps. Il n’a pas attendu d’être en Corée pour être aussi vulgaire, aussi grossier, aussi agressif avec les femmes. Il démolit, il détruit à jamais des gens. L’autre monstruosité, c’est celle des gens qui sont restés indifférents. On est bouche cousue devant sa violence et la violence des autres qui se taisent et qui rient. j’ai moi-même été complice et me suis tue longtemps. J’ai ri pendant quelques années, j’ai même vécu avec quelqu’un qui participait à cette violence active. Le corporatisme de ce métier ne devrait pas empêcher la vérité d’éclore. Je ne savais pas comment faire pour parler. Il vaut mieux avoir du courage 33 ans après que jamais. Je regrette mon silence : j’ai eu tort. »
Anouk Grinberg
https://www.lefigaro.fr/culture/on-est-bouche-cousue-devant-la-violence-de-depardieu-denonce-anouk-grinberg-20231211
J’aimeJ’aime
QUELLE POLITIQUE DE LA FEMME BRULEE ? (Devinez ce qui arrive quand on traite trop longtemps en roi un génie de la chanson française ?)
« Je pratique la politique de la femme brûlée : je brûle toutes celles que j’ai adorées. »
Serge Gainsbourg
« Serge Gainsbourg dans le métro, c’est non : nous demandons le changement de nom de la future station de la ligne 11. (…) le nom d’un homme violent, misogyne notoire et chantre de l’inceste sera officiellement donné à une des nouvelles stations. (…) Les violences envers les femmes et les tendances pédocriminelles voire incestueuses de Serge Gainsbourg (pour ne citer qu’elles) sont pourtant de notoriété publique, et nous sommes révolté.e.s que sa personne soit mise à l’honneur dans le métro de Paris. (…) voici quelques rappels : Dans son titre « Lemon Incest », sorti en 1984, Gainsbourg chante et fait chanter son fantasme incestueux à sa fille Charlotte, alors âgée de 12 ans. Dans le clip de cette chanson tout en « jeux de mots », il est torse nu, allongé sur un lit avec sa fille en T-shirt et culotte. En 1986 sort le film Charlotte Forever. Écrit et réalisé par Serge Gainsbourg, ce dernier met en scène une relation entre un père et sa fille, incarné.e.s par lui-même et Charlotte (15 ans à l’époque), dans un climat incesteux. La bande originale du film est la chanson du même nom, Charlotte Forever, où cette dernière chante les paroles écrites par son père « Papa papa j’ai peur/De goûter ta saveur ». Comme l’explique la dessinatrice Cécile Cee, l’inceste est là sous nos yeux, même exprimé par la négative (« L’amour que nous ne ferons jamais ensemble» , Lemon Incest). C’était d’ailleurs la défense de Gainsbourg lui-même : son sujet était le fantasme incestueux et non sa réalisation concrète. Pourtant, cette oeuvre contribue à créer un climat présentant l’inceste comme une relation d’amour, sensuelle et désirable. Dans la chanson « Love on the beat » de 1984, qualifiée de »poème pornographique », des cris et gémissements féminins audibles au long de la chanson sont ceux de sa partenaire de l’époque, Caroline Paulus renommée « Bambou » par Gainsbourg, qui auraient été enregistrés à son insu et ajoutés au titre sans son consentement. Sous couvert de rapports « tumultueux » et « passionnels » avec les femmes, il répond à un présentateur de France Inter, dans une émission en 1986, après ce que ce dernier l’ait comparé à Landru (un tueur en série) : « Je pratique la politique de la femme brûlée : je brûle toutes celles que j’ai adorées ». Gainsbourg a également eu des relations avec des femmes très jeunes, dont des mineures (Constance Meyer, « fan » de Gainsbourg raconte avoir eu une relation suivie avec lui lorsqu’il avait 57 ans et elle 16). En 1986, Michel Drucker présente Whitney Houston à Serge Gainsbourg, quelque peu ivre, qui lui bafouille quelques mots en anglais avant de lui avouer (en anglais) qu’il aimerait bien « la baiser ». La chanteuse est très choquée et déclare que Gainsbourg doit être ivre. Michel Drucker, très ennuyé, essaie de rattraper la situation. Serge Gainsbourg finit par marmonner quelques excuses. Après avoir formé avec Jane Birkin le couple icônique et apparement idyllique des années 70, cette dernière évoque les violences conjugales que Gainsbourg lui a fait subir, dans son livre Munkey Diaries publié en 2018. Plus de 30 ans après sa mort, Birkin revient sur des scènes de violences. Tout d’abord, elle décrit un homme colérique et souvent violent verbalement (« il n’arrêtait pas de hurler des ordres et de se fâcher », elle évoque des crises de colère et d’autorité devant leurs enfants), mais aussi des violences physiques : « des insultes et des bagarres devant les filles, traînée par terre, c’est le noir de nouveau, je veux dormir pour ne plus y penser ». Birkin raconte qu’à deux reprises, des hommes ont commenté à la « tripoter » dans des soirées mondaines, et que quand elle le rapportait à son compagnon, Gainsbourg lui disait de se laisser faire. Elle semble mentionner en outre une forme de relation d’emprise : « il dit qu’il a eu la bonté de me loger et de me nourrir, moi et mes enfants » , elle mentionne qu’il ouvrait son courrier ; « comment la vie avec Serge est devenue insupportable, son ivrognerie, son égoïsme et moi sa marionnette ». Un autre passage est symptomatique de ce climat violent dans le couple et des violences de Gainsbourg : »Je l’ai giflé, légèrement et comiquement je croyais, et il m’en a collé une sévère sur l’oeil droit, alors je me suis cachée la tête pendant au moins une demi-heure avec les yeux qui ruisselaient. J’ai saisi mon panier et Serge l’a renversé, tout s’est éparpillé sur le sol de chez Castel. (…) Puis d’avoir à tout ramasser, furieuse, je l’ai brûlé avec ma cigarette encore allumé. Alors il m’en a collé une autre, et m’a tirée par les cheveux et m’a encore giflée et il s’est taillé de la boîte, savais pas quoi faire, honteuse, laide et misérable ». Post-MeToo, à l’heure de la prétendue écoute des victimes de violences comme priorité politique (que ce soit des femmes, des minorités de genre ou des enfants), à l’heure où les pédocriminels comme Matzneff ou Polanski ont maintes fois été dénoncés par leurs victimes, à l’heure où nous comptons tous les jours nos mortes tuées par des conjoints violents et malgré la fameuse « séparation de l’homme et de l’artiste » prêchée par les défenseurs de notre système patriarcal, cette décision de rendre hommage à Gainsbourg est un crachat à la figure des victimes. On nous rétorquera qu’aucune victime des agissements de Gainsbourg n’a jamais porté plainte. Nous répondons que l’époque ne le permettait pas, et que les quelques éléments (non exhaustifs) que nous venons d’énumérer nous semblent par ailleurs amplement suffisants pour affirmer l’existence d’un faisceau d’indices suffisant pour montrer des comportements problématiques, violents, avec les femmes y compris très jeunes et mineures, dont sa propre fille. Dès lors, il serait bon de pouvoir glorifier et mettre en avant, dans nos villes, d’autres hommes que ceux ayant, en plus du palmarès décrit ci-dessus, chanté des féminicides sadiques et des viols incestueux (« Titi caca », « La poupée qui fait non »). Les artistes et leurs oeuvres culturelles racontent quelque chose de la société, diffusent des positionnements qui permettent, le cas échéant, de considérer les enfants et les femmes et minorités de genre comme des proies dont il est possible de ne pas respecter les limites, le corps, le consentement, le désir propre. En 2023, plus de trente ans après sa mort et alors que ses agissements sont connus de tous, c’est Serge Gainsbourg qui est choisi pour être mis à l’honneur sur les plans de métro de Paris. Quel message cette décision d’inscrire son nom dans l’espace public envoie-t-elle ? Qu’il est acceptable, voir encouragé, d’être violent envers les femmes, les enfants si on le fait au nom de l’art et qu’on est un homme. Nous, féministes et citoyen.ne.s, usager.e.s des transports parisiens, demandons à la RATP, à IDF mobilités et aux élus locaux de revoir leur copie pour le nom de cette station. Si vous manquez d’inspiration, demandez-nous, nous ne manquons pas d’idées de personnes à célébrer. »
Marie G.
https://www.change.org/p/pour-que-la-ratp-renomme-la-future-station-de-la-ligne-11-serge-gainsbourg
J’aimeJ’aime
QUEL TROUBLE DES INTERDITS ET QUEL BESOIN DES ENTRAVES ? (Quelle image et quelle mauvaise réputation de misogyne soigneusement entretenue par notre Gainsbourg national – et par sa corporation et son public qui lui passaient tout ?)
« [Serge Gainsbourg] est [dandy] par son élégance originale, qui ne suit aucune mode. Celle de Gainsbourg se fonde sur une alliance des contraires: le luxe et le bon marché, illustrés par ses vestes de grands couturiers portées sur un tee-shirt parfois découpé. Dans le même ordre d’idées, son relâchement apparent, comme sa célèbre «barbe de trois nuits», est très élaboré. Son dandysme apparaît aussi dans la distance qu’il met entre lui et les autres, qu’il s’agisse de son public, de ses amis ou des femmes. C’est pourquoi Charlotte dit avec raison que le 5 bis rue de Verneuil est une «maison de célibataire». Cette «maison musée» est une autre illustration de son dandysme. Chaque objet occupe une place régie par la règle du nombre d’or. Comme Baudelaire, il a un goût prononcé pour l’artifice. Rue de Verneuil, la lumière du jour pénètre peu et la lumière électrique est constamment allumée. Comme le poète, il admire Poe et Delacroix. Sa proximité avec Baudelaire s’illustre aussi poétiquement, notamment dans la chanson Initials B.B., qui porte l’empreinte du poème Les Bijoux. Mais Gainsbourg ne reconnaît pas volontiers cette haute influence. Par orgueil, sans doute. (…) C’est sur elle [la laideur] qu’il fonde aussi son dandysme. Mais, chez Gainsbourg, le complexe de laideur pèse lourdement et entretient sa timidité maladive, surtout à l’égard des femmes. Il a beau en avoir conquis d’innombrables, et souvent très belles, il souffre irrémédiablement de sa «sale gueule». Gainsbourg voulait être Sade, il est devenu Gainsbarre, par goût du masque. Le masque chez un dandy n’est pas inauthentique. C’est un double qui lui colle à la peau. On peut rapprocher ce goût du masque de son dégoût de la peau. Il déteste la nudité, la sienne ou celle des femmes. Comme Baudelaire, il n’aime que les femmes savamment parées et maquillées. (…) [Ses relations avec elles étaient] Complexes! Certes, il ne s’est pas toujours illustré par son élégance envers les femmes. Que l’on songe au trop célèbre «I want to fuck you!» adressé à Whitney Houston, mais cela fait partie des provocations déplorables de Gainsbarre, et de ce qu’il appelle lui-même des «prestations assez nulles». Mais il est un peu responsable de cette mauvaise réputation car il a soigneusement entretenu son image de misogyne. Dans ses relations intimes, c’est autre chose. Sa première épouse, Lise Lévitzky, dit qu’elle a rarement connu un homme qui avait autant le sens de la réciprocité. Gainsbourg est rebelle par jeu et ne cherche pas à faire la révolution. Sa rébellion n’est ni politique, ni sociale, ni morale. On s’imagine que Gainsbourg est un libertin et que la libération sexuelle des années 1960 lui convient. C’est faux! Gainsbourg a besoin des entraves. Elles suscitent ce qu’il appelle «le trouble des interdits», nécessaire à son plaisir. En art, il ne cherche pas non plus à abolir les règles. Visiteur assidu du Louvre, il se montre respectueux des règles et admiratif des grands maîtres. (…) [La suppression des accents, apostrophes, points sur les «i»…] Oui, mais il s’agit seulement là d’une fantaisie graphique. Son désir de faire du neuf, qu’il partage avec Baudelaire, il l’exprime surtout dans son jeu virtuose avec les mots et dans son appropriation très personnelle des courants musicaux, comme le jazz, le rock, le reggae. Cependant, malgré son apport remarquable à la chanson française, Gainsbourg reste modeste. Il affirme que la chanson est un art mineur au regard de la poésie ou de la peinture. Rappelons que Gainsbourg rêvait de devenir peintre. Il a fini par abandonner le pinceau au bout de quinze ans parce qu’il était dans une impasse: «Je sais peindre mais je n’ai rien à dire», affirmait-il. Impatient de devenir riche et célèbre, il s’est tourné vers la chanson. Il aurait de même voulu être écrivain mais son entreprise a tourné court. Il a mis sept ans à écrire Evguénie Sokolov, roman autobiographique de 90 pages, qu’il a publié en 1980 chez Gallimard. L’ouvrage a été éreinté, ce qui est injuste. Certes, ce n’est pas un chef-d’œuvre, mais il témoigne d’une authentique recherche stylistique dans la lignée de Huysmans et de la littérature fin de siècle. (…) [il fait partie de notre patrimoine] Incontestablement. En 1962, il écrit L’Accordéon, une chanson que Juliette Gréco chante lors de l’inauguration du paquebot France. Selon elle, cette chanson est «une image de la France à l’étranger, comme peut l’être le Paris canaille de Ferré». Cette image de chanteur national plaît à Gainsbourg, qui est très patriote. À ce propos, La Marseillaise en reggae, qui a fait scandale, n’est en aucun cas une offense à l’hymne national. Gainsbourg bouscule son pays, mais il l’aime. Il est très heureux des reconnaissances officielles qu’il reçoit, comme celle de chevalier des Arts et des Lettres. (…) Faire cette chanson [Lemon Incest aujourd’hui], oui: son goût et même son besoin de provocation ne l’en auraient pas empêché. Bien au contraire. Mais sa publication aurait suscité un scandale beaucoup plus fort aujourd’hui. Cela aurait été aussi le cas des chansons violemment misogynes de ses débuts. Aurait-il donc aimé notre époque? Ayant toujours été à l’avant-garde du progrès, il aurait été fasciné par le numérique et les nouvelles technologies. En revanche, il aurait détesté le moralisme et le puritanisme véhiculés par le wokisme. À l’instar de Baudelaire, Gainsbourg refuse d’introduire la morale dans l’art. »
Marie-Christine Natta
https://www.lefigaro.fr/livres/marie-christine-natta-gainsbourg-fait-partiedu-patrimoine-20220506
J’aimeJ’aime
QUELLES LIMITES DANS L’ART ? (Cherchez l’erreur quand au nom de la beauté de l’art… un réalisateur de 40 ans couche avec son actrice de 14 ans ?)
« J’étais une jeune fille très solitaire, très idéaliste. Je vivais à travers mes livres, ma mère est partie de la maison quand j’avais 9 ans, j’ai été élevée par un homme seul, j’étais vulnérable malgré une certaine maturité. (…) Je n’avais aucune idée de ce que disait la loi, j’ai arrêté l’école à 15 ans, les histoires qu’on lit, les films qu’on voit, tout valorisait cette image de lolita, de baby doll. En tant qu’actrice, on a besoin d’être aimée, regardée. C’est comme si, en vous choisissant, le réalisateur vous donnait vie. On peut se faire prendre dans les filets d’une personne plus puissante, et l’art est un tremplin extrêmement favorable à ça. On peut faire des films sublimes sans aller jusqu’à coucher avec son actrice mineure. La position de l’adulte dans la société, c’est de savoir où mettre les limites, même quand il s’agit d’art. Quand on a 15 ans et qu’on fait une scène torse nu, qu’il y a quarante-cinq prises, qu’on doit embrasser un homme de 45 ans et que cet homme, c’est votre réalisateur, c’est fou qu’il n’y ait aucun adulte sur le plateau pour dire : ‘On va s’arrêter là’. »
Judith Godrèche
https://www.elle.fr/Loisirs/Television/Judith-Godreche-en-couple-a-14-ans-avec-un-quadragenaire-C-est-parce-que-j-ai-une-fille-adolescente-que-je-parviens-a-realiser-ce-qui-m-est-arrive-4183441
J’aimeJ’aime
https://www.voici.fr/news-people/actu-people/maurice-barthelemy-eloigne-de-sa-fille-depuis-sa-rupture-avec-judith-godreche-ses-douloureuses-confidences-695351
J’aimeJ’aime
LE CINEMA, C’EST UNE COUVERTURE POUR TRANSGRESSER LES INTERDITS (Merci à la bienveillance du psychanalyste pour avoir conduit nos réalisateurs à lâcher le morceau sur le véritable dispositif d’attrape-chair fraiche !)
« Si une femme avec qui j’entreprends quoi que ce soit au moins n’a pas eu l’idée, le vœu, le souhait, le désir d’être actrice à un moment ou un autre, ça marche pas. (…) C’est parce qu’il y a pour commencer ce désir qui était là, manifesté très radicalement, très violemment, par une très jeune femme de commencer quelque chose, à savoir d’être actrice, pour le coup Judi a braqué mon désir mais comme une très jeune femme peut le faire je crois comme une femme plus avancée dans son temps dans son âge à ma connaissance que je sache ou crois en tout cas n’aurait jamais procédé comme ça.(…) Oui, c’est forcément une transgression parce que je ne sais plus, ne serait-ce qu’au regard de la loi telle qu’elle se dit, on n’a pas le droit en principe, je crois. Donc une fille comme elle, comme cette Judith qui avait en effet 15 ans, en principe, moi à 40, j’avais pas le droit, je crois pas. Mais ça, elle en avait rien à foutre et même elle, ça l’excitait beaucoup, je dirais (…) Le fait est que d’une certaine façon, faire du cinéma est une sorte de couverture, au sens où on a une couverture pour tel ou tel trafic illicite. C’est une sorte de couverture pour des mœurs de ce type là, je dirais, sûrement ça peut être comme ça. « Ah oui, mais il est cinéaste, il est artiste, il est en train de créer une actrice, de fabriquer, oui, c’est leur truc, bon voilà. » Et en même temps, dans le landerneau cinématographique, on peut sentir qu’il y a une certaine estime ou une certaine admiration pour ce que d’autres aimeraient sans doute bien pratiquer aussi, voilà. Il y a ça aussi, ce qui est pas désagréable d’ailleurs. Pour commencer, je la choisis pour ce film, mais réellement sans ce qu’on appellerait en mauvaise part, sans arrière-pensée choisi pour le film et puis ça arrive, ça arrive et à chaque fois ça arrive, c’est comme ça. (…) Si je fais d’autres films, ce qui est arrivé souvent avec de très jeunes actrices, il y a toujours une espèce de crainte de Barbe bleue, comme ça: est-ce que c’est est-ce qu’il va m’enlever, me sauter dessus ? (…) Et puis au fond est-ce que je vais y passer moi aussi d’une certaine façon? Aussi bien au sens prosaïque qu’au sens amoureux, est-ce que je vais être amoureuse de lui comme l’ont été machine, machine, machine, et ça produit des effets qui s’inscrivent dans le film dans les films et qui moi, m’intéressent.
Benoit Jacquot
« C’est amusant ces échanges de chair fraîche qu’il peut y avoir entre cinéastes amis. »
Benoît Jacquot
« Je dirais que le film est fait sur mon désir de son désir. (…) Je lui donne le film. Avec tout de même un pacte à la clé : si je lui donne le film, elle, en retour, se donne complètement. Ce qui est à entendre dans tous les sens qu’on voudra. (…) Pour moi, l’indice de vérité quant au monde, c’est la jeune fille. On a tous des fenêtres qui nous permettent d’envisager la réalité, sinon d’y accéder. Moi, c’est vrai que ce sont les femmes à ce moment-là de leur existence. »
Benoit Jacquot (Les Inrockuptibles, 2006)
« Mon travail de cinéaste consiste à pousser une actrice à passer un seuil. La rencontrer, lui parler, la mettre en scène, la diriger, m’en séparer, la retrouver : le mieux, pour faire tout ça, c’est encore d’être dans le même lit »
Benoît Jacquot (Libération, 2015)
« La question de l’emprise et du consentement, de ce qu’on veut ou pas, de ce qu’on ne veut pas malgré ce qu’on veut, m’a intéressé de film en film. Avec cette histoire, je voulais que ces ambivalences soient tressées jusqu’au vertige. »
Benoît Jacquot (2010)
« [En Léa Seydoux] J’ai eu l’impression de voir une sorte de résurrection, un remake d’Anna Karina. (…) Et en plus, elle avait une façon de se dépoitrailler, de montrer ses seins comme ça rapidement… Je m’y attendais pas, cela m’a beaucoup suffoqué. »
Benoît Jacquot (AlloCiné, 2012)
« Le désir est nécessairement hors la loi, et aujourd’hui encore, rien ne m’intéresse vraiment qui ne soit transgressif. En fait, je suis resté voyou et comme fixé névrotiquement à l’adolescence. Je pense d’ailleurs que mon symptôme est à chercher de ce côté-là. »
Benoît Jacquot (La Vie, 2011)
« Avant le tournage de Pas de scandale, on me prévient que Benoît Jacquot aime beaucoup les jeunes femmes. Je ne sais plus qui m’a mise en garde. Très vite, je dois manœuvrer, j’évite des situations, comme lorsqu’il veut faire des lectures dans l’hôtel où il loge. Sur le plateau, il est d’abord dans un jeu de séduction, assez subtil. Mais cela bascule au moment d’une scène, celle du lit. (…) Je fais la scène une première fois. Puis Benoît Jacquot vient me voir et me demande de la refaire sans porter de culotte en dessous du T-shirt. Cela n’a aucun sens scénaristique, puisqu’il couvre ma culotte. Mais il me fait comprendre que je n’ai pas le choix. Je vais voir l’habilleuse et lui demande de me donner une culotte couleur chair ou un string. Elle panique un peu, car elle a peur de se faire virer, mais elle finit par dire oui. Je refais la scène avec cet accessoire, sans rien dire. Benoît Jacquot me regarde d’en bas, avec ce petit sourire narquois et me dit : “Tu vois, ce n’était pas si difficile.” C’était seulement pour lui une question de pouvoir, un fantasme personnel. (…) Quelques jours après la scène du lit, Benoît Jacquot me demande : “Est-ce que tu comprends bien que, si tu es gentille avec moi, tu feras le prochain ?” Je lui ai répondu : “Je ne suis pas une gentille fille.” (…) Je le méprise. Il bénéficie d’une réputation d’intellectuel, mais il y a tellement de cynisme, d’arrogance, de sentiment de supériorité que cela ne mérite que le mépris. Je le vois comme un voleur d’enfance, émoustillé par le désir de pureté. Benoît Jacquot est dans une confusion telle qu’il recherche une histoire d’amour en même temps. Il se met en position de créateur, de demi-dieu, il façonne une femme, et cela ne l’intéresse plus quand la jeune fille devient une femme. Il cherche une dimension d’innocence, de malléabilité, pour que l’emprise puisse s’exercer. Après cela, son attitude a changé, il a été froid, distant, odieux. Il me parlait à peine et préférait passer par le premier assistant réalisateur. »
Vahina Giocante
« Comme toutes ces comédiennes qui parlent aujourd’hui, j’ai mis du temps à comprendre où mes limites avaient été franchies, comment, par qui. Comme pour beaucoup d’entre elles, mon histoire personnelle me prédisposait à être utilisée, objectifiée. Comme elles, mon image, mon corps ont nourri des fantasmes alors que, tout juste adolescente, je n’avais même pas conscience d’être sexualisée. En devenant réalisatrice, je suis devenue celle qui impose ses propres limites et sa propre vision du monde. Mon combat aujourd’hui consiste à ne pas reproduire ce système de domination avec les personnes avec lesquelles je travaille, femmes et hommes. Si toutes celles et ceux qui ont subi ces violences psychologiques ou physiques parviennent à faire face, à trouver la force de les nommer et surtout, arrêtent de les reproduire, on peut espérer que les nouvelles générations du cinéma et des arts fonctionneront désormais sur des bases plus saines. Et au-delà, pour le bien de la création, que la dénonciation de ces actes servira à renouveler nos imaginaires des femmes, des hommes, et de ce qui les lie. »
Isild Le Besco
« Benoît Jacquot surveille ce que mange Isild, la reprend, lui parle mal. On dirait un père malsain. Isild est tout le temps terrifiée et semble transformée en accessoire. »
Laurence Cordier
« J’ai lu les articles du Monde. Je n’imaginais pas. Je suis sidérée, bouleversée. Mon histoire avec Benoît Jacquot n’est pas comparable, même si je n’avais que 17 ans. Je n’ai connu aucune de ces souffrances. Ces témoignages me sidèrent, me bouleversent, je les crois et leur apporte tout mon soutien. »
Benoît Jacquot
« Ce qu’elle appelle emprise, moi je l’appelle séparation. Benoît Jacquot a une façon de travailler, sur les tournages, qui sépare les gens les uns des autres, et notamment les femmes. J’ai vécu ce mécanisme de séparation avec d’autres actrices parfois plus âgées. C’est aussi cette foutue notion d’auteur : le film appartiendrait à un seul, auquel tout est dû, auquel on doit tout, auquel on passe tout. Et avec une certaine désinvolture, plus les dépassements se manifestent, plus on les salue. Mais quand il y a violence ou prédation, c’est quelque chose que tout le monde questionne aujourd’hui. »
Caroline Champetier
« Je n’ai pas du tout la même histoire que Judith Godrèche. Benoît Jacquot m’a donné ma chance, le film est allé à Cannes, j’ai donné la réplique à Isabelle Huppert… Cela a été une super expérience pour moi, et le tournage le plus professionnel que j’ai connu. J’étais accompagnée par ma mère, qui est toujours venue avec moi sur les plateaux. Et, aujourd’hui, je ne laisserais jamais ma fille aller seule sur un tournage. »
Roxane Mesquida
« Dans ses interviews, il répète qu’il est féministe parce qu’il filme les femmes. En réalité, les femmes sont souvent maltraitées dans ses films et il aime voir ça. »
Julia Roy
« Le réel n’est pas seulement régi par des règles sociales ou des jeux de pouvoir, mais qu’il est aussi truffé par le désir, la jouissance, le manque, etc. »
Serge Toubiana (ancien patron des Cahiers du cinéma)
Benoît Jacquot, un système de prédation sous couvert de cinéma
A la suite de Judith Godrèche, plusieurs comédiennes prennent la parole dans « Le Monde » pour dénoncer des violences et du harcèlement sexuel de la part du réalisateur. Le cinéaste reconnaît certains faits.
Lorraine de Foucher et Jérôme Lefilliâtre
Le Monde
8 février2023
Dans l’amphithéâtre de Sciences Po à Paris, Julia Roy s’assoit au fond de la salle. L’étudiante de 23 ans vient écouter, ce 29 janvier 2013, la conférence d’un réalisateur qu’elle ne connaît pas, Benoît Jacquot, invité à parler de « politique de l’intime ». « Il me fixe pendant toute la séance, ça m’étonne un peu », raconte-t-elle au Monde onze ans plus tard. A la fin, elle s’approche pour saluer l’animateur de la rencontre. « Benoît Jacquot me saute dessus pour me remettre un papier avec son numéro, et me demande plusieurs fois de l’appeler. »
Depuis son enfance autrichienne à Vienne, Julia Roy, qui n’a alors joué qu’un petit rôle dans une série télévisée, nourrit une cinéphilie précoce. Elle décide de rappeler ce cinéaste : peut-être peut-il la conseiller, elle qui rêve de faire des films ? Au restaurant Le Hangar, dans le Marais, où ils se retrouvent, « il me regarde comme un miracle ». D’après son récit, il lui fait immédiatement de grandes déclarations : « Il m’annonce qu’il va faire tous ses films avec moi, qu’il m’aidera à écrire les miens, qu’il veut m’avoir tout le temps avec lui et devant lui. » Tout juste est-il déçu en apprenant son âge : il la pensait plus jeune.
Six ans après, en 2019, c’est une jeune femme traumatisée par la relation nouée avec le réalisateur qui s’enfuit en Autriche. « J’ai été diagnostiquée comme atteinte d’un syndrome de stress post-traumatique. » En janvier 2024, elle découvre les accusations de Judith Godrèche sur sa relation passée avec Benoît Jacquot qui ont motivé l’ouverture d’une enquête préliminaire, mercredi 7 février. Elle décide à son tour d’évoquer publiquement son vécu avec le réalisateur, composé de manipulation, de domination, de violences physiques et de harcèlement sexuel. Certains des faits qu’elle dénonce pourraient ne pas être couverts par la prescription.
Au début, leur rapport prend la forme d’une amitié professionnelle, une sorte de mentorat, par lequel le réalisateur veut aider l’étudiante à faire des films. Il l’invite à Venise en 2013, comme Judith Godrèche en 1987. « Dans le train couchette, il m’approche physiquement. Je suis mal à l’aise, je trouve ça étrange vu notre différence d’âge. »
En 2015, sur le tournage d’A jamais, un film dont Julia Roy est la scénariste et dans lequel elle tient le rôle principal face à Mathieu Amalric, elle vit un premier épisode traumatique. « Dans une chambre d’hôtel dans l’Algarve au Portugal, il se met à m’insulter, à me traiter de pute et de salope », explique-t-elle. Il y aura trois autres films ensuite, jusqu’à la fuite en 2019. Dans la presse de l’époque, Julia Roy est alors décrite comme la « nouvelle muse » ou « égérie » de Benoît Jacquot.
« Tu seras morte en France »
Entre l’actrice et le réalisateur, la relation se dégrade progressivement au point qu’elle reçoit une gifle si puissante qu’elle tombe par terre. Les brimades se poursuivent : il contrôle sa nourriture, la longueur de ses cheveux, sa façon de s’habiller et de parler, et la dissuade de reprendre des études. « Il voulait contrôler tout ce que je faisais. Quand je le confrontais sur ses violences verbales et physiques, il détournait tout, prétendait que rien de tout cela n’était arrivé, et son discours était souvent contradictoire. Je commençais à douter sur mon propre ressenti, à perdre mon libre arbitre et mon esprit critique. Je n’avais plus confiance en moi. »
Elle craint d’aller au restaurant avec lui, de peur que cela dégénère. Il lui lance des verres d’eau au visage. Au festival de Lisbonne & Estoril, en 2017, lors d’un repas avec d’autres invités du festival, juste avant de s’asseoir, il recule sa chaise pour qu’elle tombe par terre. « Il avait des crises de rage fréquentes, au cours desquelles il jetait des chaises (comme lors du Festival de Venise, à l’Hôtel Excelsior en 2017), des assiettes et des verres, et donnait des coups de pied, qui me laissaient stupéfaite. »
Benoît Jacquot profère des menaces : si elle arrête de le voir, il ternira sa réputation dans le cinéma et elle ne pourra plus jamais travailler nulle part. « Tu seras morte en France », lui dit-il. A table en 2018, lors des Ciné Rencontres de Prades (Pyrénées-Orientales), il lui répète : « T’es morte pour moi, t’es comme morte. » Quand elle l’accuse et se défend, il essaye d’acheter son silence en voulant lui offrir sa maison en Grèce. « Si nous restons amis, elle sera à toi. »
« Il ne supportait pas l’image de la vieillesse que je lui renvoyais, il se haïssait de ne pas être jeune, me répétait qu’il était un éternel adolescent. Il ne voulait pas que je lui rappelle son âge », analyse aujourd’hui la comédienne et scénariste. « Il me disait que j’étais une femme-enfant. Je le voyais lire Sade et Nabokov, et il me disait que je lui faisais penser à une peinture de Balthus. Comme à Judith Godrèche deux décennies plus tôt.
Un marché formulé aux comédiennes
Pour se reconstruire, Julia s’est tournée vers sa première passion : l’écriture, à travers laquelle elle a pu mieux comprendre ce qu’elle a vécu. Elle vient de finir le scénario d’un long-métrage sur le mouvement #metoo en France et compte prochainement passer à la réalisation de son premier court métrage. « Il me fait de la peine parce qu’en fait il est terrifié – son sadisme est à la mesure de sa peur », conclut-elle.
Interrogé par Le Monde, Benoît Jacquot nie plusieurs de ces faits, mais en reconnaît certains. « Je lui ai donné un coup de pied au cul, lors d’un dîner à Florence, dans un hôtel où nous étions. Mais ce n’était pas un coup de poing dans le ventre. C’était comme un truc qu’on fait à un enfant pour le calmer. Je ne culpabilise pas à propos de cela aujourd’hui. » Il admet également lui avoir jeté le contenu d’un verre d’eau au visage et avoir eu avec elle « des discussions assez violentes, fortes », « des engueulades éventuellement vigoureuses ». Les insultes ? « C’est très possible. » Le cinéaste ajoute : « Il y a une violence dans les rapports amoureux. Je ne suis pas particulier ou exceptionnel. Mais comme je fais du cinéma, cela prend des proportions exceptionnelles. » Et de regretter l’importation depuis les Etats-Unis d’un « néopuritanisme assez effrayant ».
Le réalisateur, 77 ans aujourd’hui et auteur d’une trentaine de films, a toujours revendiqué une conviction artistique : il faut être « amoureux » de ses actrices pour éprouver le désir de les mettre en scène. Avec pour conséquence, dans sa vie personnelle, que les films et les femmes se mêlent. Ce dont il ne s’est jamais caché. A l’écouter, il s’agirait même d’un contrat qu’il passe avec ses comédiennes. En 2006, dans Les Inrockuptibles, il évoque sa collaboration avec Judith Godrèche sur La Désenchantée en ces termes : « Je dirais que le film est fait sur mon désir de son désir. (…) Je lui donne le film. Avec tout de même un pacte à la clé : si je lui donne le film, elle, en retour, se donne complètement. Ce qui est à entendre dans tous les sens qu’on voudra. »
Le marché est explicitement formulé : le réalisateur de films d’auteur célébré offre un beau rôle à une comédienne, souvent en devenir, et attend en échange qu’elle s’offre à lui. En 2015 dans Libération, Benoît Jacquot redit la même chose, mais pour la généraliser à l’ensemble de son œuvre : « Mon travail de cinéaste consiste à pousser une actrice à passer un seuil. La rencontrer, lui parler, la mettre en scène, la diriger, m’en séparer, la retrouver : le mieux, pour faire tout ça, c’est encore d’être dans le même lit.»
« Un voleur d’enfance »
Ce contrat, plus ou moins tacite, Vahina Giocante dit l’avoir refusé. La comédienne a 17 ans lorsqu’elle rejoint le tournage de Pas de scandale, film de Benoît Jacquot diffusé en salle en 1999. A l’époque, celle qui se destinait à une carrière de danseuse mais a été repérée sur une plage par une directrice de casting a déjà joué dans trois longs-métrages. Avec ce nouveau projet, elle décroche un rôle de premier plan, partageant l’affiche avec Fabrice Luchini, Isabelle Huppert et Vincent Lindon, trois des comédiens fétiches du réalisateur. Vahina Giocante incarne Stéphanie, une jeune coiffeuse entretenant une relation ambiguë avec le personnage plus âgé interprété par Luchini.
Au bar d’un hôtel parisien, Vahina Giocante, 42 ans désormais, accepte de replonger dans ses souvenirs, dans le but de soutenir Judith Godrèche. « Avant le tournage de Pas de scandale, raconte-t-elle, on me prévient que Benoît Jacquot aime beaucoup les jeunes femmes. Je ne sais plus qui m’a mise en garde. Très vite, je dois manœuvrer, j’évite des situations, comme lorsqu’il veut faire des lectures dans l’hôtel où il loge. Sur le plateau, il est d’abord dans un jeu de séduction, assez subtil. Mais cela bascule au moment d’une scène, celle du lit. »
C’est le premier plan de Pas de scandale dans lequel apparaît l’actrice. On la voit s’extraire d’un lit où elle a passé la nuit avec un homme plus âgé, attraper un long T-shirt vert qui traîne au sol et commencer à s’habiller, le vêtement récupéré par terre sur le corps. « Je fais la scène une première fois. Puis Benoît Jacquot vient me voir et me demande de la refaire sans porter de culotte en dessous du T-shirt. Cela n’a aucun sens scénaristique, puisqu’il couvre ma culotte. Mais il me fait comprendre que je n’ai pas le choix. Je vais voir l’habilleuse et lui demande de me donner une culotte couleur chair ou un string. Elle panique un peu, car elle a peur de se faire virer, mais elle finit par dire oui. Je refais la scène avec cet accessoire, sans rien dire. Benoît Jacquot me regarde d’en bas, avec ce petit sourire narquois et me dit : “Tu vois, ce n’était pas si difficile.” » C’était seulement pour lui une question de pouvoir, un fantasme personnel.
Un autre épisode sur ce tournage, dont elle a gardé des souvenirs précis, a marqué Vahina Giocante. « Quelques jours après la scène du lit, Benoît Jacquot me demande : “Est-ce que tu comprends bien que, si tu es gentille avec moi, tu feras le prochain ?” » Pour l’actrice, l’allusion est limpide : si elle couche avec le réalisateur, elle obtiendra un rôle dans son film suivant, en l’occurrence Sade, pour lequel le cinéaste a finalement engagé Isild Le Besco. Vahina Giocante refuse les avances du metteur en scène. « Je lui ai répondu : “Je ne suis pas une gentille fille.” Après cela, son attitude a changé, il a été froid, distant, odieux. Il me parlait à peine et préférait passer par le premier assistant réalisateur. » Interrogé sur ces éléments, qui pourraient relever du délit de harcèlement sexuel, Benoît Jacquot dément.
Vahina Giocante n’a plus jamais tourné avec le cinéaste. « Je le méprise, dit-elle. Il bénéficie d’une réputation d’intellectuel, mais il y a tellement de cynisme, d’arrogance, de sentiment de supériorité que cela ne mérite que le mépris. Je le vois comme un voleur d’enfance, émoustillé par le désir de pureté. Benoît Jacquot est dans une confusion telle qu’il recherche une histoire d’amour en même temps. Il se met en position de créateur, de demi-dieu, il façonne une femme, et cela ne l’intéresse plus quand la jeune fille devient une femme. Il cherche une dimension d’innocence, de malléabilité, pour que l’emprise puisse s’exercer. »
La question de l’emprise » au cœur de ses films
Sur les photos d’archives, qui datent d’août 1999, Isild Le Besco a les airs de la fillette qu’elle était encore : corps minuscule, visage frêle, tresse et regard tendre. Lors du tournage de Sade, film sorti en 2000, elle a 16 ans. C’est à ce moment qu’elle fait la rencontre de Benoît Jacquot, 52 ans à l’époque, et qu’elle entame avec lui une relation qui durera plusieurs années, jusqu’au film L’Intouchable (2006). La comédienne, 41 ans aujourd’hui, voit-elle dans l’histoire de Judith Godrèche des similarités avec la sienne ? Au Monde, elle répond qu’elle ne se sent « pas prête à évoquer cette histoire dans la presse ». Elle réserve sa parole à une éventuelle convocation « devant un tribunal » et pour un récit écrit sur lequel elle travaille depuis des mois.
Elle nous a toutefois transmis un texte dans lequel elle reconnaît avoir subi des « violences psychologiques ou physiques » de la part de Benoît Jacquot. « Comme toutes ces comédiennes qui parlent aujourd’hui, j’ai mis du temps à comprendre où mes limites avaient été franchies, comment, par qui, écrit-elle. Comme pour beaucoup d’entre elles, mon histoire personnelle me prédisposait à être utilisée, objectifiée. Comme elles, mon image, mon corps ont nourri des fantasmes alors que, tout juste adolescente, je n’avais même pas conscience d’être sexualisée. En devenant réalisatrice, je suis devenue celle qui impose ses propres limites et sa propre vision du monde. Mon combat aujourd’hui consiste à ne pas reproduire ce système de domination avec les personnes avec lesquelles je travaille, femmes et hommes. Si toutes celles et ceux qui ont subi ces violences psychologiques ou physiques parviennent à faire face, à trouver la force de les nommer et surtout, arrêtent de les reproduire, on peut espérer que les nouvelles générations du cinéma et des arts fonctionneront désormais sur des bases plus saines. Et au-delà, pour le bien de la création, que la dénonciation de ces actes servira à renouveler nos imaginaires des femmes, des hommes, et de ce qui les lie. »
Confronté à ce propos, Benoît Jacquot nie toute violence physique à l’égard d’Isild Le Besco. Sur d’éventuelles violences psychologiques, il avance une hypothèse. D’après lui, la comédienne lui reprocherait de n’avoir pas voulu faire d’enfants avec elle. « Elle l’a très mal vécu », dit-il. Au moment de ce qu’il décrit comme sa « vie amoureuse » avec Isild Le Besco, Benoît Jacquot explique qu’il habitait avec l’actrice Anne Consigny, la mère de ses deux fils.
Isild Le Besco a participé à six films de Benoît Jacquot, dont Au fond des bois (2010). Ce film relate l’histoire d’une jeune bourgeoise qui suit un vagabond sans que l’on sache si elle le fait de son plein gré. Au moment de sa sortie, le réalisateur en parlait dans Le Journal du dimanche de la manière suivante, qui résonne étrangement aujourd’hui : « La question de l’emprise et du consentement, de ce qu’on veut ou pas, de ce qu’on ne veut pas malgré ce qu’on veut, m’a intéressé de film en film. Avec cette histoire, je voulais que ces ambivalences soient tressées jusqu’au vertige. »
Un homme en plein délire
Présente en 2004 sur le tournage du film A tout de suite avec Isild Le Besco, la comédienne Laurence Cordier se souvient d’une jeune femme séparée des autres acteurs de son âge : « Benoît Jacquot surveille ce que mange Isild, la reprend, lui parle mal. On dirait un père malsain. Isild est tout le temps terrifiée et semble transformée en accessoire. »
La même Laurence Cordier a, elle aussi, connu une expérience étrange avec Benoît Jacquot. C’était en 2009, peu avant l’avant-première de Villa Amalia, l’un des plus grands succès du cinéaste. Au restaurant, ce dernier lui fait une déclaration : « Il faut qu’on vive une histoire ensemble, tu vas être mon égérie. » Il explique qu’il a besoin d’être amoureux de son actrice, comme un peintre et son modèle. Il lui promet comme aux autres de l’emmener en Italie, de lui faire découvrir Venise.
Lorsque, d’après son récit, Laurence Cordier tente de l’éconduire, il lui demande de se taire et insiste : « Je sais qu’au fond de toi tu en as envie, ça va être merveilleux. » Au bout d’une heure, pendant laquelle elle a l’impression de se trouver face à un homme en plein délire, il sort des clés de chez lui. « C’est pour quand tu vas venir chez moi », l’informe-t-il. Face au refus de la comédienne de prendre la clé, Benoît Jacquot finit par la lui glisser dans la poche de son manteau. Désarçonnée, elle court après lui pour lui rendre l’objet. Il se retourne, furieux : « Tu ne me touches pas et tu gardes cette clé. » Le soir même, Laurence Cordier reçoit un message vocal sur son répondeur. C’est Benoît Jacquot qui lui donne son adresse et ses codes et l’invite à venir quand elle veut.
La comédienne ne sait pas comment réagir. Elle doit retrouver quelques semaines plus tard le réalisateur pour le téléfilm Les Faux-Monnayeurs, sur lequel elle a décroché un rôle. Va-t-elle le perdre si elle ne se rend pas chez Benoît Jacquot ? Elle n’est finalement pas virée et participe au projet. Mais à la fin du tournage, le cinéaste vient la voir pour lui signifier qu’elle « ne veu[t] pas vraiment être actrice car [elle] [se] sabotai[t] [elle]-même ». Elle a gardé la clé des années dans son bureau, ne sachant pas quoi en faire, pour finalement la jeter. Aujourd’hui, Laurence Cordier a délaissé le cinéma pour devenir metteuse en scène de théâtre. Auprès du Monde, Benoît Jacquot confirme l’histoire : « Je lui ai mis une clé dans la poche. C’est un crime ? Elle me plaisait beaucoup, j’avais l’impression que je lui plaisais aussi. »
« Cette foutue notion d’auteur »
Entre le cinéaste et Virginie Ledoyen, la rencontre a lieu en 1994, alors que la comédienne n’a pas encore 18 ans – lui en a 47. C’est à l’occasion d’essais pour un téléfilm diffusé un an plus tard sur Arte, La Vie de Marianne. Inspiré du roman de Marivaux, ce récit d’initiation, genre chéri par le cinéaste, narre le destin d’une jeune héroïne sur laquelle s’exerce le désir des hommes, dont l’un beaucoup plus âgé qu’elle, en même temps que leur chantage. Soit l’assurance de leur protection contre le cadeau de la chair. Comme un rappel fictionnel du « pacte » évoqué par Benoît Jacquot à propos de Judith Godrèche dans La Désenchantée.
Ces essais, lectures filmées en très gros plan sur le visage de Virginie Ledoyen, figurent dans les bonus d’un double DVD édité par les Cahiers du cinéma, où l’on trouve aussi un entretien avec le réalisateur. Interrogé sur la façon dont il a découvert la comédienne, le réalisateur explique l’avoir vue pour la première fois dans un film d’Olivier Assayas, L’Eau froide, sorti en 1994. « C’est amusant ces échanges de chair fraîche qu’il peut y avoir entre cinéastes amis », commente au passage Benoît Jacquot.
Contactée par Le Monde par le biais de son agent, Virginie Ledoyen n’a d’abord pas répondu à nos sollicitations. Après lecture des articles publiés, elle nous a fait parvenir ce message : « J’ai lu les articles du Monde. Je n’imaginais pas. Je suis sidérée, bouleversée. Mon histoire avec Benoît Jacquot n’est pas comparable, même si je n’avais que 17 ans. Je n’ai connu aucune de ces souffrances. Ces témoignages me sidèrent, me bouleversent, je les crois et leur apporte tout mon soutien. »
Directrice de la photographie réputée, Caroline Champetier a travaillé sur une dizaine de films avec Benoît Jacquot. Lorsqu’elle a vu la série sur Arte de Judith Godrèche, Icon of French Cinema, elle a été admirative et rattrapée par ses souvenirs. « Ce qu’elle appelle emprise, moi je l’appelle séparation. Benoît Jacquot a une façon de travailler, sur les tournages, qui sépare les gens les uns des autres, et notamment les femmes. J’ai vécu ce mécanisme de séparation avec d’autres actrices parfois plus âgées. » Et celle qui a débuté avec Jean-Luc Godard de poursuivre : « C’est aussi cette foutue notion d’auteur : le film appartiendrait à un seul, auquel tout est dû, auquel on doit tout, auquel on passe tout. Et avec une certaine désinvolture, plus les dépassements se manifestent, plus on les salue. Mais quand il y a violence ou prédation, c’est quelque chose que tout le monde questionne aujourd’hui. »
Une manière d’esthétiser ses pratiques
Toutes les jeunes actrices n’ont pas vécu la même pression. Roxane Mesquida a joué dans L’Ecole de la chair, film datant de 1998. « Je n’ai pas du tout la même histoire que Judith Godrèche, assure la comédienne franco-américaine, 15 ans à l’époque, 42 ans aujourd’hui. Benoît Jacquot m’a donné ma chance, le film est allé à Cannes, j’ai donné la réplique à Isabelle Huppert… Cela a été une super expérience pour moi, et le tournage le plus professionnel que j’ai connu. » Et de préciser tout de suite : « J’étais accompagnée par ma mère, qui est toujours venue avec moi sur les plateaux. Et, aujourd’hui, je ne laisserais jamais ma fille aller seule sur un tournage. »
Benoît Jacquot confond-il « désir créatif et désir sexuel », comme l’analyse par ailleurs Vahina Giocante ? Dans le café où il a accepté de rencontrer Le Monde, le cinéaste admet sans peine qu’il associe les deux élans. « C’est l’histoire de l’art et du cinéma. Je ne suis pas le seul. C’est aussi le cas de Chaplin, Bresson, Pialat, Kechiche. » Il ne voit pas ses liaisons avec des actrices qu’il fait tourner comme des « abus de pouvoir » : « cela désérotiserait ces histoires », argue-t-il. « Dans le cinéma, il y a le début, la naissance de quelqu’un, d’un acteur ou d’une actrice, par la façon dont ils apparaissent dans un film. Cela m’intéresse beaucoup. »
Les inclinations assumées de Benoît Jacquot pour ses comédiennes, souvent mineures, ont suscité très peu d’émoi dans le monde culturel. Toute sa carrière, le cinéaste a produit un discours théorique cherchant à esthétiser ces pratiques, à les transformer en geste subversif et artistique. Avec un succès certain. « Pour moi, l’indice de vérité quant au monde, c’est la jeune fille, disait-il ainsi dans Les Inrocks en 2006. On a tous des fenêtres qui nous permettent d’envisager la réalité, sinon d’y accéder. Moi, c’est vrai que ce sont les femmes à ce moment-là de leur existence. »
Son œuvre cinématographique est traversée par un motif récurrent : celui de la jeune fille objet d’un désir amoureux agressif, émanant souvent d’hommes plus âgés. L’un de ses films les plus récents, Dernier Amour (2019) avec Vincent Lindon, s’intéresse à l’histoire d’un échec amoureux de Casanova auprès d’une jeune prostituée. Dans Journal d’une femme de chambre (2015), la domestique incarnée par Léa Seydoux doit se défendre des agressions sexuelles du maître de maison (joué par Hervé Pierre) et faire avec la brutalité sexuelle du jardinier (Lindon, encore).
« Dans ses interviews, il répète qu’il est féministe parce qu’il filme les femmes, relève Julia Roy. En réalité, les femmes sont souvent maltraitées dans ses films et il aime voir ça. » De Léa Seydoux, le cinéaste racontait, dans une interview filmée pour AlloCiné en 2012, l’avoir découverte dans La Belle Personne, de Christophe Honoré : « J’ai eu l’impression de voir une sorte de résurrection, un remake d’Anna Karina. (…) Et en plus, elle avait une façon de se dépoitrailler, de montrer ses seins comme ça rapidement… Je m’y attendais pas, cela m’a beaucoup suffoqué. »
« Fixé à l’adolescence »
Pendant sa carrière, le cinéaste a été souvent soutenu par des médias influents, dont Le Monde, Télérama, Libération, Radio France, etc. En 2007, il a fait l’objet d’une rétrospective à la Cinémathèque, le temple français des cinéphiles. Dans son texte de présentation de l’événement, l’ex-directeur de l’établissement, Serge Toubiana, par ailleurs ancien patron des Cahiers du cinéma et proche de Jacquot, saluait un artiste pour lequel « le réel n’est pas seulement régi par des règles sociales ou des jeux de pouvoir, mais qu’il est aussi truffé par le désir, la jouissance, le manque, etc. » Sollicité, Serge Toubiana n’a pas répondu au Monde.
Cette conception du cinéma de Benoît Jacquot est partagée par le réalisateur lui-même. En 2011, dans une conversation publiée par La Vie avec le psychanalyste Gérard Miller (par ailleurs accusé de viols et agressions sexuelles, dans des enquêtes de Elle et Mediapart), il faisait cette réflexion sur lui-même : « Le désir est nécessairement hors la loi, et aujourd’hui encore, rien ne m’intéresse vraiment qui ne soit transgressif. En fait, je suis resté voyou et comme fixé névrotiquement à l’adolescence. Je pense d’ailleurs que mon symptôme est à chercher de ce côté-là. »
https://www.lemonde.fr/societe/article/2024/02/08/benoit-jacquot-un-systeme-de-predation-sous-couvert-de-cinema_6215357_3224.html
J’aimeJ’aime