
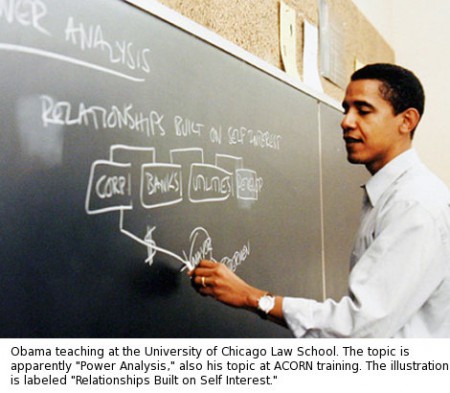
 C’est ainsi que finit le monde. Pas sur un Boum, sur un murmure. TS Eliot
C’est ainsi que finit le monde. Pas sur un Boum, sur un murmure. TS Eliot
If by « intellectual » you mean people who are a special class who are in the business of imposing thoughts, and framing ideas for people in power, and telling everyone what they should believe, and so on, well, yeah, that’s different. Those people are called « intellectuals » — but they’re really more a kind of secular priesthood, whose task is to uphold the doctrinal truths of the society. And the population should be anti-intellectual in that respect, I think that’s a healthy reaction. In fact, if you compare the United States with France, or with most of Europe for that matter, I think one of the healthy things about the United States is precisely this: there’s very little respect for intellectuals as such. And there shouldn’t be. What’s there to respect? I mean, in France if you’re part of the intellectual elite and you cough, there’s a front-page story in Le Monde. That’s one of the reasons why French intellectual culture is so farcical – it’s like Hollywood. You’re in front of the television cameras all the time, and you’ve got to keep doing something new so they’ll keep focusing on you and not the guy at the next table, and people don’t have ideas that are that good, so they have to come up with crazy stuff, and the intellectuals get all pompous and self-important. So I remember during the Vietnam War, there’d be these big international campaigns to protest the war, and a number of times I was asked to co-sign letters with, say, Jean-Paul Sartre [French philosopher]. Well, we’d co-sign some statement, and in France it was front-page news; here, nobody even mentioned it. And the French thought was scandalous; I thought it was terrific – why the hell should anybody mention it? What difference does it make if two guys who happen to have some name recognition got together and signed a statement? Why should that be of any particular interest to anybody? So I think the American reaction is much healthier in this respect. Noam Chomsky (Rowe, Massachusetts; April 1989)
Ces gens-là sont appelés « intellectuels », mais il s’agit en réalité plutôt d’une sorte de prêtrise séculière, dont la tâche est de soutenir les vérités doctrinales de la société. Et sous cet angle-là, la population doit être contre les intellectuels, je pense que c’est une réaction saine. (…) En France, si vous faites partie de l’élite intellectuelle et que vous toussez, on publie un article en première page du Monde. C’est une des raisons pour lesquelles la culture intellectuelle française est tellement burlesque : c’est comme Hollywood. Noam Chomsky
Le boulot des intellectuels du courant dominant, c’est de servir en quelque sorte de « clergé laïque », de s’assurer du maintien de la foi doctrinale. Si vous remontez à une époque où l’Église dominait, c’est ce que faisait le clergé : c’étaient eux qui guettaient et traquaient l’hérésie. Et lorsque les sociétés sont devenues plus laïques […], les mêmes contrôles sont restés nécessaires : les institutions devaient continuer à se défendre, après tout, et si elles ne le pouvaient pas le faire en brûlant les gens sur le bûcher […], il leur fallait trouver d’autres moyens. Petit à petit, cette responsabilité a été transférée vers la classe intellectuelle – être les gardiens de la vérité politique sacrée, des hommes de main en quelque sorte. Noam Chomsky
[La vie intellectuelle française] a quelque chose d’étrange. Au Collège de France, j’ai participé à un colloque savant sur » Rationalité, vérité et démocratie « . Discuter ces concepts me semble parfaitement incongru. A la Mutualité, on m’a posé la question suivante : » Bertrand Russell nous dit qu’il faut se concentrer sur les faits, mais les philosophes nous disent que les faits n’existent pas. Comment faire ? » Une question de ce type laisse peu de place à un débat sérieux car, à un tel niveau d’abstraction, il n’y a rien à ajouter. (…) Comme observateur lointain, je formulerai une hypothèse. Après la Seconde Guerre mondiale, la France est passée de l’avant-garde à l’arrière-cour et elle est devenue une île. Dans les années 30, un artiste ou un écrivain américain se devait d’aller à Paris, de même qu’un scientifique ou un philosophe avait les yeux tournés vers l’Angleterre ou l’Allemagne. Après 1945, tous ces courants se sont inversés, mais la France a eu plus de mal à s’adapter à cette nouvelle hiérarchie du prestige. Cela tient en grande partie à l’histoire de la collaboration. Alors, bien sûr, il y a eu la Résistance et beaucoup de gens courageux, mais rien de comparable avec ce qui s’est passé en Grèce ou en Italie, où la résistance a donné du fil à retordre à six divisions allemandes. Et il a fallu un chercheur américain [Robert Paxton, NDLR] pour que la France soit capable d’affronter ce passé. (…) beaucoup d’intellectuels français sont restés staliniens même quand ils sont passés à l’extrême droite. Comment peut-on accepter que l’Etat définisse la vérité historique et punisse la dissidence de la pensée ? (…) Au Timor-Oriental, entre un quart et un tiers de la population a été décimée avec l’accord des Etats-Unis et de la France, et peu de gens le savent alors que tout le monde connaît les crimes de Pol Pot. Noam Chomsky
Si les révolutions symboliques sont particulièrement difficiles à comprendre, surtout lorsqu’elles sont réussies, c’est parce que le plus difficile est de comprendre ce qui semble aller de soi, dans la mesure où la révolution symbolique produit les structures à travers lesquelles nous la percevons. Autrement dit, à la façon des grandes révolutions religieuses, une révolution symbolique bouleverse des structures cognitives et parfois, dans une certaine mesure, des structures sociales. Elle impose, dès lors que ‘elle réussit, de nouvelles structures cognitives qui, du fait qu’elles se généralisent, qu’elles se diffusent, qu’elles habitent l’ensemble des sujets percevants d’un univers social, deviennent imperceptibles. Pierre Bourdieu
C’est une chose que Weber dit en passant dans son livre sur le judaïsme antique : on oublie toujours que le prophète sort du rang des prêtres ; le Grand Hérésiarque est un prophète qui va dire dans la rue ce qui se dit normalement dans l’univers des docteurs. Bourdieu
La bourgeoisie s’est toujours méfiée – à raison – des intellectuels. Mais elle s’en méfie comme d’êtres étranges qui sont issus de son sein. La plupart des intellectuels, en effet, sont nés de bourgeois qui leur ont inculqué la culture bourgeoise. Ils apparaissent comme gardiens et transmetteurs de cette culture. De fait, un certain nombre de techniciens du savoir pratique se sont, tôt ou tard, faits leurs chiens de garde, comme a dit Nizan. Les autres, ayant été sélectionnés, demeurent élitistes même quand ils professent des idées révolutionnaires. Ceux-là, on les laisse contester : ils parlent le langage bourgeois. Mais doucement on les tourne et, le moment venu, il suffira d’un fauteuil à l’Académie française ou d’un prix Nobel ou de quelque autre manœuvre pour les récupérer. C’est ainsi qu’un écrivain communiste peut exposer actuellement les souvenirs de sa femme à la Bibliothèque nationale et que l’inauguration de l’exposition est faite par le ministre de l’éducation nationale. (…) Cependant il est des intellectuels – j’en suis un – qui, depuis 1968, ne veulent plus dialoguer avec la bourgeoisie. En vérité, la chose n’est pas si simple : tout intellectuel a ce qu’on appelle des intérêts idéologiques. Par quoi on entend l’ensemble de ses œuvres, s’il écrit, jusqu’à ce jour. Bien que j’aie toujours contesté la bourgeoisie, mes œuvres s’adressent à elle, dans son langage, et – au moins dans les plus anciennes – on y trouverait des éléments élitistes. Je me suis attaché, depuis dix-sept ans, à un ouvrage sur Flaubert qui ne saurait intéresser les ouvriers car il est écrit dans un style compliqué et certainement bourgeois. Aussi les deux premiers tomes de cet ouvrage ont été achetés et lus par des bourgeois réformistes, professeurs, étudiants, etc. Ce livre qui n’est pas écrit par le peuple ni pour lui résulte des réflexions faites par un philosophe bourgeois pendant une grande partie de sa vie. J’y suis lié. Deux tomes ont paru, le troisième est sous presse, je prépare le quatrième. J’y suis lié, cela veut dire : j’ai 67 ans, j’y travaille depuis l’âge de 50 ans et j’y rêvais auparavant. Or, justement, cet ouvrage (en admettant qu’il apporte quelque chose) représente, dans sa nature même, une frustration du peuple. C’est lui qui me rattache aux lecteurs bourgeois. Par lui, je suis encore bourgeois et le demeurerai tant que je ne l’aurai pas achevé. Il existe donc une contradiction très particulière en moi : j’écris encore des livres pour la bourgeoisie et je me sens solidaire des travailleurs qui veulent la renverser. Jean-Paul Sartre (1976)
Les intellectuels ont pris l’habitude de travailler non pas dans l’universel, l’exemplaire, le juste-et-le-vrai-pour-tous, mais dans des secteurs déterminés, en des points précis où les situaient soit leurs conditions de travail, soit leurs conditions de vie (le logement, l’hôpital, l’asile, le laboratoire, l’université, les rapports familiaux ou sexuels). (…) Ils y ont gagné à coup sûr une conscience beaucoup plus concrète et immédiate des luttes. Et ils ont rencontré là des problèmes qui étaient spécifiques, non universels, différents souvent de ceux du prolétariat ou des masses. (…) Et cependant, ils s’en sont rapprochés, je crois pour deux raisons : parce qu’il s’agissait de luttes réelles, matérielles, quotidiennes, et parce qu’ils rencontraient souvent, mais dans une autre forme, le même adversaire que le prolétariat, la paysannerie ou les masses (les multinationales, l’appareil judiciaire et policier, la spéculation immobilière) ; c’est ce que j’appellerais l’intellectuel spécifique par opposition à l’intellectuel universel. Michel Foucault
Tout ce qui pouvait nuire à Obama serait donc omis et caché; tout ce qui pouvait nuire à McCain serait monté en épingle et martelé à la tambourinade. On censurerait ce qui gênerait l´un, on amplifierait ce qui affaiblirait l´autre. Le bombardement serait intense, les haut-parleurs répandraient sans répit le faux, le biaisé, le trompeur et l´insidieux. Qu´importe! Nulle enquête, nulle révélation, nulle curiosité. «Je ne l´ai jamais entendu parler ainsi » -, mentait Obama, parlant de son pasteur de vingt ans, Jeremiah Wright, fasciste noir, raciste à rebours, mégalomane délirant des théories conspirationnistes – en vingt ans de prêches et de sermons. Circulez, vous dis-je, y´a rien à voir – et les media, pieusement, de n´aller rien chercher. ACORN, organisation d´activistes d´extrême-gauche, aujourd´hui accusée d´une énorme fraude électorale, dont Obama fut l´avocat – et qui se mobilise pour lui, et avec laquelle il travaillait à Chicago? Oh, ils ne font pas partie de la campagne Obama, expliquent benoîtement les media. Et, ajoute-t-on, sans crainte du ridicule, «la fraude aux inscriptions électorales ne se traduit pas forcément en votes frauduleux». Si, si, c´est ce que dit la presse. La démocratie part du postulat que : «la puissance de bien juger, et distinguer le vrai d’avec le faux» est possession de chaque citoyen, et non d´une élite basée sur la naissance, la fortune, la puissance, ni même le savoir. Bisque, bisque, le déchaînement d´aigreur de la gauche face à Sarah Palin et son adhésion passionnée à l´image vide, charismatique et caméléonesque d´Obama, le Rédempteur qui sauvera le parti intellectuel de la vulgarité du monde et de l´électorat; celui qui «s´accroche à sa foi et à ses armes à feu», comme Obama l´avait dit avec d´autant plus de candeur qu´il ne croyait pas être entendu par eux. (…) Je suggère que cette rage écumante est fondée sur un sentiment exacerbé de lèse-majesté. En l´occurrence, la majesté lésée est celle du monopole d´opinion, que la classe intellectuelle et assimilée (la classe médiatique, l´universitaire, celle du spectacle, etc.) estime lui revenir de droit, et exclusivement. (…) L´intellectuel manie des objets symboliques, ou objets mentaux, d´une grande variété. Leur maniement tend souvent à persuader l´intellectuel qu´il est mieux à même de saisir le monde que quiconque. Or, son pouvoir sur ce monde n´est pas du tout commensurable à la compréhension qu´il estime en avoir. Son ressentiment en est d´autant plus vif. Il ne peut se résoudre à n´être «que» professeur, écrivain, journaliste, lui qui en sait tant et plus que les autres, ceux qui ont du pouvoir. (…) C´est à lui qu´il faudrait s´adresser, vers lui qu´il faudrait se tourner. En l´absence d´une telle demande, l´intellectuel professionnel devient un homme révolté. L´intellectuel moderne tend donc souvent à se dresser contre cette réalité, qui lui refuse ce qu´il estime de droit être sa place en majesté. (…) Ce réel qui minimise et minore son importance personnelle est donc mauvais et devrait être refait. L´homme du commun, qui vote, est ignare. Les politiciens (qui n´écoutent pas notre intellectuel) sont nuls et ignorants. La dextérité dans le maniement des objets intellectuels (la dialectique, comme on disait jadis) devient mandat du Ciel. Laurent Murawiec
There’s little doubt that law student Obama was a political radical by any conventional, society-wide measure of the term. But that’s not the end of the story. At Harvard at least, radical was mainstream and conservative was radical. In fact, the radical view was so mainstream that one couldn’t help but think that even the loudest students would graduate, go to law firms, and fit in just as seamlessly to the new mainstream of their legal professions. And, in fact, most did. They weren’t intellectual leaders; they were followers. My reading of Barack Obama’s political biography is pretty simple: He’s not so much a liberal radical as a member of the liberal mainstream of whatever community he inhabits. In that video, he was doing no more and no less than what most politically engaged leftist law students were doing — supporting the radical race and gender politics that dominated campus. When he went to Chicago and met Bill Ayers, he was fitting within a second, and slightly different, liberal culture. He shifted again in Washington and then again in the White House. But radical, “conviction” politicians don’t decry Gitmo then keep it open, promise to end the wars then reinforce the troops, express outrage at Bush war tactics then maintain rendition and triple the number of drone strikes. Obama’s biography is essentially the same as many of the liberal mainstream-media journalists who cover him. They’ve made the same migration — from leading campus protests, to building families in urban liberal communities, to participating in a national political culture. At the risk of engaging in dime-store pop psychology, they like Obama in part because they identify with him so thoroughly and see much of themselves in him. David French
That pope endorsed the Iran deal, the UN’s environmentalist goals and what amounts to a worldwide open-borders policy on refugees — and offered a very specific view of how to promote development in the Third World that’s straight out of a left-wing textbook. (…) Sorry: When the pontiff sounds less like a theological leader and more like the 8 p.m. host on MSNBC or the editor of Mother Jones, what’s a guy to do? Pope Francis is entirely within his rights to become the world’s foremost liberal. But, since that’s what he is, it can’t be wrong to say so. (…) When a leader speaks in these sorts of bureaucratic specifics, he is descending from the highest heavens into ordinary, even trivial, reality. He’s using his authority in the realm of the spiritual to influence the political behavior of others. He becomes just another pundit. And who needs another one of those? John Podhoretz
Au lendemain des attentats contre Charlie Hebdo et le magasin Hyper Cacher de Vincennes, et après le refus cinglant des jeunes des « quartiers populaires » de participer à la grande manifestation unitaire du 11 janvier, il était difficile pour les Français, même les plus angéliques, de continuer à faire l’impasse sur les dangers et sur la séduction de l’islamisme radical. Mais la propension à noyer le poisson dans ses causes supposées n’a pas disparu. Et le gouvernement a donné l’exemple en dénonçant l’apartheid culturel, ethnique et territorial qui sévirait dans nos banlieues. Ainsi la République a-t-elle plaidé coupable pour les attaques mêmes dont elle faisait l’objet. (…) Je ne vois chez nos intellectuels ni naïveté, ni lâcheté, mais, si j’ose dire, une vigilance anachronique. En Sarkozy, conseillé par Patrick Buisson, son « génie noir », ils combattaient la réincarnation du maréchal Pétain. Les musulmans leur apparaissaient comme les juifs du XXIe siècle. L’antifascisme façonnait leur vision du monde. Ils ne voulaient pas et ne veulent toujours pas voir dans la crise actuelle des banlieues autre chose qu’une résurgence de la xénophobie et du racisme français. (…) Les élites dont vous parlez ne sont pas francophobes ; face au nationalisme fermé de « l’idéologie française », elles se réclament de la patrie des droits de l’homme. Leur France est la « nation ouverte » célébrée par Victor Hugo, « qui appelle chez elle quiconque est frère ou veut l’être ». Le problème, c’est que, toutes à cette opposition gratifiante entre l’ouvert et le fermé, ces élites légitiment la haine qui se développe dans certains quartiers de nos villes pour les « faces de craie ». C’est l’exclusion, disent ces élites, qui engendre la francophobie. (…) « L’Amérique victime de son hyperpuissance », titrait Télérama après le 11 septembre 2001. Ce qu’on a du mal à penser aujourd’hui comme alors, c’est que l’Occident puisse être haï non pour l’oppression qu’il exerce, mais pour les libertés qu’il propose. Sayyid Qotb est devenu le principal doctrinaire des Frères musulmans, après un séjour aux Etats-Unis, en 1948, où il a été confronté à cette « liberté bestiale qu’on nomme la mixité », à « ce marché d’esclaves qu’on nomme « émancipation de la femme » », à « ces ruses et anxiétés d’un système de mariage et de divorce si contraire à la vie naturelle. En comparaison, quelle raison, quelle hauteur de vue, quelle joie en islam, et quel désir d’atteindre celui qui ne peut être atteint ». (…) L’esprit du temps réussit l’exploit paradoxal de nous faire vivre hors de notre temps, à côté de nos pompes. Alors que la France change de visage, il affirme, imperturbable, que l’histoire se répète, et il cherche des racistes et des fascistes pour donner corps à cette affirmation. J’ai beau être juif et défendre l’école républicaine, me voici lepéniste, et même – il faut ce qu’il faut – maurrassien. (…) La menace était très clairement énoncée en 2004 par le rapport Obin sur les signes et manifestations d’appartenance religieuse dans les établissements scolaires : « Tout laisse à penser que, dans certains quartiers, les élèves sont incités à se méfier de tout ce que les professeurs leur proposent, qui doit d’abord être un objet de suspicion, comme ce qu’ils trouvent à la cantine dans leur assiette ; et qu’ils sont engagés à trier les textes étudiés selon les mêmes catégories religieuses du halal (autorisé) et du haram (interdit). » La question du voile et celle de la nourriture sont deux composantes d’un phénomène beaucoup plus large de sécession culturelle. Et ce phénomène est en expansion. (…) Ce que je sais, grâce à Gilles Kepel, c’est que les Beurs, qui avaient fait la grande marche pour l’égalité en 1983, rejettent maintenant avec horreur ce vocable « tenu au mieux pour méprisant à leur endroit, au pire, pour un complot sioniste destiné à faire fondre comme du beurre leur identité arabo-islamique dans le chaudron des potes de SOS Racisme touillé par l’Union des étudiants juifs de France ». (…) Je pense que Michel Onfray préfère aussi – et il l’a dit – une analyse juste de Bernard-Henri Lévy à une analyse fausse d’Alain de Benoist. Pour ma part, je citerai Camus dans sa lettre adressée aux Temps modernes après la critique au vitriol de l’Homme révolté, parue dans cette revue : « On ne décide pas de la vérité d’une pensée selon qu’elle est à droite ou à gauche, et moins encore selon ce que la droite et la gauche décident d’en faire. A ce compte, Descartes serait stalinien et Péguy bénirait M. Pinay. Si, enfin, la vérité me paraissait à droite, j’y serais. » Je ne suis donc pas plus impressionné par la sortie de Manuel Valls que par la campagne de 1982 contre le « silence des intellectuels ». Le gouvernement est légitimement affolé par la montée du Front national, mais ce ne sont pas les incantations antifascistes qui inverseront la tendance et changeront la donne ; c’est la prise en compte par la gauche comme par la droite traditionnelle de l’inquiétude de toujours plus de Français devant la mutation culturelle qui nous tombe dessus, qui n’a été décidée par personne. (…) Fontenelle a écrit un jour : « On s’accoutume trop quand on est seul à ne penser que comme soi. » J’essaie donc de ne pas rester seul trop longtemps et je fais même l’émission « Répliques » pour être confronté à des points de vue très différents des miens. Mais ce n’est pas ma faute si l’actualité radote et me renvoie sans cesse à la réalité insupportable de l’éclatement de mon pays. Je suis attaqué et même insulté par ceux qui ne veulent surtout pas regarder cette réalité en face. Devant les mauvaises nouvelles, ou, pis encore, devant les nouvelles qui contredisent l’idée reçue du mal et du méchant, le plus simple est encore de s’en prendre au messager et de lui faire la peau. Alain Finkielkraut
Du XVIIIe au XXe siècle, les intellectuels étaient des guides spirituels. Une substitution au clergé – on parle d’ailleurs parfois de «clercs» pour les désigner ou d’«hérésie» de certaines conviction … Le débat d’idées y structure la société beaucoup plus qu’ailleurs. J’irai même jusqu’à dire que la pensée est une composante essentielle de ce que veut dire «être français». Et cela pour une raison historique simple : quand il fallu inventer une nation après la Révolution française, on a dû le faire à travers des principes abstraits. Procédez de cette manière, et vous serez constamment dans un débat d’idées. Etre français, c’est réfléchir sans fin aux valeurs sur lesquelles repose la citoyenneté, savoir ce qu’elles veulent dire, s’il faut les mettre à jour… Sudhir Hazareesingh
Son essai L’Identité malheureuse a été l’un des plus grands succès de librairie de l’automne 2013, tandis que son auteur devenait l’incarnation ultime du repli de l’esprit français. Toute l’oeuvre d’Alain Finkielkraut est parcourue d’images de décadence, de maladie et de mort. Il a l’habitude des hypothèses paradoxales, par exemple que l’antiracisme serait plus pernicieux que le racisme. Il a des idées fixes, sur l’islamisme ou la prétendue omniprésence de l’antisémitisme. De plus en plus nationaliste, il est de moins en moins républicain. Il défend une conception hiérarchique de l’ordre culturel et social et, tout comme le Front national, il dénonce le détournement de l’identité française par des minorités immigrées – encore une fantaisie. Son parcours illustre à quel point le pessimisme ambiant a corrompu l’héritage rousseauiste et républicain. (…) On confond trop souvent l’islam, qui est la religion paisible de l’écrasante majorité des musulmans de France, et l’islamisme radical, qui est le fait d’une petite minorité d’agités (nous les avons aussi en Angleterre, et il faut évidemment les combattre). Quant à l’antisémitisme, il faut situer ce phénomène aujourd’hui dans le cadre plus général d’une lepénisation (ou, pour être plus précis, une « marinisation ») des esprits, qui répand la peur de l’autre, qu’il soit musulman, juif, immigré ou homosexuel. Le repli identitaire, surtout lorsqu’il est relayé par des intellectuels complaisants, ne fait qu’alimenter tous les fantasmes. (…) J’y vois la résurgence d’un courant classique de l’individualisme français, à la fois frivole et cérébral, orienté vers ce que Benjamin Constant a appelé la « jouissance paisible de l’indépendance privée ». Dans Le Mystère français, Hervé Le Bras et Emmanuel Todd soulignent l’écart entre le pessimisme conscient des Français et leur optimisme inconscient au cours des trente dernières années: d’où la bonne tenue du taux de natalité, la baisse du nombre de suicides et d’homicides, les progrès de la réussite scolaire, l’émancipation des femmes et l’intégration des immigrés. (…) J’ai choisi ce discours [du ministre des Affaires étrangères Dominique de Villepin contre l’intervention armée en Irak, devant le Conseil de sécurité de l’ONU, le 14 février 2003] parce que c’est un condensé de l’esprit français, un mélange de virilité et de verve enracinées dans ce que la rhétorique française a de meilleur. Un appel à la raison et à la logique cartésienne, construit sous le signe d’oppositions binaires: conflit-harmonie, intérêt personnel- bien commun, politique de puissance-moralité… L’auteur se fait le porte-parole d’une sagesse ancestrale: « Nous sommes les gardiens d’un idéal, nous sommes les gardiens d’une conscience… » Avec le recul, cet exercice apparaît comme un ultime morceau de bravoure, le dernier acte d’une magnifique tradition universaliste. (…) la France a la particularité de mettre en avant ses prouesses morales et intellectuelles, et la conviction de devoir penser pour le reste du monde. Au XIXe siècle, Auguste Comte affirme que Paris est le centre de l’humanité, parce que l' »esprit philosophique » y règne. L’historien Ernest Lavisse écrit en 1890 que la mission de la France est de « représenter la cause de l’humanité ». La Révolution française a été la source des idéaux messianiques français: liberté, égalité, fraternité, droits de l’homme… (…) Ce culte se reflète dans la consécration de l’écrivain, véritable guide spirituel de la société, et dans l’importance accordée au style, à la syntaxe, au mot juste, au monde des idées. En 1944, un petit manuel avertissait les soldats britanniques du débarquement: « Vous aurez souvent l’impression [que les Français] se disputent violemment, alors qu’ils ne font que débattre d’une idée abstraite. » (…) Du début des années 1950 à la fin des années 1970, j’ai répertorié le « nouveau roman », la « nouvelle vague », la « nouvelle histoire », la « nouvelle philosophie », la « nouvelle société », la « nouvelle gauche », la « nouvelle droite » – sans oublier la « nouvelle cuisine »… Il suffit d’examiner comment les uns et les autres se présentent ou sont présentés, sous la forme d’oxymores: « rationaliste passionné », « missionnaire laïque », « spectateur engagé », « défaite glorieuse »… Vous ne vous en rendez pas forcément compte, mais ce genre d’expression paradoxale est déroutante pour un étranger. Julien Green l’a vécu à ses dépens à Oxford lors d’une conférence qu’il donnait sur « les trois Barrès », c’est-à-dire les trois aspects contradictoires de la pensée de l’écrivain nationaliste. Mais l’assistance n’a pas forcément saisi cette subtilité. La preuve, à l’issue de son intervention, un auditeur a levé la main et demandé: « Quels sont les prénoms des deux autres frères Barrès? » (…) L’intellectuel est un « clerc »; son engagement, une « foi »; sa rupture avec une idéologie, une « hérésie » ou une « délivrance »… Rappelez-vous Edgar Morin racontant son adhésion au communisme comme « l’espérance du salut dans la rédemption collective ». Et depuis la Révolution, les héros nationaux entrent au Panthéon, une ancienne église, et de Gaulle est devenu le Saint-Père national. (…) J’avais été surpris par les Mémoires d’Elizabeth Teissier, l’astrologue de François Mitterrand, dénichées à l’étal d’un bouquiniste, avant de découvrir que le président français n’était que le dernier d’une longue série d’hommes célèbres à croire aux « forces de l’esprit »: Robespierre, Victor Hugo, Jaurès, Poincaré, Clemenceau… Entre les deux pôles de la théologie et du matérialisme s’étend un territoire où coexistent l’attachement au rationalisme et la foi dans le surnaturel. Même si cela peut paraître paradoxal s’agissant d’un XVIIIe siècle rejetant les croyances en tout genre, certains principes de l’occultisme à la française sont enracinés dans les idées des Lumières, voire dans celles de la gauche: croyance en la bonté de l’homme, ouverture sur les valeurs et cultures différentes… (…) Cette prédisposition utopiste puise sa source chez Rousseau, qui considère que la faculté première de l’homme est l’imagination. Les oeuvres de Louis-Sébastien Mercier, Saint-Simon, Charles Fourier, Etienne Cabet sont toutes marquées par la révolte contre l’injustice et par l’ambition d’épanouir la nature humaine. Par ailleurs, le raisonnement utopique est marqué par son caractère systématique et radical. Ces idéaux progressistes ont contribué à l’adhésion de très nombreux Français au communisme. Car, au fond, les promesses du Parti communiste français ne renvoyaient-elles pas à l’ambition des Lumières de former des citoyens instruits partageant une morale laïque commune, à l’aspiration rousseauiste à régénérer l’homme, au désir de Fourier de promouvoir une plus grande harmonie sociale, au culte de la perfection et de l’industrie de Saint-Simon, à la « dictature bienveillante » de Cabet… ? Sudhir Hazareesingh
Today’s Left Bank is but a pale shadow of this eminent past. Fashion outlets have replaced high theoretical endeavor in Saint-Germain-des-Près (…) Indeed, as Europe fumbles shamefully in its collective response to its current refugee crisis, it is sobering that the reaction which has been most in tune with the Enlightenment’s Rousseauist heritage of humanity and cosmopolitan fraternity has come not from socialist France, but from Christian-democratic German. Sudhir Hazareesingh
French thought is in the doldrums. French philosophy, which taught the world to reason with sweeping and bold systems such as rationalism, republicanism, feminism, positivism, existentialism and structuralism, has had conspicuously little to offer in recent decades. Saint-Germain-des-Prés, once the engine room of the Parisian Left Bank’s intellectual creativity, has become a haven of high-fashion boutiques, with fading memories of its past artistic and literary glory. As a disillusioned writer from the neighbourhood noted grimly: “The time will soon come when we will be reduced to selling little statues of Sartre made in China.” French literature, with its once glittering cast of authors, from Balzac and George Sand to Jules Verne, Albert Camus and Marguerite Yourcenar, has likewise lost much of its global appeal – a loss barely concealed by recent awards of the Nobel prize for literature to JMG Le Clézio and Patrick Modiano. Yet little of this ideological fertility is now in evidence, and French thinking is no longer a central point of reference for progressives across the world. (…) Since the late 20th century French thought has lost many of the qualities that made for its universal appeal: its abundant sense of imagination, its buoyant sense of purpose, and above all its capacity (even when engaging in the most byzantine of philosophical issues) to give everyone tuning in, from Buenos Aires to Beirut, the sense that they were participating in a conversation of transcendental significance. In contrast, contemporary French thinking has become increasingly inward-looking – a crisis that manifests itself in the sense of disillusionment among the nation’s intellectual elites, and in the rise of the xenophobic Front National, which has become one of the most dynamic political forces in contemporary France. (…) This pessimistic sensibility has been exacerbated by a widespread belief that French culture is itself in crisis. The representation of France as an exhausted and alienated country, corrupted by the egalitarian heritage of May 68, overrun by Muslim immigrants and incapable of standing up for its own core values is a common theme in French conservative writings. Among the bestselling works in this genre are Alain Finkielkraut’s L’identité malheureuse (2013) and Éric Zemmour’s Suicide Français (2014). This morbid sensibility (which has no real equivalent in Britain, despite its recent economic troubles) is also widespread in contemporary French literature, as best exemplified in Michel Houellebecq’s recent oeuvre: La carte et le territoire (2010) presents France as a haven for global tourism, “with nothing to sell except charming hotels, perfumes, and potted meat”; his latest novel Soumission (2015) is a dystopian parable about the election of an Islamist president in France, set against a backdrop of a general collapse of Enlightenment values. (…) This ascendency of technocratic values among French progressive elites is itself reflective of a wider intellectual crisis on the left. The singular idea of the world (a mixture of Cartesian rationalism, republicanism and Marxism) that dominated the mindset of the nation’s progressive elites for much of the modern era has disintegrated. The problem has been compounded by the self-defeating success of French postmodernism: at a time when European progressives have come up with innovative frameworks for confronting the challenges to democratic power and civil liberties in western societies (Michael Hardt and Antonio Negri’s notion of empire, and Giorgio Agamben’s concept of the state of exception), their Gallic counterparts have been indulging in abstract word games, in the style of Derrida and Baudrillard. French progressive thinkers no longer produce the kind of sweeping grand theories that typified the constructs of the Left Bank in its heyday. They advocate an antiquated form of Marxism (Alain Badiou), a nostalgic and reactionary republicanism (Régis Debray), or else offer a permanent spectacle of frivolity and self-delusion (Bernard-Henri Lévy). Sudhir Hazareesingh
Sur les migrants, au lieu de mener son peuple, Hollande a parlé comme un fonctionnaire : toujours cette peur du Front national qui empoisonne la vie politique française. Sudhir Hazareesingh
Et si la French theory avait été victime de son succès ?
A l’heure où, entre l’Iran, Cuba et les Palestiniens, les chefs prétendus à la fois du Monde libre et de la chrétienté ne sont plus que les petits perroquets des slogans les plus éculés du gauchisme primaire …
Et où – accès de folie (ou retour du refoulé ?) et avec les conséquences catastrophiques que l’on sait, la jusqu’ici plutôt pragmatique chef du gouvernement allemand s’est transformée sous nos yeux en passionaria du multiculturalisme …
Comment ne pas être surpris après l’étonnante inimitié (réciproque) d’un des plus grands intellectuels américains vivants, déclaré persona non grata au Pays des intellectuels depuis sa défense de la liberté de parole d’un Faurisson …
Du néo-déclinisme de ce Mauriço-britannique d’Oxford et groupie déclarée de nos Napoléon et autre Villepin …
Se lamentant, dans son dernier livre, du déclin et du déclinisme de l’actuelle pensée française ?
A l’instar justement, comme il le rappelle lui-même, d’un pays qui, entre culte de la culture, clercs nouveaux directeurs de conscience et rites panthéoniques …
Semble ne s’être toujours pas remis de la laïcisation forcée de sa Révolution ?
A moins qu’après la débâcle communiste que l’on sait et l’américanisation honnie qu’appelait de ses voeux Chomsky pour l’Europe et la France, il ait enfin perdu son « respect » pour les membres de cette « sorte de prêtrise séculière » ou de « clergé laïc » qui n’étaient en fait que les « gardiens de la vérité politique sacrée » ?
« La France croit devoir penser pour le reste du monde »
Propos recueillis par Emmanuel Hecht
L’Express
28/08/2015
Francophile invétéré et grand spécialiste de Napoléon et du général de Gaulle, Sudhir Hazareesingh porte un regard d’entomologiste sur les moeurs, us et coutumes de nos intellectuels et penseurs. Interview.
Sudhir Hazareesingh, professeur au Balliol College, à Oxford, fait paraître Ce pays qui aime les idées (éd. Flammarion). En version originale: « Comment les Français pensent. Portrait affectueux d’un peuple intellectuel ». Plutôt que d’un essai à charge, il s’agit en effet d’une enquête sur les moeurs, us et coutumes de nos intellectuels et penseurs. Il a enseigné à l’EHESS, à l’Ecole pratique des hautes études et à Sciences po, et n’ignore pas que « sans la liberté de blâmer… »
Comment, en étant originaire de l’océan Indien, peut-on se passionner pour la vie culturelle et politique française?
C’est une vieille histoire. Au Collège royal de Curepipe, à l’île Maurice, j’ai été nourri de littérature française: Molière, Racine, Saint-Exupéry, Gide, Sartre et Camus. Mon père, Kissoonsingh, historien formé à Cambridge et à la Sorbonne, chef de cabinet du Premier ministre sir Seewoosagur Ramgoolam, avait des liens étroits avec Malraux et Senghor. Je baignais dans un climat de francophilie. Et je n’oublierai jamais le rôle de l’attaché culturel français Antoine Colonna, qui me permettait de suivre l’actualité dans les hebdomadaires, dont L’Express!
Ma francophilie a également été aiguisée par Apostrophes, l’émission télévisée de Bernard Pivot. Je me souviens en particulier d’une intervention de Marguerite Yourcenar, en 1979, sur les notions du bien et du mal. Vous ne pouvez pas imaginer comment, de l’océan Indien, cette émission avait quelque chose de léger et subtil. Etudiant à Oxford pendant les années 1980, j’ai conservé cette passion pour la France, pour son dynamisme culturel, pour son mépris du matérialisme et pour l’éventail de ses opinions politiques et leur complexité historique. C’était un bonheur que de se plonger dans les arcanes du catholicisme, du communisme, de l’extrême droite, de la république, de la monarchie… dans un Royaume-Uni à l’apogée du bipartisme et en pleine déprime thatchérienne!
Votre dernier livre traduit en français, Ce pays qui aime les idées, est la synthèse d’une trentaine d’années consacrées à l’histoire des idées en France, mais aussi une tentative de réponse à la question: pourquoi les Français sont-ils si pessimistes? Quelle est votre réponse, à vous, qui êtes familier des rives de la Seine et qui enseignez de l’autre côté du Channel, dans la prestigieuse université d’Oxford?
Le « malaise français » est au coeur des débats intellectuels depuis une vingtaine d’années: perte de repères idéologiques, crise du modèle républicain, euroscepticisme et rejet de la mondialisation, obsession du « déclinisme » devenue l’idée fixe de la classe politique. En 1995, Jean-Marie Domenach dressait un bilan accablant de la littérature contemporaine française et de l’absence de véritable critique littéraire à la mode anglo-saxonne, celles du Times Literary Supplement et de la New York Review of Books.
En ce début de rentrée littéraire – un rendez-vous très français -, il faut souligner que, pour le monde anglophone, la littérature française s’est égarée entre nombrilisme et abstraction. Lorsqu’un livre attire l’attention à l’étranger, c’est rarement un roman ou un essai philosophique. Le dernier best-seller hors des frontières est Le Capital au XXIe siècle, de l’économiste Thomas Piketty.
A vos yeux, les intellectuels, Alain Finkielkraut en tête, sont les porte-drapeaux d’un « nationalisme fermé ». Notre philosophe n’est-il pas un « coupable » parfait?
Je ne crois pas. Tenons-nous-en aux faits. Son essai L’Identité malheureuse a été l’un des plus grands succès de librairie de l’automne 2013, tandis que son auteur devenait l’incarnation ultime du repli de l’esprit français. Toute l’oeuvre d’Alain Finkielkraut est parcourue d’images de décadence, de maladie et de mort. Il a l’habitude des hypothèses paradoxales, par exemple que l’antiracisme serait plus pernicieux que le racisme. Il a des idées fixes, sur l’islamisme ou la prétendue omniprésence de l’antisémitisme.
De plus en plus nationaliste, il est de moins en moins républicain. Il défend une conception hiérarchique de l’ordre culturel et social et, tout comme le Front national, il dénonce le détournement de l’identité française par des minorités immigrées – encore une fantaisie. Son parcours illustre à quel point le pessimisme ambiant a corrompu l’héritage rousseauiste et républicain.
Vous ne croyez pas au danger de l’islamisme en France? Et vous ne constatez pas la montée d’un antisémitisme de banlieue?
On confond trop souvent l’islam, qui est la religion paisible de l’écrasante majorité des musulmans de France, et l’islamisme radical, qui est le fait d’une petite minorité d’agités (nous les avons aussi en Angleterre, et il faut évidemment les combattre). Quant à l’antisémitisme, il faut situer ce phénomène aujourd’hui dans le cadre plus général d’une lepénisation (ou, pour être plus précis, une « marinisation ») des esprits, qui répand la peur de l’autre, qu’il soit musulman, juif, immigré ou homosexuel. Le repli identitaire, surtout lorsqu’il est relayé par des intellectuels complaisants, ne fait qu’alimenter tous les fantasmes.
En France, l’intellectuel est un « clerc », son engagement une « foi » et de Gaulle « le Saint-Père national ». Ici, la cérémonie des panthéonisés du 27 mai.
Comment expliquez-vous le contraste entre le pessimisme collectif des Français et, à en croire les sondages, leur relatif optimisme individuel?
J’y vois la résurgence d’un courant classique de l’individualisme français, à la fois frivole et cérébral, orienté vers ce que Benjamin Constant a appelé la « jouissance paisible de l’indépendance privée ». Dans Le Mystère français, Hervé Le Bras et Emmanuel Todd soulignent l’écart entre le pessimisme conscient des Français et leur optimisme inconscient au cours des trente dernières années: d’où la bonne tenue du taux de natalité, la baisse du nombre de suicides et d’homicides, les progrès de la réussite scolaire, l’émancipation des femmes et l’intégration des immigrés.
Cet état d’esprit n’est pas si nouveau. Il est ancré chez les élites depuis l’ère postrévolutionnaire, dites-vous. Y compris à gauche, où vous avez même repéré un « désespoir progressiste »? On ne sait plus à qui se fier…
Eh oui, la gauche n’a pas toujours baigné dans un optimisme béat, fondé sur la croyance au progrès. En 1863, au faîte de la gloire de Napoléon III, Proudhon écrit: « Je crois que nous sommes en pleine décadence, et plus je reconnais que j’ai été dupe de mon excessive générosité, moins il me reste de confiance dans la vitalité de ma nation. »
Les premières pages de votre essai sont consacrées au discours du ministre des Affaires étrangères Dominique de Villepin contre l’intervention armée en Irak, devant le Conseil de sécurité de l’ONU, le 14 février 2003. C’est plutôt inattendu, comme entrée en matière?
J’ai choisi ce discours parce que c’est un condensé de l’esprit français, un mélange de virilité et de verve enracinées dans ce que la rhétorique française a de meilleur. Un appel à la raison et à la logique cartésienne, construit sous le signe d’oppositions binaires: conflit-harmonie, intérêt personnel- bien commun, politique de puissance-moralité… L’auteur se fait le porte-parole d’une sagesse ancestrale: « Nous sommes les gardiens d’un idéal, nous sommes les gardiens d’une conscience… » Avec le recul, cet exercice apparaît comme un ultime morceau de bravoure, le dernier acte d’une magnifique tradition universaliste.
N’est-ce pas le cas de nombreuses nations que de se considérer comme investies d’une mission, les Etats-Unis, la Russie, Israël…?
Certes, mais la France a la particularité de mettre en avant ses prouesses morales et intellectuelles, et la conviction de devoir penser pour le reste du monde. Au XIXe siècle, Auguste Comte affirme que Paris est le centre de l’humanité, parce que l' »esprit philosophique » y règne. L’historien Ernest Lavisse écrit en 1890 que la mission de la France est de « représenter la cause de l’humanité ». La Révolution française a été la source des idéaux messianiques français: liber té, égalité, fraternité, droits de l’homme…
Vous avez été frappé par l’étrange culte à la culture célébré par les Français. Il s’agit vraiment d’une spécificité nationale?
J’en suis convaincu. Ce culte se reflète dans la consécration de l’écrivain, véritable guide spirituel de la société, et dans l’importance accordée au style, à la syntaxe, au mot juste, au monde des idées. En 1944, un petit manuel avertis sait les soldats britanniques du débarquement: « Vous aurez souvent l’impression [que les Français] se disputent violemment, alors qu’ils ne font que débattre d’une idée abstraite. »
Pour les Français, dites-vous, la meilleure façon de vendre des idées, c’est d’affirmer qu’elles sont nouvelles. N’y aurait-il pas un peu de marketing dans l’air?
La question se pose. Du début des années 1950 à la fin des années 1970, j’ai répertorié le « nouveau roman », la « nouvelle vague », la « nouvelle histoire », la « nouvelle philosophie », la « nouvelle société », la « nouvelle gauche », la « nouvelle droite » – sans oublier la « nouvelle cuisine »…
Autre trouvaille de vos recherches: le paradoxe serait l’une des clefs d’entrée de la pensée française?
Il suffit d’examiner comment les uns et les autres se présentent ou sont présentés, sous la forme d’oxymores: « rationaliste passionné », « missionnaire laïque », « spectateur engagé », « défaite glorieuse »… Vous ne vous en rendez pas forcément compte, mais ce genre d’expression paradoxale est déroutante pour un étranger. Julien Green l’a vécu à ses dépens à Oxford lors d’une conférence qu’il donnait sur « les trois Barrès », c’est-à-dire les trois aspects contradictoires de la pensée de l’écrivain nationaliste. Mais l’assistance n’a pas forcément saisi cette subtilité. La preuve, à l’issue de son intervention, un auditeur a levé la main et demandé: « Quels sont les prénoms des deux autres frères Barrès? »
Au vocabulaire. L’intellectuel est un « clerc »; son engagement, une « foi »; sa rupture avec une idéologie, une « hérésie » ou une « délivrance »… Rappelez-vous Edgar Morin racontant son adhésion au communisme comme « l’espérance du salut dans la rédemption collective ». Et depuis la Révolution, les héros nationaux entrent au Panthéon, une ancienne église, et de Gaulle est devenu le Saint-Père national.
Autre surprise: au pays de Descartes et du rationalisme philosophique, les Français se passionneraient pour l’occultisme?
J’avais été surpris par les Mémoires d’Elizabeth Teissier, l’astrologue de François Mitterrand, dénichées à l’étal d’un bouquiniste, avant de découvrir que le président français n’était que le dernier d’une longue série d’hommes célèbres à croire aux « forces de l’esprit »: Robespierre, Victor Hugo, Jaurès, Poincaré, Clemenceau… Entre les deux pôles de la théologie et du matérialisme s’étend un territoire où coexistent l’attachement au rationalisme et la foi dans le surnaturel. Même si cela peut paraître paradoxal s’agissant d’un XVIIIe siècle rejetant les croyances en tout genre, certains principes de l’occultisme à la française sont enracinés dans les idées des Lumières, voire dans celles de la gauche: croyance en la bonté de l’homme, ouverture sur les valeurs et cultures différentes…
Dernière caractéristique des Français cartésiens, selon vous, l’inclination pour l’utopie…
Cette prédisposition utopiste puise sa source chez Rousseau, qui considère que la faculté première de l’homme est l’imagination. Les oeuvres de Louis-Sébastien Mercier, Saint-Simon, Charles Fourier, Etienne Cabet sont toutes marquées par la révolte contre l’injustice et par l’ambition d’épanouir la nature humaine. Par ailleurs, le raisonnement utopique est marqué par son caractère systématique et radical.
Ces idéaux progressistes ont contribué à l’adhésion de très nombreux Français au communisme. Car, au fond, les promesses du Parti communiste français ne renvoyaient-elles pas à l’ambition des Lumières de former des citoyens instruits partageant une morale laïque commune, à l’aspiration rousseauiste à régénérer l’homme, au désir de Fourier de promouvoir une plus grande harmonie sociale, au culte de la perfection et de l’industrie de Saint-Simon, à la « dictature bienveillante » de Cabet… ?
Sudhir Hazareesingh en 6 dates
1961 Naissance à l’île Maurice dans une famille de lettrés et de hauts fonctionnaires d’origine indienne.
1981 Etudiant au Balliol College, à Oxford, où il enseigne aujourd’hui les sciences politiques et les relations internationales.
1990 Soutenance d’une thèse sur les rapports entre les intellectuels français et le communisme.
2006 Prix d’histoire de la Fondation Napoléon pour La Légende de Napoléon.
2010 Le Mythe gaullien (Gallimard).
2015 Ce pays qui aime les idées. Histoire d’une passion française (Flammarion).
Interview
Sudhir Hazareesingh : «Chez les intellectuels français émerge un néoconservatisme républicain, frileux et nombriliste»
Sonya Faure
Libération
28 août 2015
Professeur à Oxford, le Britannique né sur l’île Maurice publie «Ce pays qui aime les idées», un essai consacré à la passion typiquement française pour le débat, de plus en plus schématisant et pessimiste.
Face au succès des thèses déclinistes d’Eric Zemmour, d’Alain Finkielkraut ou de Michel Houellebecq, on les cherche anxieusement du regard : mais où sont les intellectuels de gauche ? Pourquoi un tel silence du camp «progressiste» quand ne cesse de se répandre une vision anxieuse et anxiogène du monde ? Dans Ce pays qui aime les idées, un essai paru cette semaine chez Flammarion, un Britannique, professeur à Oxford, se penche sur cette inclination si française pour le débat. Sudhir Hazareesingh a connu son premier émoi intellectuel sur l’île Maurice, où il a grandi, quand il a vu, sur le petit écran, Marguerite Yourcenar débattre des notions de bien et de mal à Apostrophes, l’émission culte de Bernard Pivot. «Même si tant de subtilité avait quelque chose de légèrement cocasse (tout particulièrement lorsqu’on l’observait d’une île tropicale de l’océan Indien), personne ne pouvait à l’époque rivaliser avec l’énergie intellectuelle et le panache des Français», écrit-il. Que reste-t-il de ce panache ? L’universitaire britannique dresse un tableau assez alarmant. Qu’est-il donc arrivé à la France et à ses intellectuels pour qu’ils s’enlisent dans un tel pessimisme teinté d’ethnocentrisme ?
Vous faites le constat très sévère d’une crise de la pensée française. Quels en sont les symptômes ?
La neurasthénie s’est emparée de la France. La vie intellectuelle a versé dans une très forte tendance au déclinisme. En témoigne l’élection d’Alain Finkielkraut à l’Académie française ou les deux derniers romans de Houellebecq, qui a certes toujours donné dans le morbide, mais qui touche désormais à l’extrême névrose… Ce qui me frappe, c’est que ces intellectuels, polémistes ou écrivains ont une vision psychologisante du déclin français. On parle de la France comme d’un patient, on évoque la pourriture – voyez Bernard-Henri Lévy qui compare la gauche française à un «grand cadavre à la renverse», reprenant un mot de Sartre. Dans la culture anglo-saxonne, ce genre de constat s’accompagnerait d’une analyse empirique. On irait voir ce qu’il en est réellement, sur le terrain. Ainsi, l’école française républicaine tant brocardée est-elle vraiment en déclin ? Sur quelles notations s’appuie ce constat ? Où est la chute du taux d’alphabétisation ? C’est une particularité bien française : le débat – et particulièrement le débat décadentiste – s’en tient à un discours très abstrait et à des schémas globalisants.
Ce pessimisme français est-il nouveau ?
Il me semble au contraire être le propre de la pensée française : la certitude que la France est un grand pays, qui doit penser non seulement pour lui-même mais aussi pour le reste du monde, est associée à une grande angoisse de déclin. On retrouve cette dialectique depuis la Révolution jusqu’aux écrits du général de Gaulle. Lorsqu’on a des ambitions extraordinaires, on craint toujours de ne pas être à la hauteur. La France est chargée de représenter la cause de l’humanité, selon Lavisse. Et quand la France n’arrive pas à concrétiser cet universalisme, elle se dit : «Tout est foutu».
Ce qui est plus grave aujourd’hui, c’est qu’une partie du monde intellectuel diffuserait, dites-vous, «une forme étriquée de nationalisme ethnique»…
Pour le dire vite, jusqu’à la fin du XXe siècle, le nationalisme qui dominait en France était républicain : un patriotisme plutôt. On était français tant qu’on adhérait à des valeurs abstraites – le fameux «plébiscite de tous les jours» de Renan. L’identité collective était une construction sociale réinventée à chaque génération. Mais ce schéma-là a commencé à s’effriter à la fin du XXe siècle – à droite surtout, mais aussi à gauche. Le «non» au référendum sur la Constitution européenne de 2005 est un tournant majeur : il représente, entre autres choses, la victoire de la gauche fermée, repliée sur elle-même (le silence des intellectuels, lors de cette campagne, est d’ailleurs éloquent). A partir de 2011, le «marinisme» a commencé à émerger, avec l’ambition de banaliser les idées et les valeurs du Front national, et à droite, Alain Finkielkraut a entamé son évolution vers un nationalisme xénophobe et larmoyant. Une espèce de néoconservatisme républicain, frileux, nombriliste et nostalgique émerge en France.
Cette pensée, on la retrouve aussi chez l’acteur royaliste Lorànt Deutsch, qui vend ses livres sur Paris et la France à plusieurs dizaines milliers de d’exemplaires…
Pour comprendre les grands mouvements de pensée et leur diffusion, il ne faut pas se contenter d’étudier les grands intellectuels. On assiste aujourd’hui à la résurgence d’une histoire conservatrice (dans la tradition royaliste et nationaliste). Y participent aussi bien Deutsch que Jean Sévillia, du Figaro magazine. C’est important car l’histoire a une place de premier plan dans la constitution de l’identité collective française. Pour Sévillia, depuis plus d’un siècle, un complot entre historiens républicains aurait servi à occulter la vraie histoire de la France en minimisant le poids du royalisme et de la chrétienté, et en inventant le mythe d’une terre d’accueil et d’assimilation. Ces polémiques – on pourrait aussi mentionner les débats houleux sur les lois mémorielles – soulignent à quel point l’historien est toujours considéré en France à la fois comme un guérisseur et un oracle chargé de révéler la continuité de la nation et son destin.
Pourquoi le débat français ne parvient-il pas à se saisir plus sereinement de la question des minorités ?
La source du problème vient là encore de l’approche très schématisée des problèmes sociaux en France. On ne pense pas au sort concret des musulmans ou des minorités postcoloniales, on réfléchit à leur place par rapport au principe abstrait qu’est la laïcité. La tournure qu’a pris le débat sur le voile en France est frappante. Dès les années 80, à partir de l’histoire de deux jeunes filles qui arrivent voilées dans un collège de banlieue, un texte signé par des intellectuels de gauche, comme Régis Debray ou Elisabeth Badinter, parle du «Munich de l’école républicaine» ! Les traits caractéristiques du débat d’idées français sont en place : explosion de concepts tonitruants, schématisation extrême. On ne parle jamais des immigrés eux-mêmes, de ce qu’ils sont ou de la manière dont ils se voient. On touche ici à un autre problème : l’interdiction de faire des statistiques ethniques en France. Elles sont pourtant devenues indispensables si on ne veut pas laisser le champ libre aux «fantasmagoristes» qui occupent le terrain aujourd’hui.
Ce refus du multiculturalisme en France, vous le faites remonter à Descartes.
Descartes pose que la pensée est l’essence fondamentale de l’être humain. Et la pensée est indivisible. C’est pour cette raison que toute la tradition républicaine a vu en Descartes son fondateur. Les républicains disaient en effet exactement la même chose au niveau politique : c’est la rationalité qui fonde l’identité politique, et celle-ci ne se divise pas – des schémas très holistiques déjà. Cette grande tradition totalisante a certes été très créative, mais elle a aussi empêché les Français de réfléchir à l’identité de manière souple. Le contraste est évident avec l’Angleterre, où l’on peut être British-Asian, à la fois britannique et asiatique. En France, les mots n’existent pas pour dire cette possible hybridation. On en revient toujours à l’expression «Français d’origine» algérienne ou malienne. Mais l’origine est un faux problème. Elle ne dit que la trace de ce qu’était la personne – ou ses parents – il y a vingt ou cinquante ans. Pas ce qu’elle est aujourd’hui et qui peut tenir d’un brassage des identités.
La figure de l’intellectuel français existe-t-elle encore ?
Elle a connu un repli indéniable. Du XVIIIe au XXe siècle, les intellectuels étaient des guides spirituels. Une substitution au clergé – on parle d’ailleurs parfois de «clercs» pour les désigner ou d’«hérésie» de certaines convictions. La grande tradition intellectuelle française, de Voltaire et Rousseau à Sartre et Foucault, reposait sur un socle littéraire et philosophique, et sur la puissance de l’Ecole normale supérieure. On est désormais passé du lettré philosophe au technocrate. Sans doute parce qu’une société très moderne n’a plus besoin de maître à penser. Sans doute aussi parce que les intellectuels français ont abusé de concepts abstraits – Derrida et les structuralistes notamment. Les fonctions intellectuelles sont toujours là – elles n’évoluent d’ailleurs pas beaucoup quand on voit que Saint-Germain-des-Près concentre toujours autant de maisons d’édition -, des pamphlets s’écrivent tous les six mois… Mais les intellectuels ne s’investissent plus autant dans le débat politique et les politiques n’en sont d’ailleurs plus demandeurs.
Les intellectuels de gauche sont-ils responsables de leur perte de crédit, en France ou à l’étranger ?
Ils ont toujours de nobles sentiments : la défense des plus démunis, le rejet de la fatalité sociale, le mépris pour le mercantilisme anglo-saxon. Mais ils n’ont pas su développer une alternative européenne, une authentique troisième voie entre le mirage du social-libéralisme et les vieilles chimères jacobino-marxistes. Nous l’attendions justement de la France, pays des intellectuels. Mais ils se sont repliés et ont fermé les volets, tournant ainsi le dos au grand principe francais de fraternité. Dès le XVIIIe siècle pourtant, les républicains avaient une culture totalement européenne : ils lisaient Kant et, plus tard, les utilitaristes anglais… Rousseau n’était même pas français ! Mais la production intellectuelle est aujourd’hui devenue très franco-française. A double titre : elle ne parle que de la France et s’exporte peu… à de rares exceptions près, comme le travail sur les lieux de mémoire de l’historien Pierre Nora.
Vous oubliez l’économiste Thomas Piketty ?
Pour le dire de manière provocante, Piketty n’est pas aussi français que les Français le pensent. Sa formation intellectuelle est en partie anglo-américaine et son mode de raisonnement – sa grande utilisation de statistiques – ne s’inscrit pas précisément dans la tradition française. Je suis surtout frappé par une chose : à quel point il est célébré en France, mais à quel point aussi il n’est pas du tout écouté par le gouvernement socialiste. Nul n’est prophète en son pays…
L’autre grand échec des intellectuels français selon vous, c’est de ne pas avoir su endiguer la montée du Front national.
C’est navrant pour le pays de la tradition dreyfusarde. C’est une constante depuis les années 80 : on a systématiquement sous-estimé le Front national. Sans doute est-ce encore une fois dû à une forme de pensée holistique et essentialiste typiquement française : on part de l’idée que la France est le pays de la Révolution et des droits de l’homme. Donc, dans ce pays-là, le Front national ne peut être qu’un phénomène éphémère. Donc on n’a pas besoin d’y réfléchir.
La France est-elle vraiment si intello ?
Le débat d’idées y structure la société beaucoup plus qu’ailleurs. J’irai même jusqu’à dire que la pensée est une composante essentielle de ce que veut dire «être français». Et cela pour une raison historique simple : quand il fallu inventer une nation après la Révolution française, on a dû le faire à travers des principes abstraits. Procédez de cette manière, et vous serez constamment dans un débat d’idées. Etre français, c’est réfléchir sans fin aux valeurs sur lesquelles repose la citoyenneté, savoir ce qu’elles veulent dire, s’il faut les mettre à jour… En France, le moindre village célèbre l’écrivain inconnu qui est né sur ses terres. Il y a encore une épreuve de philo au bac et, chaque année, en juin, la France se met à en discuter… Hier, j’assistais à une altercation entre deux automobilistes parisiens au sujet d’une place de parking. En tout dernier recours, la femme a lancé à l’homme : «C’est une question de principe, monsieur !» Je me suis dit : «Voilà, je suis en France.»
Ce qui est d’abord nouveau aujourd’hui, c’est cela : une forme de fusion des pensées antimodernes dans un éloge commun d’un « républicanisme » nostalgique et passéiste qui réunit les ennemis d’hier, ceux qui sont effectivement les héritiers d’une culture républicaine comme ceux qui s’inscrivent dans une tradition profondément antirépublicaine. La deuxième chose qui me frappe, c’est la dimension très franco-française de cette pensée du repli. (…) Troisième élément qui caractérise notre époque : l’absence de véritable débat. (…) . On n’entend plus de contre-discours. Les antimodernes ont cannibalisé l’espace public. Enfin, quatrième point frappant : la tendance très actuelle à diaboliser tout ce qui est « autre ». (…) Tout ce qui est « autre » est représenté comme une menace pour « l’identité française », cet autre étant à la fois l’étranger (l’Allemagne, les Etats-Unis, le monde arabo-musulman) et le minoritaire (les féministes, les homosexuels, les immigrés, etc.). (…) ces auteurs définissent l’identité française comme un archipel d’îlots menacés. Le premier de ces îlots, c’est la laïcité, dont l’ennemi est à leurs yeux le multiculturalisme. Le deuxième, c’est la souveraineté : ici, l’adversaire s’appelle la mondialisation (ou l’Europe). Le troisième de ces îlots, c’est la civilisation française au sens large : dès lors que tout ce qui est français est par définition supérieur à ce qui ne l’est pas, tout doit être fait pour éviter l’invasion d’une culture étrangère, par essence barbare et immorale. D’où, chez ces auteurs, l’éloge fréquent de la notion de frontière et, à l’inverse, le rejet de toute forme de cosmopolitisme.(…) Dans d’autres pays européens, le réflexe souverainiste et pessimiste peut exister : il est le socle des populismes qui se manifestent un peu partout. Mais (…) En France (…) le pessimisme repose fondamentalement sur le déclinisme, et s’appuie sur certains traits caractéristiques de la tradition intellectuelle nationale : le penchant pour le schématisme, l’abstraction et le refus des faits, le goût du paradoxe, le recours systématique à la diabolisation et aux arguments extrêmes, et une vision apocalyptique de l’avenir. Sudhir Hazareesingh
Voir aussi:
Sudhir Hazareesingh : « En France, le déclinisme a gagné beaucoup de terrain »
LE MONDE DES LIVRES
20.08.2015
Propos recueillis par Julie Clarini
Professeur à Oxford, spécialiste de Napoléon, Sudhir Hazareesingh s’intéresse à l’histoire et à la culture politique françaises (La Saint-Napoléon, Tallandier, 2007 ; Le Mythe gaullien, Gallimard, 2010). Son nouveau livre, à paraître le 27 août, brosse un portrait intellectuel des Français.
Comment dégager un « esprit français » ?
Il s’agit d’éviter toute forme d’essentialisme. J’essaie de montrer que la pensée française est une construction sociale : à partir des Lumières, un certain mode et style de pensée s’impose et devient hégémonique. J’en décris les caractéristiques et je montre comment cette pensée a été soutenue par les institutions françaises, par l’Etat, par les grandes écoles, par les producteurs de savoirs… Par exemple, le moment que nous vivons aujourd’hui, la rentrée littéraire, est une des manifestations de cet esprit français. Tout est très codifié, très ritualisé. Après une période de vide absolu pendant l’été, les livres arrivent en masse. Et on commence à parler des prix, à chuchoter des noms. Surtout, très vite, s’opère la distinction implicite entre la masse des livres et la petite élite qui va vraiment compter.
Votre essai dégage ce qui soutient cet esprit français. On reconnaît certains traits (un rapport à la raison, à l’abstraction, une certaine propension à l’utopie, etc.) ; d’autres sont plus étonnants, comme cette tendance à l’occultisme…
Par hasard, en flânant sur les quais de la Seine, j’ai acheté les Mémoires de l’astrologue Elizabeth Teissier (Sous le signe de Mitterrand, Editions n° 1, 1997). C’est étonnant de voir à quel point Mitterrand était proche d’elle. Vous vous souvenez sans doute de cette scène où le président déclare, en 1995, face à la caméra : « Je crois aux forces de l’esprit. » Or, en travaillant sur le mythe de Napoléon, j’avais déjà repéré l’importance d’un certain mysticisme au XIXe siècle. J’ai voulu creuser un peu plus. Et il s’avère que l’ésotérisme est une composante fondamentale de la pensée républicaine et socialiste, jusqu’au milieu du XXe siècle. Ce qui est surtout très particulier à la France, c’est que ce sont les hommes et les femmes de gauche, qui croient au progrès, aux Lumières, qui sont fascinés par l’ésotérisme. L’occultisme est la partie submergée à la fois de la tradition républicaine et de la tradition progressiste. Je me permets donc d’avancer la thèse d’une continuité depuis la Révolution jusqu’à Mitterrand.
Vous analysez, dans votre dernier chapitre, l’évolution du monde intellectuel depuis dix ans. Que voyez-vous ?
Un esprit décliniste a gagné beaucoup de terrain, y compris à gauche, elle qui représentait pourtant la tradition philosophique de l’optimisme et du volontarisme. Je crois qu’il s’agit d’un conservatisme nationaliste qui auparavant était aux marges de la République. Barrès, par exemple, se disait républicain mais au sens très minimal. Ses écrits portent la trace de son refus des valeurs républicaines comme l’égalité ou la fraternité. Il me semble que c’est cette tradition-là qui renaît, mais elle renaît cette fois à l’intérieur de la tradition républicaine.
Car le repli que j’essaie d’analyser se manifeste à la fois dans l’espace et dans le temps : un repli nombriliste, qui tourne le dos à l’internationalisme et à la fraternité ; et un repli sur la IIIe République, qui devient un âge d’or. C’est par exemple étrange que François Hollande soit allé s’agenouiller devant la statue de Jules Ferry. Comment Ferry peut-il incarner un modèle pour l’homme d’Etat du XXIe siècle, lui qui justifiait l’empire colonial au nom de la supériorité de la race française ? Voilà qui reflète bien l’incapacité française à regarder en face son héritage colonial.
Qu’avez-vous pensé de la manifestation du 11 janvier ?
J’ai regardé cela avec intérêt et fascination. D’abord il y a cette chose très française, et tout à fait admirable, que chaque fois qu’on s’en prend vraiment à la République, le peuple descend dans la rue. Mais la question, c’est : au nom de quelles valeurs ces Français et ces Françaises ont-ils manifesté ?
Je ne suis pas complètement d’accord avec la thèse d’Emmanuel Todd (dans Qui est Charlie ?, Seuil), mais je pense qu’il saisit quelque chose de profond : dans tout grand mouvement de défense de valeurs républicaines, il y a aussi parfois la tentation d’une certaine forme d’exclusion. D’ailleurs, historiquement, cette ambiguïté fait aussi partie de la grande tradition républicaine : le dissident est mis au ban de la communauté politique. Le grand slogan révolutionnaire, c’était : « Liberté, Egalité, Fraternité ou la mort ! »
Il est grand temps d’avoir en France des statistiques ethniques pour savoir ce que pensent vraiment les minorités. Et dédramatiser. En Grande-Bretagne ou aux Etats-Unis, on aurait déjà eu vingt-cinq sondages ! Mais encore une fois, en France, on préfère les schémas, et la grande opposition laïcité-religions. C’est une opposition très peu subtile, trop binaire, pour permettre de comprendre ce que veut dire être musulman en France.
Les données essentielles de l’esprit français
Sans doute faut-il être un spécialiste de Napoléon, et qui plus est un Britannique, pour se découvrir non seulement l’envie mais aussi le talent de cerner « l’esprit français ». Sudhir Hazareesingh est dans ce cas. En signant Ce pays qui aime les idées (titre anglais : « Comment pensent les Français », moins flatteur), il fait montre de tout le sérieux et de toute la bienveillante ironie qui sied à l’entreprise. Bref, on le lit avec plaisir, et profit. Les premiers chapitres sont de parfaites synthèses des grandes tendances de la culture française telle qu’elle s’est construite depuis le XVIIIe siècle : l’auteur y tente d’identifier les schémas de pensée, les croyances, et la rhétorique qui forment l’enveloppe dans laquelle se déploie la réflexion.
Il dégage, par exemple, cet attachement français aux grandes oppositions binaires (ouverture et isolement, immobilisme et réforme, liberté et déterminisme, progrès et décadence), dû à l’influence du rationalisme et à son corollaire, le goût de l’abstraction. Les pages sur la réception et l’utilisation, au fil des siècles, de la référence à Descartes sont d’ailleurs instructives. Mais il convient, insiste l’auteur, de ne pas négliger le pouvoir de l’imagination qui est une donnée essentielle de l’esprit français (elle expliquerait en partie la propension nationale à l’utopie). Sudhir Hazareesingh pointe avec soin les paradoxes : en France, la fascination pour l’ordre et la prédictibilité coexiste avec le rejet du conformisme. C’est aussi un pays où l’on peut rencontrer des rationalistes mystiques (lire l’entretien ci-contre) et subir de « glorieuses défaites » (utile invention, au demeurant, comme le souligne l’auteur).
« Tentation du repli »
La fin de l’essai se consacre à des analyses plus thématiques sur la place de l’intellectuel depuis l’après-guerre (décrit subtilement comme une histoire en trois parties : l’influence de Sartre, de Tocqueville puis de Camus) ou sur le rôle de l’histoire dans la construction du sentiment national. Enfin, l’ouvrage aborde le climat intellectuel depuis une dizaine d’années : l’anxiété et le déclinisme paraissent avoir nettement emporté la partie. Cette « tentation du repli », qui semble toucher la gauche autant que la droite, « a corrompu l’héritage rousseauiste et républicain de la pensée française ». Il en résulte en effet un affaiblissement de l’influence française sur la scène politique et culturelle à l’échelle mondiale.
Ce pays qui aime les idées. Histoire d’une passion française (How the French Think. An Affectionate Portrait of an Intellectual People), de Sudhir Hazareesingh, traduit de l’anglais par Marie-Anne de Béru, Flammarion, « Au fil de l’histoire », 464 p., 26 € (en librairie le 27 août).
Voir également:
« Les antimodernes ont cannibalisé l’espace public »
Propos recueillis par Thomas Wieder
Le Monde
26.09.2015
Sudhir Hazareesingh est professeur à l’université d’Oxford. Spécialiste de la France des XIXe et XXe siècles, il vient de publier Ce pays qui aime les idées. Histoire d’une passion française (Flammarion, 464 pages, 23,90 euros).
Quel regard portez-vous sur la pensée française d’aujourd’hui ? Dans votre livre, vous parlez d’une « tentation du repli » pour caractériser la période actuelle. Quelles en sont les caractéristiques ?
Sudhir Hazareesingh : Selon moi, quatre phénomènes définissent la situation actuelle. Le premier, c’est le fait que le déclinisme et le pessimisme ne sont plus l’apanage de la droite antimoderne et réactionnaire. Aujourd’hui, l’idée que « rien ne va plus » ou que « tout fout le camp » dépasse de loin cette famille de pensée, au point que certains de ses porte-parole les plus éloquents viennent de la gauche, comme Michel Onfray ou Régis Debray. Ce qui est d’abord nouveau aujourd’hui, c’est cela : une forme de fusion des pensées antimodernes dans un éloge commun d’un « républicanisme » nostalgique et passéiste qui réunit les ennemis d’hier, ceux qui sont effectivement les héritiers d’une culture républicaine comme ceux qui s’inscrivent dans une tradition profondément antirépublicaine.
La deuxième chose qui me frappe, c’est la dimension très franco-française de cette pensée du repli. Il y a deux siècles, les auteurs français réactionnaires avaient un rayonnement international. Joseph de Maistre, par exemple, appartenait au patrimoine mondial de la pensée. Il était lu et discuté à l’étranger. Aujourd’hui, les pamphlétaires français antimodernes n’écrivent que pour un public hexagonal. A l’étranger, personne ne lit Eric Zemmour, Michel Onfray ou Alain Finkielkraut. Il y a quelques années, l’historien Pierre Nora avait dénoncé le « provincialisme » croissant de la vie intellectuelle française. J’adhère totalement à son analyse.
Troisième élément qui caractérise notre époque : l’absence de véritable débat. Autrefois, l’antimodernisme n’était qu’une composante de la scène intellectuelle française. Face aux déclinistes et aux pessimistes, il y avait des progressistes et des optimistes qui pouvaient leur porter la contradiction. De nos jours, il n’y a quasiment plus personne dans le camp d’en face. On n’entend plus de contre-discours. Les antimodernes ont cannibalisé l’espace public.
Enfin, quatrième point frappant : la tendance très actuelle à diaboliser tout ce qui est « autre ». Dans un livre merveilleux, traduit en français sous le titre Deux siècles de rhétorique réactionnaire (Fayard, 1991), le sociologue américain Albert O. Hirschman expliquait qu’un élément central de cette rhétorique était la notion de « mise en péril ». C’est exactement ce qu’on observe aujourd’hui. Tout ce qui est « autre » est représenté comme une menace pour « l’identité française », cet autre étant à la fois l’étranger (l’Allemagne, les Etats-Unis, le monde arabo-musulman) et le minoritaire (les féministes, les homosexuels, les immigrés, etc.).
Quelle est cette identité française qui serait mise en péril ?
Je dirais volontiers que ces auteurs définissent l’identité française comme un archipel d’îlots menacés. Le premier de ces îlots, c’est la laïcité, dont l’ennemi est à leurs yeux le multiculturalisme. Le deuxième, c’est la souveraineté : ici, l’adversaire s’appelle la mondialisation (ou l’Europe). Le troisième de ces îlots, c’est la civilisation française au sens large : dès lors que tout ce qui est français est par définition supérieur à ce qui ne l’est pas, tout doit être fait pour éviter l’invasion d’une culture étrangère, par essence barbare et immorale. D’où, chez ces auteurs, l’éloge fréquent de la notion de frontière et, à l’inverse, le rejet de toute forme de cosmopolitisme.
Face à l’intérêt que suscitent ces intellectuels, les responsables politiques semblent peu audibles. Pourquoi ?
Il y a un élément très important, a fortiori dans un pays comme la France, où l’on aime les idées : c’est la langue. Que l’on partage ou non leurs analyses, force est de constater que les auteurs dont nous parlons savent manier la langue française. Certes, tous ne brillent pas dans le même registre : Finkielkraut, par exemple, est assez mauvais à la télévision mais il écrit remarquablement bien ; Zemmour, même si sa prose n’est pas exceptionnelle, a un talent oratoire hors pair ; Onfray, lui, est bon à peu près partout, que ce soit dans ses livres, dans ses cours ou sur un plateau télévisé, comme celui d’« On n’est pas couché ».
De l’autre côté, le problème est que l’on a une génération d’hommes politiques qui utilisent tous, peu ou prou, une langue technocratique. Ce sont des gestionnaires, incapables de varier de registre en citant un écrivain ou un poète. Or, quand vous mettez des gestionnaires face à des intellectuels qui savent manier la rhétorique, il est logique que l’on écoute davantage les seconds.
Ce que vous observez en France, l’observez-vous ailleurs en Europe ?
Non, pas vraiment. Dans d’autres pays européens, le réflexe souverainiste et pessimiste peut exister : il est le socle des populismes qui se manifestent un peu partout. Mais la manière dont cette pensée se présente en France est particulière, autant dans sa substance que dans son style. En Grande-Bretagne, par exemple, vous avez actuellement, autour de UKIP (United Kingdom Independence Party), un état d’esprit un peu analogue. Mais c’est un mouvement très anti-intellectuel et antipolitique, qui ne repose sur aucun système de valeurs cohérent. Surtout, il n’est pas obsédé par l’idée de déclin.
En France, par contre, le pessimisme repose fondamentalement sur le déclinisme, et s’appuie sur certains traits caractéristiques de la tradition intellectuelle nationale : le penchant pour le schématisme, l’abstraction et le refus des faits, le goût du paradoxe, le recours systématique à la diabolisation et aux arguments extrêmes, et une vision apocalyptique de l’avenir.
Voir encore:
Aux yeux du monde, les Français seraient arrogants, présomptueux, ingouvernables… Ne seraient-ils pas d’abord et avant tout de grands amoureux des idées ? C’est, en tout cas, dans cette passion spécifiquement française qu’il faut, selon l’historien britannique Sudhir Hazareesingh, chercher les racines de notre identité, et en particulier celles de notre fameuse exception culturelle. Au fond, à quoi reconnaît-on la pensée française ? Peut-être à cette façon d’être un art de vivre partagé par tous.
Sans doute aussi à son inextinguible vitalité : si les Français donnent l’impression de ne jamais débattre sans se disputer, c’est qu’ils ont l’exercice de la controverse trop à coeur ; s’ils passent facilement pour des donneurs de leçons, c’est qu’ils aspirent toujours vivement à l’universel, au point de s’en estimer seuls garants ; s’ils sont râleurs, anarchiques et prompts à la révolte, c’est qu’ils ont une âme frondeuse et l’esprit critique chevillé au corps ; s’ils se croient supérieurs, c’est qu’ils ont le goût de l’abstraction, l’art d’inventer des concepts qui séduisent au-delà des frontières – le socialisme, le structuralisme, l’existentialisme, la déconstruction, le mot même d’intellectuel.
Enfin, s’ils sont enclins aujourd’hui à broyer du noir, c’est qu’ils sont nostalgiques de leur grandeur passée et qu’ils refusent d’abdiquer. Catalogue passionné des spécificités de la pensée française, ce livre nous décrit mieux que nous ne saurions le faire, en même temps qu’il nous pousse à interroger l’inquiétude que nous inspire l’idée de notre déclin
Biographie et informations
Nationalité : Royaume-Uni
Né(e) à : Île Maurice , 1961
Biographie :
Sudhir Hazareesingh est né dans une famille de hauts fonctionnaires indiens.
Il est chargé de recherches et directeur d’études en Sciences Politiques à Balliol College, à l’Université d’Oxford, et Fellow de la British Academy.
Il a été professeur invité à l’EHESS, à l’École Pratique des Hautes Études, et à Sciences-Po.
Il est membre du Comité Scientifique de la revue French Politics, de l’European Journal of Political Theory, ainsi que la revue Napoleonica.
Il contribue régulièrement au Times Literary Supplement, et a publié de nombreux ouvrages sur l’histoire et la culture politique française, dont La Saint-Napoleon. Quand le 14 Juillet se fêtait le 15 Août (Paris, Éditions Tallandier, 2007.
Son ouvrage La Légende de Napoléon (2005) a remporté le Prix du Mémorial d’Ajaccio, le Prix d’Histoire de la Fondation Napoléon, et le Prix de la Ville de Meaux.
http://www.babelio.com/auteur/Sudhir-Hazareesingh/93932
Contre ces intellectuels apôtres d’une France moisise
http://www.babelio.com/auteur/Sudhir-Hazareesingh/93932
« I was struck that on the night of the attacks people gathered spontaneously at the Place de la République, and then marched in their millions on 11 January. When confronted by a crisis, the French band together to reaffirm what they call the lien social, the social bond. It’s very much part of their democratic, Rousseauian tradition, reclaiming public space in order to illustrate that the Republic is made up not only of individual citizens but of people with shared values. That said, there were many different sensibilities represented in the march, and it is not easy to ascribe an unequivocal meaning to it. »
http://www.bbc.co.uk/programmes/b051cpx8
Philosophy
From Left Bank to left behind: where have the great French thinkers gone?
From Voltaire and Rousseau to Sartre and De Beauvoir, France has long produced world-leading thinkers. It even invented the word ‘intellectual’. But progressives around the globe no longer look to Paris for their ideas. What went wrong?
Sudhir Hazareesingh
The Guardian
13 June 2015
Writing shortly after the end of the second world war, the French historian André Siegfried claimed (with a characteristic touch of Gallic aplomb) that French thought had been the driving force behind all the major advances of human civilisation, before concluding that “wherever she goes, France introduces clarity, intellectual ease, curiosity, and … a subtle and necessary form of wisdom”. This ideal of a global French rayonnement (a combination of expansive impact and benevolent radiance) is now a distant and nostalgic memory.
French thought is in the doldrums. French philosophy, which taught the world to reason with sweeping and bold systems such as rationalism, republicanism, feminism, positivism, existentialism and structuralism, has had conspicuously little to offer in recent decades. Saint-Germain-des-Prés, once the engine room of the Parisian Left Bank’s intellectual creativity, has become a haven of high-fashion boutiques, with fading memories of its past artistic and literary glory. As a disillusioned writer from the neighbourhood noted grimly: “The time will soon come when we will be reduced to selling little statues of Sartre made in China.” French literature, with its once glittering cast of authors, from Balzac and George Sand to Jules Verne, Albert Camus and Marguerite Yourcenar, has likewise lost much of its global appeal – a loss barely concealed by recent awards of the Nobel prize for literature to JMG Le Clézio and Patrick Modiano. In 2012, the Magazine Littéraire sounded the alarm with an apocalyptic headline: “La France pense-t-elle encore?” (“Does France still think?”)
Nowhere is this retrenchment more poignantly apparent than in France’s diminishing cultural imprint on the wider world. An enduring source of the French pride is that their ideas and historical experiences have decisively shaped the values of other nations. Versailles in the age of the Sun King was the unrivalled aesthetic and political exemplar for European courts. Caraccioli, the 18th-century author of L’Europe Française, expressed a common view when he enthused about the “sparkling manners and lively vivacity” of the French, before concluding: “Every European is now a Frenchman.” Through the revolutionary epics of the late 18th and early 19th centuries, French civilian and military heroes inspired national liberators throughout the world, from Wolfe Tone in Ireland and Toussaint L’Ouverture in Haiti to Simón Bolívar in Latin America. The Napoleonic Civil Code was widely adopted by newly independent states during the 19th century, and the emperor’s art of war was celebrated by progressive writers and poets across Europe, from William Hazlitt to Adam Mickiewicz, but also by Japanese samurai warriors and Tartar tribesmen (a Central Asian folk song celebrated “Genghis Khan and his nephew Napoleon”), and by the Vietnamese revolutionary hero Võ Nguyên Giáp. In the late 1930s, when he was a history tutor at the Than Long school in Hanoi, Giáp taught French revolutionary history; one of his students later recalled the “mesmerising” quality of his lectures on Napoleon.
Jean Paul Sartre and Simone de Beauvoir take tea together in 1946. Photograph: David E Scherman/Time & Life Pictures/Getty Image
Progressive men and women across Europe celebrated the heritage of the 1789 revolution throughout the 19th century, and the first generation of Russian Bolsheviks was obsessed by the analogies between their own revolution in 1917 and the overthrow of the French ancien régime. Lenin drew on the Jacobin heritage as an inspiration for his own revolutionary organisation in Russia, and dismissed those who opposed him as “Girondists”. Stalin’s francophilia extended to obsessively reading the novels of Victor Hugo. French ideas and symbols were universally equated with self-determination and emancipation from servitude: the Statue of Liberty, the iconic emblem of American-ness, was designed by the French sculptor Frédéric Bartholdi; Poland’s national anthem celebrated Napoleon Bonaparte, while Brazil’s flag bore the motto “order and progress”, after Auguste Comte’s motto of positivism. French inspiration was most evident in stimulating traditions of critical and dissenting inquiry about modern society: Olympe de Gouges’s Declaration of the Rights of Woman and the Female Citizen (1791) was embraced by champions of feminine emancipation across the world, while social inequality and political oppression were eloquently denounced by Rousseau and the radical republican tradition of Babeuf, Buonarroti and Blanqui all the way through to the works of Sartre, Fanon, Foucault and Bourdieu. Yet little of this ideological fertility is now in evidence, and French thinking is no longer a central point of reference for progressives across the world. It is noteworthy that none of the recent social revolutions, whether the fall of Soviet-style communism in eastern Europe or the challenge to authoritarian regimes in the Arab world, took their cue from the French tradition.
A yearning towards universality
This intellectual retreat is of course not unique to France. Notwithstanding the recent electoral successes of populist radical movements such as Syriza and Podemos, the horizons of reformist, progressive and internationalist politics have dimmed across Europe since the late 20th century. But the phenomenon is felt much more acutely in France because (in notable contrast with Britain) the nation’s self-image is existentially bound up with its sense of cultural excellence, and with the assumption that their ideas have universal appeal: “France,” claimed the historian Ernest Lavisse without any irony, “is charged with representing the cause of humanity.” From the Enlightenment onwards, France was renowned for her génie scientifique. Paris was celebrated as a principal centre of the European “republic of sciences”, and indeed the discoveries of French scientists revolutionised modern life – from the Cassinis’ new principles of cartography to Louis Pasteur’s seminal findings on disease prevention, and Marie Curie’s ground-breaking research on radioactivity. France also played a pioneering role in devising original forms of intellectual sociability, such as masonic lodges, salons and cafes (the daily Libération celebrated the bistro as a provider of “key social links” among French people). Likewise, the primary impetus for the nation’s ways of thinking has traditionally come from Paris. Indeed, to an extent which is unique in western culture, France’s major cultural bodies – from the state to the great educational and research institutions, academies, publishing houses and press organs – are concentrated in its capital, hence Victor Hugo’s exorbitant claim that Paris was the “centre of the earth”.
This centralisation is one of the main reasons why French ways of thinking exhibit such a striking degree of stylistic consistency – a phenomenon further accentuated by the nation’s profoundly ambivalent intellectual relationship with religion. On the one hand, there has been an ardent tradition of anticlericalism in France, assertively upheld in recent decades by publications such as Charlie Hebdo, and in a colourful lexicon of derogatory designations of priests, with terms such as bouc, calotin, corbeau and ratichon; the place of Islam in contemporary French society continues to generate confusion and acrimonious debate. Yet, in stark contrast with Britain, French thought is also haunted by a pervasive neo-religious rhetoric. One of the modern French words for an intellectual is clerc (a member of the clergy), and the positions held by intellectuals have been consistently defined through concepts such as faith, commitment, heresy and deliverance. Like many men and women of his generation, the philosopher Edgar Morin defined his experiences in the French communist movement as a form of “religious mysticism”. France’s endemic incapacity to reform its state institutions is often represented as a mal, a term which carries connotations of physical disorder as well as sinfulness. One of the classic pamphlets denouncing France’s passion for authority and state centralisation was Alain Peyrefitte’s Le Mal Français; when in 2014 former socialist leader Lionel Jospin challenged what he perceives as France’s unhealthy fascination with Bonapartism, he entitled his polemical essay Le Mal Napoléonien.
This intellectual unity of French thought is crystallised in a number of lasting tropes about Frenchness. The most celebrated, as Siegfried said, is the sense of an exceptional Gallic aptitude for lucidity. The writer Rivarol put it even more imperiously: “What is not clear is not French.” Typically French, too, is an insouciance of manner, “doing frivolous things seriously, and serious things frivolously”, as the philosopher Montesquieu wrote. But it also bears a contrarian and disputatious tendency, as the historian Jules Michelet observed: “We gossip, we quarrel, we expend our energy in words; we use strong language, and fly into great rages over the smallest of subjects.” Above all, French thinking is famous for its love of general notions, such as the French Revolution’s classic triad of liberty, equality and fraternity. As the essayist Emile de Montégut said, “There is no people among whom abstract ideas have played such a great role, whose history is rife with such formidable philosophical tendencies, and where individuals are so oblivious to facts and possessed to such a high degree with a rage for abstractions.”
This passion for generality strongly contrasts with the practical, empirical reasoning of the British. It shows up in many dimensions of the esprit français, especially the tendency for arguments about the good life to revolve around first principles. Burke railed against the “clumsy metaphysics” of the French Revolution’s concept of the rights of man – but the ideal of monarchy celebrated in France by royalist thinkers such as Joseph de Maistre, Louis de Bonald and later Charles Maurras was just as abstract (if not more so). Equally widespread is the passion for considering questions in their totality as opposed to their particular manifestations. In his classic work Les origines de la France contemporaine (1875), Hippolyte Taine described this holism as entrenched since the Enlightenment, a method which sought “to extract, circumscribe and isolate a few very simple and general notions, then, without any reference to experience, to compare and combine them, and from the artificial compound thus obtained, to deduce by pure reasoning all the consequences which it contains”. The resistance leader Charles de Gaulle thus opened his War Memoirs by sketching his “certaine idée de la France” – a country with a vocation for an “eminent and exceptional destiny”. Such lofty aspirations remain an integral feature of French thinking, according to the academician Jean d’Ormesson: “More than any nation, France is haunted by a yearning towards universality.”
Yet paradoxically – the French love paradoxes – this holism comes with the equally cherished Gallic intellectual habit of dividing things into two. This explains why French public debate is invariably structured around a small number of recurring binaries. La France coupée en deux is a familiar representation of the political realm, referring to historical divisions between conservative and progressive blocs, but also dichotomous ways of seeing the world such as opening and closure, stasis and transformation, reason and sentiment, unity and diversity, civilisation and barbarity, masculine and feminine, and good and evil.
The progressive imagination
One of most distinctive features of modern French thought since the Enlightenment, which long provided the basis for its global appeal, is the richness of its progressive tradition. This ingeniousness shines through in the sheer number of mainstream concepts and discursive practices that have their origins in France: a (cursory) list would include the notions of ideology and socialism, the invention of the figure of the “intellectual”, and of the discipline of sociology; the spatial representation of politics as between left and right; the ideas of popular sovereignty and altruism, and the belief that culture should not only be democratically accessible, but should be assigned its own specific department in government (an innovation introduced in 1959 by De Gaulle on his return to power, the first incumbent of the new ministry being the writer André Malraux). This emphasis on creativity bears witness to the consecration of the writer as a spiritual guide for society, and to the central role assigned to imagination in French political and literary culture – hence one of the most celebrated slogans of May ’68: “L’imagination au pouvoir”.
Such has been the centrality of the ideal of creativity that the concepts of revolution and rupture have become familiar tropes across the French humanities and social sciences, whether in politics, history, literature, philosophy, sociology, linguistics, psychology or anthropology. The period between the early 1950s and the late 1970s alone gave us the nouveau roman, the nouvelle vague (in cinema), the nouvelle histoire, the nouvelle philosophie, the nouvelle gauche (and even, in echo, the nouvelle droite), without forgetting nouvelle cuisine – although that concept dates back at least as far as Menon’s Nouveau traité in 1742. For the ethnologist Claude Lévi-Strauss, whose notion of structuralism arguably represented the single most inventive French contribution to western thought in the second half of the 20th century, this thirst for innovation is inherent in the very idea of knowledge: “The great speculative structures are made to be broken. There is not one of them that can hope to last more than a few decades, or at most a century or two.”
This creativity also manifests itself in the French predilection for grand theorising, and in the often breathtaking ambition of progressive thinkers in their quest to uncover original truths about the human condition. Descartes’ cogito ergo sum broke new philosophical ground by locating the source of all certain knowledge in the thinking self, and providing an account of human understanding that was independent of God. Much of Rousseau’s political philosophy was driven by the goal of regenerating humankind through the achievement of republican virtue. Comte wrote extensively about astronomy, physics, chemistry, biology and mathematics, and he devoted his life to elaborating an original scientific synthesis that would herald “the definitive stage of human intelligence”. Indeed, the most remarkable feature of French grand theorising is its aspiration to find comprehensive and universal explanations for all social phenomena: hence the Annales historians’ ambition to provide an account of the entire range of human activities (histoire totale). Likewise, Sartre’s Critique of Dialectical Reason (1960) aimed to establish “whether there is any such thing as a Truth of humanity as a whole”. Simone de Beauvoir’s Second Sex offered a sweeping alternative to the classic view that gender difference was grounded in human nature: “One is not born, but one becomes a woman.” His scattered observations of Brazilian-Amerindian tribes led Claude Lévi-Strauss to conclude that all social thought was based on certain shared symbolic patterns or myths, while Michel Foucault’s sprawling oeuvre claimed to uncover the forms of control and domination that were inherent in all ideologies and ways of thinking. The most recent product of this distinguished line of grand theorising is the republican historian Pierre Nora’s concept of lieux de mémoire, which offers an overarching framework for reconsidering France’s relationship with its own past.
These intellectual constructs have enjoyed such wide appeal not only because of their seductive literary qualities, but also because of their critical functions in shaping the French collective self-understanding (the contrast with British self-perception is again noteworthy: in Keir Hardie’s memorable expression, the British are “not given to chasing bubbles”). Rousseau’s political philosophy, to take the most obvious example, has consistently provided the bedrock for French republican patterns of thinking over the past two centuries – notably the belief in the possibility of a more rational organisation of society; and the thought that not just society but human nature itself could be regenerated through collective endeavour. Comte’s celebration of the dead (who in his view represented “the better part of humankind”) tapped into a deep fascination among French progressives for the occult. His Religion of Humanity, a secular system of belief complete with its institutions, cults and festivals, exemplified the consistent French quest for a more buoyant and less reactionary alternative to Catholicism. Sartre’s existentialism and his excursions across the philosophical terrain of Marxism in the postwar era underwrote the orthodox idea of a proletarian revolution, and justified the intellectual hegemony of the French Communist party (in his pithy expression: “un anticommuniste est un chien”). The works of De Beauvoir and Foucault are littered with intuitions about the pervasive manifestations (and corrupting effects) of power that have deep roots in French social thought from Rousseau onwards. Nora’s conception of memory has transformed the way the French see themselves, and has also provided the bedrock for a conservative form of neo-republicanism, which has become intellectually and culturally dominant in France since the late 20th century.
The darker sides of abstraction
Over the longue durée, these French progressive ways of thinking have been formidably productive, helping to generate powerful and engaging systems of thought. French thinkers have been especially influential in shaping modern conceptions of citizenship – notably the revolution’s concept of civic patriotism (based on adhesion to common values rather than ethnicity), the notion of the general interest, and the vision of the state’s enabling and enlightening power, embodied in the holistic philosophy of Jacobinism. But this penchant for abstract generality also has its darker sides: an insensitivity to the potentially intrusive and coercive role of the state; a suspicion of social groups that do not conform to shared universalistic norms (in the past, these included Catholics, women and colonial subjects); a disposition to fall back on stereotypes, negative fantasies and conspiracy theories; and a fondness for dividing the political sphere into antagonistic camps of good v evil.
Indeed, the “other” has been an enduringly problematic concept in French culture: hence the long tradition of antisemitism in French nationalist thought. But progressives have also faltered here, notably in their entrenched hostility to female emancipation (women were long viewed by republicans as reactionary agents of Catholicism, and were only granted the vote in 1944). Progressives also struggled to reconcile their universalist ideals of the good life with notions of cultural pluralism and ethnic diversity. Part of the reason why multiculturalism is regarded so negatively by the French is that it is perceived as an alien Anglo-Saxon practice. A contemporary example of these shortcomings is the discussion of the integration of postcolonial minorities from the Maghreb. The roots of this issue lie in the deeply held assumption of the beneficial quality of French civilisation for humankind. This vision underpinned the expansion of French power in Europe during the revolutionary and Napoleonic eras. A belief in the emancipatory quality of their culture explain why leading French progressives consistently advocated a policy of assimilation in the colonies, and – with the honourable exception of the communists – largely turned a blind eye to the racism and social inequalities produced by their own empire. This uncritical belief in the supremacy of the French mission civilisatrice was epitomised during the Algerian war of national liberation in the 1950s and early 1960s by François Mitterrand’s endorsement of the precept of “L’Algérie, c’est la France”. The same way of thinking led the socialist Guy Mollet to reject all manifestations of Algerian nationalism as reactionary and “obscurantist”.
This colonialist legacy still casts a long shadow over the ways in which France treats and perceives its ethnic minority citizens, especially those originating from the Maghreb. These minorities are demonised in the French conservative press and by the extreme right, in a way that would be found shocking in Britain. This vilification has been made easier by the typically abstract way French progressives have framed the debate about minority integration. Thus the principle of laïcité (secularism) has been deployed not to protect the religious freedom of the Maghrebi minorities, as would follow from a strict interpretation of the 1905 law of separation of churches from the state, but to question their Frenchness. Those who have opposed the ban on the veil in schools have been spuriously accused of communitarianism and Islamism – terms all the more terrifying in that they are never precisely defined. Since the January 2015 attack on Charlie Hebdo there have been widespread calls for French citizens of Maghrebi origin to “prove” their attachment to the nation. Presenting the issue of civic integration in such terms has proved counterproductive, not least because it has detracted from the real problems confronting these populations: unemployment, racial discrimination and educational underachievement.
This French penchant for abstraction appears in most paradoxical (and perverse) form in the absence of precise statistical information about their Maghrebi minorities, as it is illegal to collect data about ethnicity and religion in France. And so, instead of drawing on specific social facts and trends, the debate about minority integration has become mired in crude ideological oversimplifications: the equation of secularism with Frenchness; the suggestion that the (white, secular) French are the bearers of “reason”, while those who practise the Islamic faith are “reactionary” (the very same argument deployed earlier against any natives who dared question French colonial rule); and the essentialist assumption of an immutable, and yet paradoxically fragile, French national identity. This unitary and implicitly masculine sense of the French collective self, one of the less salubrious legacies of Descartes’ conception of philosophical reason, remains widespread among progressives today. As the editor of Libération, Laurent Joffrin, put it in an article in February: “Only an abstract conception of Man can confer unity upon France.”
The pessimistic turn
Since the late 20th century French thought has lost many of the qualities that made for its universal appeal: its abundant sense of imagination, its buoyant sense of purpose, and above all its capacity (even when engaging in the most byzantine of philosophical issues) to give everyone tuning in, from Buenos Aires to Beirut, the sense that they were participating in a conversation of transcendental significance. In contrast, contemporary French thinking has become increasingly inward-looking – a crisis that manifests itself in the sense of disillusionment among the nation’s intellectual elites, and in the rise of the xenophobic Front National, which has become one of the most dynamic political forces in contemporary France. Nora, writing in 2010, concluded despondently that France had become the land of “shrinking horizons, the atomisation of the life of the mind, and national provincialism”. Time magazine proved him right in 2015 when it included Marine Le Pen in its list of the world’s 100 most influential figures (the only other French person on the list was the economist Thomas Piketty, the author of the best-selling Capital in the Twenty-First Century).
How is this transformation to be explained? Among the most important factors is a collective recognition that France is no longer a major power. The complicated condition of the European project, which was decisively shaped in the past by a string of French figures (from Jean Monnet to Jacques Delors), bears witness to this decline. This change in the nation’s collective psychology also stems from a delayed recognition of the devastating character of France’s military defeat in 1940, and the impact of two further catastrophes that were not fully internalised: the loss of Indochina and the withdrawal from Algeria. For most of the post-liberation decades, these events were cushioned by the reassuring fiction that the French had behaved heroically during the war, and that France still represented an alternative force in world politics, thanks to its seat at the UN security council, its messianic Gaullist leadership and its distinct political and cultural values (as De Gaulle once observed: “I prefer uplifting lies to demeaning truths”). This myth was largely intended as a replacement of the (equally fabulous) ideal of the French mission civilisatrice in the colonies. Yet this collective confidence has been seriously damaged by the unravelling of the myth of the resistance and the emergence of a “Vichy syndrome”, which in the last two decades of the 20th century detailed the extent of French collaboration during the years of occupation.
This pessimistic sensibility has been exacerbated by a widespread belief that French culture is itself in crisis. The representation of France as an exhausted and alienated country, corrupted by the egalitarian heritage of May 68, overrun by Muslim immigrants and incapable of standing up for its own core values is a common theme in French conservative writings. Among the bestselling works in this genre are Alain Finkielkraut’s L’identité malheureuse (2013) and Éric Zemmour’s Suicide Français (2014). This morbid sensibility (which has no real equivalent in Britain, despite its recent economic troubles) is also widespread in contemporary French literature, as best exemplified in Michel Houellebecq’s recent oeuvre: La carte et le territoire (2010) presents France as a haven for global tourism, “with nothing to sell except charming hotels, perfumes, and potted meat”; his latest novel Soumission (2015) is a dystopian parable about the election of an Islamist president in France, set against a backdrop of a general collapse of Enlightenment values. A major underlying consideration here is the perception of the decline of French as a global language, and its (much-resented) replacement by English. A variety of groups and associations have long been campaigning vigorously against the importation of English words into French. The linguist Claude Hagège referred to the invasion of the English language as a “war”, claiming that its promotion “served the interests of neoliberalism”. Since 2011, the website of the Académie Française has a section dedicated to weeding out anglicisms from the French language. Among the expressions recently singled out for censure were conf call, off record, donner son go (authorise), chambre single, news and faire du running (notwithstanding this crusade, the word “selfie” is set to be included in the 2016 edition of the Larousse dictionary).
A more profound cause of the current malaise relates to the ways in which French elites are recruited and trained. For much of the modern era, the nation’s republican and socialist leaders were grounded in a meritocratic and humanist culture typically provided by institutions such as the École Normale Supérieure: among its most famous graduates were the likes of Jean Jaurès and Léon Blum. However, since the 1960s French elites have increasingly come from technocratic grandes écoles such as the École Nationale d’Administration (ENA). Most of the recent leaders of the Socialist party, including prime ministers Fabius, Rocard and Jospin; and president Hollande, are énarques. Their intellectual outlook reflects the strengths of this type of technocratic education, such as a capacity for hard work and for mastering complex briefs. But it also illustrates its endemic weaknesses: an inability to think creatively, a tendency towards formalism and rule-following, a socially exclusive and complacent metropolitan outlook, a corporatist, bunker mentality (as the joke goes, “Spain has the ETA, Ireland the IRA, and France the ENA”). Above all, it shows an overwhelmingly masculine style and ethos. Women in France struggle even more than in other advanced industrial societies to assume leading positions in politics (the law on parité, for example, is openly flouted by all parties) – and when they do break through the glass ceiling, female politicians face an exceptional barrage of hostility: Édith Cresson is the only woman to have served as prime minister, and she lasted less than a year.
This ascendency of technocratic values among French progressive elites is itself reflective of a wider intellectual crisis on the left. The singular idea of the world (a mixture of Cartesian rationalism, republicanism and Marxism) that dominated the mindset of the nation’s progressive elites for much of the modern era has disintegrated. The problem has been compounded by the self-defeating success of French postmodernism: at a time when European progressives have come up with innovative frameworks for confronting the challenges to democratic power and civil liberties in western societies (Michael Hardt and Antonio Negri’s notion of empire, and Giorgio Agamben’s concept of the state of exception), their Gallic counterparts have been indulging in abstract word games, in the style of Derrida and Baudrillard. French progressive thinkers no longer produce the kind of sweeping grand theories that typified the constructs of the Left Bank in its heyday. They advocate an antiquated form of Marxism (Alain Badiou), a nostalgic and reactionary republicanism (Régis Debray), or else offer a permanent spectacle of frivolity and self-delusion (Bernard-Henri Lévy). The sociologist Bruno Latour clearly had this syndrome in mind when he observed: “It has been a long time since intellectuals were in the vanguard. Indeed it has been a long time since the very notion of the avant-garde …passed away.” But we should remember that in France especially, there is always the potential for a sudden reversal: regeneration is one of the essential myths of French culture.
• Sudhir Hazareesingh’s How the French Think: An Affectionate Portrait of an Intellectual People is published by Allen Lane this month. To order a copy for £16 (RRP £20), go to bookshop.theguardian.com or call 0330 333 6846. Free UK p&p over £10, online orders only. Phone orders min. p&p of £1.99.,
Voir de plus:
LEFT BANK
The decline of the French intellectual
Paris has ceased to be a major center of innovation in the humanities and social sciences.
Sudhir Hazareesingh
Politico
9/19/15
One of the most characteristic inventions of modern French culture is the “intellectual.”
Intellectuals in France are not just experts in their particular fields, such as literature, art, philosophy and history. They also speak in universal terms, and are expected to provide moral guidance about general social and political issues. Indeed, the most eminent French intellectuals are almost sacred figures, who became global symbols of the causes they championed — thus Voltaire’s powerful denunciation of religious intolerance, Rousseau’s rousing defense of republican freedom, Victor Hugo’s eloquent tirade against Napoleonic despotism, Émile Zola’s passionate plea for justice during the Dreyfus Affair, and Simone de Beauvoir’s bold advocacy of women’s emancipation.
Above all, intellectuals have provided the French with a comforting sense of national pride. As the progressive thinker Edgar Quinet put it, with a big dollop of Gallic self-satisfaction: “France’s vocation is to consume herself for the glory of the world, for others as much as for herself, for an ideal which is yet to be attained of humanity and world civilization.”
* * *
This French intellectualism has also manifested itself in a dazzling array of theories about knowledge, liberty, and the human condition. Successive generations of modern intellectuals — most of them schooled at the École Normale Supérieure in Paris — have hotly debated the meaning of life in books, newspaper articles, petitions, reviews and journals, in the process coining abstruse philosophical systems such as rationalism, eclecticism, spiritualism, republicanism, socialism, positivism, and existentialism.
This feverish theoretical activity came to a head in the decades after World War Two in the emergence of structuralism, a grand philosophy which underscored the importance of myths and the unconscious in human understanding. Its leading exponents were the philosopher of power and knowledge Michel Foucault and the ethnologist Claude Lévi-Strauss, both professors at the Collège de France. Because he shared the name of the famous brand of American garments, Lévi-Strauss received letters throughout his life asking for supplies of blue jeans.
The ultimate symbol of the Left Bank intellectual was the philosopher Jean-Paul Sartre, who took the role of the public intellectual to its highest prominence. The intellectuel engagé had a duty to dedicate himself to revolutionary activity, to question established orthodoxies, and to champion the interests of all oppressed groups. Integral to Sartre’s appeal was the sheer glamor he gave to French intellectualism — with his utopian promise of a radiant future; his sweeping, polemical tone, and his celebration of the purifying effects of conflict; his bohemian and insouciant lifestyle, which deliberately spurned the conventions of bourgeois life; and his undisguised contempt for the established institutions of his time — be they the republican State, the Communist party, the French colonial regime in Algeria, or the university system.
As he put it, he was always a “traitor” — and this contrarian spirit was central to the aura which surrounded modern French intellectuals. And even though he detested nationalism, Sartre unwittingly contributed to the French sense of greatness through his embodiment of cultural and intellectual eminence, and his effortless superiority. Indeed, Sartre was undoubtedly one of the most famous French figures of the 20th century, and his writings and polemics were ardently followed by cultural elites across the globe, from Buenos Aires to Beirut.
* * *
Today’s Left Bank is but a pale shadow of this eminent past. Fashion outlets have replaced high theoretical endeavor in Saint-Germain-des-Près. In fact, with very rare exceptions, such as Thomas Piketty’s book on capitalism, Paris has ceased to be a major center of innovation in the humanities and social sciences.
The dominant characteristics of contemporary French intellectual production are its superficial, derivative qualities (typified by figures such as Bernard-Henri Lévy) and its starkly pessimistic state of mind. The pamphlets which top the best-selling non-fiction charts in France nowadays are not works offering the promise of a new dawn, but nostalgic appeals to lost traditions of heroism, such as Stéphane Hessel’s “Indignez Vous!” (2010), and Islamophobic and self-pitying tirades echoing the message of Marine Le Pen’s Front National about the destruction of French identity.
Two recent examples are Alain Finkielkraut’s “L’Identité Malheureuse” (2013) and Eric Zemmour’s “Le Suicide Français” (2014), both suffused with images of degeneration and death. The most recent work in this morbid vein is Michel Houellebecq’s “Soumission” (2015), a dystopic novel which features the election of an Islamist to the French presidency, against the backdrop of a general disintegration of Enlightenment values in French society.
* * *
How is France’s loss of its bearings to be explained? Changes in the wider cultural landscape have had a major impact on Gallic self-confidence. The disintegration of Marxism in the late 20th century left a void which was filled only by postmodernism.
But the writings of the likes of Foucault, Derrida and Baudrillard if anything compounded the problem with their deliberate opaqueness, their fetish for trivial word-play and their denial of the possibility of objective meaning (the hollowness of postmodernism is brilliantly satirized in Laurent Binet’s latest novel, “La septième fonction du langage,” a murder mystery framed around the death of the philosopher Roland Barthes in 1980).
But French reality is itself far from comforting. The overcrowded and underfunded French higher education system is fraying, as shown by the relatively low global rankings of French universities in the Shanghai league table. The system has become both less meritocratic and more technocratic, producing an elite which is markedly less sophisticated and intellectually creative than its 19th and 20th century forebears: The contrast in this respect between Sarkozy and Hollande, who can barely speak grammatical French, and their eloquent and cerebral presidential predecessors is striking.
Arguably the most important reason for the French loss of intellectual dynamism is the growing sense that there has been a major retreat of French power on the global stage, both in its material, “hard” terms and in its cultural “soft” dimensions. In a world dominated politically by the United States, culturally by the dastardly ‘Anglo-Saxons,” and in Europe by the economic might of Germany, the French are struggling to reinvent themselves.
Few of France’s contemporary writers — with the notable exception of Houellebecq — are well known internationally, not even recent Nobel-prize winners such as Le Clézio and Patrick Modiano. The ideal of Francophonia is nothing but an empty shell, and behind its lofty rhetoric the organization has little real resonance among French-speaking communities across the world.
This explains why French intellectuals appear so gloomy about their nation’s future, and have become both more inward-looking, and increasingly turned to their national past: As the French historian Pierre Nora put it even more bluntly, France is suffering from “national provincialism.” It is worth noting, in this context, that neither the collapse of communism in the former Soviet bloc nor the Arab spring were inspired by French thought — in stark contrast with the philosophy of national liberation which underpinned the struggle against European colonialism, which was decisively shaped by the writings of Sartre and Fanon.
Indeed, as Europe fumbles shamefully in its collective response to its current refugee crisis, it is sobering that the reaction which has been most in tune with the Enlightenment’s Rousseauist heritage of humanity and cosmopolitan fraternity has come not from socialist France, but from Christian-democratic Germany.
Sudhir Hazareesingh is a fellow in politics at Balliol College, Oxford. His new book, “How the French think: an affectionate portrait of an intellectual people,” is published by Allen Lane in London and Basic Books in New York. The French version is published by Flammarion as “Ce pays qui aime les idées.”
Voir de même:
Obama, Critical Race Theory, and Harvard Law School
David French
National Review
March 8, 2012
Watching Breitbart.com’s footage of law student Barack Obama praising radical law professor Derrick Bell gave me a strong sense of déjà vu. I arrived at Harvard Law School in August 1991, just a couple months after Barack Obama graduated. It would be hard to overstate the level of poison and vitriol that pervaded the school throughout the early 1990s. In 1993, GQ dubbed the law school “Beirut on the Charles” as HLS campus politics made national news.
This was the era of proud political correctness — including booing, hissing, and shouting down dissenting voices in class — combined with the vocal ascendance of the “crits.” Critical legal theorists rejected American legal systems root and branch, decrying them as the products of an irretrievably broken racist patriarchy. Their “scholarship” was unorthodox (and that’s being charitable), their voices were strident, and their student followers tended to be vicious. Many of the “crits” also had magnetic, preacher-like personalities, and it was more than a little disturbing to see the psychological hold they had over their student constituency.
Conservatives navigating this environment had to watch themselves. I can remember seeing cut-and-paste pictures of gay porn on the walls of the Harkness Commons, with the faces of Federalist Society leaders superimposed on the nude figures of the gay “actors.” If you truly angered the activist Left, they would call your future employers demanding that job offers be revoked, and I can recall receiving more than one note with some variation of “die, you f***ing fascist” for my pro-life advocacy. I was shouted down in class and verbally attacked by teachers. If it weren’t for the courageous free-speech advocacy of professors like Alan Dershowitz, the atmosphere would undoubtedly have been even worse. (I don’t mean to imply that Barack Obama ever participated in acts of political intimidation — I never heard that he did — but these stories do provide some sense of the background political intensity.)
Two events truly caused the campus to explode in the early 1990s. The first was the denial of tenure to Regina Austin (Jake Tapper tells the story here), and the second was the granting of tenure to four white male professors. The first event occurred during Barack Obama’s time at the law school, and the second almost two years later. In both instances there was enormous pressure on all left-leaning students to unite in outrage — and unite they did. But what does all this mean now? In 2012? There’s little doubt that law student Obama was a political radical by any conventional, society-wide measure of the term.
But that’s not the end of the story. At Harvard at least, radical was mainstream and conservative was radical. In fact, the radical view was so mainstream that one couldn’t help but think that even the loudest students would graduate, go to law firms, and fit in just as seamlessly to the new mainstream of their legal professions. And, in fact, most did. They weren’t intellectual leaders; they were followers.
My reading of Barack Obama’s political biography is pretty simple: He’s not so much a liberal radical as a member of the liberal mainstream of whatever community he inhabits. In that video, he was doing no more and no less than what most politically engaged leftist law students were doing — supporting the radical race and gender politics that dominated campus. When he went to Chicago and met Bill Ayers, he was fitting within a second, and slightly different, liberal culture. He shifted again in Washington and then again in the White House. But radical, “conviction” politicians don’t decry Gitmo then keep it open, promise to end the wars then reinforce the troops, express outrage at Bush war tactics then maintain rendition and triple the number of drone strikes.
Obama’s biography is essentially the same as many of the liberal mainstream-media journalists who cover him. They’ve made the same migration — from leading campus protests, to building families in urban liberal communities, to participating in a national political culture. At the risk of engaging in dime-store pop psychology, they like Obama in part because they identify with him so thoroughly and see much of themselves in him. They call him “pragmatic” or “moderate” or “technocratic” because they’re fully aware of legions of leftists who never made the transition from the purer form of activist politics. The pure activist is still leading campus protests or camped out in various parks across the country or writing radical tracts for minuscule readerships. The more moderate Left is running the country.
I would imagine that law school Barack Obama would never imagine ordering drone strikes on American citizens on foreign soil or Navy SEAL raids deep into Pakistan. Law school Barack Obama would likely think Obamacare was a thoroughly unsatisfactory half-measure and oppose it bitterly. Law school Obama is not our president, and I’m not sure that the videos tell us much at all about the man who sits in the oval office.
Voir aussi:
Pope Francis is just another liberal political pundit
John Podhoretz
New York Post
September 25, 2015
Pope Francis is unquestionably a man of uncommon personal grace, the possessor of a genuinely beautiful soul. “On Heaven and Earth,” his book-length exchange with Rabbi Abraham Skorka first published in 2010, is a remarkable testament to the breadth of his perspective.
But that’s not exactly the guy who showed up Friday at the United Nations. That pope endorsed the Iran deal, the UN’s environmentalist goals and what amounts to a worldwide open-borders policy on refugees — and offered a very specific view of how to promote development in the Third World that’s straight out of a left-wing textbook.
“The International Financial Agencies,” the pope said, “should care for the sustainable development of countries and should ensure that they are not subjected to oppressive lending systems which, far from promoting progress, subject people to mechanisms which generate greater poverty, exclusion and dependence.”
We’re told we must not view the pope’s expression of views on contemporary subjects through the lens of day-to-day issues — that we belittle him and ourselves by examining his words through an ideological filter.
Because of the awesome position he holds, and by dint of his own teachings and his life and teachings before he rose to service as the Vicar of Christ, Francis is said to be deeper and loftier than mere politics.
Sorry: When the pontiff sounds less like a theological leader and more like the
8 p.m. host on MSNBC or the editor of Mother Jones, what’s a guy to do?
Pope Francis is entirely within his rights to become the world’s foremost liberal. But, since that’s what he is, it can’t be wrong to say so.
It is undoubtedly the role of theological leaders to speak to our highest selves, to remind us of eternal moral teachings, to remove us from the everyday and put us in touch with the divine. We look to leaders to tell us what our faith traditions expect of us — what we should do and what we must do.
And, of course, it is impossible to do so without touching on the behavior of people and nations in the present. A leader whose role it is to save the souls of his flock must take account of the particular temptations that beset them and the particular challenges they face.
But that’s wildly different from specifically embracing a UN document, or endorsing a specific agreement between nations. And this is what Francis told us:
“The adoption of the 2030 Agenda for Sustainable Development at the World Summit, which opens today, is an important sign of hope. I am similarly confident that the Paris Conference on Climatic Change will secure fundamental and effective agreements.”
When a leader speaks in these sorts of bureaucratic specifics, he is descending from the highest heavens into ordinary, even trivial, reality. He’s using his authority in the realm of the spiritual to influence the political behavior of others.
He becomes just another pundit. And who needs another one of those?
Voir également:
De Thomas Merton à Dorothy Day, les quatre modèles américains du pape François
Dans son discours au Congrès américain, jeudi 24 septembre, le pape François a donné en exemple quatre figures historiques aux États-Unis, aussi spirituelles qu’engagées : Abraham Lincoln, Martin Luther King, Dorothy Day et Thomas Merton.
La Croix
24/9/15
Abraham Lincoln (1809-1865), « gardien de la liberté »
C’est l’un des présidents favoris des Américains. Né en 1809 dans le Kentucky, fils d’un fermier descendant d’une famille émigrée d’Angleterre au XVIIe siècle, cet autodidacte devient avocat, député de l’Illinois, avant d’être élu à la Chambre des représentants à Washington sous les couleurs républicaines (le parti progressiste à l’époque). L’élection de cet abolitionniste convaincu – et profondément religieux – à la présidence des États-Unis, en 1860, a pour conséquence la sécession des États du sud et la guerre du même nom. Lincoln abolit l’esclavage en 1865 et est assassiné la même année, par un sudiste nommé John Wilkes Booth, avant d’avoir vu la réunification du pays. Le pape François a salué en Lincoln un homme qui « a travaillé sans relâche en sorte que” cette nation, sous Dieu (puisse) avoir une nouvelle naissance de liberté” ».
Dr. Martin Luther King
Martin Luther King (1929-1968), « la liberté dans la pluralité et la non-exclusion »
Militant non-violent pour les droits civiques des noirs américains, ce pasteur baptiste d’Atlanta a joué un rôle majeur pour leur émancipation et la prise de conscience de l’injustice de la ségrégation aux États-Unis. En 1963, devant 250 000 personnes rassemblées à Washington, il dit son rêve, « I have a dream… », devenu un hymne à la solidarité et à la réconciliation entre les communautés. Deux ans plus tard, les noirs américains obtiennent le droit de vote. Entre-temps, lui a reçu le prix Nobel de la Paix. Son combat se radicalise : il dénonce la grande pauvreté, la guerre du Vietnam, prêche la désobéissance à l’égard des lois injustes, donnant l’exemple du Christ. Ce « Gandhi noir » est assassiné à Memphis, en 1968, d’une main jamais identifiée. « Son rêve continue de nous inspirer tous », a souligné le pape François, rêve qui conduit « à l’action, à la participation, à l’engagement ».
Dorothy Day (1897-1980), « la justice sociale et les droits des personnes »
C’est l’une des figures catholiques américaines les plus célèbres. Née dans une famille épiscopalienne peu pratiquante qui fuit le séisme de 1906 de San Francisco et connaît des années difficiles à Chicago, elle conçoit très tôt un sentiment aigu de l’injustice sociale. Devenue journaliste, proche des milieux anarchistes et d’ultra-gauche, elle s’engage dans des campagnes publiques en faveur de la justice sociale, des pauvres, des marginaux, des affamés et des sans-abri. Après une vie de bohème et un avortement, elle donne naissance à une fille, et se convertit au catholicisme en 1927. Cette révoltée n’aura de cesse de concilier sa volonté d’un changement radical de la société et sa foi. En 1933, au cœur de la crise économique, elle fonde, avec le Français Pierre Maurin, le Catholic Worker, l’un des plus grands journaux catholiques des États-Unis, puis le « Mouvement catholique ouvrier », qui défend la non-violence et l’hospitalité envers les exclus de la société. « Son activisme social, sa passion pour la justice et pour la cause des opprimés étaient inspirés par l’Évangile, par sa foi, par l’exemple des saints », a souligné le pape François. Pendant la guerre froide, son pacifisme lui vaudra maints séjours en prison. Elle reçoit le prix Pacem in Terris en 1972. Sa cause en canonisation a été ouverte en 2000.
Thomas Merton (1915-1968), « la capacité au dialogue et l’ouverture à Dieu »
Du fond de son monastère de Gethsemani, dans le Kentucky, ce moine cistercien non-conformiste a milité pour l’égalité raciale et contre la guerre froide, correspondu avec des dizaines de personnalités… Né à Prades (Pyrénées-Orientales) en 1915, il gardera toujours un grand attachement à la culture française. Mais ses études le conduisent en Angleterre, où il passe plus de temps dans les cabarets que dans les bibliothèques. Aux États-Unis, grâce à des amis influents et à la lecture de Gilson et Maritain, il se convertit et est reçu dans l’Église catholique en 1938. Après un contact avec les franciscains, il entre chez les cisterciens en 1941. À la demande de son abbé, cet écrivain talentueux rédige une autobiographie qui va faire le tour du monde : La Nuit privée d’étoiles, en 1948. Il mourra accidentellement en Asie à l’âge de 53 ans. Cet homme de prière, de dialogue, « promoteur de paix entre les peuples et les religions », a commenté le pape François, « demeure la source d’une inspiration spirituelle et un guide pour beaucoup de personnes ».
Voir par ailleurs:
» La France est devenue une île «
Propos recueillis par Elisabeth Lévy
Le Point
24/06/2010
Noam Chomsky Le Point : Comment jugez-vous la vie intellectuelle française ?
Noam Chomsky : Elle a quelque chose d’étrange. Au Collège de France, j’ai participé à un colloque savant sur » Rationalité, vérité et démocratie « . Discuter ces concepts me semble parfaitement incongru. A la Mutualité, on m’a posé la question suivante : » Bertrand Russell nous dit qu’il faut se concentrer sur les faits, mais les philosophes nous disent que les faits n’existent pas. Comment faire ? » Une question de ce type laisse peu de place à un débat sérieux car, à un tel niveau d’abstraction, il n’y a rien à ajouter.
Avez-vous une explication ?
Comme observateur lointain, je formulerai une hypothèse. Après la Seconde Guerre mondiale, la France est passée de l’avant-garde à l’arrière-cour et elle est devenue une île. Dans les années 30, un artiste ou un écrivain américain se devait d’aller à Paris, de même qu’un scientifique ou un philosophe avait les yeux tournés vers l’Angleterre ou l’Allemagne. Après 1945, tous ces courants se sont inversés, mais la France a eu plus de mal à s’adapter à cette nouvelle hiérarchie du prestige. Cela tient en grande partie à l’histoire de la collaboration. Alors, bien sûr, il y a eu la Résistance et beaucoup de gens courageux, mais rien de comparable avec ce qui s’est passé en Grèce ou en Italie, où la résistance a donné du fil à retordre à six divisions allemandes. Et il a fallu un chercheur américain [Robert Paxton, NDLR] pour que la France soit capable d’affronter ce passé.
Depuis, nous nous rattrapons : la repentance est devenue une de nos spécialités, même si elle s’est déplacée du terrain de Vichy à celui de la colonisation.
Il est tout de même surprenant que les guerres coloniales n’aient pas suscité de protestations.
Vous exagérez ! La lutte contre la guerre d’Algérie a été l’acte de naissance de la deuxième gauche.
Il y a eu une mobilisation, limitée d’ailleurs, sur l’Algérie. Mais j’ai suivi la guerre d’Indochine et j’ai été frappé par l’absence de réaction sur la scène intellectuelle. Certes, on peut dire la même chose des intellectuels américains pendant la guerre du Vietnam. Mais, de la France, on attendait autre chose !
Nous sommes au XXIe siècle et vous êtes américain. Vous critiquez durement votre pays. Les Etats-Unis peuvent-ils être responsables de tous les maux du monde ?
Ils sont responsables d’un très grand nombre d’atrocités, parce que, depuis 1945, ils dominent la politique et l’économie mondiales. Et cette domination a été voulue par les décideurs qui, pendant la guerre, imaginaient une zone d’influence américaine comprenant l’hémisphère occidental, l’ancien Empire britannique et l’Extrême-Orient – les » deux rives des deux océans « . Dans cette zone qu’ils appelaient The Grand Area, aucune souveraineté ne devait s’opposer à celle de l’Amérique. Et ils ont réussi. En commettant de nombreux crimes.
Mais le monde est désormais multipolaire, la Chine est une puissance mondiale.
Combien de bases militaires la Chine possède-t-elle dans le monde ? Aucune. Les Etats-Unis en ont environ 800. Combien de soldats chinois sont-ils déployés à l’étranger ? Presque aucun. Le gouvernement chinois est horrible sur le plan interne, mais il n’est pas agressif à l’extérieur. De plus, la croissance chinoise est en partie fallacieuse : la Chine est un atelier d’assemblage, mais la technologie et les composants viennent du Japon, de Corée, de Taïwan et des Etats-Unis. Aussi le déficit du commerce américano-chinois est-il une illusion. Il en va de même pour la dette. Les premiers créanciers des Etats-Unis sont les Japonais, mais le Premier ministre a dû renoncer à sa promesse d’évacuer Okinawa. Alors, bien sûr, le système international est plus complexe, le nouvel ordre mondial s’est adapté, mais il reste à l’ordre du jour.
Qui est responsable ? Les Etats-Unis seraient-ils dirigés par une bande de sadiques ?
Il ne s’agit pas de culpabilité mais de la nature du système. Or, aux Etats-Unis, le pouvoir est depuis longtemps aux mains du grand capital et, depuis une trentaine d’années, du secteur financier. Obama a gagné parce qu’il était soutenu par les banques. Tous ses conseillers économiques viennent de ce secteur, de sorte que les gens qui ont créé la crise sont ceux qui ont élaboré le plan de sauvetage des banques. Lesquelles sont aujourd’hui plus puissantes qu’avant.
Donc, rien n’a changé avec l’élection d’Obama ?
Les démocrates sont bien obligés de faire quelques pas en direction des plus pauvres, qui constituent leur base électorale, mais cela, même les Etats totalitaires le font. Sur le fond, Obama ne se distingue pas radicalement du second mandat de Bush. La rhétorique a changé, pas la politique.
Vous diriez-vous toujours anarchiste ? Croyez-vous que les sociétés humaines peuvent se passer de pouvoir ?
Je crois à un principe fondamental de la morale humaine qui consiste à s’opposer à toute forme de domination ou de hiérarchie, à moins que celle-ci ne puisse faire la preuve de sa légitimité. Or, la plupart du temps, c’est impossible. Il faut donc détruire ces dominations.
Sauf que, dans les pays démocratiques comme le vôtre, les dirigeants peuvent se prévaloir de la légitimité des urnes.
Il est préférable d’avoir des élections que de ne pas en avoir, mais tout dépend des conditions dans lesquelles elles ont lieu. On critique l’Iran et à juste titre parce que les candidats sont sélectionnés par le clergé mais, en Amérique, ils sont de fait choisis par le grand capital : le vainqueur est celui qui lève le plus de fonds. J’ajouterai que l’un des Etats les plus démocratiques du monde est la Bolivie, où la population indigène, la plus pauvre et la plus opprimée, a su s’organiser politiquement pour porter l’un des siens à la tête du pays. Tous les Etats commettent des crimes, mais ne sont-ils pas pour leurs populations des instances de protection ? Plus les Etats sont puissants, plus ils sont criminels, mais je ne crois nullement que la protection des peuples soit leur priorité. En envahissant l’Irak, les responsables américains savaient qu’ils allaient provoquer une intensification du terrorisme et, donc, mettre en danger les Américains. L’Europe n’a jamais été aussi sauvage qu’au moment où elle inventait l’Etat-nation, qui est à mon sens une véritable calamité imposée au monde, responsable jusqu’à aujourd’hui de nombreux conflits.
Mais le monde sans frontières dont vous rêvez n’est-il pas celui que souhaitent les partisans les plus acharnés de la globalisation capitaliste que vous honnissez ?
Absolument pas. Le » libre-échange » ne fait que protéger les droits des investisseurs et du grand capital. On pourrait définir comme » service » tout ce qui intéresse l’être humain : éducation, électricité… Mais les accords sur » le commerce et les services » ne visent qu’à privatiser ces derniers, donc à réserver leur accès à une minorité privilégiée.
En attendant, personne n’a prouvé qu’il existe une alternative au capitalisme.
C’est un peu comme si vous m’aviez dit en 1943 qu’il n’y avait pas d’alternative au nazisme parce que l’Allemagne gagnait.
Vous charriez, professeur ! Il y en a eu une, d’alternative, et elle n’a pas donné les meilleurs résultats.
L’Union soviétique n’a pas instauré le socialisme mais un capitalisme d’Etat. Seulement, comme la propagande de l’Est et celle de l’Ouest convergeaient, le monde a avalé le bobard selon lequel ce qui se réalisait là-bas était le socialisme. Je continue donc à croire au socialisme véritable, fondé sur le contrôle de la production par les producteurs et sur celui des communautés par elles-mêmes.
Difficile de prononcer votre nom à Paris sans qu’un autre nom surgisse. Comprenez-vous que votre défense de Robert Faurisson ait choqué ?
Cela prouve que beaucoup d’intellectuels français sont restés staliniens même quand ils sont passés à l’extrême droite. Comment peut-on accepter que l’Etat définisse la vérité historique et punisse la dissidence de la pensée ?
L’extermination des juifs d’Europe est une vérité historique, peut-être pas unique mais singulière, non ?
Ce fut un crime horrible et unique, mais il y a beaucoup d’autres crimes uniques. Pourquoi aurait-on le droit de nier le génocide des Mayas au Guatemala ou celui de nombreuses populations indigènes de l’hémisphère occidental – ce que d’excellents journaux américains ne se privent pas de faire – et pas celui-là ?
Le génocide des Indiens n’a peut-être pas, ne serait-ce que parce qu’il est plus ancien, le même poids dans la conscience européenne et occidentale.
C’est bien le problème ! Mais cela n’a rien à voir avec le temps écoulé : le génocide des juifs s’est arrêté en 1945, le massacre des populations indigènes se poursuit. Au Timor-Oriental, entre un quart et un tiers de la population a été décimée avec l’accord des Etats-Unis et de la France, et peu de gens le savent alors que tout le monde connaît les crimes de Pol Pot. La vérité, c’est qu’on a le droit de nier les crimes des puissants – les nôtres. Seuls les crimes des autres ou des perdants sont protégés du négationnisme. Cette hypocrisie est insupportable.
Repères
1928 Naissance à Philadelphie. 1955 Doctorat de linguistique de l’université de Pennsylvanie. 1957 » Structures syntaxiques « . 1964 Milite activement contre la guerre du Vietnam 1968 » L’Amérique et ses nouveaux mandarins » (Seuil). 1966/1976 Titulaire de la chaire de linguistique au MIT. Depuis 1976 Institute Professor au MIT. 1980 Prend la défense de Faurisson au nom de la liberté d’expression. 2001 » 11-9. Autopsie des terrorismes » (Le Serpent à plumes). 2007 » Les Etats manqués. Abus de puissance et déficit démocratique » (Fayard). 2010 » Pour une éducation humaniste » (Editions de L’Herne).
Haro sur un imprécateur
La mauvaise réputation de Noam Chomsky
Telle qu’elle est relayée par les grands médias, la vie intellectuelle française suscite parfois la consternation à l’étranger : phrases extraites de leur contexte, indignations prévisibles, « polémiques » de pacotille, intellectuels de télévision qui prennent la pose à l’affût du mot trop rapide qui servira de pâture à leurs éditoriaux indignés. En France, Noam Chomsky a été l’objet de campagnes de disqualification d’autant plus vives et régulières qu’il a su détailler, calmement, l’imposture d’un discours à géométrie variable sur les « droits de l’homme », lequel, souvent, couvrait les forfaits de l’Occident.
Le New York Times, qui n’aime guère Noam Chomsky (c’est réciproque), admet néanmoins qu’il compte au nombre des plus grands intellectuels vivants. En dehors des départements de linguistique, et des colonnes du Monde diplomatique, il reste néanmoins ignoré en France.
Quand son nom est évoqué, c’est trop souvent pour y associer ceux de Robert Faurisson ou de Pol Pot. Chomsky serait l’archétype de l’intellectuel passant son temps à minimiser ou à nier divers génocides dont l’évocation risquerait de servir l’impérialisme occidental. Il n’a d’ailleurs trouvé qu’un éditeur marginal, Spartacus, pour publier en 1984 ses Réponses inédites à mes détracteurs parisiens, compilation de lettres et d’un entretien, non publiés ou de façon tronquée et adressés à des journaux comme Le Monde, Le Matin de Paris, Les Nouvelles littéraires, pour répondre, entre autres, à des attaques de Jacques Attali et de Bernard-Henri Lévy. D’où l’importance de la publication récente de certains de ses textes (1).
Pendant la guerre du Vietnam, les écrits de Chomsky jouissaient d’une certaine audience en France. Mais, déjà à l’époque, un malentendu implicite commençait à poindre. Dans les mouvements anti-impérialistes dominait une mentalité de « prise de parti ». Il fallait choisir son camp : pour l’Occident ou pour les révolutions du tiers-monde. Une telle attitude est étrangère à Chomsky, rationaliste au sens classique du terme. Non pas qu’il se place « au-dessus de la mêlée » – rares sont les intellectuels plus engagés que lui -, mais son engagement est fondé sur des principes comme la vérité et la justice, et non sur le soutien à un camp historique et social, quel qu’il soit.
Son opposition à la guerre ne découlait pas du pronostic que la révolution vietnamienne offrirait un avenir radieux aux peuples d’Indochine, mais de l’observation que l’agression américaine serait catastrophique parce que, loin d’être motivée par la défense de la démocratie, elle visait à empêcher toute forme de développement indépendant en Indochine et dans le tiers-monde.
Dénoncer l’idéologie de l’Occident
Rigoureux, les écrits de Chomsky offraient aux opposants à la guerre du Vietnam des outils intellectuels précieux ; la différence d’optique entre lui et ses partisans en France pouvait alors passer pour secondaire. La contre-offensive politique et idéologique se déclencha quand, à partir de 1975, des boat people se mirent à fuir le Vietnam et, plus encore, lorsque les Khmers rouges commirent leurs massacres. Un mécanisme de culpabilisation de ceux qui s’étaient opposés à la guerre occidentale, et plus généralement à l’impérialisme, permit de leur imputer la responsabilité de ces événements. Mais, comme le fait remarquer Chomsky, reprocher à des adversaires de l’invasion de l’Afghanistan par l’URSS en 1979 les atrocités commises par les rebelles afghans depuis le retrait des troupes soviétiques ne serait pas moins absurde : s’opposant à l’invasion, ils avaient voulu empêcher une catastrophe dont portent la responsabilité ceux qui l’ont décidée, pas leurs adversaires. Presque banal, un argument de ce type est quasiment inaudible dans le camp occidental.
En France, la mentalité de camp avait conduit nombre d’opposants aux guerres coloniales à se bercer d’illusions sur la possibilité de « lendemains qui chantent » dans les sociétés décolonisées. Cela a rendu la culpabilisation d’autant plus efficace que la fin de la guerre du Vietnam coïncida avec le grand tournant de l’intelligentsia française, qui allait amener celle-ci à s’écarter du marxisme et des révolutions du tiers-monde et, peu à peu, avec le mouvement des « nouveaux philosophes », à adopter des positions favorables à la politique occidentale au Tchad et au Nicaragua. Une bonne partie des intellectuels français, surtout ceux de la « génération 68 », d’abord passive dans la lutte contre les euro-missiles (1982-1983), devint franchement belliciste au moment de la guerre du Golfe puis lors de l’intervention de l’OTAN au Kosovo.
N’ayant jamais eu d’illusions à perdre, Noam Chomsky n’avait aucun combat à renier. Il demeura donc à la pointe de la lutte contre les interventions militaires et les embargos qui, de l’Amérique centrale à l’Irak, ont provoqué des centaines de milliers de victimes. Mais pour ceux qui avaient opéré le grand tournant, Chomsky devenait un anachronisme bizarre et dangereux. Comment pouvait-il ne pas avoir compris que le bon camp était devenu celui de l’Occident, des « droits de l’homme » ? Et le mauvais, celui de la « barbarie à visage humain », pays socialistes et dictatures post-coloniales mêlées ?
L’étude de sa démarche intellectuelle permet de répondre. Une bonne partie de l’œuvre de Chomsky est consacrée à l’analyse des mécanismes idéologiques des sociétés occidentales. Quand un historien étudie l’Empire romain, il essaie de relier les actions des dirigeants de l’époque à leurs intérêts économiques et politiques, ou du moins à la perception que ceux-ci en ont. Au lieu de s’en tenir aux seules intentions avouées des dirigeants, l’historien met au jour la structure « cachée » de la société (relations de pouvoir, contraintes institutionnelles) pour décrypter le discours officiel. Cette démarche est tellement naturelle qu’il ne faut même pas la justifier. On l’applique à des sociétés comme l’Union soviétique hier, la Chine et l’Iran aujourd’hui. Nul expert sérieux n’expliquerait le comportement des dirigeants de ces pays en privilégiant les motivations que ceux-ci mettent en avant pour justifier leurs actions.
Cette attitude méthodologique générale change du tout au tout quand il s’agit des sociétés occidentales. Il devient alors quasi obligatoire d’accepter que les intentions proclamées de leurs gouvernants constituent les ressorts de leurs actions. On peut douter de leur capacité à atteindre leurs objectifs, de leur intelligence. Mais mettre en cause la pureté de leurs motivations, chercher à expliquer leurs actions par les contraintes que des acteurs plus puissants feraient peser sur eux revient souvent à s’exclure du discours « respectable ».
Ainsi, lors de la guerre du Kosovo, on a pu discuter des moyens et de la stratégie mis en œuvre par l’OTAN, mais pas l’idée qu’il s’agissait d’une guerre humanitaire. On a critiqué les moyens utilisés par les Etats-Unis en Amérique centrale dans les années 1980, mais rarement douté qu’ils voulaient protéger ces pays de la menace soviétique ou cubaine. L’argument qui motive ce curieux dualisme dans l’approche des phénomènes politiques est que nos sociétés sont « réellement différentes », à la fois des sociétés passées et des pays comme l’URSS ou la Chine, parce que nos gouvernements seraient « réellement » soucieux des droits de la personne ou de la démocratie.
Mais le fait que les principes démocratiques soient souvent mieux respectés « chez nous » qu’ailleurs n’empêche nullement d’évaluer empiriquement la thèse de la singularité occidentale. On peut y parvenir en comparant deux tragédies (guerre, famine, attentat, etc.) plus ou moins semblables et en observant la réaction de nos gouvernements et de nos médias. Or, quand la responsabilité de ces situations est imputable à nos ennemis, l’indignation est générale et la présentation dépourvue de la moindre indulgence. En revanche, si la responsabilité des gouvernements occidentaux ou de leurs alliés est engagée, les horreurs sont souvent minimisées. Pourtant, si les actions de nos gouvernements étaient réellement motivées par les intentions altruistes qu’ils proclament, ils devraient d’abord agir sur les tragédies dont ils sont responsables, au lieu de donner la priorité à celles qu’ils peuvent attribuer à leurs ennemis. Constater que c’est presque toujours l’inverse qui se produit oblige à retenir l’accusation d’hypocrisie. Une bonne partie de l’œuvre de Chomsky est consacrée à des comparaisons de ce genre (2).
Dans le cas de l’Indochine et du Cambodge en particulier, les écrits de Chomsky, souvent présentés comme une « défense de Pol Pot », ont cherché à comparer les réactions des gouvernements et des médias occidentaux face à deux atrocités presque simultanées : les massacres commis par les Khmers rouges au Cambodge et ceux des Indonésiens au moment de l’invasion du Timor-Oriental.
Concernant le Cambodge, l’indignation fut vive – autant qu’hypocrite (3). En revanche, au moment de l’action militaire indonésienne, les médias et les intellectuels « médiatiques » observèrent un silence presque complet alors même que les Etats-Unis et leurs alliés, dont la France, livraient à l’Indonésie des armes en sachant qu’elles seraient utilisées au Timor (4). Dresser la longue liste des non-indignations de ce type obligerait à revenir sur la Turquie et les Kurdes, Israël et les Palestiniens, sans oublier l’Irak, où, au nom du droit international, on laisse des centaines de milliers de personnes mourir à petit feu.
En se livrant à ce genre de comparaisons, Chomsky a pris le contre-pied de la mentalité de parti particulièrement accusée depuis le grand tournant : puisque le Bien (l’Occident et ses alliés) affrontait le Mal (les nationalismes du tiers-monde et les pays dits socialistes), l’analogie fut interdite. Or Chomsky fit pire. Refusant la duplicité qu’il reproche à nos gouvernants et à nos médias, il a toujours estimé qu’il devait d’abord dénoncer les crimes des gouvernements sur lesquels il pouvait espérer agir, c’est-à-dire les nôtres.
Même s’il n’entrait dans sa démarche nulle illusion sur les régimes « révolutionnaires » ou absolution des crimes commis par les « autres », il était presque inévitable que ceux-là mêmes qui avaient entretenu de telles illusions et accepté de telles absolutions l’accuseraient de tomber dans leurs travers. On peut comprendre la réaction d’une partie de l’intelligentsia française, soucieuse de brûler ce qu’elle a adoré et d’adorer ce qu’elle a brûlé et naturellement désireuse de se venger sur le dos des autres des erreurs qu’elle a autrefois commises. Parfois, Chomsky en a été plus agacé qu’amusé.
Il faut à présent aborder l’« affaire Faurisson », qui alimente les attaques françaises les plus virulentes contre Chomsky. Professeur de littérature à l’université de Lyon, Robert Faurisson fut suspendu de ses fonctions à la fin des années 1970 et poursuivi parce qu’il avait, entre autres, nié l’existence des chambres à gaz pendant la seconde guerre mondiale. Une pétition pour défendre sa liberté d’expression fut signée par plus de cinq cents personnes, dont Chomsky. Pour répondre aux réactions violentes que suscita son geste, Chomsky rédigea alors un petit texte dans lequel il expliquait que reconnaître à une personne le droit d’exprimer ses opinions ne revenait nullement à les partager. Elémentaire aux Etats-Unis, cette distinction parut difficilement compréhensible en France.
Mais Chomsky commit une erreur, la seule dans cette affaire. Il donna son texte à un ami d’alors, Serge Thion, en lui permettant de l’utiliser à sa guise. Or Thion le fit paraître, comme « avis », au début du mémoire publié pour défendre Faurisson. Chomsky n’a cessé de rappeler qu’il n’avait jamais eu l’intention de voir publier son texte à cet endroit et qu’il chercha, mais trop tard, à l’empêcher (5).
Condamner Chomsky dans cette affaire impose, au minimum, de dire ce que l’on réprouve exactement : une erreur tactique ou le principe même de la défense inconditionnelle de la liberté d’expression ? Dans le second cas, il faut alors indiquer que la France ne possède pas, en matière d’expression d’opinions, la tradition libertaire des Etats-Unis. Là-bas, la position de Chomsky ne choque presque personne. Parfois comparée à la Ligue des droits de l’homme, l’American Civil Liberties Union, dans laquelle militent de nombreux antifascistes, porte ainsi plainte devant les tribunaux si on interdit au Ku Klux Klan ou à des groupuscules nazis de manifester, fût-ce en uniforme, dans des quartiers à majorité noire ou juive (6). Le débat à ce propos oppose donc deux traditions politiques différentes, l’une dominante en France, l’autre aux Etats-Unis, et pas un Noam Chomsky, représentant d’une ultra-gauche dévoyée, face à une France républicaine.
Dans un monde où des cohortes d’intellectuels disciplinés et de médias asservis servent de prêtrise séculière aux puissants, lire Chomsky représente un acte d’autodéfense. Il peut permettre d’éviter les fausses évidences et les indignations sélectives du discours dominant. Mais il enseigne aussi que, pour changer le monde, on doit le comprendre de façon objective et qu’il y a une grande différence entre romantisme révolutionnaire – lequel fait parfois plus de tort que de bien – et critique sociale simultanément radicale et rationnelle. Après des années de désespoir et de résignation, une contestation globale du système capitaliste semble renaître. Elle ne peut que tirer avantage de la combinaison de lucidité, de courage et d’optimisme qui marque l’œuvre et la vie de Noam Chomsky.
Jean Bricmont
Noam Chomsky et les médias français
, jeudi 27 mai 2010
À l’occasion de la venue de Noam Chomsky en France en cette fin mai 2010, nous rééditons sans changement un article paru en 2003.
* * *La pensée de Noam Chomsky est interdite de débat – du débat qu’elle mérite – dans les médias français. Comme si nous n’avions le choix qu’entre l’idolâtrie et la calomnie. Petit mémento de la bêtise ordinaire de certains seigneurs des médias (Acrimed).
Noam Chomsky, linguiste américain professeur au MIT (Massachusetts Institute of Technology), et, selon les propres mots d’Alain Finkielkraut, « l’intellectuel planétaire le plus populaire » [1], n’est pas exactement la coqueluche des journalistes ou des intellectuels français, c’est le moins que l’on puisse dire.
Depuis une vingtaine d’années, ils ne parlent jamais de son œuvre, qui occupe pourtant (ou peut-être précisément parce qu’elle occupe) une place fondamentale dans la pensée critique moderne. Et les rares fois où son nom est évoqué, c’est pour ressasser encore et toujours les mêmes calomnies effarantes de bêtise et de malhonnêteté [2]. Tout en lui refusant, bien entendu, le droit de répondre librement à ces accusations [3].
Le Figaro , Libération, Le Monde, Bernard-Henri Lévy, Alain Finkielkraut, Alain-Gérard Slama, Jacques Attali, André Glucksmann, Philippe Val et bien d’autres, se sont ainsi époumonés à de nombreuses reprises [4], pour condamner les idées répugnantes qu’ils lui prêtent avec une mauvaise foi consternante.
Tout cela est pourtant connu et limpide pour toute personne qui s’est donné la peine de lire ses écrits, et qui est portée dans son travail de journaliste, ou d’intellectuel, par un minimum de rigueur et d’honnêteté.
Cambodge et Timor
Pour aller vite, car il est pénible d’être forcé de rappeler constamment ce qui ne devrait plus avoir à être discuté depuis une bonne vingtaine d’années, Chomsky n’a jamais nié ou minimisé le génocide perpétré au Cambodge par les Khmers rouges entre 1975 et 1978.
Une partie importante de son travail est consacrée à établir les preuves objectives de l’existence d’une propagande médiatique. Pour ce faire, il cherche à démontrer que toutes choses étant égales par ailleurs, les intérêts politiques et économiques en jeux influencent de manière importante la façon dont les médias rendent compte de conflits internationaux pourtant similaires.
Il a ainsi observé que pour un niveau de violence et un nombre de victimes à peu près équivalents, les atrocités commises par Pol Pot (ennemi des États-Unis), étaient traitées de manière emphatique, avec une exagération systématique des faits et des commentaires, tandis que le génocide perpétré à peu près à la même époque par l’armée indonésienne (alliée des États-Unis), au Timor oriental, était, à l’inverse, complètement occulté par les médias [5].
S’il a étudié les estimations officielles des victimes du Cambodge, c’est uniquement pour montrer que le niveau était comparable à celui du Timor, préalable indispensable à sa démonstration, non pour nier l’horreur des massacres commis, qu’il a par ailleurs, condamnés de manière parfaitement claire à plusieurs reprises, affirmant qu’il serait « difficile de trouver un exemple aussi horrible d’un tel déferlement de fureur » [6]. Tous ceux qui ont pris la peine de lire ses écrits le savent parfaitement.
La théorie du complot
Il n’a pas plus défendu ou propagé une « vulgate conspirationniste », contrairement à ce que laissent entendre là aussi, Philippe Corcuff, ou Daniel Schneidermann [7], sans doute soucieux, comme Alain Finkielkraut, que les citoyens s’en tiennent à « ce qui apparaît » [8].
Il n’a cessé, bien au contraire, de rabâcher que « rien n’est plus éloigné de ce [qu’il dit] que l’idée de conspiration » [9]. « L’idée qu’il y aurait une cabale organisée au plus haut niveau dans un pays comme les États-Unis est complètement idiote. Cela voudrait dire que cela se passe comme en Union Soviétique. C’est totalement différent, et c’est précisément pourquoi je dis exactement l’inverse » [10].
L’inverse étant, en l’occurrence, un « système de « marché dirigé » » [11], où l’information est un produit, que les médias, fonctionnant sur le même modèle que n’importe quelle société commerciale, cherchent à écouler sur un marché.
Les exigences de profit et de rentabilité communes à toute entreprise commerciale entraînent, en plus des pressions politiques, un ensemble de contraintes structurelles, et notamment, une triple dépendance des médias, à l’égard de leurs propriétaires, de leurs annonceurs, et de leurs sources d’information, la rentabilité limitant la possibilité d’investigations personnelles.
De toutes ces contraintes, découle logiquement une certaine orientation de l’information, dans sa forme et dans son contenu, et la sélection préférentielle d’un personnel en phase avec ces principes.
« Ce n’est pas une conspiration mais une analyse institutionnelle », conclut le plus naturellement du monde, Noam Chomsky. Et on se demande comment une évidence si limpide peut échapper à tous ces « grands esprits »…
Quant à la méfiance envers « ce qui apparaît », qui irrite tant Alain Finkielkraut, chez moi, cela s’appelle tout simplement garder un esprit critique.
L’affaire Faurisson
Enfin, les accusations de négationnisme trouvent leur source dans une pétition lancée en 1979 aux États-Unis, qui rassembla plus de 500 signatures, dont celle de Noam Chomsky, pour « assurer la sécurité et le libre exercice de ses droits légaux » à Robert Faurisson, un professeur de la faculté de Lyon, dont les « recherches » ont pour objet de nier la réalité du génocide juif sous le régime de l’Allemagne nazie [12].
Chomsky, devenu malgré lui, en raison de sa popularité, l’emblème de cette pétition, reçut une avalanche de protestations, ce qui l’amena à écrire un texte exposant sa position : Quelques commentaires élémentaires sur le droit à la liberté d’expression. Il y explique entre autre que la liberté d’expression, pour être réellement le reflet d’une vertu démocratique, ne peut se limiter aux opinions que l’on approuve, car même les pires dictateurs sont favorables à la libre diffusion des opinions qui leur conviennent. En conséquence de quoi la liberté d’expression se doit d’être défendue, y compris, et même avant tout, pour les idées qui nous répugnent [13].
Bien entendu, la position libertaire de Chomsky, qui s’explique en partie par l’importance capitale accordée dans la culture américaine à la liberté d’expression, peut et doit être discutée. Mais jamais les critiques n’abordent la question sous cet angle. Elles ont pour seul but de discréditer Chomsky, auteur peu connu du grand public en France, en laissant croire que c’est précisément Faurisson, et ses thèses qu’il aurait défendues et non la seule liberté d’expression.
Du reste, soupçonner Chomsky d’une quelconque sympathie ou complaisance envers les thèses négationnistes est tout simplement ridicule. Dès les débuts de son engagement politique, il affirmait en introduction à son premier ouvrage (American Power and the New Mandarins, 1969, cité dans Le Monde du 24 juillet 1994), et répétait à de nombreuses reprises (voir Chomsky, Les médias et les illusions nécessaires, K films éditions, Paris, 1993), que le simple fait de discuter avec des négationnistes de l’existence des crimes nazis, revenait à perdre notre humanité. Il a eu par la suite de multiples occasions de réitérer très clairement cette condamnation. Dans un autre de ses livres, il décrivait, par exemple, l’Holocauste comme « la plus fantastique flambée de violence collective dans l’histoire de l’humanité » [14]. Dans l’article publié dans The Nation sur l’affaire Faurisson, il indiquait encore « Les conclusions de Faurisson sont diamétralement opposées aux opinions qui sont les miennes et que j’ai fréquemment exprimées par écrit » [15], et dans l’interview publiée dans Le Monde en 1998, il décrivait le négationnisme comme « la pire atrocité de l’histoire humaine », ajoutant à nouveau que « le fait même d’en discuter est ridicule ».
Arnaud Rindel
(01.12.2003)
Ce texte est la version abrégée de la préface d’un recueil de textes de Noam Chomsky, De la guerre comme politique étrangère des Etats-Unis, Agone, Marseille, 2001.
(1) Outre De la guerre comme politique étrangère des Etats-Unis (Agone, Marseille), lire, pour les écrits les plus récents, Les Dessous de la politique de l’Oncle Sam (Ecosociété-EPO-Le Temps des cerises, Montréal-Bruxelles-Paris, 1996), Responsabilité des intellectuels (Agone, Marseille, 1998), Le Nouvel Humanisme militaire (Page Deux, Lausanne, 2000), La Conférence d’Albuquerque (Allia, Paris, 2001).
(2) Lire Edward S. Herman et Noam Chomsky, Manufacturing Consent. The Political Economy of the Mass Media, Pantheon Books, New York, 1988, et Noam Chomsky, Necessary Illusions. Thought Control in Democratic Societies, Pluto Press, Londres, 1989.
(3) Quand, en 1979, les Vietnamiens mirent fin au régime de Pol Pot, les Occidentaux décidèrent de soutenir les Khmers rouges, diplomatiquement à l’ONU, mais aussi, indirectement, sur le plan militaire. A contrario, dans le cas de l’Indonésie, de simples pressions occidentales auraient sans doute suffi pour arrêter les massacres.
(4) Ministre français des affaires étrangères, Louis de Guiringaud se rendit à Djakarta pour y signer un accord militaire. Puis il déclara que la France ne placerait pas l’Indonésie dans une situation embarrassante aux Nations unies à propos du Timor. In Le Monde, 14 septembre 1978.
(5) La version anglaise de ce texte, « Some elementary comments on the rights of freedom of expression », est disponible sur www.zmag.org.
(6) C’est ce qui s’est produit à Skokie (Illinois) en 1978.
Voir enfin:
Florilège de Dorothy Day:
« We are on the side of the revolution. We believe there must be new concepts of property, which is proper to man, and that the new concept is not so new. There is a Christian communism and a Christian capitalism…. We believe in farming communes and cooperatives and will be happy to see how they work out in Cuba…. God bless Castro and all those who are seeing Christ in the poor. God bless all those who are seeking the brotherhood of man because in loving their brothers they love God even though they deny Him. »
Dorothy Day (1961)
In these times when social concerns are so important, I cannot fail to mention the Servant of God Dorothy Day, who founded the Catholic Worker Movement. Her social activism, her passion for justice and for the cause of the oppressed, were inspired by the Gospel, her faith, and the example of the saints.
Pope Francis (US Congress, 2015)
Far better to revolt violently than to do nothing about the poor destitute.
Dorothy Day (1960)
« I am most of all interested in the religious life of the people and so must not be on the side of a regime that favors the extirpation of religion. On the other hand, when that regime is bending all its efforts to make a good life for the people, a naturally good life (on which grace can build) one cannot help but be in favor of the measures taken.
Dorothy Day (Cuba, 1960)
http://dorothyday.catholicworker.org/articles/793.html
http://dorothyday.catholicworker.org/articles/248.html
As a young man Ho Chi Minh had traveled from Indo-China to Paris and on one of his first voyages he had stopped in the ports of New York and Boston. One story is that he had worked in Harlem briefly, and perhaps–who knows–he had stopped in the Chinese and Italian area on Mott Street where the Catholic Worker had its house for fifteen years, from 1936 to 1950. Perhaps he came in for a meal with us just as Chu did or Wong, who is with us now. London, Montreal and New York have seen many exiles and political fugitives. If we had had the privilege of giving hospitality to a Ho Chi Minh, with what respect and interest we would have served him, as a man of vision, as a patriot, a rebel against foreign invaders.
Dorothy Day (1970)
http://dorothyday.catholicworker.org/articles/498.html
the two words [anarchist-pacifist] should go together, especially at this time when more and more people, even priests, are turning to violence, and are finding their heroes in Camillo Torres among the priests, and Che Guevara among laymen. The attraction is strong, because both men literally laid down their lives for their brothers. « Greater love hath no man than this. »
« Let me say, at the risk of seeming ridiculous, that the true revolutionary is guided by great feelings of love. » Che Guevara wrote this, and he is quoted by Chicano youth in El Grito Del Norte.
Dorothy Day (1970)
Cliquer pour accéder à 500.pdf
« I in turn, can see Christ in them even though they deny Him, because they are giving themselves to working for a better social order for the wretched of the earth. »
Dorothy Day (on anarchists)
We believe in widespread private property, the de-proletarianizing of our American people. We believe in the individual owning the means of production, the land and his tools. We are opposed to the « finance capitalism » so justly criticized and condemned by Karl Marx but we believe there can be a Christian capitalism as there can be a Christian Communism.
Dorothy Day
http://dorothyday.catholicworker.org/articles/300.html
« To labor is to pray — that is the central point of the Christian doctrine of work. Hence, it is that while both Communism and Christianity are moved by ‘compassion for the multitude,’ the object of communism is to make the poor richer but the object of Christianity is to make the rich poor and the poor holy. »
http://dorothyday.catholicworker.org/articles/166.html
« [L]et it be remembered that I speak as an ex-Communist and one who has not testified before Congressional Committees, nor written works on the Communist conspiracy. I can say with warmth that I loved the [communist] people I worked with and learned much from them. They helped me to find God in His poor, in His abandoned ones, as I had not found Him in Christian churches. »
The Communists point to it as forced upon them, and say that when it comes they will take part in it, and in their plans they want to prepare the ground, and win as many as possible to their point of view and for their side. And where will we be on that day? …
[W]e will inevitably be forced to be on their side, physically speaking. But when it comes to activity, we will be pacifists, I hope and pray, non-violent resisters of aggression, from whomever it comes, resisters to repression, coercion, from whatever side it comes, and our activity will be the works of mercy. Our arms will be the love of God and our brother.
Dorothy Day (1949)
http://dorothyday.catholicworker.org/articles/246.html
« We must make a start. We must renounce war as an instrument of policy. . . . Even as I speak to you I may be guilty of what some men call treason. But we must reject war. . . . You young men should refuse to take up arms. Young women tear down the patriotic posters. And all of you–young and old–put away your flags.
Dorothy Day (1941)
We are still pacifists. Our manifesto is the Sermon on the Mount, which means that we will try to be peacemakers. Speaking for many of our conscientious objectors, we will not participate in armed warfare or in making munitions, or by buying government bonds to prosecute the war, or in urging others to these efforts.
But neither will we be carping in our criticism. We love our country and we love our President. We have been the only country in the world where men of all nations have taken refuge from oppression. We recognize that while in the order of intention we have tried to stand for peace, for love of our brother, in the order of execution we have failed as Americans in living up to our principles.
Dorothy Day (1942)
[O]urs was a long-range program, looking for ownership by the workers of the means of production, the abolition of the assembly line, decentralized factories, the restoration of crafts and ownership of property,” she wrote. “This meant, of course, an accent on the agrarian and rural aspects of our economy and a changing emphasis from the city to the land.”
G.K. Chesterton and Dorothy Day on Economics:Neither Socialism nor Capitalism (Distributism)
We need to change the system. We need to overthrow, not the government, as the authorities are always accusing the Communists ‘of conspiring to teach [us] to do,’ but this rotten, decadent, putrid industrial capitalist system which breeds such suffering in the whited sepulcher of New York. »
Dorothy Day (1956)
Cliquer pour accéder à 710.pdf
We stand at the present time with the Communists, who are also opposing war…. The Sermon on the Mount is our Christian manifesto.
Dorothy Day ( « Our Stand, » Catholic Worker, June 1940)
Marx… Lenin… Mao Tse-Tung… These men were animated by the love of brother and this we must believe though their ends meant the seizure of power, and the building of mighty armies, the compulsion of concentration camps, the forced labor and torture and killing of tens of thousands, even millions.
Dorothy Day (« The Incompatibility of Love and Violence, » Catholic Worker, May 1951)
I am appalled that a woman of such loathsome character would be considered for sainthood. Vatican archives are filled with reports of Christians martyred under the regimes that Dorothy Day supported. I am revolted by the United States Conference of Catholic Bishops’ support for the canonization of a woman whose views supported the violent extermination of Christians throughout the world. I ask that these matters be carefully weighed so that the Holy See will not be inadvertently misled when considering the canonization of Dorothy Day. I am particularly concerned about her support for Ho Chi Minh » …
Virginia State Senator Richard H. “Dick” Black
The name Dorothy Day has not been used in the United States Congress terribly often. She was a valiant fighter for workers, was very strong in her belief for social justice, and I think it was extraordinary that he cited her as one of the most important people in recent American history. This would be one of the very, very few times that somebody as radical as Dorothy Day was mentioned. He is willing to identify with an extraordinarily courageous woman whose life was about standing with the poorest people in America, and having the courage to stand up to the very powerful. You know, her newspaper was the Catholic Worker, and she stood with the workers of America and fought for justice. His calling out for social justice, his talking about income and wealth inequality, his talking about creating an economy and a culture that works for everybody, not just a few, is a very, very powerful message.
Bernie Sanders
Voir de plus:
« La République ne doit pas plaider coupable »
Le philosophe et académicien s’interroge sur la difficulté de nos élites à penser ce qui nous arrive, sans céder aux anachronismes.
Alain Finkielkraut
Marianne
03/04/2015
– Marianne : Récemment, l’écrivain algérien Boualem Sansal livrait cette réflexion désabusée : « Les Européens ont toujours sous-estimé l’islamisme. » Cette minoration a-t-elle pris fin ?
Alain Finkielkraut : Au lendemain des attentats contre Charlie Hebdo et le magasin Hyper Cacher de Vincennes, et après le refus cinglant des jeunes des « quartiers populaires » de participer à la grande manifestation unitaire du 11 janvier, il était difficile pour les Français, même les plus angéliques, de continuer à faire l’impasse sur les dangers et sur la séduction de l’islamisme radical. Mais la propension à noyer le poisson dans ses causes supposées n’a pas disparu. Et le gouvernement a donné l’exemple en dénonçant l’apartheid culturel, ethnique et territorial qui sévirait dans nos banlieues. Ainsi la République a-t-elle plaidé coupable pour les attaques mêmes dont elle faisait l’objet.
– Pendant trente ans, un mélange de naïveté et de lâcheté a-t-il empêché de nombreux intellectuels de prendre la mesure du phénomène ?
Je ne vois chez nos intellectuels ni naïveté, ni lâcheté, mais, si j’ose dire, une vigilance anachronique. En Sarkozy, conseillé par Patrick Buisson, son « génie noir », ils combattaient la réincarnation du maréchal Pétain. Les musulmans leur apparaissaient comme les juifs du XXIe siècle. L’antifascisme façonnait leur vision du monde. Ils ne voulaient pas et ne veulent toujours pas voir dans la crise actuelle des banlieues autre chose qu’une résurgence de la xénophobie et du racisme français.
– En France, quelle place a tenu – et tient – la francophobie d’une part des élites dans cette minoration ?
Les élites dont vous parlez ne sont pas francophobes ; face au nationalisme fermé de « l’idéologie française », elles se réclament de la patrie des droits de l’homme. Leur France est la « nation ouverte » célébrée par Victor Hugo, « qui appelle chez elle quiconque est frère ou veut l’être ». Le problème, c’est que, toutes à cette opposition gratifiante entre l’ouvert et le fermé, ces élites légitiment la haine qui se développe dans certains quartiers de nos villes pour les « faces de craie ». C’est l’exclusion, disent ces élites, qui engendre la francophobie.
– Après le 11 septembre 2001, un vaste débat s’est levé. Vous avez pointé dans l’Imparfait du présent les disculpateurs de l’islamisme qui faisaient remonter tout le mal à « l’axe Washington – Tel-Aviv ». Ces personnes-là ont-elles empêché la prise de conscience de la menace globale ?
« L’Amérique victime de son hyperpuissance », titrait Télérama après le 11 septembre 2001. Ce qu’on a du mal à penser aujourd’hui comme alors, c’est que l’Occident puisse être haï non pour l’oppression qu’il exerce, mais pour les libertés qu’il propose. Sayyid Qotb est devenu le principal doctrinaire des Frères musulmans, après un séjour aux Etats-Unis, en 1948, où il a été confronté à cette « liberté bestiale qu’on nomme la mixité », à « ce marché d’esclaves qu’on nomme « émancipation de la femme » », à « ces ruses et anxiétés d’un système de mariage et de divorce si contraire à la vie naturelle. En comparaison, quelle raison, quelle hauteur de vue, quelle joie en islam, et quel désir d’atteindre celui qui ne peut être atteint ».
– L’année dernière, vous avez publié l’Identité malheureuse (1). Cet essai mélancolique a été étrillé par une partie de la critique, et le Monde des livres a cru pouvoir discerner des similitudes entre vos inquiétudes et celles de Marine Le Pen. Quelles réflexions vous inspire ce type de rapprochement ?
L’esprit du temps réussit l’exploit paradoxal de nous faire vivre hors de notre temps, à côté de nos pompes. Alors que la France change de visage, il affirme, imperturbable, que l’histoire se répète, et il cherche des racistes et des fascistes pour donner corps à cette affirmation. J’ai beau être juif et défendre l’école républicaine, me voici lepéniste, et même – il faut ce qu’il faut – maurrassien.
– Avec Régis Debray, Elisabeth Badinter, Catherine Kintzler et Elisabeth de Fontenay, vous avez signé un texte intitulé « Le Munich de l’école républicaine », au moment de l’affaire dite de Creil (sur le port du voile à l’école), en septembre 1989. Plus de vingt-cinq ans après, quelles menaces pèsent, d’après vous, dans l’enceinte scolaire sur la conception exigeante de la laïcité dont vous vous réclamez ?
La menace était très clairement énoncée en 2004 par le rapport Obin sur les signes et manifestations d’appartenance religieuse dans les établissements scolaires : « Tout laisse à penser que, dans certains quartiers, les élèves sont incités à se méfier de tout ce que les professeurs leur proposent, qui doit d’abord être un objet de suspicion, comme ce qu’ils trouvent à la cantine dans leur assiette ; et qu’ils sont engagés à trier les textes étudiés selon les mêmes catégories religieuses du halal (autorisé) et du haram (interdit). » La question du voile et celle de la nourriture sont deux composantes d’un phénomène beaucoup plus large de sécession culturelle. Et ce phénomène est en expansion.
– La géopolitique n’est pas votre registre d’intervention privilégié, mais vous suivez ce que l’islamologue Mohammed Arkoun a appelé « l’extension de la pandémie djihadiste ». Est-ce l’idée califale (c’est-à-dire le projet de rétablissement du califat) qui est devenue le moteur des revendications islamistes ?
Je ne sais pas. Ce que je sais, grâce à Gilles Kepel, c’est que les Beurs, qui avaient fait la grande marche pour l’égalité en 1983, rejettent maintenant avec horreur ce vocable « tenu au mieux pour méprisant à leur endroit, au pire, pour un complot sioniste destiné à faire fondre comme du beurre leur identité arabo-islamique dans le chaudron des potes de SOS Racisme touillé par l’Union des étudiants juifs de France ».
– Etes-vous de ceux qui préférez, avec Michel Onfray, une analyse juste d’Alain de Benoist à une analyse fausse de Bernard-Henri Lévy ? Qu’avez-vous pensé de la réaction de Manuel Valls, accusant le fondateur de l’Université populaire de Caen de « brouiller les cartes » avec le Front national, et regrettant, plus généralement, le silence des intellectuels face à l’extrême droite et à sa menace ?
Je pense que Michel Onfray préfère aussi – et il l’a dit – une analyse juste de Bernard-Henri Lévy à une analyse fausse d’Alain de Benoist. Pour ma part, je citerai Camus dans sa lettre adressée aux Temps modernes après la critique au vitriol de l’Homme révolté, parue dans cette revue : « On ne décide pas de la vérité d’une pensée selon qu’elle est à droite ou à gauche, et moins encore selon ce que la droite et la gauche décident d’en faire. A ce compte, Descartes serait stalinien et Péguy bénirait M. Pinay. Si, enfin, la vérité me paraissait à droite, j’y serais. » Je ne suis donc pas plus impressionné par la sortie de Manuel Valls que par la campagne de 1982 contre le « silence des intellectuels ». Le gouvernement est légitimement affolé par la montée du Front national, mais ce ne sont pas les incantations antifascistes qui inverseront la tendance et changeront la donne ; c’est la prise en compte par la gauche comme par la droite traditionnelle de l’inquiétude de toujours plus de Français devant la mutation culturelle qui nous tombe dessus, qui n’a été décidée par personne.
– Est-ce qu’il vous arrive de douter de la justesse de vos angoisses ? Vous arrive-t-il de vous demander si, comme certains vous le reprochent, vous êtes devenu obsédé par vos combats ?
Fontenelle a écrit un jour : « On s’accoutume trop quand on est seul à ne penser que comme soi. » J’essaie donc de ne pas rester seul trop longtemps et je fais même l’émission « Répliques » pour être confronté à des points de vue très différents des miens. Mais ce n’est pas ma faute si l’actualité radote et me renvoie sans cesse à la réalité insupportable de l’éclatement de mon pays. Je suis attaqué et même insulté par ceux qui ne veulent surtout pas regarder cette réalité en face. Devant les mauvaises nouvelles, ou, pis encore, devant les nouvelles qui contredisent l’idée reçue du mal et du méchant, le plus simple est encore de s’en prendre au messager et de lui faire la peau.
(1) L’Identité malheureuse, réédition, Gallimard, « Folio essais ».
Voir enfin:
Réné Girard et les joies du bashing
Nicolas journet
Sciences humaines
juin 2010
Mis à jour le 15/06/2011
Le père du désir mimétique est la dernière victime expiatoire du critique René Pommier. Le bashing est-il si nuisible qu’il se l’imagine ?
Commencer par choisir un « père fondateur », « un gourou international » ou un « maître à penser » sur lequel plus de vingt thèses ont été soutenues, couvert de récompenses et de doctorats honoris causa, bardé d’une œuvre traduite en plus de cinq langues. Autopsier cette dernière jusqu’à l’écœurement, puis en livrer les morceaux les plus obscurs et les plus navrants nappés de sauce piquante : c’est la recette de René Pommier, agrégé de lettres, professeur émérite à la Sorbonne, esprit rationaliste et autoproclamé « fervent mécréant ». À trente ans d’intervalle, il s’est offert un tableau de chasse honorable : Roland Barthes (servi en deux fois : 1978 et 1987) et Sigmund Freud (croqué en 2008). Et voici qu’il récidive : René Girard, un allumé qui se prend pour un phare (Kimé, 2010) n’est pas un quatrain de potache, mais le titre d’une jubilante entreprise de déboulonnage du maître de la pensée mimétique.
R. Girard, rappelons-le, est un spécialiste de la littérature devenu, au fil d’une œuvre abondante, l’auteur d’une ambitieuse thèse sur l’origine de la violence, des religions, de la culture et du christianisme. Académicien célébré en France, il est depuis des années tout autant enseigné, lu et commenté en Californie et à Sydney. C’est une figure internationale. En réalité, annonce d’entrée R. Pommier, son cas est simple : c’est un mégalomane, son œuvre n’est que « divagation » et sa pensée « ne vaut pas tripette ». On fait difficilement plus concis, mais on n’écrit pas cela sans quelques munitions.
Le désir mimétique, postulat séduisant mais absurde
Malgré la brièveté de son pamphlet, R. Pommier parvient à s’attaquer dans le détail à quelques thèses centrales de la pensée de R. Girard en se livrant à un épluchage en règle de ses sources et de sa logique.
Exemple : la théorie du désir mimétique, fondamentale, est un postulat séduisant, mais absurde. Si nous ne désirons que ce qu’autrui a désiré avant nous, comment cela a-t-il bien pu commencer un jour ? Les archétypes littéraires que R. Girard avance pour preuve (Don Juan, Don Quichotte) sont contrefaits : Don Juan est un adepte du coup de foudre spontané, Sancho Pança un vrai glouton, qui ne partage nullement les désirs de son maître.
Autre exemple : R. Girard affirme que la violence naît toujours et partout de cette contagion du désir. Mais sa démonstration n’est, selon R. Pommier, qu’une épatante fiction. Dans la plupart des cas qu’il analyse, la peur ou la haine sont des facteurs autrement plus probables. R. Girard, de plus, a mal lu les anthropologues : aucune étude classique n’a montré que le rite du sacrifice eût pour fonction d’apaiser les rivalités entre les hommes ni d’enrayer la violence mimétique. Les bons auteurs ont tous compris qu’il est destiné à apaiser les dieux, non les hommes. Le modèle sacrificiel, à la moulinette duquel R. Girard passe la mythologie grecque et l’Ancien Testament, n’est donc qu’un « délire interprétatif », de même que la « vérité mimétique » dont il fait la clé de la révélation chrétienne. Au mépris de la diversité des textes nouveau testamentaires et de la tradition théologique, R. Girard prétend que, deux mille ans avant lui, le Christ ne dit pas autre chose que ce que lui-même a compris : le sacrifice n’est qu’un mensonge, car la victime est innocente. C’est ainsi que le christianisme, soutenait R. Girard il y a quelques années, a anticipé sur une vérité dont lui-même serait le génial et l’unique découvreur. On fait difficilement plus fort. Il conviendrait donc, persifle R. Pommier, « que tous les chrétiens fêtassent la naissance de René Girard en même temps que celle du Christ ».
En fin de partie, le verdict tombe, et on se doute qu’il n’est pas tendre : d’élucubrations en lectures abusives, R. Girard, selon R. Pommier, ne parvient certes pas à « battre les records d’imbécillité » d’un R. Barthes, mais n’est pas loin de s’en approcher. Il l’écrase en tout cas sur un autre terrain : celui de l’outrecuidance et de l’autocélébration.
Pulsions tauromachiques et iconoclasme radical
Que dire de plus ? L’écriture de R. Pommier peut, selon le cas, réjouir ou indigner le lecteur pétrifié par tant de sarcasmes. La question de savoir si une telle critique est utile ou nuisible au débat s’efface d’abord devant la joie communicative de l’auteur. Il ne s’en cache pas : depuis qu’à l’âge de 15 ans, une vache a succombé sous la roue de sa bicyclette, il adore bousculer ces animaux sacrés. Mais pourquoi ceux-ci plutôt que ceux-là ? Il s’avère que R. Pommier déteste en particulier deux ou trois choses : la prétention intellectuelle, les idées « extravagantes » et le snobisme mêlé de crainte qui fait qu’on les écoute. Entré en lice à la fin des années 1970, il s’est donc heurté au goût immodéré de l’époque pour les théories ambitieuses, les éclats déconstructionnistes et les idées soupçonneuses des maîtres : Jacques Lacan, Michel Foucault, Pierre Bourdieu, Gilles Deleuze, Jacques Derrida et d’autres, autant de figures de premier plan dont le culte et les idées trop neuves ont éveillé en lui des pulsions tauromachiques. De là vient son penchant pour l’iconoclasme radical, celui qui se soucie peu de quoi mettre à la place. À ce jeu-là, que gagne-t-on ?
Rappelons que R. Pommier n’est ni le premier, ni le dernier à pratiquer ce sport de plume que les Américains appellent « bashing », et qu’en français on traduira par « éreintement ». Souvenons-nous. D’abord, il y eut en 1980 le goguenard Effet ’yau de poêle de François Georges sur les pitreries de J. Lacan. Plus modéré, La Pratique de l’esprit humain, de Marcel Gauchet et Gladys Swain (1980), ne laissa pourtant pas intacte la réputation de M. Foucault. Puis vint le galop d’essai – sérieux mais accusateur – de La Pensée 68 (Luc Ferry et Alain Renaut, 1985) dénonçant les abus du quatuor Foucault-Lacan-Bourdieu-Derrida. Il inaugurait l’ère des « nouveaux philosophes », aujourd’hui à leur tour placés dans le collimateur. Huit ans plus tard, James Miller cible, lui, la vie sexuelle de Michel Foucault.
Puis Alan Sokal et Jean Bricmont épinglent, tout à la fois, J. Lacan, Julia Kristeva, J. Derrida et la nouvelle génération des postmodernes (Impostures intellectuelles, 1997). Ensuite, c’est au tour de P. Bourdieu, relativement épargné jusque-là : en 1998, Jeannine Verdès-Leroux le peint en charlatan et en terroriste (Le Savant et la Politique), Louis Gruel en illusionniste (2005). La même année, Le Livre noir de la psychanalyse importe en France une spécialité déjà florissante aux États-Unis : le « Freud bashing », qui fera souche à Paris et vient de gagner Michel Onfray. Bien des têtes célèbres ont été dévissées avant celle de R. Girard. Ce qui signifie que, contrairement à une idée répandue, la vindicte n’est pas morte et que le politiquement correct ne règne pas vraiment. Ensuite, qu’elle ne tue personne : le bashing est aussi un hommage rendu au rayonnement des auteurs et des œuvres qu’il vise. La plupart y survivent très bien. Enfin, que sa fonction est aussi de faire de la place pour de nouvelles idées. Mais pas toujours : R. Pommier, quant à lui, se contenterait bien d’un retour au bon sens et au respect de l’antérieur. C’est sans doute là ce qu’il y a de moins passionnant chez lui.
René Pommier, René Girard, un allumé qui se prend pour un phare, Kimé, 2010.
Pourquoi … cette levée de boucliers dans l’édition et les médias, reliée par certains politiques qui n’ont rien de mieux à faire? Tout simplement parce que, durant des décennies, se proclamer de droite, dans l’université, l’édition et les médias, revenait à être soit le valet du grand capital et des patrons, soit le beauf radoteur, le Dupont Lajoie qui occupait, dans ses colonnes, la place du vieux fou contre lequel on pouvait s’épancher sans frais. La gauche de gouvernement, comme la droite au pouvoir, a, depuis les années 70, relégué aux oubliettes de la périphérie, un pan entier du peuple français. Celui-ci montre régulièrement, par ses votes de rejet, qu’il en a légèrement assez d’être traité par pertes et profits. Certains intellectuels ont osé l’écrire. Ils auraient tort: on le leur fait bien voir. Ils ont raison: il n’était que temps d’ouvrir les boîtes de Pandore et de commencer de les nettoyer.
André Bercoff
J’aimeJ’aime
Le succès persistant de Houellebecq, Finkielkraut ou Zemmour laisse en effet penser que plus personne n’écoute les donneurs de leçons et même que leurs proscriptions fonctionnent comme des prescriptions.
Elisabeth Lévy
J’aimeJ’aime
Beaucoup de gens ont dit, et ils l’ont dit ensemble, « Je Suis Charlie » à un moment où Charlie même n’était plus tout à fait Charlie. La bande de Charlie était constituée de post-soixante-huitards qui batifolaient dans la post-Histoire or l’Histoire leur est tombée dessus brutalement sous la forme d’un ennemi dont ils avaient longtemps refusé de concevoir la simple hypothèse et cet ennemi les a changés. Contre ce qui lui est apparu comme la lâcheté du multiculturalisme, Charb a défendu une conception intransigeante de la laïcité. Il faut savoir que le livre, hélas, testamentaire de Bernard Maris était précisément un hymne à la France et dans le « Je Suis Charlie » il n’y avait pas que cela, il y avait « Je Suis la République », « Je Suis Juif », « Je Suis la Police » et voir autour de Charlie des gens manifester leur soutien aux CRS devenu soudain la police républicaine qui veillaient sur leur sommeil, c’était un paradoxe sidérant et quand même assez émouvant. Il s’est donc passé quelque chose.
Alain Finkielkraut
J’aimeJ’aime
La gauche a gagné dans les urnes, la droite dans les têtes.
Gaël Brustier
J’aimeJ’aime
En vertu de son slogan de campagne, «l’identité heureuse», l’ancien Premier ministre se donne une image généreuse, cultive les bons sentiments optimistes, prônant «l’amour du prochain , l’accueil de l’étranger , le respect de l’autre , l’attention porté au plus petit, au plus faible, au plus pauvre». Ces paroles étonnantes, à mi-chemin de l’expert socialiste et de l’homélie d’un prêtre, sont en parfaite conformité avec l’attente du microcosme médiatique et le discours sur les «valeurs» du parti au pouvoir. Alain Juppé reprend intégralement à son compte le discours obsessionnel des animateurs, humoristes, spécialistes et autres faiseurs d’opinion, sur le «vivre ensemble» et le «devoir impérieux d’accueil». Mais les sermons font-ils une politique?
Tout en s’adonnant à une démonstration de bons sentiments, il fustige «l’arrogance des bienpensants», c’est-à-dire, selon lui, de la poignée d’intellectuels présentés comme «déclinistes». Eux bienpensants? Eux qui subissent un lynchage médiatique permanent, les amalgames et les pires insultes, en tentant d’exprimer le malaise populaire?
Cette intervention d’Alain Juppé n’est pas exempte de l’agressivité qu’il dénonce. Il revient abondamment sur l’immense polémique de ces jours derniers, «relative à la France comme race blanche». Pourquoi remuer ainsi le fer dans la plaie au sujet d’une affaire qu’il qualifie pourtant de simple «sottise», dès lors qu’il prône l’apaisement et la fin des crises d’hystérie? Dix jours de déchirements stériles ne lui ont-ils pas suffi? Tout en s’adonnant à une démonstration de bons sentiments, il fustige «l’arrogance des bienpensants», c’est-à-dire, selon lui, de la poignée d’intellectuels présentés comme «déclinistes». Eux bienpensants? Eux qui subissent un lynchage médiatique permanent, les amalgames et les pires insultes, en tentant d’exprimer le malaise populaire? Reprenant à son compte une extraordinaire inversion des réalités, il les qualifie même de «politiquement corrects». Ne lui vient-il pas à l’esprit que la douleur et l’inquiétude identitaire qui se manifestent à travers cette poignée d’intellectuels, quel que soit le mépris qu’ils peuvent inspirer dans la France dite «d’en haut», méritent d’être prises en compte par un éventuel futur «président de tous les Français»?
Ainsi, Alain Juppé semble lui aussi, sombrer dans les travers de l’ensemble de la classe politique, de l’extrême droite à l’extrême gauche: l’obsession de la communication, de la posture et la fuite devant les réalités. Il ne dit pas un mot de le souffrance d’un peuple qui compte 5 millions de chômeurs, le plus souvent des jeunes dévastés par l’exclusion. Il parle de l’accueil de l’étranger mais évite ne serait-ce qu’une allusion aux désastres des cités ghettoïsée, au triomphe des passeurs esclavagistes, aux images hallucinantes des foules de migrants en perdition qui hantent et déchirent l’Europe. Il dénonce une France «frileuse devant le monde global, barricadée dans d’illusoires frontières nationales». A lire les propos de l’ancien ministre des Affaires étrangères, on se demande avec stupeur s’il vit bien dans le même monde que les Français. Ces derniers ont des raisons d’être préoccupés par l’avenir. Comment pourraient-ils ne pas s’inquiéter devant l’impuissance de la communauté internationale face au chaos génocidaire qui se répand au Moyen Orient, les massacre de l’Etat islamique Daesh commis notamment envers les minorités chrétiennes et yazidies, la reprise des violences au proche-Orient, la déstabilisation du Moyen-Orient et d’une partie de l’Afrique. Quant à la belle «union» (européenne), «construite si patiemment avec nos voisins», il est surprenant qu’Alain Juppé ferme ainsi les yeux sur les déchirements, les désastres, son impuissance à protéger les Européens qui expliquent son rejet par une grande partie de la population. Là aussi, la politique de l’autruche a ses limites. Notre temps se prête-t-il vraiment à l’optimisme, à la conscience heureuse?
Cette intervention d’Alain Juppé déçoit profondément. L’ancien Premier ministre est certes inquiet de voir le parti lepéniste potentiellement à 30% des suffrages et peut-être en passe de gagner des régions. Il n’est pas le seul. Mais ce n’est sûrement pas dans la négation de la réalité et en se noyant dans le conformisme médiatique et l’angélisme le plus banal qu’il contribuera à sortir la France de l’impasse. Son message ressasse toujours les mêmes rengaines, les mêmes obsessions, se complaît, comme tout le monde, dans la polémique stérile et la posture, une posture béni oui-oui de bien mauvais aloi. Il ne propose rien, n’esquisse pas la moindre piste concrète, ni sur la France, ni sur l’Europe…
Maxime Tandonnet (ancien conseiller de Nicolas Sarkozy)
J’aimeJ’aime
Une petite ritournelle commence à être chantonnée, sous tous les tons et en canons, dedans les choeurs à gauche. Cette chansonnette raconte que désormais la droite a gagné le combat des idées par la grâce de ces polémistes réacs que l’on verrait et entendrait partout. Ce ne serait plus désormais qu’une question de temps pour que leurs idées s’imposent.
Cette chanson est jolie, et douce à l’oreille droite, mais ce n’est qu’une chanson. Il est vrai que quelques intellectuels libres, ou des pseudos à en croire notre ministre de l’éducation autrefois nationale, ont réussi à ridiculiser l’imposture gauchisante. Il est vrai qu’autrefois ceux-ci risquaient la mort civile, alors qu’aujourd’hui l’ostracisme de gauche ostracise la gauche.
Il est vrai que cette gauche gauchisante a perdu sa superbe ironie, sa faconde mordante, qui lui servait de machine à exclure du débat faussement démocratique.
Mais dans le monde virtuel, ce ne sont pas les faiseurs d’idées qui triomphent, mais les faiseurs d’émotion. Ceux qui, précisément, détiennent la capacité de sidération qui annihile le pouvoir de raisonner.
Et dans ce domaine, la gauche, conserve largement le pouvoir de sidérer la pensée rationnelle.
Elle peut non seulement compter sur ses relais médiatiques habituels, mais encore sur les esprits qu’elle a asservis depuis des lustres, mollement, à leur insu, dans le cadre, sans doute, de la plus grande et insidieuse entreprise de décérébration de tous les temps. Le progrès des idées est en train de modifier progressivement cette donne médiatique, dont les effets ne changent que lentement.
S’il en était autrement, la crise des réfugiés ou les déclarations de Nadine Morano n’auraient pas entraîné les débordements émotionnels observés. Il aura fallu le temps de la pensée pour que celui du pathos inconsidéré veuille bien s’estomper.
La semaine écoulée peut donner d’autres exemples de ce que le pathos de gauche continue largement d’imprégner les esprits labourés depuis un demi-siècle.
– Les nervis de la CGT et d’autres syndicats conservateurs, ont failli lyncher des responsables d’Air France. Les pays étrangers n’en reviennent pas de cette spécificité culturelle française qui autorise les organes fossoyeurs de l’entreprise française et leurs gros bras truands à vouloir imposer, par la force -faute de toute représentativité- leurs désirs de nuisance. Au-delà de l’approbation de Besancenot, sorte de Tintin chez les soviets, et d’un Robespierre d’opérette nommé Mélenchon, une bonne partie d’intervenants sur les médias, principalement publics, opposent à la violence de voyous qu’ils ne dénoncent que pour la symétrie, «la violence sociale». Ils refusent de voir que ce sont les mêmes qui , des deux côtés du même bâton , cognent aujourd’hui les responsables des airs après avoir estourbi hier les industries et les ports français. Déjà, au nom de la fausse paix sociale, on parle moins des sévères sanctions internes dont on menaçait il y a peu les frappes encartées .
Faut-il que l’opinion ait été matraquée par le mythe d’un syndicalisme français progressiste et défenseur des plus modestes pour que soient tolérés les matraqueurs et pour que le gouvernement compte sans rire sur ces étranges «partenaires sociaux», plutôt que sur la loi, pour moderniser une économie dont ils ont contribué à la thrombose?
– Est déjà passé par pertes et profits, le policier à l’article de la mort pour avoir rencontré sur son chemin ce criminel chevronné en voie de radicalisation islamiste qui a bénéficié d’une permission de sortie qui ne s’imposait nullement juridiquement. Notre inénarrable Garde des Sceaux, s’en est tiré une nouvelle fois à bon compte en promettant sans frais une réflexion sur la politique carcérale. Nulle part sans doute plus qu’au pays du Mur des cons le sort des policiers et les dysfonctionnements de la justice sont considérés comme des sortes de coups du sort. La faute à pas de chance. Les mondes médiatique et juridique sont autrement moins fatalistes en d’autres circonstances. S’agissant des syndicats de magistrats, leur principale antienne est «nous sommes débordés!» Je jure que si pour l’un de mes clients, entrepreneur harassé de fatigue, je venais à plaider devant un tribunal un même argument pour tenter d’excuser le non-respect d’une obscure règle fiscale, son compte serait bon, c’est-à-dire mauvais.
Faut-il que l’opinion ait été matraquée par trois décennies de tolérance dix mille, expliquée là encore par le mythe d’une violence sociale expliquant donc excusant la violence criminelle, pour tolérer l’intolérable et rendre les responsables irresponsables?
-En politique étrangère la même décérébration explique le regard oblique d’une opinion endormie par la xénophilie depuis 30 ans.
C’est selon ces règles inconscientes que le casting des bons et des méchants est ordonné depuis longtemps. Méchant Victor Orban, coupable principalement de vouloir faire respecter les règlements européens en matière de frontières. Jusqu’à peu Recep Tayyip Erdogan était considéré par cette presse gauchisante qui s’est tellement toujours trompée qu’elle persévère dans la certitude de son infaillibilité, comme un gentil «islamo- conservateur» qui avait prouvé que l’islamisme modéré n’est pas un oxymore. Et tant pis si la Turquie détenait le record des journalistes embastillés, ou qu’elle aidait en sous-main les salafistes. Encore aujourd’hui, le sultan ottoman bénéficie d’un traitement de faveur: il peut venir cracher sur l’Occident jusque dans Strasbourg, que les journalistes accrédités dans son dernier meeting acceptent de s’asseoir gentiment sur leur derrière, en fonction de leur sexe.
Si j’osais, je comparerais le même traitement, selon les mêmes règles, s’agissant des responsables israéliens et palestiniens. M. Nétanyahou, le «nationaliste», a bien mauvaise presse. Mahmoud Abbas quant à lui fait figure médiatique de gentil «modéré».
Sans remonter une nouvelle fois aux origines du conflit, chacun s’accorde à reconnaître que dans sa dernière séquence celui-ci a pour cause la querelle à propos de l’esplanade des mosquées-mont du temple.
Il ne se sera pas trouvé un seul journaliste hexagonal pour dire que l’intention prêtée aux responsables israéliens d’empêcher les musulmans d’exercer paisiblement leur culte à l’intérieur de leurs mosquées relevait du fantasme incantatoire islamiste.
Il ne s’en est pas trouvé non plus un seul- au rebours de la presse étrangère-pour révéler la teneur du discours du «modéré» président palestinien à la télévision officielle daté du 16 septembre à propos des émeutes qui commençaient à Jérusalem, organisées par les extrémistes qui agressaient ces juifs venus pour prier pendant leur fêtes religieuses: «Nous bénissons les Mourabitoun, nous saluons chaque goutte de leur sang versé à cause de Jérusalem. Ce sang est pur, ce sang est propre , versé au nom d’Allah, chaque martyr aura sa place au paradis. La mosquée Al Aqsa, l’église du Saint-Sépulcre, tout est à nous, entièrement à nous ; ils n’ont pas le droit (les juifs) de les souiller de leurs pieds sales.»
Depuis, et compte tenu de l’aggravation de la situation, Mahmoud Abbas a tenté de mettre de l’eau sur le feu. Mais comme le disait déjà le clairvoyant Bourguiba: «les chefs arabes sont toujours étonnés d’être pris au pied de la lettre et de ne plus savoir éteindre les incendies qu’ils ont allumés.»
Je ne veux pas prétendre ici que la partie israélienne sois exempte de reproches, a fortiori son premier ministre, plus pragmatique qu’on ne le dit, mais affaibli au sein d’une coalition gouvernementale trop à droite, pour cause de système électoral littéralement criminel.
Je persiste néanmoins à penser que dans un cadre intellectuel libéré de tout surmoi xénophile, la première question qui vaudrait d’être posée sans crainte de blasphémer serait de savoir pour quelle miraculeuse raison le monde palestinien échapperait à une radicalité islamiste qui met le feu à toute la région.
La question ne sera pas posée.
Pas de quoi pousser la chansonnette, le progrès des idées n’est que très progressif.
Gilles William Goldnadel
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2015/10/12/31003-20151012ARTFIG00228-violences-a-jerusalem-le-point-de-vue-de-gilles-william-goldnadel.php
J’aimeJ’aime
Peut-être assistons-nous à la première cristallisation d’un nouveau clivage idéologique qui se superpose, sans le recouper, à celui qui, sous diverses formes, oppose à l’intérieur de la gauche les « libéraux » aux « radicaux » – tous représentant, n’en déplaise à l’ami Hervé Algalarrondo, diverses nuances de la social-démocratie …
comme les copains du Point, on s’est amusés à dresser notre liste, et comme eux, on a abouti à la liste de Lindenberg, relookée et renforcée par quelques héritiers comme Guilluy, Bouvet et Le Goff, qui étaient trop verts (ou trop timides) en 2002 pour figurer dans Le rappel à l’ordre. Il faut se rendre à l’évidence : cette gauche qui se rebelle contre les inquisiteurs de son camp rappelle beaucoup les « néo-réacs ». Plaisant retournement justement que celui qui voit une liste noire de traîtres à la gauche incarner aujourd’hui son renouveau.
En attendant que la décantation idéologique fasse son travail de clarification, on peut au minimum flairer un nouvel état d’esprit. Finalement, c’est Pascal Bruckner qui a tapé dans le mille. La gauche, dit-il en substance dans Le Point, doit se réconcilier avec le réel. Le réel, voilà peut-être en effet le point commun entre Chevènement et Valls, Polony et Couturier. Ce n’est pas un hasard si le conflit, qui couvait depuis des mois, en particulier depuis les attentats, a éclaté autour de l’affaire Bianco et de la laïcité. D’abord, parce que, depuis des années c’est d’abord sur ces questions, donc sur notre rapport à l’islam, que la gauche de l’aveuglement a tenté de faire régner la loi du silence. Sans grand succès d’ailleurs, tant les noms d’oiseaux, procès en sorcellerie et appels au lynchage social ont perdu leur force dissuasive. Ensuite, parce que ces questions nous ont explosé à la figure avec les bombes de Charlie et du Bataclan. Ce que refusent non seulement les têtes pensantes dont on vous entretient dans les pages qui suivent, mais aussi tous les sans-grades qui bataillent dans le monde virtuel, c’est qu’on leur interdise de voir ce qu’ils voient et de le dire. Beaucoup découvrent de bonne foi qu’on les a roulés dans la farine pendant des années, en leur désignant comme adversaires ceux qui tentaient de les alerter sur la catastrophe en cours. Et maintenant qu’ils sont dopés au réel, comme dit Élisabeth Badinter, on ne leur « fermera pas la bouche » avec l’accusation d’islamophobie. Une fois qu’on a tiré le fil, on ne peut plus s’arrêter. Défendre la laïcité, c’est défendre la liberté de penser. On sait où ça peut mener.
Peu importe qu’on ne sache pas désigner cette mouvance bizarre, et que ses contours soient élastiques. Peu importent les innombrables désaccords qui opposent les défenseurs du choc de compétitivité et les contempteurs de l’euro. Ce qui compte, c’est précisément qu’on puisse se disputer entre gens civilisés. Alors espérons que, contre le parti de la cécité, l’esprit voltairien a, pour de bon, recommencé à souffler à gauche.
http://www.causeur.fr/printemps-republicain-ps-laicite-37280.html#
J’aimeJ’aime